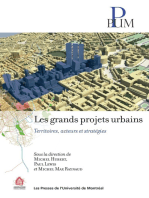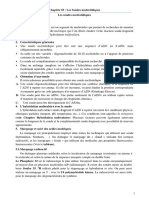Professional Documents
Culture Documents
3 3 Koolhaas Entretien
Uploaded by
morphologics0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2K views49 pagesOriginal Title
3-3-Koolhaas-entretien
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2K views49 pages3 3 Koolhaas Entretien
Uploaded by
morphologicsCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 49
FACE À LA RUPTURE
Une conversation avec Rem Koolhaas
Catalogue Mutations, Actar, 2000.
François Chaslin. Rem Koolhaas, vous êtes un architecte et
quelque chose comme un théoricien ou un idéologue. C'est lui
que nous rencontrons aujourd'hui, celui qui s'efforce de
comprendre le monde et son évolution avant de prétendre le
façonner, le plier à une géométrie, à une esthétique, une
rationalité ou une poétique, ce qui est l'attitude
traditionnelle et peut-être la responsabilité de
l'architecte.
On se demande si vous lisez le monde tel qu'il est
effectivement, ou si vous ne le lisez pas en l'esthétisant à
outrance, en soumettant vos questions à des hypothèses trop
radicales et spectaculaires pour être vraiment crédibles.
Nous en reparlerons.
Aujourd'hui, vous travaillez sur les grandes mutations de la
société et de la ville, notamment au sein d'un séminaire que
vous conduisez à l'université de Harvard. Vous annoncez
périodiquement que l'urbanisme vit ses dernières heures, que
sa mort est programmée en raison de "la résistance qu'il
oppose aux phénomènes observés et du retard qu'il prend à les
mesurer". Ce jugement à l’encontre d’une discipline bien plus
que centenaire, diverse dans ses approches et ses méthodes,
paraît sévère.
Rem Koolhaas. Dans tout ce que je fais, et dans ce que je
dis, il y a une part de rhétorique, de jeu et de provocation.
Je prétends rarement à la parfaite objectivité. Mes analyses
offrent une composante de manifeste, et toujours un mélange
de réflexion rétroactive et de démarche prospective. Cela
suppose que je ne sois ni particulièrement sévère ni
pessimiste face à une profession à laquelle il revient, en
effet, de comprendre la formation des villes, de l’analyser
et de les transformer.
Mais je suis convaincu de ce que l’urbanisme tel qu’il est
pensé aujourd’hui n’est plus tenable, car il suppose des
systèmes de maîtrise et de contrôle des phénomènes qui
n’existent plus. Cette incapacité présente divers aspects. Le
plus important est peut-être dans cet écart entre la
conception de leur rôle qui anime les professionnels (qui se
considèrent traditionnellement comme représentant la chose
publique et la volonté collective) et ce que nous vivons
maintenant, une logique totalement opposée, celle du marché
qui, par définition, ne laisse aucune place à ce genre de
préoccupations. Là-dessus se greffe le scepticisme qui règne
aujourd'hui presque universel face à la modernisation (qui
n’est plus considérée comme une source de progrès),
Entretien Rem Koolhaas, p 1
scepticisme qui se double d’une incertitude quant à notre
aptitude à en contrôler les mouvements.
Et il y a d’autres explications. D’abord le fait que le cadre
intellectuel, le vocabulaire, les valeurs et les références
les plus intimes de nos professions sont très anciens,
souvent bimillénaires. Ils sont impropres à saisir les
événements qui se déroulent, cette accélération des choses
qui fait que toute action qui prétendrait régulariser le
développement urbain selon des critères esthétiques, sociaux
ou éthiques est vouée à l’échec. Aucune activité de
composition formelle, aucune ambition de composition urbaine
ne tient le choc face à une telle accélération des
phénomènes, alors que tant de changements interviennent dans
un temps raccourci. C’est donc l’ensemble les valeurs
anciennes, devenu inopérant et contre-productif, qui ne
fonctionne plus et qui, aujourd’hui, paralyse ceux qui
doivent penser la ville. Un peu comme si nous,
professionnels, étions programmés pour freiner tout ce qui
arrive et dont nous savons bien que le triomphe est
inéluctable. Notre culture d’architectes se hérisse et nous
dresse face à ces nouveaux paysages des mégalopoles
mondiales, notamment asiatiques. Nous n’y voyons que laideur,
abandon et échec, et nous en souffrons. Echec formel, échec
fonctionnel, échec du social, échec dans le sentiment même de
notre incapacité à maîtriser les processus, échec de
cohérence, échec dans la qualité propre de chacune des
constructions, échec partout. Nos métiers ne savent comment
se consoler des ambitions perdues.
FCh. Vous revendiquez ce que les scientifiques appellent
depuis vingt ou vingt-cinq ans un changement de paradigme. Un
monde entier basculerait et nous forcerait à reformuler nos
pensées, très profondément.
RK. C’est dans ce sens que portent mes efforts. Comprendre
cette rupture, ce changement de la condition urbaine. C'est
le champ même de nos interventions qui a changé, davantage
peut-être que nos paradigmes, qui sont longs à se mettre en
place.
FCh. Ce type de révision radicale s’est produit plusieurs
fois dans l’histoire des pensées urbanistiques. Déjà dans la
seconde moitié du dix-neuvième siècle, puis au début de
celui-ci, et dans l’après-guerre avec le triomphe du
rationalisme, et encore dans les années soixante-dix au
moment du postmodernisme et des visions typomorphologiques et
historicistes. Ce n’est pas une chose nouvelle. Le point de
vue des urbanistes quant à la fabrication de la forme urbaine
ne vous paraît plus viable. Mais cela ne prouve pas que leur
discipline ne puisse retrouver de nouvelles bases, plus
adaptées aux réalités. D’ailleurs, elle s’en préoccupe
sérieusement. Dans le monde entier, on multiplie recherches
Entretien Rem Koolhaas, p 2
ou colloques sur ce qu’en France, par exemple, on désigne
comme la ville "émergente".
RK. Mais les professionnels ne vont pas assez loin dans
l’observation lucide des phénomènes. Surtout, ils n’en tirent
pas les conséquences qui conviendraient pour appréhender le
futur de nos propres cultures et pour réviser de fond en
comble les modalités de leurs actions.
FCh. Vous exposez qu'il faut d'abord regarder, fuir les a
priori, et ne "pas trop chercher de réponses". Est-il
vraiment possible, pour ces praticiens, de ne pas chercher
les réponses alors même qu’ils portent en eux (comme par
automatisme et souvent inconsciemment) des tas de réponses,
ou de réflexes?
RK. Nous avons réussi à l'OMA, dans les dernières années, à
séparer d’une façon radicale (presque schizophrénique)
travaux spéculatifs, projets et démarches d’observateurs ou
d’interprètes. L’architecte agit sur des bases absurdes. A
chaque fois qu’il est appelé à se prononcer sur telle ou
telle situation, il croit devoir la modifier complètement.
Incapable de la laisser telle quelle, ou de commencer par
l'analyser, il est emporté par une espèce d’activité bestiale
qui suppose la nécessité d'une transformation et le désigne
comme véhicule du changement. J'ai donc voulu découpler
clairement nos deux activités, et ménager dans la vie de
notre agence une sorte de droit d’abstention, une liberté
d'analyser, voir et comprendre, sans que cela ait
nécessairement de répercussion professionnelle.
FCh. Que ces recherches aient un rapport avec votre propre
activité et vos propositions d’urbaniste, c’est manifeste.
Que votre projet d’Euralille ait un rapport avec ces
hypothèses, et qu'il soit notamment une tentative de rendre
compte de la culture de la congestion, des flux circulatoire
et des réseaux, c'est évident. Mais ils est plus difficile de
comprendre jusqu’à quel point ces menées théoriques
nourrissent votre production proprement architecturale, ce
travail sophistiqué, très élégant, dont témoignent, par
exemple, vos villas et vos réalisations de petite échelle, un
travail joueur et presque maniériste. Y a-t-il une relation
entre cette activité d’observation du monde, ce travail de
commentaire, et l’esthétique de vos villas?
RK. C’est difficile à dire. Il y a toute une série de
questions auxquelles j’ai chaque jour plus de mal à répondre
et je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour expliquer
comment nous travaillons. Nous tenons à maintenir dans notre
activité un domaine inconscient. Si nous avions sans cesse à
l’esprit le fait que, même dans nos plus petits bâtiments, il
y pourrait y avoir une dimension critique, le métier
deviendrait infernal. Ce que je peux dire, c’est que
l’ensemble de nos préoccupations se trouve d’une manière ou
Entretien Rem Koolhaas, p 3
d’une autre présent au tréfonds de chacun de nos projets.
Evidemment, on pourrait lire la maison de Bordeaux comme une
maison avec une infrastructure urbaine, comme un mélange, la
rencontre entre un élément vraiment domestique et un monde
plus mécanique. Mais j’hésite à expliquer ces
caractéristiques par une obsession de l’urbanisme.
Il y a par contre des bâtiments d’une échelle sensiblement
plus grande où nous-mêmes avions l’impression d’être plus
urbanistes qu’architectes. Pour ce qui est du palais
Congrexpo à Lille ou du projet de la bibliothèque de Jussieu,
nous avions adopté une approche urbaine, avec tout ce que
cela implique en termes d’ouverture des possibles, plutôt
qu’architecturale, laquelle suppose pour moi une définition
précise des choses et l'intention d'en contrôler
ultérieurement jusqu'aux moindres détails. Ce que nous avons
fait, dans presque tous nos projets, c’est que nous avons
utilisé l’urbain contre l’architectural, pour le vivifier.
FCh. Mais si l’on prend une petite maison, comme la villa
Dall’Ava à Saint-Cloud, on lui découvre une allure
désarticulée et syncopée qui pourrait être tenue, à certains
égards, pour un reflet de l'état du monde ou au moins du
regard que vous portez sur le monde, et pour sa transcription
en termes esthétiques.
RK. Sur ce type de questions, l’opinion des critiques importe
plus que ma propre réponse. C’est à eux d’en juger et
d’interpréter notre travail.
FCh. Nous sommes dans une période d'explosion extraordinaire
du phénomène urbain. Et paradoxalement de creux théorique, de
panique peut-être devant l’ampleur des enjeux et le caractère
déroutant des changements. Mais la course à la théorie est
très engagée et toutes sortes de disciplines, depuis
plusieurs années, se plongent dans l’analyse de cette ville
émergente ou de l'apparent chaos qui semble gouverner
aujourd’hui les phénomènes urbains. Toute explication
ancienne se défait. La dernière grande mobilisation
volontariste, parmi les architectes, a été celle du
postmodernisme européen, au milieu des années soixante et
dans la décennie qui a suivi. C’était un effort pour élaborer
des instruments de lecture de la ville historique et une
ultime tentative d’en poursuivre la fabrication. Comme si la
rupture moderne n'avait pas existé, ailleurs que dans
l'idéologie et dans les formes, comme si la sociabilité elle-
même n'était pas bouleversée, comme si de rien n'était.
Trente ans plus tard, nous voici à mille lieux de ces
problématiques-là. Vous avez été parmi les premiers à prendre
ces questions à bras le corps, d'une façon radicale et
délibérée. Ces mutations, beaucoup de gens se demandent si
vous en êtes un simple explorateur, un annonciateur, ou si
vous vous en faîtes l'avocat. Si vous vous contentez d’en
être l'observateur lucide, ou si vous prétendez en devenir le
Entretien Rem Koolhaas, p 4
prophète. Avouez que ces mutations vous fascinent et que vous
leur trouvez une certaine beauté, un caractère excitant.
RK. Je joue probablement tout à tour ces divers rôles, selon
le contexte. Il s'agit d'un engagement pour une certaine
transformation des villes mais aussi d'une volonté de réduire
en miettes certaines conceptions occidentales, de révéler
quelles potentialités existent dans des conditions urbaines
qu'un regard hâtif jugerait dégradées ou compromises, comme
l’urbanisation chinoise ou celle de Singapour. Deux mobiles
me conduisent : l’intérêt que j’éprouve à saisir ces
transformations, à les voir se dérouler, à les comprendre, et
le plaisir que j’aurais à détruire certaines perspectives
intellectuelles qui me semblent devoir être condamnées. L'un
des problèmes de notre profession réside dans toutes ces
supposées valeurs qui nous mènent à refuser systématiquement,
a priori, tout ce qui se passe. Mon travail vise notamment à
nous libérer de cette obligation.
FCh. On sent chez beaucoup de nos contemporains une
fascination devant ces phénomènes de rapide transformation.
Même un urbaniste de culture traditionnelle appréciera un
film rendant compte des paysages de Hong Kong ou du Japon
moderne, ou à lire un roman qui reflète un certain état des
villes, voire leur dégradation. Il y trouvera la matière
d’une jouissance esthétique. Cette exploration artistique ou
documentaire de territoires en mutation est l'un des
registres préférés de l'époque. Nous en avons soif mais nous
la refoulons dans nos approches professionnelles. Il y a peu
de spécialistes qui s’avoueraient à eux-mêmes les qualités
spatiales, humaines, oniriques de ces formes urbaines. Il y a
un dévoilement à accomplir, et peut-être un effort de
sincérité. Nos contemporains ne voient pas comme les
photographes, comme les écrivains ou comme les artistes
voient. Ou comme voit chacun d’entre nous, dès lors que nous
voyageons, ou dès lors que nous sommes les spectateurs d’un
film.
RK. Il est évident que l’on trouve maintenant partout, chez
chacun, la compréhension de ces phénomènes. Mais il existe
pourtant une masse de connaissances qui demeurent
inaccessibles à notre compréhension et à nos actions
d’architectes. Cette espèce de déconnexion fondamentale
traduit le super ego de la profession, un mécanisme moral
plus ou moins réfléchi qui exclut que nous puissions
participer à ces mouvements de la société contemporaine.
FCh. Commençons, si vous le voulez bien, par une rapide
rétrospective. Dans vos premiers travaux, vos projets
théoriques du tout début des années soixante-dix, on repérait
diverses sources, notamment certaines inspirations sadiennes
et surréalistes (collage sur le mode du cadavre exquis,
paranoïa critique, nous y reviendrons). Ces inspirations
côtoyaient de fréquentes références à Nietzsche, au
Entretien Rem Koolhaas, p 5
renversement des valeurs établies, une invitation tacite plus
qu’explicite à penser "par-delà bien et mal". Mais ce n’était
jamais de manière ouverte et vous n’avez jamais, à ma
connaissance, renvoyé à telle ou telle thèse de Nietzsche.
Pourtant, sa position philosophique est présente chez vous.
RK. Qu'il faille ou non affirmer ses sources est une question
que je me suis posée très tôt. J’étais attiré par les gens
comme Charles Jencks ou Kenneth Frampton, très préoccupés par
leurs lectures, et dont le travail fonde sur des références
explicites. Et j’ai trouvé leur démarche erronée; je n'ai
jamais été impressionné par leurs lectures, même si je
l'étais par leur travail critique. Il y a souvent une
relation abusive, en architecture, entre la lecture que l’on
fait des différentes sources et les conséquences que l’on en
tire. Pour m’éviter ces travers, j’ai revendiqué le droit à
m’inspirer de telle ou telle pensée, sans être obligé de le
faire de manière affichée.
FCh. Mais lisez-vous de la philosophie, ou bien en avez-vous
lu dans certaines périodes de votre vie?
RK. Oui, simplement parce que je lis tout.
FCh. Donc, vous avez lu Nietzsche?
RK. Oui.
FCh. Mais son œuvre ne figure pas sur votre table de chevet.
RK. Non, mais elle est bien là. Une autre raison pour ne pas
être explicite dans l’évocation de mes références, c’est que
cela me permet de manipuler plus aisément, manipuler ce que
j'appellerais le matériau génétique de ces diverses sources.
FCh. Parmi ces sources, je ne pense pas qu'il y ait
Heidegger.
RK. Non, en effet.
FCh. Ni Christian Norberg-Schulz, heideggerien tardif, et son
génie des lieux.
RK. Non. Sauf qu’il y existe pour moi des sources positives,
et des négatives. L’univers heideggerien m’inspire une sorte
d’angoisse. Je le trouve très malsain, mais il peut être
aussi une occasion d'inspiration. Peut-être.
FCh. Il y a plus de vingt ans déjà, dans New York Délire, qui
était à la fois une recherche historique et une sorte de
fiction dédiée à Manhattan que vous qualifiiez de "capitale
de la crise permanente", vous faisiez l'apologie de la crise.
En ces années-là, faire l’apologie de la crise était chose
nouvelle. Le livre se présentait comme le manifeste
rétroactif (posthume en quelque sorte) d'un processus
urbanistique "sans retenue" et par là même fascinant qui
aurait toujours été refoulé bien qu’ayant inspiré une
Entretien Rem Koolhaas, p 6
véritable "extase" à ses spectateurs, à ses contemporains,
aux gens qui le vivaient directement (il n’est que de voir le
nombre extraordinaire de cartes postales de Manhattan éditées
dans les années vingt, que vous collectionnez d’ailleurs). Ce
processus grandiose et stimulant aurait été occulté par la
pensée architecturale.
Cette volonté de dévoiler, de montrer et d'accepter, d'aimer
peut-être ce qui est, constitue chez vous un thème récurrent.
La vérité de ce qui est, de ce que chacun vit comme
prodigieux mais que les architectes ne veulent pas voir. Ce
qui est partout, flagrant, irrépressible, mais que personne,
et surtout pas les professionnels, ne veut admettre et encore
moins tenir pour positif. C’est une démarche presque
méthodologique. Vous vous proposez de voir pour les
contemporains, et de leur désigner ce que vous avez vu, comme
Le Corbusier au tout début des années vingt lorsqu’il
incriminait dans l’Esprit nouveau "des yeux qui ne voient
pas".
RK. Je n'ai pas le même type d’ambition pédagogique. Ce n’est
pas chez moi une opération didactique, plutôt une façon de
susciter une autre lecture. Chez Le Corbusier, il s’agissait
vraiment d'une obligation, il fallait témoigner d’un autre
monde et convaincre. Chez nous, il n’y a pas cette
inquiétude. Nous présentons l’état des choses, on pourra
l’accepter ou non. Il n’y a dans nos intentions aucune
dimension moraliste ou didactique.
FCh. Parce que la fin de ce siècle est plus désabusée, moins
programmatique, et moins bâtisseuse d’idéaux. Le Corbusier
espérait contribuer à ce que s'établisse un monde rationnel,
à l’image de ses spéculations intellectuelles.
RK. Pas seulement. Je pense notre stratégie plus habile parce
qu’on adhère plus volontiers à une opinion lorsqu'on on est
invité à la pénétrer d’une manière séduisante, plutôt que sur
un mode trop polémique et du ton d'un donneur de leçons.
FCh. D’où ces jeux, ces paradoxes, ces slogans et ces
démarches parfois plus poétiques que vraiment didactiques.
New York Délire annonçait un plan pour une "culture de la
congestion", culture que vous avez plus tard tenté de mettre
en œuvre. De quoi s'agissait-il?
RK. Tous les projets d’urbanisme que je connaissais à
l’époque s’attachaient à réduire, voire à démanteler la
complexité fondamentale des choses. Il s’agissait de prendre
à part chaque niveau de problèmes, d’organiser les flux sur
plusieurs strates, de prétendre que tout ce qui était
complexe constituait une espèce de nœud gordien qu’il fallait
trancher. Nous avons adopté une position plus positive,
affirmant qu'il ne fallait pas défaire cette contradiction,
cette complexité, mais au contraire l’exacerber".
Entretien Rem Koolhaas, p 7
FCh. Fallait-il du même coup exacerber la rythmique du monde,
son battement? Les grands sociologues de la fin du siècle
passé, comme Georg Simmel, ont insisté sur le rythme
particulier du monde moderne et de la grande ville en
général, sur l'intensification de la vie nerveuse qui en
naissait.
RK. Je ne l’avais pas pensé exactement en ces termes, mais il
y a un peu de ça.
FCh. Il y a une quinzaine d'années, comme beaucoup de
contemporains, et pas seulement parmi les architectes, vous
donniez volontiers dans un certain jargon scientiste,
scientiste plutôt que scientifique. Vous empruntiez par
exemple à la physique moderne la notion de saut quantique. Ce
trait, assez caractéristique des années quatre-vingt,
accompagnait le mouvement de découverte des théories du
chaos, des fractals et de la complexité en général, théories
d’ailleurs suffisamment confuses pour que les scientifiques
en débattent encore. Votre regard sur le chaos a-t-il changé,
maintenant qu'il s'est établi de manière si universelle, si
visible et qu'il est presque universellement admis?
RK. En fait, j’ai très peu parlé de chaos, mais surtout de
notre incapacité à pleinement participer à ce domaine de
discussion. Et je suis rétrospectivement toujours étonné que
l’on m’associe à ces démarches alors que je pense ne rien
avoir à y faire. Je n’en ai jamais été l’avocat, et c’est une
de ces lectures un peu bizarres que les gens font de mon
parcours.
FCh. Quand même, vous vous êtes souvent référé au saut
quantique, cette théorie de Max Planck.
RK. Oui, mais ça n’a rien à faire avec le chaos.
FCh. Il y a eu cette curiosité simultanée pour Heisenberg,
Max Planck, le chaos, toutes théories qui ont été découvertes
en même temps par nos milieux intellectuels. Et pas seulement
par les architectes, mais aussi bien par les philosophes, les
artistes, les écrivains. Tout le monde s’est rué dessus comme
sur une nouvelle explication, ou plutôt une nouvelle
description du monde.
RK. Je pense que l'on gagne à être précis et, à l’école,
j’étais orienté sur les mathématiques et la physique plutôt
que vers des domaines plus culturels.
FCh. Votre position quant au contexte vous est souvent
reprochée. Essentiellement à cause du slogan "fuck context".
Il se trouve qu'à un certain moment, particulièrement en
France, le contexte a constitué la seule dimension
susceptible de réconcilier les diverses tendances
architecturales. Dans un milieu hétérogène et éclectique,
dont les doctrines cohabitaient tant bien que mal, il y avait
Entretien Rem Koolhaas, p 8
un seul mot d'ordre sur lequel les gens s’accordaient :
"Sauvegardons le contexte". S'agissait-il du contexte
physique, naturel ou urbain, ou bien du contexte historique?
On ne savait pas exactement. Et Jean Nouvel pouvait s’en
réclamer aussi bien qu’un architecte traditionaliste, pour
des raisons évidemment différentes. Votre slogan était-il une
réaction polémique, dans ce moment particulièrement
contextualiste des mentalités architecturales, ou bien en
faites-vous aujourd'hui encore un principe?
RK. Ce n’est pas la question. J’ai utilisé cette formule dans
un article particulier, celui sur les gros bâtiments,
bigness. Ce qui est bizarre, et vraiment paradoxal, c’est que
le slogan a toujours été pris hors du contexte dans lequel il
avait été écrit. Il faut se rapporter à son contexte pour
comprendre "fuck context". Je disais que, dans certains cas,
il n’y a tout simplement pas de relation possible entre ce
qui est nouveau et ce qui existe. Et qu’en plus, ce qui
existe n’a pas toujours de qualité particulière et qu’il faut
donc se réserver la liberté d’avoir une attitude flexible, au
cas par cas. Il y a des situations où l’on peut prendre en
compte le contexte, et même lui rendre hommage. Et d’autres
fois où il vaut mieux l’ignorer. Ce qui n’était qu'un élément
parmi d'autres dans un ensemble de réflexions plus complet a
servi en France, d’une manière trop commode, à caricaturer
notre travail et permis de déclarer qu'il fallait cesser de
prendre au sérieux ce type qui appelait à brutaliser le
contexte.
FCh. Je me souviens qu'en 1998, lorsque a été inaugurée la
maison de Bordeaux, certains découvraient que vous l'aviez
excellemment inscrite dans son contexte physique. Et ils ne
comprenaient pas que vous puissiez avoir proclamé "fuck
context" et dessiner pourtant une maison qu'ils jugeaient
parfaitement contextuelle. C'est bien qu’ils n’avaient pas
compris ce que vous entendiez par là.
Lorsque vous dessiniez les premières esquisses du projet
urbain d'Euralille, il y a un peu plus de dix ans, vous
insistiez de manière alors nouvelle et inaccoutumée sur les
réseaux. Les voies ferrées, bien sûr, puisque le projet
s’établissait entre deux gares, mais aussi les voies
routières, autoroutières, les parkings, les bretelles et les
rampes. C'est normal du point de vue circulatoire, surtout
dans ce site de frange entre réseaux ferroviaires et
boulevard périphérique. Mais vous en tiriez un effet
proprement esthétique et architectural. Votre urbanisme
constituait une sorte de road movie littéral, une exaltation
de la circulation, au sens le plus matériel du terme. Un peu
comme si vous aviez voulu émanciper les chaussées de leur
rapport au sol, désir particulièrement lisible dans les
croquis d'intention, que vous dessiniez à la manière de
bandes dessinées. Certains rubans routiers montaient à
Entretien Rem Koolhaas, p 9
l'assaut des équipements, taillaient dans la nouvelle gare,
grimpaient sur le toit de la grande ellipse du palais
Congrexpo. De la station de métro de la gare T GV, vous
attendiez qu'il soit un espace piranésien. Elle devait être
le point d'orgue, le moment de concentration sublime de cette
rencontre du fer, de la route, du parking, des ascenseurs et
des escaliers mécaniques, bref, de tout le circulatoire. D’où
vient cette fascination?
RK. Ce n'est pas une obsession, mais justement une réponse
contextuelle à la situation lilloise. Tout le monde suppose
qu’un architecte qui débarque sur un site, sur un terrain
nouveau, y apporte ses propres marottes, plus générales, des
a priori qui le poussent à travailler de telle ou telle
manière. Or, dans le cas d’Euralille, c’est le contraire.
Nous avons développé le thème du circulatoire parce que nous
étions dans une zone de voiries et de réseaux, avec déjà,
latente, une incroyable présence de cette esthétique du
circulatoire, généralement tenue pour négative bien qu'elle
si elle fasse fonctionner la ville. C'est une contradiction
caractéristique de l’Europe contemporaine : nous dépendons de
ces systèmes de réseaux, ils nous sont indispensables et
pourtant nous les détestons, sans évidemment être à même de
leur opposer la moindre alternative.
Notre volonté était justement de rendre un statut, y compris
un statut esthétique, à ce qui était considéré comme terrible
et devant être caché. Nous voulions tenter de l’intensifier,
de façon à ce que naisse peut-être une manière de terribilità
dans le genre du sublime. Nous étions là en parfaite
cohérence avec le site et les enjeux de la maîtrise
d’ouvrage. Car tous les éléments dont nous jouions, tous les
ingrédients du projet, étaient des contraintes techniques
impératives avec lesquelles nous devions composer. Il
s’agissait de prendre en compte des données fonctionnelles
légitimes et inévitables, et de les faire accéder à une
dimension supérieure. En même temps (et c’était peut-être la
plus importante de nos motivations), il y avait le désir
d’utiliser ces éléments d'infrastructure pour annoncer à
cette agglomération qu’elle allait changer, qu’elle entrait
dans une nouvelle période de son développement, et pour lui
indiquer certaines clés de ce changement. Ce même site avait
connu toute une série de projets antérieurs qui avaient
cherché à réprimer ces modifications, à les cacher, on
pourrait presque dire les refouler dans le sens freudien du
terme. Un petit temple posé sur le terrain était supposé
préfigurer les gares. J’ai trouvé ça inacceptable, surtout
dans l’euphorie qui dans cette période-là s'était emparée de
la France en matière de transformations et d’infrastructures.
Nous pensions jouer avec une certaine mentalité française,
cette ambiance grand projet, train à grande vitesse,
modernisation du pays.
Entretien Rem Koolhaas, p 10
FCh. Certains dessins étaient fascinants. Ils montraient des
chaussées vues par-dessous, avec les voitures qui semblaient
rouler sur un ruban de verre, comme dans ces perspectives "à
la Choisy" dans lesquelles les bâtiments étaient figurés de
sous leurs jupes. Ils ont développé dans l’imaginaire des
jeunes architectes l’idée que peut-être un jour la voirie
serait une chose extrêmement flexible et qu’on pourrait
éprouver une jouissance de ces mouvements de rampes. Cela
tient du rêve, la route est évidemment demeurée lourde,
matérielle et très encombrante. Et ces intentions ont
largement échoué à Lille, notamment parce que l’architecture
proprement dite vous a échappé. L’espace piranésien n'a pas
tenu ses promesses d’exaltation des temps nouveaux et de la
congestion urbaine. On est même, ce printemps, en train de le
barbouiller des fresques que vous aviez refusées.
RK. Le projet a souffert de ce qu’il a démarré dans une
période où l’économie française était entrée en crise. La
récession a duré pendant toute sa réalisation. Il a également
pâti de ce que l’environnement politique a changé. A un
certain moment, il est devenu clair qu’il faudrait faire face
à une autre perspective politique. J’admets tout ça. Et je
crois qu’il reste quand même là-dedans des moments de
grandeur, surtout lorsque, depuis la tour de Christian de
Portzamparc, on voit toute cette voirie disparaître à
l’intérieur de nos bâtiments. Ce sont des moments urbains
d’une certaine force, en dépit de la laideur ambiante, des
infrastructures, de la durée de la procédure et de tant
d'autres éléments qui ont desservi l'opération. C’est
pourquoi je pense qu’il faut accepter l’idée qu’un certain
degré de laideur est inévitable dans les conditions
actuelles. C'est évidemment difficile à expliquer et à faire
admettre.
FCh. Nous reviendrons sur la laideur. Le seul bâtiment que
vous ayez véritablement dessiné et construit à Euralille,
c’est le palais Congrexpo, qui est à la fois un palais des
congrès, un centre de colloques, un grand hall d’expositions
et une salle de concerts rock. Ce palais illustrait cette
théorie de la grandeur (que vous appelez bigness) selon
laquelle, au-delà d'une certaine taille, toute construction
devient en quelque sorte impersonnelle et échappe de manière
irrépressible au dialogue avec le contexte urbain.
RK. L’essentiel de la thèse de l'article bigness c’est qu’à
partir d’une certaine dimension, on ne peut plus parler d’une
seule architecture mais plutôt d’architectures plurielles. Il
y a effectivement dans ce bâtiment beaucoup d’architectures
différentes. D’un côté, cela crée une espèce d’éclatement des
différentes valeurs, quand même intégrées dans une entité, un
tout. Le jeu était entre cette tendance à l’éclatement et
cette insistance sur l'entité. Je ne crois pas que le
bâtiment soit pour autant devenu faussement impersonnel, je
Entretien Rem Koolhaas, p 11
le trouve au contraire très personnel. Mais il échappe à
l'articulation architecturale au sens classique et relève
d’une forme d’urbanisme qui contiendrait de nombreux moments
architecturaux plutôt que d’un objet d’architecture stricte.
Et même si, à son propos, j’ai pu déclarer "fuck context", je
le trouve tout à fait contextuel dans la mesure où, entouré
par les voies ferrées et routières, il se nourrit énormément
de ces fortes présences.
FCh. Beaucoup de critiques, et notamment la célèbre
spécialiste de l’urbanisme et théoricienne Françoise Choay,
vous ont reproché de négliger une sorte d'invariant des
comportements humains, une échelle d'appréhension de
l'architecture et de l’espace qui serait d'ordre quasiment
anthropologique, celle-là même que vos compatriotes
(notamment Aldo van Eyck) défendirent dans les années
soixante. C’est-à-dire échelle humaine, "clarté
labyrinthique" des espaces, seuils et transitions, intimité,
attention presque maniaque aux usages, avec l’idée que d’une
part on servait des invariants mais aussi qu’il y avait là
une sorte de condition de la démocratie architecturale. Vous
seriez donc ainsi par-delà toute idée de démocratie, et votre
architecture serait d’une certaine façon inhumaine puisque
vous blesseriez ces invariants qui nous seraient essentiels,
presque consubstantiels.
RK. Ce qui m’a frappé, en analysant le phénomène de la
consommation moderne, le shopping, c’est que toutes les
valeurs qu'affiche la grande distribution sont des valeurs
que l'on pourrait qualifier d'humanistes. Il y a bizarrement
une forte analogie entre la qualité labyrinthique des lieux
du shopping contemporain et les théories d’Aldo van Eyck.
Cela traduit clairement un problème : est-ce la petite
échelle des architectures qui leur confère une dimension
d’humanité ou faut-il admettre qu'il existe des programmes
qui impliquent nécessairement certaines échelles? Parce qu'on
parle d’une échelle inhumaine pour ce bâtiment de Congrexpo,
mais où a-t-on vu qu’une salle pour des concerts rock et un
hall d’exposition étaient des programmes qui se prêtaient à
une articulation de cet ordre? On a souvent tenté de réduire
l'échelle, prétendument afin d'humaniser la grande dimension.
Cela a toujours plus ou moins échoué, par l’incapacité des
concepteurs à reconnaître que nous sommes confrontés
aujourd’hui à beaucoup d’échelles simultanées et qu’il faut
les prendre en compte simultanément.
FCh. Beaucoup d’entre vos aînés, parmi ceux de la génération
d’Aldo van Eyck, étaient structuralistes, avec un arrière-
plan de culture anthropologique, parfois spécialistes de la
préhistoire. Il y avait donc, dans les invariants qu’ils
invoquaient, l’idée que l’homme ne changeait pas. Que, pour
l’essentiel, il restait le même, qu'il vive au seizième
siècle ou au vingt-et-unième. Sans renvoyer une fois encore à
Entretien Rem Koolhaas, p 12
cette idée de la rythmique et de la nervosité chez Simmel, ou
sans évoquer cette longue dérive historique vers la vie
nocturne qu'a décrite Wolfgang Schivelbusch, on sent bien que
nous sommes différents de ce furent d'autres générations, et
même de ce que nous fûmes. Et que peut-être était-elle
illusoire, cette idée anthropologique selon laquelle il y
aurait en nous des invariants, idée qui semble au moins
partiellement remise en question par notre acceptation de
nouvelles conditions de vie.
RK. En partie oui. Mais ils avaient aussi en partie raison.
L’architecture du shopping le montre d’une certaine façon,
sauf qu’elle n’est pas lisible telle quelle. J’ai eu très tôt
des polémiques avec Aldo van Eyck et Herman Hertzberger.
Elles sont oubliées et n'ont d'ailleurs jamais été très
connues en dehors des Pays-Bas. Comme je venais de revenir de
New York, j’ai souligné que leur terrain d'action privilégié,
celui sur lequel ils construisirent leurs plus célèbres
projets, visait à pallier des difficultés sociales, il
s'agissait de bâtiments pour des mères célibataires, pour des
vieillards, pour des orphelins. Et je leur reprochais cette
manière d’inventaire des handicaps humains qui servait à
prouver le caractère démocratique et humaniste de leur
approche. Ils avaient toujours une tendance à généraliser des
cas très spéciaux pour en faire l'emblème de cas universels
que je n’ai pas trouvée bien convaincante.
FCh. Il s'agit de savoir si, dans les comportements, il y a
de l’invariant ou si tout est flexible et provisoire, et si,
finalement, l’homme sera tout à fait remodelé. Les jeunes
architectes sont aujourd’hui fascinés par l’hybridation et
les prothèses. Ils pensent que nous allons changer, du point
de vue biologique, dans les vingt ou trente années à venir,
et ils le désirent. Ils aspirent à ce nous soyons différent,
y compris dans chacun de nos gestes, dans nos corps. Et une
partie de l’évolution de la science semble leur donner
raison. La condition humaine évolue à une vitesse que nous
n'aurions pas soupçonnée il y a quelques années et ce n'est,
de toute évidence, qu'un début. Y a-t-il quand même des
invariants, une dimension minimale, anthropologique pour
reprendre ce terme un peu désuet? Y a-t-il quelque chose
qu'il faille protéger comme étant le noyau même de l'identité
humaine?
On vous traite souvent de cynique, nous reviendrons plusieurs
fois dans cet entretien sur la question de ce cynisme. On
vous traite de cynique à cause de votre acceptation de ce qui
est, de tout ce qui arrive, et de votre refus supposé
d’endiguer le déferlement de ce qui arriverait de bien comme
de mal. De votre idéalisation, de votre héroïsation peut-
être, de l'ordinaire, du banal et du "laid". Il y a chez vous
une oscillation entre l'invocation de la plus totale des
banalités, le côtoiement d'une certaine laideur peut-être, la
Entretien Rem Koolhaas, p 13
prise en compte de la pauvreté, et l'exploit plastique, ou
structurel, qui confine au maniérisme. Est-ce le goût de la
contradiction qui vous conduit, par une sorte de dandysme? Et
que veut dire cette acceptation du laid? Pensez-vous être
cynique, ou simplement lucide? S'agit-il seulement de
comprendre?
RK. Je ne pense pas être ouvert à n’importe quoi autant qu’on
le prétend. Je ne pense pas être quelqu’un qui accepterait
tout, sans la moindre critique, comme tout le monde le
suppose. Generic City est un essai très critique à l’encontre
du phénomène que j’analyse. Comme d'ailleurs Junkspace, le
texte que je suis en train d'écrire sur l’espace
architectural contemporain. Dans tous les travaux que nous
menons, à Harvard par exemple sur le shopping, il y a une
forte dimension critique. Bien sûr, elle ne mène pas toujours
au rejet explicite, explicitement critique, parce que je
trouve que le refus pur et simple est complètement stérile
dans ce genre de contexte. J’ai été étonné de voir à quel
point la dimension critique de mes positions a toujours été
noyée derrière cette accusation de prétendu cynisme. La
simple quantité de mes travaux militerait contre l’idée d’un
cynisme de ma part.
FCh. Un certain nombre de théoriciens modernes, je pense
notamment à l’épistémologue Bruno Latour, développent
aujourd’hui une théorie sur le peuple des objets. Cette
théorie me fait penser à ce slogan du groupe Haus-Rucker que
vous avez souvent aimé citer : " Amnistie pour l’existant ".
Pourquoi faudrait-il amnistier l’existant?
RK. C’est un propos que j’avais trouvé très profond en ce
sens qu’il proposait une attitude vraiment libératrice,
tellement en contraste avec cette idée qui voudrait que le
simple fait d’être architecte donnerait droit à juger de
tout. La formule d’Haus-Rucker était passionnante simplement
par son invitation à résister à l'obligation de condamner ce
qui est.
FCh. Le cynisme que l'on vous prête est supposé menacer la
ville dans sa dimension la plus humaine. Ainsi Eurallile a-t-
il été mal reçu par la majorité des architectes français.
Notamment par les professeurs et notamment par les critiques.
"Déception massive, collage dont les principes semblent
simplistes, héroïsme vain, grisaille", écrivait Jean-Louis
Cohen. Quant aux autres, ils vous ont presque unanimement
reproché un manque d'urbanité, sans jamais véritablement
préciser ce qu'ils entendaient par là. Avez-vous
personnellement une notion de ce qu’est l’urbanité?
RK. La notion d’urbanité est une espèce de code, de mot de
passe en Europe. Il amalgame la lecture des thèses de gens
comme Maurice Culot. Et tout le spectre de pensée
architecturale qui s’étend d’Antoine Grumbach, Henri Ciriani
Entretien Rem Koolhaas, p 14
à Bernard Huet répète ce mot clé, comme si ces architectes
possédaient les instruments qui permettraient de fabriquer
cette condition d’urbanité à laquelle ils aspirent. Je pense
que personne n'a cette connaissance aujourd’hui. Il y a dans
Euralille des conditions urbaines que je trouve totalement
convaincantes, même si elles n’ont aucun rapport avec la
notion d'une urbanité conventionnelle qui est au cœur de
cette demande mal formulée, et de ce reproche que l'on me
fait.
FCh. Tout comme cette notion floue d’urbanité, apparue assez
tôt (dans les années 1975), celle de contexte dont nous
parlions tout à l’heure et qui est apparue en France un peu
plus tard, sans doute vers le milieu des années quatre-vingt,
est au nombre des expressions à connotation magique qui, dans
les périodes d’éclectisme comme celle que nous avons
traversée, ont le mérite de réconcilier le monde dispersé des
architectes. Ils s’accordent enfin sur quelque chose, cette
urbanité dont ils ne savent pas très bien de quoi il retourne
exactement, aussi indicible que l'était l’espace pour Le
Corbusier. Et la plupart d’entre eux n’ont pas trouvé cette
urbanité à Euralille. Cela dit, on n'a pas toujours bien
saisi, ou pas voulu comprendre ce que vous vouliez dire
exactement lorsque à propos d'Euralille encore, dans le
catalogue Poser-Exposer édité à la fin de l’opération, vous
écriviez qu'il était incompréhensible que "dans ce siècle de
la laideur", le vingtième siècle, le laid comme catégorie
reste toujours si mal compris.
RK. Vous connaissez cette étrange statistique selon laquelle,
si l’on considérait tout ce qui a été construit dans ce
siècle, on ne trouverait trace de la participation d’un
architecte que pour 2 % du total peut-être. Lorsque je parle
du laid, je ne parle pas forcément d’une valeur esthétique ;
plutôt de constructions sans esthétique explicite ou dans
lesquelles l'ambition esthétique n'est pas primordiale. C’est
plutôt le générique, l’ordinaire qui m’intéresse là-dedans,
la neutralité ou le fait que l’on puisse très bien construire
des choses intéressantes dépourvues de la moindre valeur
esthétique. Eliminer le beau et le laid comme catégories nous
permettrait de mieux percevoir toute une série d’autres
qualités.
FCh. Là, vous êtes tout à fait à l’opposé de Le Corbusier.
Lui disait, en 1925 : "Regardez comme ce bidet est beau, il
est beau comme la Victoire de Samothrace". Vous disiez
plutôt : "Regardez comme les choses, finalement, sont laides
et ordinaires". C’est un peu le même discours, mais renversé.
Et vous poursuiviez : "Evidemment, Euralille est laid; il
aurait été pathétique (oserais-je dire malhonnête) s'il ne
l'avait pas été."
RK. Je laisse cette idée exactement comme je l'ai formulée;
et je ne veux rien en dire de plus. J’en reste là parce que
Entretien Rem Koolhaas, p 15
je ne pense pas que l’on puisse gagner quoi que ce soit à une
explication complémentaire. Comprenne qui voudra.
FCh. Vous êtes, à certains égards, un architecte français.
Par plusieurs de vos références intellectuelles qui ont
d’ailleurs marqué toute la jeunesse occidentale des années
soixante, ces philosophies dites du "soupçon". Par Foucault,
par exemple…
RK. Et Roland Barthes peut-être encore plus.
FCh. Architecte français aussi par certains concours auxquels
vous avez participé (celui de la Villette, Melun-Sénart, le
Grand Axe de la Défense, la Bibliothèque de France pour
laquelle vous avez fourni l’un de vos plus extraordinaires
projets, conceptuellement, et celui de la bibliothèque
universitaire de Jussieu). Et puis par ces deux superbes
maisons individuelles que vous y avez construites, l’une à
Saint-Cloud, l'autre près de Bordeaux, vos chefs d'œuvre
peut-être. Enfin par le quartier Eurallile. Or, c'est un pays
où vous êtes particulièrement peu aimé par l'establishment
architectural et universitaire.
RK. C’est un paradoxe que j’ai du mal à comprendre. Il est
certain que j’ai fait mon meilleur travail en France et que
j’ai répondu à des conditions spécifiquement françaises. Je
pense que les projets que nous avons faits pour Paris sont
peut-être les plus contextuels, les plus précis, les plus
nuancés parmi tout ce que nous avons fait. Les plus
polémiques et en même temps les plus crédibles. Alors, je
tiens cette difficulté de relation avec le milieu
architectural français pour une espèce de quiproquo, de
tragédie inexplicable. Mais aussi pour le fruit d'une
insondable bêtise.
FCh. Vous avez pourtant beaucoup de supporters dans ce pays.
Depuis le début, des critiques, intellectuels,
administrateurs, clients et maîtres d’ouvrage, vous ont aidé
et soutenu, et bien compris. Mais il y a toujours en France
ce problème qui plane, la grande ombre de votre supposé
cynisme, de votre satanisme. La France est un pays de
tradition assez rationnelle, qui semble ne pas supporter la
manière étrange dont vous lui paraissez jouer et dériver sur
les sentiers de l'irrationnel, de la dérision et du sarcasme.
RK. Je ne sais pas ce que c’est. Sans doute essentiellement
un problème avec les architectes, parce qu’avec d’autres
milieux j’ai d’excellentes relations. Bruno Latour, par
exemple, s’intéresse absolument à ce que nous faisons.
FCh. Est-ce que cette situation de mal amour existe aussi
dans d’autres pays européens? En Italie, peut-être?
RK. Non, l’Italie nous témoigne plutôt une espèce
d’indifférence, ou même un manque de connaissance. Je n’en
Entretien Rem Koolhaas, p 16
suis pas trop préoccupé parce que ce sont des choses
instables et parce que je n’ai pas envie de m’impliquer trop
dans tout ça, mais je rencontre des versions du même problème
aux Pays-Bas ou en Allemagne. Presque partout, pourrait-on
dire, sauf en Amérique.
FCh. C’est une chose intéressante parce qu’elle permet de
dessiner une sorte de géographie mentale de l’état de la
pensée architecturale. D'ailleurs, si je vous pose ces
questions, ce n’est pas en termes de ragots ou de cancans, ou
pour mesurer l’état de votre notoriété, mais bien par désir
de mieux connaître l’état d’esprit qui règne dans divers pays
d’Europe.
RK. Aux Pays-Bas, il y a une sorte d’acceptation, ou plutôt
de tolérance, qui, en fait, contient plus de réticence à mon
égard que la franche détestation française.
FCh. Vous disiez être principalement apprécié aux Etats-Unis.
Que c’est l'un des pays dans lesquels vous rencontriez le
moins de critique. C’est paradoxal parce que vous êtes
justement un intellectuel européen, avec ce que cela suppose
d’attachement à la dimension politique et sociale des choses.
Et à une certaine héroïsation du métier d’architecte, à une
conception idéologique de son rapport à la société. Comment
l'expliquer alors que la modernité est en Amérique du Nord
sensiblement plus formaliste, moins politique et sociale.
Qu’il s’agisse de Richard Meier ou de Peter Eisenman,
l’approche du moderne y est parfaitement apolitique.
RK. Ce que je trouve intéressant, c’est qu’il existe
actuellement une espèce de résonance entre la culture
américaine, et même celle des grandes compagnies, et
l’architecture. Parce que les composantes les plus
importantes de la société américaine sont en cours de
redéfinition. Il y a un mot américain, reengineering, qui
signifie que le concept de toute organisation peut être en
permanence remis en cause, ce qui entraîne que n’importe
quelle entreprise se transforme, achète, vend, licencie des
gens et réembauche. Dans cette situation d’instabilité
permanente, notre capacité d'analyse idéologique joue un rôle
positif car elle nous permet de dialoguer avec ce type de
position. Ainsi, pour la bibliothèque de Seattle, avons-nous
été capables de nous accrocher à une angoisse touchant aux
relations du virtuel et du réel, particulièrement intense
dans cette ville qui est un peu la capitale de ce type de
rapport de forces. Pour notre projet pour les studios
Universal, notre capacité à produire une analyse à caractère
social et à formuler une lecture politique de ce qu’est un
projet de siège social, a été une des choses qui les ont
convaincus. Il existe là-bas, au cœur de beaucoup
d'opérations, une espèce de contrecoup né de l'expansion et,
parallèlement, un doute énorme.
Entretien Rem Koolhaas, p 17
FCh. Vous avez noué pas mal de contacts avec l’Asie et
beaucoup de vos élèves ou de vos thésards sont asiatiques.
Cette approche politique si spécifiquement européenne,
comment la prennent-ils? Parce les jeunes architectes
d'Extrême-Orient sont souvent très amateurs de spéculations,
de théories et de littérature européennes, et même très
sophistiquées. Ils lisent Derrida, Mallarmé, Raymond Roussel
et ils s'en inspirent dans leurs projets. Mais ils conçoivent
assez différemment la question politique.
RK. Cela dépend. Elle est sans doute peu présente dans le
milieu de mes clients, c’est clair. C’est un genre de
préoccupation qui leur est presque inaccessible. Il faut donc
expliquer les projet sans trop insister sur cette dimension.
Mais, en même temps, on peut parler des phénomènes
d’instabilité ou de leur impossibilité de maîtriser les
mécanismes, réalités qu'ils admettent parfaitement.
FCh. La ville générique est un texte de 1994, que vous avez
republié l'année suivante dans votre phénomène de livre
S,M,L,XL, imprimé à 130 000 exemplaires en trois ans.
Phénomène, par son poids, sa nouveauté graphique et son
message doctrinal. Vous y exposiez donc cette théorie d'une
ville "générique", qu’on voit parfois reprendre çà et là hors
de notre milieu, cette idée d’une ville sans qualité ni
identité particulière, amnésique, appelée à se répandre
inexorablement dans le monde entier. Et vous y demandiez si
la ville contemporaine était vouée, comme déjà l'aéroport, à
être toujours "pareille", identique à elle-même, notamment
parce que la croissance urbaine exponentielle que nous
connaissons condamnerait immanquablement la ville historique
et le passé en général (et peut être l'ensemble de la culture
historique européenne) à être en quelque sorte "trop petits"
pour contenir tant de destinées humaines et tant de
phénomènes, et tant de mouvements économiques. Faut-il pour
autant rompre avec ce que vous appelez d’un terme assez
péjoratif et négatif des "dépendances" (dépendance au centre,
au patrimoine, à toutes sortes d’héritages)? Ces villes sont,
d’une certaine façon, plus libres que les nôtres, bien sûr.
Mais pourquoi faudrait-il libérer le monde de ses nostalgies?
RK. Ce n’est pas forcément nécessaire. C'est dans cette même
perspective d’une malheureuse obligation de condamner que je
l’ai suggéré. Parce nous sommes contraints de décréter tout
ce qui se fait maintenant inférieur aux divers types de
villes anciennes ou historiques. C’est seulement d'une
émancipation du contemporain qu'il s'agit, sans qu'il faille
nécessairement abandonner l'idée d’établir des relations
entre les deux. L’Europe est destinée à devenir une espèce de
machine à tourisme de masse à l'usage du monde entier. Elle
est vouée à représenter la culture. Et c’est une raison
supplémentaire pour célébrer ce qui est contemporain. Parce
qu’évidemment ce rôle de centre touristique mondial sera
Entretien Rem Koolhaas, p 18
toujours plus pesant, toujours plus présent et plus
déterminant pour l’appréciation que nous ferons de la ville
historique et pour l’usage que nous en ferons. Il s'agit d'un
effort pour rééquilibrer les regards plutôt qu'admettre la
séparation définitive et l'incompatibilité de ces deux âges
de la ville.
FCh. Mais la ville générique rompt, plus généralement, avec
tout ce qui n'a plus d'utilité marchande, fonctionnelle ou
ludique (ce qui est aujourd’hui une catégorie du marchand).
Pékin, ainsi, dont il ne restera bientôt plus aucune trace,
sinon quelques monuments emblématiques, des alibis, des
logos. Vous reconnaissez qu'admettre cette ville générique,
implique le renoncement à l'identité. L'identité est souvent
un mythe. Les villes n’avaient pas forcément autant
d’identité qu’on le dit. Elles étaient souvent très
semblables les unes aux autres. Mais il reste que nous les
voyons rétrospectivement avec l'idée que chacune était
différente de la voisine ou paraissait l'être, ou rêvait de
l'être. Cette identité était une sorte de condensation
héritée de l'histoire, du contexte et de la géographie, de ce
que certains théoriciens plus ou mois influencés par
Heidegger ont appelé le génie du lieu. Même sans chausser les
bottes de Christian Norberg-Schulz, il y a bien un certain
génie des lieux.
RK. Il y a aussi des identités dans la ville générique. C'est
parce que l’on se réfère au modèle de la ville historique que
l'on est contraint d'analyser la ville générique comme
totalement dépourvue de qualités particulières. Mais, dès que
l’on dépasse ce type de lecture obligée, cette définition
univoque de l’identité, il y a plein d’identités nouvelles
qui se manifestent. Il s’agit de capter divers autres types
d’identité et c’est le propos de ce texte. Il s’agit de
comprendre qu’il y a des identités particulières à Singapour
ou à Shenzhen, et qu’il est trop facile de les lire comme des
villes de série B, des villes sans qualités.
FCh. Dans le même texte, vous appeliez à rompre avec ce que
vous appelez "l'asservissement au centre". Cela veut-il dire
que ce que l'on avait mis des centaines d'années à
consolider, ce que nous croyions assez pérenne, ce que nous
maintenons sans cesse à grande difficulté et que nous
appelions la ville, doive partir en lambeaux?
RK. On ne les maintient pas, les villes anciennes. On ne les
maintient pas exactement, parce qu’elles ont à assurer toutes
sortes de nouvelles tâches. Elles sont en permanente
transformation et modernisation. Toutes présentent un
décalage absolu entre leur apparence physique et leur contenu
effectif. Ce décalage, je le trouve chaque jour plus pénible,
tel qu'on peut le découvrir à Paris, à New York même où de
grandes parties de la ville sont devenues des malls, des
shopping centers et rien d’autre. L’urbanité séculaire qui
Entretien Rem Koolhaas, p 19
était là a été emportée par les phénomènes de la consommation
et du tourisme. C’est aussi pour réfléchir à une autre façon
de vivre la ville que j’ai écrit ce texte.
FCh. Il est vrai que si l'on considère une ville comme
Montpellier, on voit qu'elle n’est plus qu’artifice. Posée
sur tout un réseau de tramways, de gares et de parkings
souterrains, c’est une sorte d’artifice ludique, presque un
Disney Land. C’était une ville extraordinaire il y a encore
cinquante ans. Amsterdam, que je n’avais pas vue depuis
longtemps, m'a parue largement réduite à une machine à
tourisme local ou international. Mais cette concrétion stable
qu'est la ville ancienne (dispositif à certains égards
rassurant) fonctionne encore malgré tout à Paris, ou dans des
grandes villes comme Milan ou même Rome. Il y a un certain
intérêt à la maintenir, vous en conviendrez. À lutter pour
qu’elle ne s’écroule pas, ne serait-ce que parce qu’un jour
peut-être la fonction ludique pourrait disparaître et des
populations de toutes sortes, on ne sait pour quelles
raisons, s’établir dans le cœur de villes et donner un statut
moins agaçant à leur décor.
RK. Sans doute, mais il faut analyser la question
attentivement. Chaque ville a des valeurs différentes.
Amsterdam est passée de l’autre côté. Milan a une résistance
incroyable parce qu’elle n’est pas très séduisante. Rome a
peut-être mieux résisté parce qu’elle a été un parc
d’attractions depuis le tout début et qu’elle a toujours vécu
avec cette dimension.
FCh. À Venise, c’est depuis le dix-huitième siècle. La ville
générique paraît quand même supposer la fin de
l'architecture, son inutilité, son caractère microscopique et
dérisoire dans la marée des choses existantes. Pourtant, vous
prétendez encore faire de l’architecture, aux différentes
échelles de cette discipline. Comment justifier ce pessimisme
et conserver néanmoins ce désir d’agir?
RK. Je n’ai pas besoin de justifications, ou peut-être n'ai-
je pas la capacité de les formuler. Mais ce type de
contradiction apparente nous a conduits à restructurer notre
agence d’une façon assez drastique. Elle connaît maintenant
deux composantes, l’OMA, qui fait de l’architecture au sens
plein du mot, et l’AMO qui mène un travail purement
conceptuel de recherche architecturale, sans se préoccuper de
construire. Ceci fonctionne depuis le début de l’année et
c’est le premier résultat manifeste de cette tension.
FCh. À part l’inversion de votre sigle OMA, AMO, ça veut dire
quoi?
RK. Je ne l’expliquerai pas, cela peut signifier beaucoup de
choses.
Entretien Rem Koolhaas, p 20
FCh. Pékin est plein d’architecture, grêlé, mitraillé
d’architectures plutôt que composé d’architecture. Cela veut
dire sinon la fin de l'architecture, au moins de son rôle
comme responsable de l'ordonnancement des villes, et de leur
identité. Et pourtant, en tout cas en Europe, les pouvoirs
locaux se tournent encore vers les architectes à forte
notoriété pour inventer, remodeler, triturer l'identité, ou
au moins l'image de leur cité. Ainsi Piano à Berlin, Buffi à
Paris-Bercy, Bohigas à Barcelone, Aix-en-Provence ou Lyon,
Bofill à Montpellier, autrefois à Bordeaux, etc. Et vous pour
Euralille. Parce que l'architecture a ses manières à elle de
signifier. En cela elle est efficace, même dans le monde du
marché et du marketing.
RK. C’est évidemment un phénomène duquel nous dépendons, que
nous n’essayons peut-être pas de contredire mais
d’approfondir. Je déteste toujours plus l’idée d’être celui
qui propose une image. Je suis très gêné par l’idée que
l’architecte possède une signature et qu’il puisse être
apprécié pour cette seule signature. C'est une des raisons
pour lesquelles nous travaillons de plus en plus dans le
cadre d'associations, permanentes ou occasionnelles. Par
exemple en ce moment avec Herzog et de Meuron pour un projet
à New York, simplement afin de contredire ce type
d’utilisation de l’architecte. Nous commençons aussi à
collaborer avec d’importantes agences américaines qui, sans
être nécessairement très grandes, possèdent une compétence
spécifique, et nous montons avec elles des partenariats. Nous
sommes donc en train de mettre en place un autre système.
FCh. A Euralille, vous aviez été en compétition avec d’autres
équipes. Si un certain nombre de personnes ont poussé Jean-
Paul Baïetto et le maire à vous retenir, c’est parce qu’elles
pensaient qu'il fallait choisir un architecte dont l’image
pourrait signifier que le Nord n’était plus en train de
patauger dans la dépression et ses décors de briques et que
quelque chose de nouveau pouvait surgir dans cette partie de
l’Europe. Ce qui a fonctionné d’ailleurs puisque les sondages
d'opinion menés par l'Express au moment des élections
municipales de 1995 montraient que la population locale
l’avait bien compris. Il s'avérait que les gens n’aimaient
pas nécessairement votre architecture mais qu’elle signifiait
néanmoins à leurs yeux que Lille n’était pas seulement la
vieille agglomération croulant sous les effets de la crise
économique mais aussi la capitale d'une région qui pouvait
s'inventer un destin nouveau, en l'occurrence européen. De ce
point de vue, votre réalisation avait été jugée efficace. Et
puis, vous nous dites ne pas être favorable aux signatures.
Mais, quand vous décidiez que sur la gare d’Euralille il y
aurait cinq ou six tours sympathiques, ce qui voulait dire un
peu torturées ou un peu dégingandées, c'était bien leur
apposer une signature?
Entretien Rem Koolhaas, p 21
RK. Une mise en scène, plutôt qu’une signature.
FCh. Ce n’est pas de votre écriture proprement dite qu'il
s'agissait, puisque ce n’était pas vous qui alliez construire
chacune de ces tours, mais c’était quand même jouer d'une
capacité un peu prométhéenne à faire que quelque chose
naisse.
RK. Etant donnée la quantité aberrante d'obstacles que nous
avons rencontrés, le mot prométhéen ne s’applique pas du tout
au cas d'Euralille.
FCh. La globalisation est vécue en Europe (notamment par les
intellectuels) comme la fin d'un monde, comme un deuil. Comme
la disparition de ce qui était l'essence de nos cultures (et
qui assumait aussi leur hégémonie, mais c’est une autre
affaire). Elle est perçue différemment dans d'autres régions
du monde, où elle signifie au contraire modernité,
émancipation et projection dans l'avenir. Ce que, pour notre
part, nous appelions autrefois le progrès.
RK. En Afrique, il est sans doute trop tôt pour le dire. Et
je ne prétendrai pas être capable de lire ainsi la perception
que les gens s'y font du progrès ou de la mondialisation. En
revanche, en Asie, et même en Amérique, il paraît certain que
la population projette sur la globalisation d’autres valeurs
que nous.
FCh. C’est-à-dire que pour eux, elle veut dire futur.
RK. Et progrès, oui. Ce qui est bizarre, c’est qu'ici tout le
monde participe de ce mouvement et en profite mais que tout
le monde le décrie. A mon avis, il y a là une espèce
d’hypocrisie plutôt qu’une émotion authentique.
FCh. Depuis 1996, vous animez à la Graduate School of Design
de l'université de Harvard, avec chaque année une poignée
d’étudiants et de thésards, des séminaires de recherche
consacrés aux questions urbaines dans le monde contemporain.
RK. C’est un projet documentaire, un travail de pure
recherche, que nous conduisons sans trop de réflexion
proprement architecturale, très loin aussi des préoccupations
de l’urbanisme appliqué ou de toute intention prescriptive.
Nous essayons de capter les mutations qui sont à l’œuvre dans
les conditions urbaines, ces mutations qui se déroulent sous
nos yeux mais ne sont pas toujours bien comprises. Notamment
parce que, s’il y a un énorme travail spéculatif quant au
devenir des villes, on s'interroge peu sur leur état réel et
on recueille peu d'informations précises sur leurs conditions
actuelles. Il s’agit de nous attaquer à ce décalage, toujours
plus grand, qui règne entre le monde formel de l'architecture
au sens étroitement disciplinaire et le phénomène urbain.
Les années soixante-dix restent comme la dernière époque au
cours de laquelle le monde architectural eut une confiance
Entretien Rem Koolhaas, p 22
absolue en sa capacité à faire des hypothèses précises sur
les villes du futur. Rétrospectivement, on s’aperçoit qu’il a
été incapable d’en prévoir le devenir. Il existe des
documents cartographiques de Doxiadis qui montrent trois
conditions urbaines. Les zones d’urbanisation totale,
figurées par une trame noire qui recouvre les régions les
plus développées du monde, une zone grise qui indique une
condition intermédiaire, et le reste en blanc, suggérant le
vide, les territoires non urbanisés. On se rend compte
aujourd'hui que ce type de regard a été inefficace, il n'a
pas su apprécier ce qu’allait devenir la réalité urbaine. Il
est devenu inutile de parler simplement de ville et de non-
ville, en opposant ces deux catégories, parce que la ville
est devenue un phénomène universel. Elle est partout, elle
règne partout, même là où elle ne le paraît pas. C’est pour
tenter de capter cette nouvelle réalité que nous menons notre
projet. Il s’agit de décrire cette modification qui fait
qu'aujourd'hui nous travaillons et vivons tous dans un
système régi par le marché, et que cela bouleverse les
valeurs qui, traditionnellement, dominaient la théorie
architecturale et urbaine.
FCh. Vous avez d’abord étudié l'urbanisation d'une région du
Sud-Est asiatique, le delta de la Rivière des Perles. Puis ce
que vous nommez le shopping, et que vous qualifiez d'activité
"ultime" de l'espèce humaine, c'est-à-dire le commerce
moderne et mondialisé, mais aussi le loisir moderne et
mondialisé, ce bain de consommation et de loisirs que
d'autres, en d'autres temps, ont pu appeler la société de
consommation, ou bien la situation unidimentionnelle de
l'homme, et d'autres encore la société du spectacle. Un
phénomène, ce shopping, que vous décrivez comme touchant de
manière indistincte le mall commercial, l'aéroport et
jusqu'au musée. Enfin la ville africaine, que vous explorez
en ce moment, saisie dans son point le plus apoplectique et
pourtant le plus fluide peut-être, du moins à vous entendre,
en l'occurrence Lagos, la proliférante capitale du Nigeria.
Pourquoi travailler de préférence sur des mondes où la
réalité urbaine apparaît si confuse?
RK. Il est possible d'identifier trois couches et trois
phénomènes caractéristiques de ce système global, trois
phénomènes qu’en effet nous avons successivement analysés, en
trois étapes. D’abord l’accélération, que nous avons explorée
en Chine du Sud. Ensuite le phénomène planétaire du shopping.
Enfin la situation de villes qui se fabriquent selon des
processus plus légers que ceux que nous connaissons en
Occident, ce que nous avons étudié avec Lagos.
FCh. Vos groupes d'étudiants sont multiethniques, de toutes
origines géographiques et culturelles : encore un fruit de la
globalisation.
Entretien Rem Koolhaas, p 23
RK. C’est un choix délibéré. Lorsque je suis venu pour la
première fois à Harvard, j’ai découvert qu’il y avait des
professeurs qui enseignaient un certain savoir théorique à
des étudiants parfois plus informés qu’eux sur tel ou tel
sujet. Ainsi y avait-il un atelier où l’on se demandait
comment renouveler une zone portuaire qui avait périclité.
Dans la classe se trouvaient des étudiants originaires de
Singapour où l’idée d’un port tombé en déshérence est
complètement incompréhensible. En plus, certains d’entre eux
avaient déjà connu dans leur propre pays une carrière durant
laquelle ils s’étaient montrés capables de planifier une
partie de ville. Il n’y a plus à concevoir forcément
l’enseignement comme la transmission aux étudiants d’une
connaissance préétablie; eux-mêmes sont porteurs de
connaissances particulières que l’on peut facilement
mobiliser à l’occasion d’un travail de recherche. J'ai
découvert là un effet indirect de la mondialisation.
À Harvard, l’enseignant peut recruter ses dix élèves parmi
une soixantaine de candidats. Cela permet de constituer des
équipes cohérentes, avec des étudiants aux compétences
spécifiques, susceptibles de bien maîtriser le sujet qu’on se
propose d’aborder. Et de distribuer les rôles au sein des
équipes. Ainsi, dans le projet chinois, chaque étudiant
était-il à la fois en charge d’une ville particulière et
d’une problématique d'ordre général : architecture, paysage,
aspects idéologiques ou économiques. Une ancienne communiste
roumaine était chargée de découvrir tout ce qui dans ces
régions subsiste du communisme. Elle a pu en identifier
partout les traces et dans un très beau texte, Infrared
(l'infrarouge), analyser comment cette condition rouge
continue derrière toutes les apparences, occultée aux regards
dans le spectre invisible du politique. Car le communisme a
toujours su justifier les difficultés et les souffrances du
présent en jouant sur le sacrifice, le sublime de la
finalité, la promesse du lendemain, etc.
FCh. Avec ces étudiants, vous étudiez les mutations, à votre
avis définitives, qui bouleversent les villes mondiales et
bientôt l'ensemble de la condition urbaine, c'est-à-dire
l'ensemble de la condition humaine. C'est le Harvard Project
on the City, ou plus exactement The Project For What Used to
be Called the City, le projet "pour ce que l'on avait
l'habitude d'appeler la ville".
RK. C’était le titre original, mais on me l’a refusé, le
jugeant trop provocateur.
FCh. On the City paraît plus objectif et plus approprié car
votre projet n’est pas précisément un projet "pour" la ville.
Enfin cette année, en manière de paradoxe, vous étudiez un
sujet sur lequel on ne vous attendait guère, la Rome antique.
Ce travail est en cours, et vous le présentez sous forme
d’une sorte de manuel, ou de logiciel, ou de jeu interactif,
Entretien Rem Koolhaas, p 24
le Roman System qui salue le lecteur : Welcome to the Roman
System, puis lui explique comment bâtir la ville. Quelle
forme physique aura-t-il?
RK. Ce sera principalement un livre imprimé mais accompagné
d'un logiciel.
FCh. Qu'apprenez-vous de Rome?
RK. L’amour de l'architecture romaine a toujours été l’une de
mes sources secrètes, une affinité particulière. Rome me
fascine. Ce qui m’a ici plus particulièrement frappé, c’est
combien les Romains ont été capables, sur la base d’un
vocabulaire urbain prescriptif, limité et très strict, avec
peu de variations, de bâtir une telle diversité de villes. La
qualité systématique et générique de leur approche m’a
toujours attiré et le projet d’Harvard vise à vérifier si la
situation urbaine s’est transformée depuis l'époque antique
ou si elle s’est modifiée moins qu’on ne le pense
généralement et si, au contraire, dans le système romain, il
n’y avait pas déjà, sous une forme embryonnaire, presque
toute la densité, tous les moyens, toutes les conditions que
nous connaissons maintenant.
Parallèlement, nous essayons d’interpréter l’empire romain
comme une préfiguration du processus actuel de
mondialisation. Parce que c’est une situation qui, de la même
façon, offrait à partir d’un point central une extension
presque infinie. Et parce que ce phénomène d’extension
suscitait, aux limites des territoires connus de l’époque,
des conditions hybrides développées sur la base des schémas
reconnus. Notre lecture envisage l’empire romain et la
diffusion de ses modèles comme une sorte de prototype de la
modernisation, susceptible de fournir l’occasion d’en
conduire une approche plus neutre et détendue. Ce n’est pas
tant Rome qui nous concerne en l’occurrence que le système
romain.
FCh. Il y a plusieurs modèles de Rome, bien sûr, dans notre
culture d'architectes. Celui du cardo et du decumanus, celui
du plan réglé, du quadrillage à base militaire, de la ville
tracée et fondée. Et puis il y a cet autre modèle qui a
beaucoup captivé nos générations, celui qu’a développé Colin
Rowe dans son livre de la fin des années soixante-dix Collage
City, c’est-à-dire l’évocation d'édifices gigantesques et
prodigieux, flottant dans une espèce de substance urbaine
(justement) presque labyrinthique.
RK. C’est pourquoi je me suis plutôt attaché à l'empire qu'à
la ville de Rome. Colin Rowe est le grand théoricien de Rome
et il s'est intéressé à la collision entre les différents
systèmes, pas seulement entre les objets architecturaux d’une
certaine période, mais vraiment entre ceux de toutes les
Entretien Rem Koolhaas, p 25
périodes. Mais c'est d'une lecture archéologique qu'il s'agit
chez lui, ce qui, nous, ne nous intéresse pas tellement.
FCh. Une archéologie esthétisante, littéraire, et très fine.
RK. Cela nous intéresse peu. Colin Rowe pratiquait un type de
lecture vraiment postmoderne qui a d’ailleurs constitué l’un
des manifestes de la postmodernité, dans sa dimension la plus
crédible. Nous ne faisons pas du tout la même chose.
FCh. Vous intéressez donc plus au modèle de la ville tracée,
fondée et maniant des paramètres répétitifs…
RK. Et surtout au modèle d’une ville qui fonctionne comme une
collection de types et de prototypes qui (bien
qu’individuellement assez rigides), lorsqu'ils sont mis
ensemble, engendrent des conditions différenciées. C’est
pourquoi nous jouons avec une sorte de jeu vidéo inspiré de
SimCity dont toutes les typologies, connues et répétitives,
n’évoluent guère durant les mille ans que nous étudions. On a
trouvé de formidables documents, par exemple un écrit de
Ménandre, rhétoricien d'origine grecque du quatrième siècle
qui, dans Laus Urbis, explique que, lorsqu'on s'adresse à une
ville et à sa population, il faut toujours commencer par lui
rendre justice et par vanter ses mérites. Cette façon de
considérer toute ville est très proche de mon texte sur la
ville générique. N’importe quelle ville peut être louée et
décrite de façon positive.
FCh. Je me souviens d'une conférence que vous avez donnée à
Vienne, dans le bâtiment de la Caisse d'épargne d'Otto
Wagner, en novembre 1997 Devant un public incrédule, ne
sachant avec quel degré de sérieux il fallait considérer vos
propos, vous exposiez les travaux menés l'année précédente
dans le Sud-Est asiatique.
RK. Nous avons travaillé sur la région de Pearl River Delta,
en Chine du Sud, qui gravite autour de Hong Kong, ville que
nous n’avons d’ailleurs pas étudiée car elle est ne connaît
plus cette croissance hystérique d’il y a quelques années et
sa population a été stabilisée autour de cinq ou six millions
d’habitants. La région comprend Guangzhou (autrefois Canton),
vieille capitale provinciale, deux villes récentes, Shenzhen
et Zhuhai, nées du développement des zones économiques
spéciales, Dongguan et l’ancienne colonie portugaise de
Macao. C'est une zone urbaine de quelque douze millions
d'habitants qui, dans vingt ans, en aura trente-six. Shenzhen
est passée en quinze années de zéro à trois millions
d’habitants.
On y assiste à une explosion du phénomène urbain qui rend
toutes les histoires d'urbanisme, toutes les approches
anciennes, toutes les notions habituelles complètement
inopérantes, décalées, et même absurdes. C’est jusqu’à notre
langage qui est défaillant face à cette nouvelle réalité. Il
Entretien Rem Koolhaas, p 26
fallait notamment établir un catalogue de concepts adaptés.
D’où ces 75 termes que nous avons proposés et chacun frappés
d’un copyright pour leur donner un certain relief (et bien
sûr aussi par provocation). Copyrights sans valeur ni
conséquence légale, simplement destinés à insister de façon
frappante sur le nouveau statut que nous proposions pour ces
diverses notions.
FCh. Un siècle s'est véritablement achevé, un monde
imprévisible déferle et les exemples que vous donniez étaient
stupéfiants. Il y avait dans votre exposé ce jeu constant de
caricature, de fiction, de narration exemplaire qui est
récurrent dans votre manière de présenter les choses. Cent
gratte-ciel par an à Shenzhen, 900 en une décennie : vous
mettiez en valeur, d’abord, le prodigieux développement de ce
que vous appelez d'un terme parfaitement matériel, objectif
et même clinique, la "substance" urbaine, substance dont il
serait produit annuellement 500 km2 dans cette zone
géographique.
RK. C’était pour reconnaître le phénomène. Pour en prendre la
mesure avec la volonté de le comprendre comme participant
effectivement de l’urbain, d’une sorte de substance urbaine
en effet, sans trop nous interroger sur le point de savoir
s’il présente les caractéristiques classiques de la ville,
alors que ce processus de construction va tellement vite, et
dans une telle accélération historique, qu’il ne prend même
pas la peine de veiller à son bon achèvement (et il ne
s’achèvera d'ailleurs probablement jamais). Cela fait qu’à
l’intérieur des plus grandes métropoles, il y a des
alternances d’endroits de creux et de vide et des territoires
non utilisés. Par cette expression de substance urbaine, nous
voulions simplement marquer notre intention de saisir ces
territoires en tant que ville.
FCh. Dire substance, c’est aussi une façon de débarrasser la
ville de tout ce qu’elle a de sentimental ou d’historique, de
la présenter comme moins qu’une matière biologique. Et
lorsque vous parlez de substance vous êtes en deçà des
métabolistes japonais des années soixante. La lave est une
substance, la boue en est une autre. Si cette objectivisation
n’a pas de caractère franchement péjoratif, on pourrait au
moins y lire une dépréciation du vitalisme du phénomène
urbain.
RK. Ce n’est pas de la ville au sens d’un objet fini. On y
voit cohabiter un centre urbain, un carrefour des plus denses
avec une atmosphère vraiment métropolitaine et, juste à côté,
des rizières. Cette nouvelle condition urbaine n’établit pas
la même relation entre le centre et la périphérie, entre les
points de concentration et la banlieue, elle se présente
plutôt comme une espèce de catalogue, un assemblage, le
montage de toutes les conditions dans le même cadre. Les plus
diverses coexistent dans un seul paysage.
Entretien Rem Koolhaas, p 27
FCh. Vous souligniez alors le caractère provisoire des
formations urbaines, et aussi leur pragmatisme. Telle
construction qui avait été conçue initialement pour être un
parking, vous comptiez qu’elle avait occupé 45 fonctions en
peu d'années. Et que seules de légères modifications du mur-
rideau de façade, comme un frémissement de la peau des
choses, comme un tic sur un visage, avaient traduit,
extériorisé et révélé ces mutations. L’architecture, dans ces
pays, exprime-t-elle si peu?
RK. C’est difficile à dire. Le phénomène qui me fascine est
que, même si les architectes sont très peu nombreux, même
s’ils gagnent peu, même s’ils travaillent énormément avec une
vitesse inouïe, pourtant leur architecture ressemble
énormément à celle qu’on produit ici, par exemple à la
Défense. Notre travail est aussi bien une manière de regarder
ce que nous produisons nous, ici, et (ce qui est encore plus
important pour moi) de faire constater que les conditions
sont 100 % différentes mais le résultat à 99 % similaire. Ce
qui suppose une relative absence de l’architecte et la
présence plus essentielle d’autres forces comme l’industrie,
l’accélération, la promotion immobilière. Ce travail analyse
évidemment une situation spécifique mais, en même temps, de
façon implicite, il tente de mettre à jour les situations
parallèles (ou équivalentes) qui se développent dans nos
propres régions.
FCh. C’est aussi une façon de considérer l’architecture comme
une sorte de volume capable plutôt que comme un être. Un
volume capable, et capable d’être autre chose...
RK. C'est dans la continuité du concept de ville générique,
d’un certain type de bâtiment et finalement, peut-être, de
notre idée de bigness qui veut qu'à partir d'une certaine
échelle le bâtiment puisse s'accommoder de n’importe quel
programme. Il s'agit toujours de la même constatation,
récurrente : il n’y a plus de relation directe entre forme et
programme.
FCh. Au terme de votre travail, vous avez donc introduit 75
notions ou concepts, et vous les avez frappés d'un copyright.
Ainsi Photoshop©, comme technique de collage et de
fabrication de la ville, parce que tout peut être copié et
assemblé, sans jugement. Une fois de plus, il ne s'agit pas
du collage selon Colin Rowe, celui de Collage City.
RK. C’est une façon technique d’incorporer dans une seule
masse toutes les choses que l'on trouve désirables. Cela n’a
rien à faire avec l’esthétique mais simplement avec cette
espèce de réalité factice que peuvent fabriquer les moyens
contemporains.
Entretien Rem Koolhaas, p 28
FCh. Tout peut être copié, assemblé sans difficulté, sans
tabou, sans jugement, y compris dans les architectures
construites, pas seulement dans les images.
RK. C’en est la conséquence.
FCh. Ainsi pacte faustien©, parce que la Chine communiste a
pactisé…
RK. Je ne m’en souviens pas.
FCh. Vous avez oublié les copyrights que vous aviez déposés?
RK. J’en ai déposé tellement ! Soixante-quinze dans ce seul
projet car, depuis, j'en ai déposé d’autres encore, pour le
shopping et pour Lagos. Il y en a un très grand nombre. Je
crois que nous avons tenté d’en réintroduire quelque deux
cents dans le vocabulaire de l’urbanisme.
FCh. Pacte faustien©, parce que la Chine communiste a pactisé
avec le diable, c'est à dire l'économie de marché. Ainsi
revirement transitoire.
RK. Un pari assez intelligent a été fait avant qu'Hong Kong
ne redevienne communiste. Au lieu d’attendre que cette ville
devienne toujours plus grande, les Chinois ont pensé que la
période de transition pourrait privilégier le développement
d'agglomérations comme celle de Shenzhen. Le communisme a
sauvé l’économie occidentale en refusant de dévaluer sa
monnaie. Ils ont tenu, d’une façon complètement secrète, pour
éviter que tout le système ne s’effondre.
FCh. Ainsi vitesse Shenzhen©, qui est cette capacité
extraordinaire qu’il y aurait en Chine à "architecturer",
projeter et construire à toute vitesse, sans avoir même le
temps de se constituer des experts, alors que les écoles de
ce pays sont trop peu nombreuses et encore assez faibles.
RK. Cette accélération a d'énormes impacts sur le statut de
l'architecture, et sur les conditions d’exercice de cette
profession. Si l’on considère le nombre d’architectes pour
mille habitants, on s’aperçoit qu’en Europe il en a beaucoup,
en Amérique, moitié moins et très peu en Chine. Nous avons
calculé qu’il y a, dans ce pays, des endroits où l’on ne
compte qu’un architecte pour sept millions de personnes. En
observant le nombre d’architectes chinois, le montant de
leurs honoraires et leur production, nous avons découvert une
complète inversion des ratios et nous avons réalisé qu’ils
étaient peu nombreux, qu’ils gagnaient très peu, mais
produisaient énormément. En moyenne, un architecte chinois
construit chaque année un volume bâti équivalent à un gratte-
ciel de trente étages.
FCh. Et vous insistez sur la différence de pratique
professionnelle entre les architectes chinois et européens.
Dix fois moins nombreux, ils conçoivent dix fois plus de
Entretien Rem Koolhaas, p 29
volume construit, en dix fois moins de temps (une tour en
quatre demi-journées, avec leur Macintosh installé sur le
frigo de la cuisine, disiez-vous), ce qui fait un coefficient
d'efficacité de un pour mille. Ils ont une capacité frappante
à émerger avec rapidité d’une phase assez archaïque.
RK. Sans phase intermédiaire. Mais c’est justement cette
absence de culture qui leur permet de fonctionner si
efficacement. Et je pense qu’à Lagos aussi, l’absence
d’héritage permettra de faire un saut, un bond beaucoup plus
grand que ce que nous pourrions envisager dans nos pays.
FCh. Ainsi cités des extrêmes différences©, ou COED©, qui veut
marquer que, bien que toutes ces villes soient destinées à
former un même et immense organisme, il y a des phénomènes
qui, dans cette ville générique, dans cette substance urbaine
à caractère presque biologique, font que chaque ville se
forge, s’invente une différence qu’elle doit constamment
refaçonner. Car une identité est toujours provisoire et
fragile. La ville générique n’est donc pas aussi atone et
neutre qu’on aurait pu le craindre. Est-ce visible dans le
paysage chinois de ce delta de la Rivière des Perles? Y sent-
on vraiment des différences morphologiques ou paysagères?
RK. Le delta consiste en six villes spécifiques. L’identité
de chacune ne peut être définie qu’en relation avec toutes
les autres dans la mesure où elles tendent à constituer un
unique organisme urbain. Il y a Hong Kong, avec à son côté sa
ville parasitaire, Shenzhen. Ensemble elles constituent un
système hyper performant en termes d’économie et de
construction. Et il y a Zhuhai, qui a le même statut que
Shenzhen mais où les choses ne marchent pas aussi bien parce
qu’elle ne dispose pas à proximité d’une ville comme Hong
Kong qui l’alimenterait. Alors, elle décide de devenir la
cité-jardin par excellence, une espèce de banlieue
résidentielle très luxueuse. Et, du coup, elle aussi peut
vivre et se développer parce qu’elle s’est définie en
contraste avec toutes les autres. Ce phénomène est très
présent dans ces conditions historiques. Il implique un
réglage permanent de toutes les identités. On est dans un
monde d’instabilité, de concurrence, d’ajustement réciproque,
de ruse constante.
FCh. Vous avez aussi frappé de copyright des attitudes
architecturales, comme l'architecture© de la tabula rasa©.
RK. C’était simplement pour souligner qu’il y avait une
grande absente dans le répertoire des architectes actuels,
c’est la capacité à concevoir l’idée même de la table rase,
bien qu’il soit évident qu'elle a toujours été la condition
indispensable de tout recommencement. Cette impossibilité du
recours à la table rase explique le sentiment de stagnation
qui règne presque partout.
Entretien Rem Koolhaas, p 30
FCh. Nous ne faisons plus jamais place nette. C’est tout le
problème du palimpseste, de la sédimentation, de
l’accumulation des couches, et plus généralement du respect
du contexte qui sont devenus des fondements incontournables
de la pensée urbaine occidentale. Autre concept frappé de
copyright, le faire fin©, thinning© qui consiste à recouvrir
de vastes territoires d'une sorte d'urbanisation continue, ou
scape©.
RK. Scape©, c'est cet univers qui n'est ni ville ni campagne.
Il est frappant que, dans ces régions, on voit toujours d’un
seul regard un gratte-ciel (ou l’autre forme du bâti, les
taudis) et des rizières. C'est l'un des traits de la
condition post-urbaine, cette confrontation de la verticale
des façades et de la platitude des étendues non urbanisées.
Les conditions métropolitaines coexistent avec des conditions
de paysage naturel plus ou moins ravagé, ou bien
d’agriculture. Et j’ai appelé thinning cet autre phénomène
qui est que, même s’il y a des densités particulières en des
endroits spécifiques, rien ne force à ce que l’espace
interstitiel, les intervalles entre les zones bâties soient
densément construits.
FCh. On trouve cela aussi bien, pour des raisons de rente
foncière, dans certaines banlieues de Bordeaux où l’on peut
voir des rangs de vignes de crus réputés qui subsistent parmi
des quartiers de tours de logement social, ou de pavillons.
RK. Oui, et c’est aussi une espèce de thinning.
FCh. Et l’on voit ça de façon très forte aussi dans les Pays-
Bas, cet agglomérat de campagne agricole et d’urbanisation.
RK. C’est une des raison qui nous ont poussés à indiquer ces
copyrights, notre ambition étant d’introduire une
terminologie qu’on puisse appliquer ailleurs.
FCh. Autre copyright, le lissage©, smoothing©.
RK. Smoothing. Cela renvoie à cette réflexion que l'on trouve
chez Deleuze, dans Mille Plateaux, à propos du lisse et du
strié. Et à tout ce courant de l'architecture occidentale qui
depuis quelques années essaye de simuler des effets de sol,
avec des projets topologiques, avec des plans continus
manipulés et déformés. J'ai été frappé de voir qu'en Chine on
avait compris le paysage, le sol plutôt, comme une espèce de
couche qui serait en charge de multiples responsabilités et
qui pourrait adopter n’importe quelle forme et librement
connecter n’importe quoi à n’importe quoi.
FCh. Encore guerre du mur-rideau©, et puis le pittoresque©.
Là, pas de chance, la notion de pittoresque, comme vous le
savez, a déjà été déposée au XVIII ° siècle.
RK. Oui, et c'est bien à ce genre de l'esthétique du paysage
que nous nous référons. Parce qu'il n'y a que cette approche
Entretien Rem Koolhaas, p 31
qui puisse expliquer la beauté de la Chine actuelle, cette
juxtaposition monstrueuse d'éléments incompatibles.
FCh. Mais le pittoresque était toujours, en bonne théorie de
l’art (chez Burke et d’autres), opposé au sublime. Il y avait
ce qui dépasse l'entendement humain dans ce qu'il a de
raisonnable, ce qui est grand et beau et un peu terrible
aussi, et puis le pittoresque qui serait fait de choses
touchantes dans le genre d’une ruine, d’un moulin, de petites
références humaines et nostalgiques. Dans la peinture
anglaise du dix-huitième siècle, le sublime exaltait et le
pittoresque était là pour rassurer. Quel genre de pittoresque
que avez-vous découvert en Chine du Sud?
RK. Il s'agissait d'essayer de comprendre comment, dans ces
régions, on parvient à assembler une situation
invraisemblablement hétérogène. Car le pittoresque, c’est
aussi l’art d’incorporer des juxtapositions fortes, comme ici
ces vastes golfs, ces theme parks et ces fragments de
rizières mélangés avec les zones construites, sans le moindre
souci de les articuler.
FCh. Encore une fois, le maelström de l'urbanisation
asiatique est un événement qui devrait ébranler toute cette
doctrine de la ville que les architectes ont eu tant de mal à
reconstituer il y a une trentaine d'années. Vous parlez
d'impasse de la théorie, et même ceux qui adhèrent à ces
théories de la ville traditionnelle avoueraient leur
impuissance face à l’urbanisation actuelle, et face à ces
paysages. Toutes les digues doivent-elles pour autant céder?
Faut-il abandonner le volontarisme positiviste qui était à la
base de toute pensée aménageuse, dont l'urbanisme? Pensez-
vous qu’il soit un frein au libre développement des villes?
RK. Absolument pas. Je pense qu’il faut se définir des buts
et se donner des ambitions. Mais nous souffrons d’un décalage
complet entre les moyens dont nous disposons et les ambitions
que nous nous fixons. Il s'agit de plaider pour une
adaptation systématique aux faits, plutôt que pour l'abandon
de nos ambitions.
FCh. Vous ne pensez donc pas que le corps français des
ingénieurs des Ponts et Chaussées ou ses équivalents
néerlandais ou anglais devraient être affaiblis? Vous n’êtes
pas en urbanisme, et notamment pour l’Europe, un tenant du
libéralisme à tout crin?
RK. Pas du tout! Je trouve au contraire que les Pays-Bas, par
exemple, souffrent terriblement, en ce moment, du quasi-
libéralisme auquel ils sont livrés et qui nuit vraiment et de
manière visible à tous les aspects de la vie.
FCh. C’est bon à entendre, car la plupart des gens ne
s’attendent pas à ce genre de réponse de votre part. Vous
êtes donc toujours désireux de vous appuyer sur des hommes
Entretien Rem Koolhaas, p 32
politiques et des maîtres d’ouvrage puissants, volontaires et
informés?
RK. Puissants n'est peut-être pas le mot. Il est évident que
la réputation de l'OMA nous attire certains types de client,
mais ce n'est pas nous qui en appelons à un certain type
d’hommes ou de femmes.
FCh. Avec Shopping, qui explore le grand commerce et la
consommation, c'est un nouveau chapitre que vous ajoutez à
l'histoire, ancienne, du rapport des techniques et de
l'architecture. Ceci un demi-siècle après le Mechanization
takes command de Giedion, trente ans après The Architecture
of the Well-tempered Environment de Banham, qui a tellement
compté dans le monde anglo-saxon pour ce qu'il annonçait de
la culture des réseaux, des gaines et de la climatisation, et
vingt ans après votre propre New York Delire qui est (en
partie) une fable, une fiction et une réflexion sur
l'ascenseur et ses effets. En tant qu'industrie moderne, la
consommation est née de certains développements techniques,
la construction métallique, le grand magasin à étages et
l'ascenseur au siècle dernier, puis l'escalier mécanique, la
climatisation et le hangar de surface quasi illimitée
aujourd'hui, qui est une conquête moderne de la technique,
laquelle nous permet de construire des surfaces de plusieurs
dizaines, voire centaines d’hectares sans façades ni cours.
Sans compter, dans les aéroports notamment, le tapis roulant,
qui introduit une autre dimension, à la fois fonctionnelle et
sensorielle, de la mécanisation.
RK. Le phénomène du shopping a introduit une mécanisation
toujours plus forte dans l'existence des villes. C’est une
sorte de bombardement de technologies, qui a commencé aux
alentours du début du siècle, autour de deux inventions clés,
celle de l'escalator d'un côté (il y en a 300 000 dans le
monde et leur nombre double tous les dix ans), l’escalator
qui établit une continuité des plans urbains et crée une
indifférenciation des niveaux, et l'air conditionné, ensuite,
qui permet aux bâtiments d'atteindre une taille presque sans
borne. On peut multiplier les surfaces, on peut les relier et
les connecter d'une façon presque insensible. Et les
escalators, dont le rôle dans les villes modernes reste
vraiment à étudier, sont devenus des machines à fabriquer
dollars, euros ou francs.
FCh. On lira dans votre livre Harvard Guide of Shopping,
lorsqu’il paraîtra, des pages curieuses sur l'ampleur des
grandes surfaces commerciales. Aux Etats-Unis, la surface
construite totale des grandes surfaces (772 millions de m2)
équivaut à 12,7 fois celle de la presqu'île de Manhattan. Ils
pèsent 7 558 fois le centre Pompidou. En Asie, il y aurait
12,1 fois Manhattan. En Europe, trois fois. Dans le monde
entier, 33 fois. Vous insistez beaucoup sur le factuel, et
sur le quantitatif. Parce que évidemment cela fait
Entretien Rem Koolhaas, p 33
extraordinairement image. Qu'attendez-vous de ces
statistiques?
RK. Elles ne sont là que pour établir le contexte et pour
donner une idée de l'échelle du shopping. Parce que l’un de
nos premiers constats a été qu’il y a aujourd’hui un fossé
entre la profession d’architecte et le shopping. Cette
profession veut ignorer la véritable apothéose d’un phénomène
social essentiel, et feindre qu’il n’existe pas. Dans sept
universités, j’avais regardé à quelle date on avait pour la
dernière fois inscrit ces questions au programme et organisé
un atelier de projet consacré au phénomène de la
consommation : pas une fois en douze ans, ce qui révèle un
décalage catastrophique entre ces deux mondes. Nous avons
donc d'abord eu un regard quantitatif sur le shopping et
mesuré sa répartition dans le monde, pour vérifier l’échelle
du phénomène et, du même coup, l’échelle de ce fossé. Il y a
évidemment beaucoup de surfaces vouées au shopping en
Amérique, beaucoup en Asie, relativement peu en Europe,
encore moins dans l’ex-Union soviétique et très peu en
Afrique. Nous avons essayé de calculer combien il en existait
dans le monde et de se représenter la chose, et c'est en
effet 33 fois le contenu de Manhattan. Voici donc un
phénomène urbain qui, en termes quantitatifs, risque de
devenir dominant. Nous avons également chiffré la quantité de
shopping disponible par habitant et par pays. C’est un peu
comme si, dans beaucoup de pays, les habitants possédaient
inconsciemment une espèce de résidence secondaire, un certain
nombre de m2 qu'il leur fallait assumer durant toute leur
vie, sans cesse en train de s'élargir, comme une espèce de
taxe invisible à supporter. En lui-même, le poids de cette
activité est une dimension essentielle de notre relation avec
la ville. Car la ville, traditionnellement gratuite, devient
de plus en plus quelque chose qui se paye.
FCh. Les techniques du commerce sont sans cesse mieux
rodées : façonnage de nos comportements et de nos désirs,
avec le marketing, ses slogans, ses logos, ses musiques, ses
atmosphères, ses dispositifs d'organisation physique et
paysagère de l'espace, avec l'arrivée récente des techniques
olfactives, avec de puissants moyens de cartographier les
populations, de cartographier l'argent mais aussi les
diverses catégories humaines, classes, âge, sexes, désirs et
préférences, imaginaires, avec le branding, avec les moyens
logistiques et les stratégies de manipulation de chacun
d'entre nous en tant qu'acheteur. Le branding et la
surexposition de la marque vous intéressent beaucoup,
notamment en ce qui concerne l’architecture. Et vous en
employez même certaines techniques à l’appui de vos
démonstrations, détournées, bien sûr.
RK. C’est un phénomène important qui façonne aujourd’hui
beaucoup d’identités. Il y a deux écoles : celle qui imagine
Entretien Rem Koolhaas, p 34
que le branding nécessite une espèce de définition définitive
de l'identité de la marque, qu'il convient donc d'insister et
de toujours la réaffirmer, et l'autre, qui interprète une
marque comme quelque chose de vivant, mobile et susceptible
de changer de caractère. En Amérique, c’est plutôt la
première attitude qui est à l'œuvre et l'on essaye
généralement de trouver et renforcer une identité stable. En
Europe, par exemple pour la société Prada, les entreprises
sont plus intéressées par une définition qui puisse évoluer,
muter d'elle-même, avec une certaine marge de changement
d’approche.
FCh. Il y a dans votre étude une réflexion sur la guerre et
le commerce. Vous remarquez que, dans beaucoup de grandes
entreprises privées, on embauchait des experts venus du
domaine militaire (vous citez l’exemple de la firme Sears
qui, lorsqu'elle allait mal, a fait appel aux compétences du
général Gus Pagonis qui s'était illustré durant la guerre du
Golfe). Mais, en même temps, les spécialistes de la guerre la
décrivent parfois comme une branche, un sous-ordre du
commerce mondial, du marketing et de la communication. Dans
une certaine mesure, comme technique, elle est sans cesse
plus articulée à celles de la communication, dans ses
méthodes comme dans ses fins.
RK. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu’en plus des
personnalités impliquées dans ce système, il a maintenant des
techniques dérivées de la guerre des étoiles qui y sont mises
en œuvre, afin de contrôler la fidélité du consommateur. Il
est dramatique de voir à quel point les stratégies militaires
ou les technologies militaires ont pénétré le domaine du
commerce.
FCh. Ce système de la consommation semble connaître son
apothéose. Mais ça pourrait être aussi son chant du cygne,
avec la venue du virtuel et du net qui déjà transforment
radicalement commerce, loisir, érotisme, diffusion et
consommation culturelles.
RK. A terme, le e-commerce risque de rendre encombrantes,
inutiles et donc désuètes toutes les manifestations physiques
du shopping. L'économie du shopping connaît en ce moment un
mouvement angoissant. Elle est triomphante et pourtant en
risque permanent d'extinction. Déjà les gens passent moitié
moins de temps qu’il y a dix ans dans le shopping. Et les
theme parks, les Disney Land, Planète Hollywood, etc.,
parties intégrantes de ce phénomène, pourraient bien
s’effondrer si survenait une lassitude ou une révolte
soudaine. Le système de la grande consommation actuelle
serait alors comme un éléphant à l’agonie qui pourrait
devenir dangereux, brutal et incontrôlable. On voit se
développer en Amérique une gangrène du monde des parcs
thématiques qui annonce peut-être la fin de cet univers de
villes synthétiques et artificielles.
Entretien Rem Koolhaas, p 35
C’est ce que nous avons voulu décrire, ce moment d’apothéose
et de crise du shopping, moment où, pour survivre, il se voit
contraint de s’associer avec de tout autres programmes, de se
faire omniprésent, d’utiliser le virtuel pour renforcer la
consommation traditionnelle, de créer des interdépendances
qui feront que l’un ne tuera pas l’autre. Le phénomène
atteint une échelle inimaginable et, en même temps, il est
déjà menacé par d'autres phénomènes parallèles; cela lui
donne une dimension encore plus désespérée. Il lui faut
s'infiltrer dans toutes les activités urbaines, dans tous ces
programmes qui font le territoire de l'architecture. Et l'on
trouve maintenant la consommation infiltrée dans les musées,
dans le divertissement, dans les aéroports, comme s’il était
le ciment invisible de notre condition urbaine, fondant les
activités humaines en une sorte de grand tout. On sait avec
quel sérieux on a, il y a quelques années, reconstruit le
pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone, l'un des plus purs
mythes de l'architecture. Dans cette reconstruction figure
maintenant une grande boutique à destination des touristes.
Paradoxalement, alors qu’on souhaitait établir avec l’édifice
une relation respectueuse, on la détourne immédiatement par
l'obligation du shopping. D'un phénomène relativement isolé,
c’est devenu un phénomène universel qui risque de
complètement gouverner l’urbain.
FCh. Que devenons-nous, en tant que citadins, dans cette
transformation?
RK. Très peu de gens admettent aujourd’hui qu’ils sont des
consommateurs, qu’ils se livrent au shopping. Cette activité
constitue une sorte de continent refoulé que l’on fréquente
durant une partie de son temps et que l’on préfère ignorer le
reste du temps. Il est bizarre que la participation des
contemporains à la consommation engendre si souvent chez eux
un sentiment de culpabilité. Très peu de gens assument cette
dimension de leur vie, même si, pour presque tout le monde,
elle constitue un vif plaisir.
FCh. J'enseigne à Villeneuve-d'Ascq, la ville nouvelle
lilloise, tout près du centre ville : station de métro, hôtel
de ville, une chapelle, trois équipements, quatre petits
restaurants qui sans cesse périclitent, un parc, une
médiathèque, un théâtre public, un espace scientifique
François-Mitterrand. Tout ce que l'on veut, et jamais
personne. Tout contre ce centre (qui a été conçu par les
architectes de l'AUA), est tapi un centre commercial immense,
enchanté, peut-être horrible (ce que vous appelez du
junkspace) mais climatisé, offrant une atmosphère de luxe et
de suavité sans la moindre aspérité. Il s'y promène une foule
constante. Les gens y viennent en voiture, pénètrent
directement du parking dans le centre commercial et ne
sortent jamais dans la ville nouvelle, pleine de qualités
pourtant, de bonnes intentions architecturales et urbaines,
Entretien Rem Koolhaas, p 36
ne serait-ce que pour y prendre un verre. Du coup, l'espace
public, que les urbanistes occidentaux valorisent tant, n'a
plus guère de statut, ni d'intérêt. C'est à peine si on peut
l'entretenir. Les collectivités locales ont du mal, les
espaces sont abîmés ou dégradés, usés, tagués, alors que les
marbres du centre commercial sont parfaitement astiqués. Que
doit faire le collectif? Que peut-il contrôler, maîtriser?
Que doit-il abandonner? Cela se pose aussi dans votre
quartier d’Euralille, qui connaît une grande difficulté à
entretenir les abords, la voirie, le parc, le bassin devant
la gare, l’arbre sur la dalle en pente qui sèche et qui
meurt, tandis que le centre commercial, lui, est nickel.
RK. C’est l’élément le plus dramatique. Notre conception de
ce qu’est le caractère public d’un espace est devenue
illusoire. Il nous faut admettre que ce statut a changé de
caractère et en assumer les conséquences. Les villes, dont la
fabrication et le contrôle furent longtemps le fruit d’un
processus public, se transforment en un phénomène de plus en
plus privé. Et cette mutation fondamentale modifie
complètement leur statut. C’est pourquoi j’étais tellement
excité lorsque à Euralille Jean Nouvel s'est dit intéressé
par l’idée de construire le centre commercial. Et sa
réalisation prouve que ce n’est pas si difficile, qu’il n’est
pas impossible de récupérer ce type d'équipement par
l'architecture, au profit de l’architecture, qu’il n’y a pas
nécessairement un conflit a priori entre l’un et l’autre.
FCh. L'une des raisons du reproche que l'on fait à votre
quartier d’Euralille, ce reproche selon lequel il manquerait
d’urbanité, est que l’urbanité s'y trouve, incontestablement,
mais intériorisée, refoulée à l’intérieur du centre
commercial plus que distribuée dans les espaces publics
extérieurs.
RK. Je l’ai toujours conçu comme ça.
FCh. Vous consacrez dans vos travaux une place importante à
l'aéroport moderne. Ce n'est plus un diagramme, une machine
fonctionnelle à distribuer des flux. C'est devenu un dédale
marchand délibéré, savamment combiné, qui organise une
expérience légèrement onirique d'errance (mais d’errance
surveillée, manipulée), de dépaysement et de rêve
consumériste. On y circule, captif, fragile et médusé. Vous
avez étudié ces plans d’aéroports et vous nous expliquez
qu’il s’agit d'y offrir la plus grande surface possible de
contact avec les vitrines.
RK. Même le plus sérieux et le plus rationnel des
équipements, l'aéroport qui, il y a encore dix ans, relevait
principalement d'une exigence de clarté et d'efficacité, se
voit maintenant transformé en un labyrinthe de consommation.
La lisibilité qui était traditionnellement exigée pour ces
infrastructures, cette fonctionnalité qui, par exemple, nous
Entretien Rem Koolhaas, p 37
conduisait très directement de l'entrée à la sortie d'un
aéroport, sont détournées au profit d'un cheminement. Tout le
réseau des éléments organisationnels est aujourd'hui masqué
derrière des attributs commerciaux qui bouleversent la
logique de la production architecturale de ce type de
construction. On assiste à une transformation de
l'architecture elle-même, puisqu’elle doit produire des
espaces comme ceux-là, toujours plus séducteurs, plus
arbitraires, plus manifestement dédiés au spectacle.
FCh. Dans votre travail sur le shopping, vous esquissez aussi
une nouvelle "leçon de Las Vegas". Trente ans après Venturi,
Scott Brown et Izenour, ce n'est plus tant de signes qu'il
s'agit, mais d'un total patchwork d'activités, en fondu-
enchaîné. On y est noyé dans le commerce, comme dans une
coulée de boue tiède, en continu.
RK. C’est un des thèmes qui se sont imposés à nous au cours
de la recherche. Nous étions à Las Vegas pour une semaine
avec les étudiants, à l’occasion d’un congrès immobilier
focalisé sur le shopping. Et nous nous sommes rendu compte
qu’il nous fallait effectuer une relecture de Learning from
Las Vegas. Pour Venturi, Las Vegas était une ville du futur
parce qu’elle était immatérielle, parce qu’elle avait toutes
les apparences d’une ville sans en avoir la matérialité,
grâce à toute une série de phénomènes comme la lumière qui en
donnaient l’illusion. On se trouve aujourd'hui dans une
situation absolument différente où c’est devenu une énorme
masse urbaine agglomérant des bâtiments gigantesques
(notamment des hôtels plus grands que n’importe où ailleurs,
des hôtels de 5 000 chambres), tout cela pris dans une sorte
de magma, un patchwork d’activités indistinct et soumis à la
loi du shopping. Il fallait complètement repenser Venturi et
réviser ses pronostics quant aux villes du futur. D’une
certaine manière c'était décevant, puisque nous préférons
tous une ville immatérielle, et il est un peu triste qu'en ce
début du vingt-et-unième siècle ce soit toujours la matière
qui soit la manifestation la plus flagrante d’une situation
urbaine. Il s'agissait donc aussi de réagir à l’espoir que le
virtuel devait alléger la situation urbaine. On voit au
contraire le virtuel incorporé dans une architecture plus
lourde que jamais.
FCh. Ce qui était frappant chez Venturi, c’était aussi ce
paysage du Strip, ce paysage plat semé de symboles, de
signes, de panneaux routiers, de hangars décorés dans un
environnement finalement assez vide.
RK. Le Strip est devenu complètement stalinien, avec des
bâtiments colossaux qui font que les signes ne peuvent plus
représenter quelque chose de plus important que les bâtiments
eux-mêmes et les constructions elles-mêmes sont redevenues
les signes.
Entretien Rem Koolhaas, p 38
FCh. Vous semblez trouver regrettable que les architectes
constituent la seule profession à ne pouvoir admettre cet
univers du commerce. Voudriez-vous vraiment qu'ils l'aiment?
RK. J’ai moi-même des difficultés à l’admettre. C’est
pourquoi j’ai écrit mon article sur le junkspace, un texte
assez dur qui essaie de comprendre les nouvelles lois et
souligne en même temps la difficulté qu’il y a à les
admettre. Mais il est assez tragique que les architectes
constituent la seule catégorie humaine à ne pouvoir aimer ces
atmosphères, à ne pas voir ce qu’il pourrait peut-être y
avoir de riche et foisonnant dans une telle situation
urbaine, une sorte d’équivalent moderne du forum romain, en
un sens.
FCh. Finalement, quelle est la place de l'architecte et de
l'architecture dans cette affaire? Vous reconnaissez qu'elle
insulte la plupart de nos valeurs établies, notre culture et
même notre intelligence de ce qu'est un espace, une lumière,
un son, un décor, toute beauté et toute rigueur.
RK. Pour moi, ce n’est pas tellement une question d’insulte,
mais d’incapacité. Simplement, comme tout le monde, je ne
parviens pas à l'aimer, je n’ai pas l’imagination qui serait
nécessaire. Je perçois mon attitude comme une carence plutôt
que comme la marque d'une résistance.
FCh. Qu'entendez-vous par junkspace?
RK. Junkspace veut dire qu’il y a une expérience
contemporaine de l’espace qui est universelle et qui est
fondée sur des valeurs complètement non-architecturales. Et
sur le fait paradoxal qu'elle exploite et recycle tous les
thèmes architecturaux sans conserver aucune de leurs
qualités. On assiste à une espèce de démantèlement de
l’architecture, à l'exacerbation de ses qualités
spectaculaires (et donc en un sens architecturales) mais avec
un tout autre effet conceptuel ou physique. Je trouve
hallucinant que, si l'on identifie le junkspace comme la
production d’espace probablement la plus importante des vingt
dernières années, il devient possible de lire l’architecture
de Frank Gehry ou l’architecture de mes contemporains, ou
même la mienne, comme du junkspace. Il règne un arbitraire
complet dans la manipulation des signes.
FCh. On dirait en français "tout ce bordel ambiant"?
RK. Ce n’est pas forcément un bordel. Les barres de logement
social, ce n’est certainement pas du bordel mais cela
participe quand même d'une esthétique sauvage qui ne se
reconnaît que peu de règles.
FCh. Les règles traditionnelles de connivence et de
cohabitation. Mais junkspace, n'est-ce pas dans votre esprit
Entretien Rem Koolhaas, p 39
un terme péjoratif? Ne veut-il pas dire cette camelote, cet
environnement de mauvaise qualité, ce sous-produit?
RK. Pas forcément, non, vraiment. On assiste à l'émergence de
conditions hybrides. Ce que j'ai appelé junkspace (je ne
saurais absolument pas traduire le mot, quand même
architecture-bordel peut-être) est le réceptacle de la
modernisation, une sorte de dépotoir, de désordre. Ce paysage
évoque un lieu jadis bien ordonné qui aurait été secoué par
un ouragan. En fait il n’ait jamais été ordonné, ce n’est pas
son problème, et nous nous trompons quand pour nous rassurer
nous y voyons un désordre passager et rattrapable. Produit du
vingtième siècle, le junkspace connaîtra son apothéose au
vingt-et-unième. Et ce sont les résidus des organisations
antérieures, tout ce qui dans cet espace relève du plan, du
tracé, de la géométrie, qui lui confèrent un sentiment morne
et attristant de résistance inutile, qui en plus en gêne les
mouvements et les flux circulatoires.
Le caractère presque sans fin de cette architecture est
fascinant. Elle ne peut jamais y être considérée comme
achevée, car il y a toujours des parties dans ces édifices
qui sont en train de se reconstruire. Il y a, face-à-face,
ceux qui utilisent l'architecture, la consomment, et,
derrière, ceux qui sont en train de la produire. C'est
presque devenu un phénomène permanent, cette reconstruction
au sein de la même architecture. Le plus choquant, dans tout
ça, c'est peut-être que l'architecture de ce junkspace-
architecture-bordel, bien que parfois intense, violente,
parfois belle entre guillemets, ne peut pas être mémorisée.
Elle est instantanément et totalement oubliable, et je vous
mets au défi de vous souvenir du moindre de ses aspects, de
ses détails. C'est l'architecture du futur.
FCh. Vous nous décrivez au sein de ce système comme des
boules agitées dans un flipper. Vous avez parfois pourtant
des formules assez tendres à son égard. Ainsi, celle selon
laquelle vivre dans le junkspace, ce serait comme "être
condamné à un perpétuel jacuzzi avec ses meilleurs amis par
millions". Le rêve fait cauchemar, American Beauty, le
meilleur des mondes, y compris dans sa dimension sensuelle.
RK. J’essaie toujours de comprendre ce qu’il y a de positif
là-dedans. Parce que je veux expliquer l’attraction que ces
phénomènes suscitent chez tellement de monde. Et pas
forcément chez les seuls Américains.
FCh. Le junkspace est souvent doux, scintillant, clos et
chaud (maternant).
RK. Souvent, mais je découvre qu’il peut aussi être
radicalement nu et dépouillé. Par exemple Malpensa, le nouvel
aéroport de Milan, est vraiment du junkspace, sans aucune
Entretien Rem Koolhaas, p 40
chaleur, junkspace par l’indifférence complète, l’absence de
honte avec laquelle il a été composé.
FCh. Ce junkspace est filtré, contrôlé, aseptisé, chauffé et
bien éclairé. N'est-ce pas ce qu'autrefois on appelait
simplement être conditionné : l'air, l'espace et nos
comportements?
RK. Il ne conditionne pas à ce point nos comportements. Le
penser, ce serait croire à une espèce de manipulation
manichéenne et parfaitement efficace. Le public du junkspace
est tellement divers qu’on ne peut prétendre qu’il ait un
seul genre d'effet.
FCh. Parce qu’il s’adresse à l’homme universel, indistinct, à
tous. Le junkspace est furtif, musique douce, marbre au sol,
escalators silencieux, tout glisse. C’est l’atmosphère du
shopping?
RK. Et de n’importe quoi. Le junkspace c'est tout ce qui est
contemporain.
FCh. Revenons au conditionnement. Avec l'air conditionné, les
volumes construits n'ont plus besoin de façade, d'aération ni
de lumière. Il sont donc virtuellement sans fin. On peut
associer des immeubles côte à côte en surfaces infinies.
RK. C'est l'une des qualité du junkspace. Elle implique qu’un
bâtiment ne peut plus être terminé. Et ça introduit une
lecture opposée à toutes les lectures traditionnelles de
l’architecture. Donc une rupture qu'il est urgent de
théoriser.
FCh. Il n'y a pas de typologie de cet univers informe, car il
est instable par nature, en devenir. Il est expansif,
flexible, adaptable et donc (en son principe même) informe.
RK. Parce que l’infini ne peut jamais être une typologie.
FCh. Sauf qu’il a une façon particulière de constituer ses
réseaux, ses flux, par exemple le mouvement des personnes.
RK. C’est presque comme une écologie. Il faut comprendre la
consommation comme un système global, comme une sorte
d'écologie. Et il faut avouer que nous ne pouvons pas plus
facilement la critiquer que nous ne pouvons critiquer
l'oxygène de l'air, car nous y baignons.
FCh. Pourtant, à sa manière, cet univers aime l’architecture.
Il aime les signifiants architecturaux de base, les poncifs :
dômes, pyramides, nefs et voûtes en cylindre, verrières,
escaliers et coursives, mezzanines.
RK. Il utilise l’architecture. Il emploie les portes, les
axes, les piazzas et joue de tout l’héritage de
l’architecture. Il habite le passé et le contemporain en même
temps.
Entretien Rem Koolhaas, p 41
FCh. Cet espace mue sans cesse. Sans cesse, le junkspace
change d’allure, il change de peau, il se dévêt de son
architecture, qui n'est pas à proprement parler immatérielle
mais qui est d'une matérialité légère, une matérialité
d'apparence, ou plutôt d'enveloppe.
RK. C’est une matérialité provisoire, fondée sur des formes
plutôt qu'élaborée à partir de vrais matériaux. Cela a
complètement changé le fait de construire. Ce qui était un
travail lourd est devenu une activité comparable à celle d'un
tailleur. On ne se sert plus du marteau, mais on emploie le
scotch, les agrafes et c'est c’est une transition radicale
quant au caractère traditionnel de solidité et de masculinité
de l’architecture. Il n’y a plus de structure ou d’ossature.
Ou s'il y a une ossature, elle est invisible, brutale et
invisible. Ou elle est devenue symbole, esthétique, et
décoration.
FCh. Tout est provisoire. Pas de parois fixes, pas de mur,
guère de façades, une maigre structure invisible qui, avez-
vous écrit d’une jolie formule, "gémit sous la décoration";
des parois provisoires, de simples membranes que vous dites
n’être faites de rien, mais "couvertes d'or". On ignore alors
l'une des plus anciennes exigences de l'architecture, la
firmitas de Vitruve, la pérennité, le désir et le devoir de
durer. Et c’est une chose que vous imaginez se répandre dans
d’autres domaines que le shopping?
RK. Je pense qu’elle s'est déjà partout répandue, parce que
le placoplâtre est dans toutes les constructions.
FCh. Vous travaillez actuellement sur Lagos, la capitale du
Nigeria, dix à quinze millions d'habitants. Vous considérez
cette ville comme exemplaire de la ville moderne en Afrique
de l'Ouest (son paradigme) mais aussi comme son point de plus
extrême pathologie.
RK. Je ne sais pas encore comment la considérer. Je suis
seulement convaincu que c’est une ville importante avec des
conditions particulières qui la rendent différente des autres
agglomérations africaines. Ce qui m’attire aussi en elle,
c’est qu’elle est inconnue parce qu’elle a sombré dans une
espèce d’occultation politique, du fait de sa terrible
histoire, faite de corruption et de régime militaire.
FCh. Elle est difficile à appréhender parce qu’elle est mal
cartographiée, mal analysée par les disciplines
traditionnelles. C’est finalement en hélicoptère qu’on la
voit le mieux.
RK. Oui mais aussi sur la route. Nous faisons beaucoup
d’efforts pour en recomposer les éléments. Lagos a connu des
couches de planification antérieures, des projets américains,
des projets israéliens, tchèques, bulgares, et même un plan
directeur de Doxiadis. On y trouve donc une sédimentation des
Entretien Rem Koolhaas, p 42
théories de la planification urbaine. Cela nous permet de
revisiter aussi les idées de Team Ten, l’influence de
Brasilia et tout ce qui s’est joué par le biais des régimes
communistes. En cela, c'est un terrain d'étude vraiment
riche.
FCh. Cette urbanisation est fascinante parce qu’elle est
fluide, en même temps que souvent saturée et embouteillée,
elle est provisoire et mobile. Les habitants paraissent s'y
débrouiller souplement mais, en même temps, c’est une ville
d’une grande pathologie, une ville qui souffre peut-être
beaucoup.
RK. Qui souffre certainement.
FCh. Vous intéressez-vous à Lagos parce que c’est une ville
africaine, ou bien parce que ce serait aussi, d’une certaine
façon, une sorte de modèle de la ville en devenir?
RK. L’absence manifeste d’urbanisme et même d’architecture
est peut-être un avant-goût de ce qui pourrait se répandre
dans nos pays. J’ai l’intuition (mais ce n’est guère plus)
que ce pourrait être prochainement une ville très importante.
Parce qu’il y a là, dans toutes les actions, une intelligence
qui pourrait avoir des effets considérables dès qu'il s'y
sera accumulé une certaine couche de technologie (et cette
couche est actuellement en train de se constituer, ne serait-
ce que parce qu’il y a beaucoup de téléphones mobiles et
d’ordinateurs et une incroyable capacité à marier l’un avec
l’autre). Le marché des appareils électroniques y est le plus
important point d’importation de technologie dans le monde,
celui de plus grande échelle, le plus efficace et le plus
réactif. On rencontre dans cette ville une série d’éléments
annonciateurs de la manière dont la situation urbaine
pourrait se développer, en combinant une capacité
technologique avec une présence matérielle tout à fait
légère. On sait par ailleurs que Microsoft commence à
recruter des programmateurs nigériens, nouvelle vague de
techniciens venant après les Indiens.
FCh. Ce serait à la fois la détresse d’une grande ville
africaine et l’espoir de la globalisation.
RK. Oui, la globalisation comme issue. Paradoxalement, même
en Afrique, règne le phénomène du marché. Là aussi, il dicte
sa loi. Comme, au Nigeria, on a beaucoup dévalué la monnaie
et jamais imprimé de nouvelles coupures, chaque transaction
exige l’échange d’une liasse de billets de banque, d'un
énorme volume de papier et ces échanges rendent encore plus
tangible l'effet de marché.
FCh. Mais vous n’en tirez pas de leçons effectives pour
l’urbanisme contemporain dans d’autres régions du monde?
Entretien Rem Koolhaas, p 43
RK. Je ne sais pas encore, parce que je suis au milieu de la
recherche. Nos survols en hélicoptère nous ont permis de
mieux prendre la mesure de cette ville qui, d'un côté,
consiste en des éléments que nous reconnaissons
traditionnellement comme relevant de la ville (aéroports,
routes et autoroutes, échangeurs), mais aussi de tout autres
conditions, sans doute plus urbaines encore mais qui ne
relèvent pas des critères habituels de l’urbanité.
FCh. C'est une ville sans guère d'infrastructure, mais elle
est pourtant le support d'une intense activité, notamment
économique. Elle est faite de misère et d'excitation.
RK. J’ai découvert un endroit où cette autre condition
urbaine était particulièrement dramatique. C'est au débouché
d'une autoroute, qui se terminait dans une sorte de carrefour
labyrinthique, très dangereux (surtout le soir) comme l’est
d'ailleurs toute cette ville. Il y a neuf mois encore, ce
n'était qu'une sorte de grande décharge, avec des tas
d'ordures mêlés d'agriculture, des maisons de voleurs et de
criminels, une sorte d'interface entre le monde civilisé et
un monde d’une certaine sauvagerie. Neuf mois plus tard,
quand j'y suis revenu, cela ressemblait encore à une
décharge, mais on commençait à y repérer des éléments de tri,
de démantèlement. On découvrait que maintenant des gens y
travaillaient, en train d'affiner les différentes zones, les
différents éléments. Même au Nigeria, du fait du nouveau
régime politique, il y a une forte tendance et une capacité à
s'accrocher au monde de la globalisation et du YES. On voit
donc qu’en neuf mois, sur cette décharge, s'était établie une
manière de nouvelle condition urbaine. Parmi ce désordre
commençait à se faire jour une activité d’une grande
précision et le début d'une véritable condition organisée.
J’ai pensé qu'un changement survenu en si peu de temps était
le signe d’une énorme explosion du potentiel local.
FCh. Vous y voyez la preuve de l'efficacité des systèmes
informels, irrationnels parfois, marginaux et même illégaux.
Vieille fascination des urbanistes pour les systèmes
organiques (quasiment biologiques) et pour la capacité de
tout système à s'adapter, à se réguler. Déjà, dans les années
soixante, vos aînés admiraient pour les mêmes raisons les
urbanisations sauvages, les favellas et les bidonvilles.
RK. Les photographies aériennes montrent comment cette
évolution d'une ville plus légère peut s'imaginer, comment
peut s'établir une condition urbaine minimale. Ainsi dans une
zone de marché, le long d’une intersection routière qui
semble embouteillée et en proie à une paralysie permanente,
une paralysie non pas accidentelle, mais plutôt voulue. Il y
a là, sur le même site, une voie de chemin de fer, qui n’est
visible que lorsqu'il y passe des trains et disparaît
immédiatement quand il n'y en a pas, immédiatement noyée sous
la foule et les marchandises. C'est une utilisation du
Entretien Rem Koolhaas, p 44
terrain intensive, telle que nous ne pouvons pas l’imaginer
ici. J’ai voulu montrer ce type d'interface, de coexistence
qui est en train de s'installer là-bas et la densité humaine
qui s'y déploie. L'embouteillage apparent des véhicules est
plutôt une espèce de ralentissement, de décélération, de
mécanisme efficace qui permet le contact entre ceux qui sont
dans la rue et ceux qui sont dans les voitures. Même le
parcours du train, le plus souvent invisible, devient dès
qu’arrive le train l'interface intensif entre le monde des
voyageurs et les étals des marchands. Car tout ça, en plus,
est un marché. Tout un territoire organisé en couches : une
zone construite, une bande de marché puis une autre zone
construite, les traces du chemin de fer, la trace de bandes
de décharge avec des ordures qui brûlent, à nouveau une zone
de marché, une route, un espace de marché encore.
FCh. Mais vous considérez aussi Lagos, par-delà l'Afrique
(qu'elle soit ou non en voie de développement ou de
modernisation, la question n'est pas là), comme l'une des
plus frappantes matérialisations de la ville en devenir. Vous
prétendez en tirer des leçons pour l'urbanisme contemporain,
y compris occidental, l'un des plus ordonnés, coordonnés,
gérés qui soient.
RK. Il s'agit de comprendre qu'au Nigeria, à Lagos et dans
d'autres situations encore, pourrait apparaître une nouvelle
condition urbaine, avec cette manière d’occuper le sol,
combinée avec une capacité qui commence juste à être
alimentée par les moyens de communication mobiles et les
ordinateurs. Elle est latente, déjà prête à exploser, plus
mobile que la nôtre car elle n'a pas la responsabilité de ce
lourd héritage historique que nous sommes, dans nos cultures,
obligés de porter.
FCh. Lorsque, dans les années soixante qui étaient anti-
impérialistes, Jean-Luc Godard cadrait les deux lettres
centrales du mot Esso, il nous y donnait à lire le sigle SS.
Vous jouez, de la même façon, avec l'interprétation
sémantique du symbole des trois principales monnaies : le Y
du yen, l'E étrange de l'euro, et le S barré du dollar. À eux
trois, lorsqu'on les associe, ils composent une sorte de mot,
YES. Vous y lisez une allégorie de l'intégration économique,
Y plus E plus S égale YES, c'est-à-dire acceptation de tout,
érosion de toute idéologie, de toute résistance possible.
RK. Non. Comme les choses sont tout à fait instables, il
n’est pas inimaginable que l’idéologie puisse revenir très
vite. Il y a partout déjà des signes de ce que cette
idolâtrie du marché ne peut pas tenir indéfiniment. Je pense
que , l'idée qu'il serait définitif un mythe très efficace à
l’intérieur même du système du marché. J'ai déjà vécu quatre
périodes idéologiques dans ma vie et que je n'ai pas de
raison de croire que ça se terminera un jour. Nous avons
inventé ce régime du YES pour donner une dimension clairement
Entretien Rem Koolhaas, p 45
idéologique au système. C'est, pour le moment, quelque chose
qui définit nos paramètres, et notre marge de manœuvre.
FCh. Y a-t-il une autre langue envisageable que l'anglo-saxon
international du business, shopping, etc… et d'autres icônes
que celles des logos?
RK. Je ne sais pas si le monde devient définitivement anglo-
saxon, mais il est évident que la langue anglaise est notre
instrument commun. Que nous participons à sa dissémination
universelle. Et que cela s’accompagne, pour le moment, d’une
vague de pragmatisme qui étouffe les velléités d’expression
plus idéologique. Et aussi que cela menace, pour le moment,
l’existence d’autres cultures, minoritaires, résistantes ou
non conformes.
FCh. Quelques questions, pour conclure, qui auront un
caractère plus personnel. Vous associez à un point rare dans
le monde de l’architecture la théorie et l’ironie (parfois
même l’auto-ironie), une espèce d’arrogance et une manière
d’autodérision si je puis dire, l’utopie et le réalisme, un
ton souvent proclamateur, héroïque, et les pas d’esquive d'un
danseur. Etes-vous conscient de cette image que vous offrez?
Et ressemble-t-elle à ce que vous pensez être?
RK. Que puis-je répondre? Evidemment, je dois être comme ça
puisque c’est l'effet que je produis. Pourtant, même si tous
mes textes ne sont pas forcément objectifs ni même sincères,
même si je manipule des éléments autobiographiques dans une
espèce de dense tissu de significations, et même s’il y a une
touche d'ironie dans toutes mes actions, cela correspond à
mes diverses facettes.
FCh. Ce qui fait que votre théorie, comme toute théorie
d’ailleurs, est en partie autobiographique, et marquée par
une psychologie particulière, la vôtre.
RK. C’est un type de commentaire que vous, les critiques,
pouvez faire et auquel je peux pas répondre. Je reconnais que
les choses sont ainsi, mais je n’ai rien à ajouter parce que
je bénéficie d'une situation assez luxueuse, j’ai plein de
moyens de m’exprimer et, pour ce type de communication tout
de même assez contrôlée, je mets de côté l’expression de mon
moi.
FCh. Ce qui est intéressant, dans ces contradictions elles
aussi plus ou moins contrôlées, c’est qu’elles concernent un
individu bien sûr, vous-même, mais également une société. On
s’y reconnaît. Vous êtes emblématique du comportement que
beaucoup aimeraient avoir. Vos lectures de la réalité
précèdent celles qu'ils aimeraient avoir faites. Votre
attitude et certaines de vos ambiguïtés elles-mêmes sont
celles du moment. Elles sont historiques aussi, pas seulement
individuelles donc mais historiques. Pourquoi, dans vos
réalisations, ce désir constant de bousculer la topologie :
Entretien Rem Koolhaas, p 46
nappe imbriquée de Fukuoka, masse très pleine, évidée, du
projet pour la bibliothèque de France, structures feuilletées
du projet de Jussieu, structure pliée de l'Educatorium
d'Utrecht? C’est une approche dont vous avez été l’un des
pionniers, mais qu’on voit se répandre absolument partout. Il
faut bien que quelque chose soit à l’œuvre, à ce propos, dans
l’inconscient collectif.
RK. Je pense que, dans l’inconscient collectif, cela
représente simplement le signe d’une certaine modernité et de
retrouvailles éventuelles avec une manière fonctionnelle de
concevoir l’architecture. Quand j’entends Greg Lynn et
surtout Ben van Berkel à ce propos, ils invoquent une
architecture qui serait redevenue efficace et opérationnelle.
Moi je doute très fortement que cela marche vraiment comme
ça. Je crains que ce ne soit là qu'une espèce de retour au
fonctionnalisme, au slogan Form follows fonction.
FCh. Il y a aussi chez beaucoup d’entre eux une part
d’ivresse, d’ivresse topographique et topologique
RK. Topologique, sauf que l’ivresse est toujours justifiée
chez ces architectes par des connexions très précises et par
une analogie avec l'idée de flux. C'est une architecture de
flux, qui ne reconnaîtrait pas la qualité nécessairement
impermanente de tout flux.
FCh. Quelle est, dans votre architecture, la part de la
narration? Il y a cette phrase de Mark Taylor que vous citez
dans les marges de S,M,L,XL : "I have always wondered why
layers of a building are called stories, Je me suis toujours
demandé pourquoi les couches d'un immeuble sont appelées
étages (ou histoires, puisque c'est le même mot en anglais,
stories)".
RK. C’est ma seule affinité avec le cinéma. J’ai toujours été
frappé par l’effet de montage que donne le découpage d’un
bâtiment en étages successifs. J’ai toujours pensé que cela
correspondait exactement au même phénomène, et que l’on
pourrait imaginer de structurer un édifice en séquences, soit
prévues, soit aléatoires.
FCh. Le cinéma nous influence tous. Nous ne cessons de parler
à tout propos de flash-back, d'arrêt sur image, de fondu
enchaîné pour exprimer les moindres de nos idées, ceci que
nous soyons écrivains, philosophes, architectes ou n’importe
quoi. Beaucoup de vos propres notions sont venues du cinéma.
Sauriez-vous les décliner?
FCh. Je pense qu’il y a chez moi une influence importante du
cinéma italien des années soixante, Antonioni, Pasolini et
tout ça. Plus importante sans doute que celle du cinéma
français, parce que j'y trouvais l'exemple d’une modernité
sans illusion, et très sceptique, qui m'a toujours
extrêmement séduit.
Entretien Rem Koolhaas, p 47
FCh. Une dimension poétique ou morale, un rapport au monde?
RK. Ce sont plutôt les systèmes et les techniques internes au
cinéma, et surtout celles du montage, qui ont joué le rôle
clé. Il y a toujours en architecture une volonté de
continuité alors que le cinéma est au contraire fondé sur un
système de ruptures systématiques et intelligentes. C’est mon
affinité avec ce système de la rupture plus qu'avec
l'imaginaire de la continuité qui constitue l'essentiel de
mon engagement avec le cinéma.
FCh. Pour finir, quelques questions sur vos sources, votre
généalogie. Que devez-vous au surréalisme?
RK. Pas beaucoup de choses, sauf que, d’une certaine manière,
je ne l’aime pas. Et beaucoup de surréalistes me paraissent
profondément ennuyeux. La seule exception, c’est Salvador
Dali, comme écrivain surtout. Ce n’est pas son langage visuel
qui m’a intéressé mais sa manière d’analyser les choses qui
correspondait en même temps à une espèce de production
d’idées. Et surtout sa systématisation de la paranoïa.
FCh. La source de la paranoïa critique selon Dali, c’est la
thèse de Jacques Lacan, qui était parue l’année précédente,
en 1932. Elle a donc bien une dimension psychanalytique. Or,
vous vous n’êtes pas extrêmement mêlé à l’inconscient, à la
psychanalyse. Un peu, comme tout le monde, mais, dans vos
raisonnements, elle ne revient pas constamment.
RK. Comme tout le monde, sans plus.
FCh. La paranoïa critique, Salvador Dali la décrivait lui-
même comme un "indestructible système délirant
interprétatif". On pourrait dire que, d’une certaine façon,
votre travail est un système délirant interprétatif.
RK. Oui, New York, le delta de la Rivière des Perles,
Singapour, Lagos, tous mes sujets.
FCh. Et il avouait : "Je suis dans cette constante
interrogation : je ne sais quand je commence à simuler ou
quand je dis la vérité". N’est-ce pas d’une certaine façon ce
que vous nous disiez tout à l’heure à propos de vous-même?
Les techniques du hasardeux, du collage et du cadavre exquis
ne vous ont-elles pas marqué?
RK. Non, pas du tout.
FCh. Par exemple, dans la maison Dall’Ava, n’y a-t-il pas un
côté collage?
RK. Pas pour moi, pas du tout. Les techniques du découpage et
du montage cinématographique, sans doute, mais pas celles du
collage surréaliste. La maison de Saint-Cloud est assez
cohérente, les choses proviennent du même univers. Un aspect
de sa bizarrerie tient au règlement d’urbanisme qui était
complexe et rendait difficile d'y inscrire le volume. Nombre
Entretien Rem Koolhaas, p 48
d'aspects qui peuvent paraître bizarres sont directement
venus de cette situation.
FCh. Que devez-vous au situationnisme qui fut, en partie, un
mouvement hollandais?
RK. Il a été très influent, mais pas forcément pour moi d’une
manière explicite. Le critique hollandais Bart Lootsma vient
de publier dans le premier numéro de Hunch, la nouvelle revue
du Berlage Institute, un article qui consiste en une
relecture de mes travaux de jeunesse. J’étais à cette époque
assez critique à l’encontre de Constant et des autres, mais
évidemment, en même temps, énormément inspiré par leur
exemple. Et Lootsma a été étonné de mon ton critique à
l’égard de ce courant. Le plus important, c’est que j’ai
toujours pu combiner une critique de leurs positions avec
l'intérêt sincère que je leur portais.
FCh. C’est un de vos traits constants, critique et
fascination, critique et intérêt. Amnistie pour l’existant, y
compris dans les idées. Nous avons déjà évoqué Nietzsche.
J’ai trouvé cette phrase où Zarathoustra déclare que "toutes
choses [...] préfèrent danser sur les pieds du hasard". Il y
a chez vous comme chez Nietzsche une vision tragique du
monde, tragique et gaie, et innocente, c'est-à-dire sans
ressassement, sans ressentiment, sans négation de la vie.
Alors que nombre d'idéologies architecturales souffrent de ce
que ce philosophe reprochait au christianisme : mauvaise
conscience et culte du négatif.
Entretien Rem Koolhaas, p 49
You might also like
- LArchitecture Du Bonheur The ArchitecturDocument2 pagesLArchitecture Du Bonheur The ArchitecturEcho Utis100% (1)
- Les grands projets urbains: Territoires, acteurs et stratégiesFrom EverandLes grands projets urbains: Territoires, acteurs et stratégiesNo ratings yet
- Perspectives critiques et analyse territoriale: Applications urbaines et régionalesFrom EverandPerspectives critiques et analyse territoriale: Applications urbaines et régionalesNo ratings yet
- Mise en oeuvre d'un complexe urbain autour du périphérique.: Développement de la frange périphérique Porte des LilasFrom EverandMise en oeuvre d'un complexe urbain autour du périphérique.: Développement de la frange périphérique Porte des LilasRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (3)
- PERRET - Contribution A Une Theorie de L'architectureDocument7 pagesPERRET - Contribution A Une Theorie de L'architecturesfasdasfNo ratings yet
- T Et C Du Projet ArchP1005 ImagesDocument44 pagesT Et C Du Projet ArchP1005 ImagesluluNo ratings yet
- La ConceptionDocument210 pagesLa ConceptionSofiaProfNo ratings yet
- FERRANI Sabrina PDFDocument51 pagesFERRANI Sabrina PDFMohamed Abh100% (1)
- These Habitat Haut StandingDocument176 pagesThese Habitat Haut Standingmokhtari aminaNo ratings yet
- Cours1HA M1Arch22Document19 pagesCours1HA M1Arch22Ro FiNo ratings yet
- L'art N'est Pas L'architectureDocument16 pagesL'art N'est Pas L'architectureValeriaTellezNiemeyerNo ratings yet
- Creuser, ÉviderDocument112 pagesCreuser, ÉvidergarcieNo ratings yet
- Apologie Du Banc PublicDocument74 pagesApologie Du Banc PublicGilles MalatrayNo ratings yet
- QuentinGaucher, Architecte, Portfolio Design ParamétriqueDocument11 pagesQuentinGaucher, Architecte, Portfolio Design ParamétriquequentingaucherNo ratings yet
- Modéliser Le Processus de Conception Architecturale ÀDocument757 pagesModéliser Le Processus de Conception Architecturale ÀYasmine KaraNo ratings yet
- Bureau Greisch BrochureDocument23 pagesBureau Greisch BrochurebriankimbjNo ratings yet
- Ecozac Clichy - Parc Urbain 3ha - Dossier de Presse2007Document11 pagesEcozac Clichy - Parc Urbain 3ha - Dossier de Presse2007susCitiesNo ratings yet
- Renzo Piano - CompressedDocument13 pagesRenzo Piano - CompressedpianoNo ratings yet
- Cours 03Document53 pagesCours 03Ibtissam Ait ighoudNo ratings yet
- Analogies Et Autres CanauxDocument46 pagesAnalogies Et Autres CanauxmayarNo ratings yet
- Master 564Document115 pagesMaster 564Ikram AbdennouriNo ratings yet
- BOHLI 2015 ArchivageDocument587 pagesBOHLI 2015 ArchivageOrios KadNo ratings yet
- Architecte Durable RevueDocument11 pagesArchitecte Durable RevueKelfasNo ratings yet
- 12 Plan LibreDocument37 pages12 Plan LibreFrancisco FernandezNo ratings yet
- Conf - Architecture Bioclimatique - Presentation - 141107Document43 pagesConf - Architecture Bioclimatique - Presentation - 141107ريحانةالحنةNo ratings yet
- Les Approches Spatiales. Rapport Espace Structure 2020 PDFDocument43 pagesLes Approches Spatiales. Rapport Espace Structure 2020 PDFTouiza BelkaisNo ratings yet
- Le Metier D Architecteet L Art D EdifierDocument20 pagesLe Metier D Architecteet L Art D EdifierAlexis GonzalezNo ratings yet
- L'architecture Totalitaire. Un Monographie Du CentreDocument450 pagesL'architecture Totalitaire. Un Monographie Du CentreAnaisNo ratings yet
- Fich Nouv p124 Manuel Architecture NaturelleDocument1 pageFich Nouv p124 Manuel Architecture NaturelleMarième Sy100% (1)
- La Charte D - Athènes en DiaposDocument45 pagesLa Charte D - Athènes en Diaposarchi archNo ratings yet
- Notes VernaculaireDocument6 pagesNotes VernaculaireLEANo ratings yet
- 20220602M - Le Virtuel Comme Espace AutreDocument113 pages20220602M - Le Virtuel Comme Espace AutreTurtleNo ratings yet
- Toutes Les CivilisationDocument155 pagesToutes Les CivilisationAmine PastoreNo ratings yet
- Pages From de La Foreme Au Lieu - Pierre Von Meiss - Partial BookDocument8 pagesPages From de La Foreme Au Lieu - Pierre Von Meiss - Partial BookElton Qepali100% (1)
- Définition de L'architectureDocument16 pagesDéfinition de L'architectureMartin QuirotNo ratings yet
- Cours 1 MAU S3 Master II PDFDocument13 pagesCours 1 MAU S3 Master II PDFAmi Na100% (1)
- Projet Alejandra Pumar Silveira PDFDocument87 pagesProjet Alejandra Pumar Silveira PDFbaden baden edgarNo ratings yet
- Analyse Du Site PR Un Projet D'archiDocument78 pagesAnalyse Du Site PR Un Projet D'archiRndvan FérusNo ratings yet
- Architecture BioclimatiqueDocument2 pagesArchitecture Bioclimatique영재리No ratings yet
- La Charte D'athènes en DiaposDocument45 pagesLa Charte D'athènes en DiaposAmine Pastore100% (2)
- CM 120Document44 pagesCM 120gpsalvaNo ratings yet
- Aménagement Du Quartier de La Gare.Document34 pagesAménagement Du Quartier de La Gare.CapChateaulinNo ratings yet
- Jakob + MacfarlaneDocument141 pagesJakob + MacfarlaneБјелић ТеодораNo ratings yet
- L'analyse Architecturale Comme Préalable À La Conception Architecturale Le Site: Entre Caractéristiques de La Forme Architecturale Et Notion de LieuDocument27 pagesL'analyse Architecturale Comme Préalable À La Conception Architecturale Le Site: Entre Caractéristiques de La Forme Architecturale Et Notion de LieuabdelghaniNo ratings yet
- Simminaire Approche PaysagereDocument49 pagesSimminaire Approche Paysagereaymen bonoisNo ratings yet
- La Lumière Et Les OmbresDocument20 pagesLa Lumière Et Les OmbresMartin QuirotNo ratings yet
- THP Concepts Et Idées 1 PDFDocument72 pagesTHP Concepts Et Idées 1 PDFSaid Mazouz100% (1)
- Revision M2Document79 pagesRevision M2sabrineNo ratings yet
- Cours PUADocument9 pagesCours PUAJean Charles100% (1)
- Larchitecture VernaculaireDocument2 pagesLarchitecture VernaculaireSelma Bettahar100% (1)
- FORME URBAINE DE L'ILOT A LA BARRE - Castex PaneraiDocument201 pagesFORME URBAINE DE L'ILOT A LA BARRE - Castex PaneraiChahrazed AsliNo ratings yet
- 6 - La Forme UrbaineDocument30 pages6 - La Forme UrbaineMohamed BoutoumiNo ratings yet
- La Conception Bioclimatique - Des Maisons Confotables Et ÉconomesDocument16 pagesLa Conception Bioclimatique - Des Maisons Confotables Et ÉconomesfiNo ratings yet
- ESCALIER - Architecture Paramétrique Séance 4/12Document9 pagesESCALIER - Architecture Paramétrique Séance 4/12immaginotecaNo ratings yet
- Frampton, La Tectonique Revisitée, 2005Document4 pagesFrampton, La Tectonique Revisitée, 2005Yann OberholzerNo ratings yet
- Cours D'architecture: Idees Et Parti-PrisDocument41 pagesCours D'architecture: Idees Et Parti-PrisSophie RoussetNo ratings yet
- Dessin Thechnique TOME 3tracé Des OmbresDocument14 pagesDessin Thechnique TOME 3tracé Des OmbresAbdel ElouahidNo ratings yet
- Problematique de La FormeDocument3 pagesProblematique de La FormeRiaadh LnsNo ratings yet
- Qualités ArchitecturalesDocument138 pagesQualités ArchitecturalesNarcisse WogninNo ratings yet
- 100 Ans Durbanisme A Casablanca 1914 210Document17 pages100 Ans Durbanisme A Casablanca 1914 210Salah BoussettaNo ratings yet
- Capture D'écran . 2023-05-23 À 09.14.59Document4 pagesCapture D'écran . 2023-05-23 À 09.14.59Papis DialloNo ratings yet
- Epreuve 3Document9 pagesEpreuve 3CEG1 DASSA-ZOUMENo ratings yet
- Bac 2012Document2 pagesBac 2012MEDJDOUBNo ratings yet
- AntifongiquesDocument21 pagesAntifongiquesyousra guendouzNo ratings yet
- SVT TP 2Document3 pagesSVT TP 2manNo ratings yet
- 2 - Les PeptidesDocument15 pages2 - Les PeptidesFella Boukenaoui100% (1)
- BTEVDocument27 pagesBTEVloutrageNo ratings yet
- Fiche3 de Revision CAP Petite Enfance Le Systeme NerveuxDocument3 pagesFiche3 de Revision CAP Petite Enfance Le Systeme NerveuxsbensletenNo ratings yet
- 1-Fascicule SVT 1ère S2 IA PG-CDC Février 2020 (VF)Document77 pages1-Fascicule SVT 1ère S2 IA PG-CDC Février 2020 (VF)Mamadou Moustapha Sarr96% (351)
- Abrege Hemorragies Et ThrombosesDocument482 pagesAbrege Hemorragies Et Thrombosesfatmamegdiche8No ratings yet
- L'Insuffisance Rénale ChroniqueDocument19 pagesL'Insuffisance Rénale ChroniqueAit Elhaj SalouaNo ratings yet
- Diufral QCM Module0 Immunologie Corrige 2014 2Document4 pagesDiufral QCM Module0 Immunologie Corrige 2014 2ohamo mikelNo ratings yet
- 2° Contrôle SMPC S2 2012 2013 PDFDocument2 pages2° Contrôle SMPC S2 2012 2013 PDFAbdelah El ArabiNo ratings yet
- Swade Deadlandstheweirdwest ScnleroicoDocument6 pagesSwade Deadlandstheweirdwest ScnleroicoLaurentNo ratings yet
- Les 9 Revelations de La Prophetie Des AndesDocument7 pagesLes 9 Revelations de La Prophetie Des AndesJeremy Tomasck100% (1)
- Anal-Seq-part 2Document44 pagesAnal-Seq-part 2shooberNo ratings yet
- 101 - Alternatif Bien-Être-Fev-2015Document32 pages101 - Alternatif Bien-Être-Fev-2015Kenji OsamiNo ratings yet
- Pied Plat Valgus StatiqueDocument10 pagesPied Plat Valgus StatiquejimmyNo ratings yet
- Chapitre 10: L. LauzanneDocument22 pagesChapitre 10: L. Lauzannericci loeNo ratings yet
- Etats Généraux de La Servitude (Irresponsabilité Et Ignominie en Milieu Scientifique) Suivi de Totem Et Tabous (2005)Document42 pagesEtats Généraux de La Servitude (Irresponsabilité Et Ignominie en Milieu Scientifique) Suivi de Totem Et Tabous (2005)croquignolNo ratings yet
- Partie 1. Cours de BioCell 1ASNVDocument9 pagesPartie 1. Cours de BioCell 1ASNVايمن معطااللهNo ratings yet
- OUMBA Fabrice Parfait CVDocument6 pagesOUMBA Fabrice Parfait CVparfelieNo ratings yet
- 0541 0558 Chap24Document18 pages0541 0558 Chap24Essassi AmmarNo ratings yet
- Genie Genetique Chapitre 3Document5 pagesGenie Genetique Chapitre 3Ñoor ĒllîzzaNo ratings yet
- Mon Dc1 Bac 2017Document4 pagesMon Dc1 Bac 2017slimdamak100% (1)
- 2014LEMA1017Document249 pages2014LEMA1017Rahma HosniNo ratings yet
- Programme 2eme Annee Medecine DentaireDocument25 pagesProgramme 2eme Annee Medecine Dentaireasoase100% (1)
- Tumeurs AppendiculairesDocument5 pagesTumeurs AppendiculairesDjallal HassaniNo ratings yet