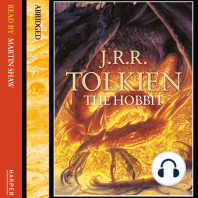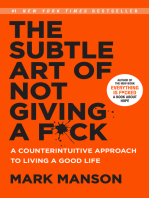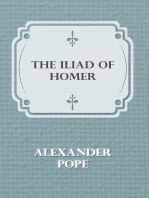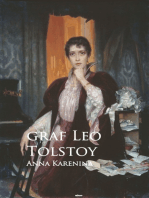Professional Documents
Culture Documents
Cadres Sociaux Memoire
Uploaded by
Mónica FranchCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Cadres Sociaux Memoire
Uploaded by
Mónica FranchCopyright:
Available Formats
Maurice HALBWACHS (1925)
LES CADRES SOCIAUX DE LA MMOIRE
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay, bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
Maurice Halbwachs (1925)
Les cadres sociaux de la mmoire.
Une dition lectronique ralise partir du livre de Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire. Paris : Flix Alcan, 1925. Collection Les Travaux de lAnne sociologique. Paris : Les Presses universitaires de France, Nouvelle dition, 1952, 299 pages. Collection Bibliothque de philosophie contemporaine. Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times, 12 points. Pour les citations : Times 10 points. Pour les notes de bas de page : Times, 10 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11) dition complte le 19 juillet 2002 Chicoutimi, Qubec.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Table des matires
Avant-propos Chapitre I. - Le rve et les souvenirs-images i Nous ne pouvons pas voquer en rve des scnes compltes ou des tableaux dtaills de notre vie d'autrefois ii Diffrence entre les cadres de la pense de la veille et du rve iii La mmoire ne fait pas revivre le pass, mais elle le reconstruit iv Rsum de cette analyse Chapitre II. - Le langage et la mmoire i Sous quelle forme les cadres de la pense sociale pntrent dans le rve : le temps et l'espace ii Le rle du langage dans le rve iii L'aphasie et l'intelligence. Les expriences de Head sur les troubles de la pense conventionnelle chez les aphasiques iv En rsum. Chapitre III. - La reconstruction du pass i ii iii iv La dformation des souvenirs d'enfance chez les adultes Les cadres de la pense et de la mmoire chez l'enfant et chez l'homme Comment les cadres de la mmoire permettent de reconstituer les souvenirs La mmoire chez les vieillards et la nostalgie du pass
Chapitre IV. - La localisation des souvenirs i La reconnaissance et la localisation des souvenirs. Le rle du raisonnement dans la localisation. Les points de repre collectifs ii Vivacit et familiarit des souvenirs les plus rcents. Pourquoi nous les retenons presque tous iii L'association des ides et la localisation, Les divers groupes collectifs sont les supports d'autant de mmoires collectives Chapitre V. - La mmoire collective de la famille i Les cadres de la vie collective et les souvenirs de famille ii La famille et le groupe religieux. La famille et le groupe paysan. Nature spcifique des sentiments de famille iii Les rapports de parent et l'histoire de la famille. Les prnoms iv La cration de familles nouvelles. La famille et les autres groupes
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Chapitre VI. - La mmoire collective des groupes religieux i La religion est la reproduction mythique de l'histoire primitive des peuples. Les vestiges des anciennes croyances subsistent dans les religions nouvelles ii En quel autre sens la religion est une commmoration du pass. La religion chrtienne et la passion du Christ. La socit chrtienne primitive. L'glise et le sicle. Clercs et laques iii La tradition dogmatique de lglise et les courants mystiques iv En rsum Chapitre VII. - Les classes sociales et leurs traditions i Le systme des valeurs nobiliaires et les traditions des familles nobles. Titres et fonctions. Noblesse de race et noblesse de robe ii Vie professionnelle et vie sociale. Dans quelle partie du corps social se transmettent les traditions de classe. Mmoire des fonctions et des fortunes. L'apprciation sociale de la richesse. Classe bourgeoise traditionnelle et riches progressifs iii Zone de l'activit technique et zone des relations personnelles. Technique et fonction Conclusion i Perception et souvenirs collectifs. Les cadres sociaux de la mmoire ii Les souvenirs collectifs sont la fois des notions gnrales et des reprsentations de faits et de personnes iii La mmoire et la raison. Les traditions et les ides
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Avant-propos
Retour la table des matires
Comme nous feuilletions, dernirement, un ancien volume: du Magasin pittoresque, nous y avons lu une histoire singulire, celle d'une jeune fille de 9 ou 10 ans qui fut trouve dans les. bois, prs de Chlons, en 1731. On ne put savoir o elle tait, ne, ni d'o elle venait. Elle n'avait gard aucun souvenir de son enfance. En rapprochant les dtails donns par elle aux diverses poques de sa vie, on supposa qu'elle tait ne dans le nord de l'Europe et probablement chez les Esquimaux, que de l elle avait t transporte aux Antilles, et enfin en France. Elle assurait qu'elle avait deux fois travers de larges tendues de mer, et paraissait mue quand on lui montrait des images qui reprsentaient soit des huttes et des barques du pays des Esquimaux, soit des phoques, soit des cannes sucre et d'autres produits des les d'Amrique. Elle croyait se rappeler assez clairement qu'elle avait appartenu comme esclave une matresse qui l'aimait beaucoup, mais que le matre, ne pouvant la souffrir, l'avait fait embarquer 1. Si nous reproduisons ce rcit, dont nous ne savons s'il est authentique, et que nous ne connaissons que de seconde main, c'est parce qu'il permet de comprendre en quel sens on peut dire que la mmoire dpend de l'entourage social. 9 ou 10 ans, un
1
Magasin Pittoresque, 1849, p. 18. Comme rfrences, l'auteur nous dit : On crivit son sujet un article dans le Mercure de France, septembre 173. (le dernier chiffre en blanc), et un petit opuscule en 1755 (dont il ne nous indique pas le titre) auquel nous avons emprunt ce rcit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
enfant possde beaucoup de souvenirs, rcents et mme assez anciens. Que lui en resterait-il, s'il tait brusquement spar des siens, transport dans un pays o on ne parle pas sa langue, o ni dans l'aspect des gens et des lieux, ni dans les coutumes, il ne retrouverait rien de ce qui lui tait familier jusqu' ce moment ? L'enfant a quitt une socit pour passer dans une autre. Il semble que, du mme coup, il ait perdu la facult de se souvenir dans la seconde de tout ce qu'il a fait, de tout ce qui l'a impressionn, et qu'il se rappelait sans peine, dans la premire. Pour que quelques souvenirs incertains et incomplets reparaissent, il faut que, dans la socit o il se trouve prsent, on lui montre tout au moins des images qui reconstituent un moment autour de lui le groupe et le milieu d'o il a t arrach. Cet exemple n'est qu'un cas limite. Mais si nous examinions d'un peu plus prs de quelle faon nous nous souvenons, nous reconnatrions que, trs certainement, le plus grand nombre de nos souvenirs nous reviennent lorsque nos parents, nos amis, ou d'autres hommes nous les rappellent. On est assez tonn lorsqu'on lit les traits de psychologie o il est trait de la mmoire, que l'homme y soit considr comme un tre isol. Il semble que, pour comprendre nos oprations mentales, il soit ncessaire de s'en tenir l'individu, et de sectionner d'abord tous les liens qui le rattachent la socit, de ses semblables. Cependant c'est dans la socit que, normalement, l'homme acquiert ses souvenirs, qu'il se les rappelle, et, comme on dit, qu'il les reconnat et les localise. Comptons, dans une journe, le nombre de souvenirs que nous avons voqus l'occasion de nos rapports directs et indirects avec d'autres hommes. Nous verrons que, le plus souvent, nous ne faisons appel notre mmoire que pour rpondre des questions que les autres nous posent, ou que nous supposons qu'ils pourraient nous poser, et que d'ailleurs, pour y rpondre, nous nous plaons leur point de vue, et nous nous envisageons comme faisant partie du mme groupe ou des mmes groupes qu'eux. Mais pourquoi ce qui est vrai d'un grand nombre de nos souvenirs ne le serait-il pas de tous ? Le plus souvent, si je me souviens, c'est que les autres m'incitent me souvenir, que leur mmoire vient au secours de la mienne, que la mienne s'appuie sur la leur. Dans ces cas au moins, le rappel des souvenirs n'a rien de mystrieux. Il n'y a pas chercher o ils sont, o ils se conservent, dans mon cerveau, ou dans quelque rduit de mon esprit o j'aurais seul accs, puisqu'ils me sont rappels du dehors, et que les groupes dont je fais partie m'offrent chaque instant les moyens de les reconstruire, condition que je me tourne vers eux et que j'adopte au moins temporairement leurs faons de penser. Mais pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans tous les cas ? C'est en ce sens qu'il existerait une mmoire collective et des cadres sociaux de la mmoire, et c'est dans la mesure o notre pense individuelle se replace dans ces cadres et participe cette mmoire qu'elle serait capable de se souvenir. On comprendra que notre tude s'ouvre par un et mme deux chapitres consacrs au rve 1, si l'on remarque que l'homme qui dort se trouve pendant quelque temps dans un tat d'isolement qui ressemble, au moins en partie, celui o il vivrait s'il n'tait en contact et en rapport avec aucune socit. A ce moment, il n'est plus capable et il n'a plus besoin d'ailleurs de s'appuyer sur ces cadres de la mmoire collective, et il est passible de mesurer l'action de ces cadres, en observant ce que devient la mmoire individuelle lorsque cette action ne s'exerce plus.
Le premier chapitre, qui a t le point de dpart de notre recherche, a paru sous forme d'article, peu prs tel que nous le reproduisons, dans la Revue philosophique, en janvier-fvrier 1923.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Mais, lorsque nous expliquions ainsi la mmoire d'un individu par la mmoire des autres, ne tournions-nous pas dans un cercle ? Il fallait, en effet, expliquer alors comment les autres se souviennent, et le mme problme semblait se poser de nouveau, dans les mmes termes. Si le pass reparat, il importe fort peu de savoir s'il reparat dans ma conscience, ou dans d'autres consciences. Pourquoi reparat-il ? Reparatrait-il, s'il ne se conservait pas ? Ce n'est point apparemment sans raison que, dans la thorie classique de la mmoire, aprs l'acquisition des souvenirs on tudie leur conservation, avant de rendre compte de leur rappel. Or, si l'on ne veut pas expliquer la conservation des souvenirs par des processus crbraux (explication, en effet, assez obscure et qui soulve de grosses objections), il semble bien qu'il n'y ait pas d'autre alternative que d'admettre que les souvenirs, en tant qu'tats psychiques, subsistent dans l'esprit l'tat inconscient, pour redevenir conscients lorsqu'on se les rappelle. Ainsi, le pass ne se dtruirait et ne disparatrait qu'en apparence. Chaque esprit individuel tranerait derrire lui toute la suite de ses souvenirs. On peut admettre maintenant, si l'on veut, que les diverses mmoires s'entr'aident et se prtent mutuellement secours. Mais ce que nous appelons les cadres collectifs de la mmoire ne seraient que le rsultat, la somme, la combinaison des souvenirs individuels de beaucoup de membres d'une mme socit. Ils serviraient, peut-tre, les mieux classer aprs coup, situer les souvenirs des uns par rapport ceux des autres. Mais ils n'expliqueraient point la mmoire elle-mme, puisqu'ils la supposeraient. L'tude du rve nous avait apport dj des arguments trs srieux contre la thse de la subsistance des souvenirs l'tat inconscient. Mais il fallait montrer qu'en dehors du rve, le pass, en ralit, ne reparat pas tel quel, que tout semble indiquer qu'il ne se conserve pas, mais qu'on le reconstruit en partant du prsent 1. Il fallait montrer, d'autre part, que les cadres collectifs de la mmoire ne sont pas constitus aprs coup par combinaison de souvenirs individuels, qu'ils ne sont pas non plus de simples formes vides o les souvenirs, venus d'ailleurs, viendraient s'insrer, et qu'ils sont au contraire prcisment les instruments dont la mmoire collective se sert pour recomposer une image du pass qui s'accorde chaque poque avec les penses dominantes de la socit. C'est cette dmonstration que sont consacrs les 3e et 4e chapitres de ce livre, qui traitent de la reconstruction du pass, et de la localisation des souvenirs. Aprs cette tude, en bonne partie critique, et o nous posions cependant les bases d'une thorie sociologique de la mmoire, il restait envisager directement et en ellemme la mmoire collective. Il ne suffisait pas en effet de montrer que les individus, lorsqu'ils se souviennent, utilisent toujours des cadres sociaux. C'est au point de vue du groupe, ou des groupes qu'il fallait se placer. Les deux problmes d'ailleurs non seulement sont solidaires, mais n'en, font qu'un. On peut dire aussi bien que l'individu se souvient en se plaant au point de vue du groupe, et que la mmoire du groupe se ralise et se manifeste dans les mmoires individuelles. C'est pourquoi, dans les 3 derniers chapitres, nous avons trait de la mmoire collective ou des traditions de la famille, des groupes religieux, et des classes sociales. Certes, il existe d'autres soci1
Bien entendu, nous ne contestons nullement que nos impressions ne durent quelque temps et quelquefois longtemps aprs qu'elles se sont produites. Mais cette rsonance des impressions ne se confond pas du tout avec ce qu'on entend communment par la conservation des souvenirs. Elle varie d'individu individu, comme, sans doute, d'espce espce, en dehors de toute influence sociale. Elle relve de la psycho-physiologie, qui a son domaine, comme la psychologie sociologique a le sien.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
ts encore, et d'autres formes de mmoire sociale. Mais, obligs de nous limiter, nous nous en sommes tenus celles qui nous paraissaient les plus importantes, celles aussi dont nos recherches antrieures nous permettaient le mieux d'aborder l'tude. C'est sans doute pour cette dernire raison que notre chapitre sur les classes sociales dpasse les autres en tendue. Nous y avons retrouv, et essay d'y dvelopper quelques ides que nous avions exprimes ou entrevues ailleurs.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
Chapitre I
Le rve et les images-souvenirs
Retour la table des matires
Bien souvent, dit Durkheim 1, nos rves se rapportent des vnements passs ; nous revoyons ce que nous avons vu ou fait l'tat de veille, hier, avant-hier, pendant notre jeunesse, etc. ; et ces sortes de rves sont frquents et tiennent une place assez considrable dans notre vie nocturne. Il prcise, dans la suite, ce qu'il entend par rves se rapportant des vnements passs : il s'agit de remonter le cours du temps , d' imaginer qu'on a vcu pendant son sommeil une vie qu'on sait coule depuis longtemps , et, en somme, d'voquer des souvenirs comme on en a pendant le jour, mais d'une particulire intensit . Au premier abord, cette remarque ne surprend point. En rve, les tats psychologiques les plus divers, les plus compliqus, ceux-l mmes qui supposent de l'activit, une certaine dpense d'nergie spirituelle, peuvent se prsenter. Pourquoi, aux rflexions, aux motions, aux raisonnements, ne se mlerait-il pas des souvenirs ? Pourtant, lorsqu'on examine les faits de plus prs, cette proposition parat moins vidente. Demandons-nous si, parmi les illusions de nos rves, s'intercalent des souvenirs que nous prenons pour des ralits. A cela on rpondra peut-tre que toute la matire
1
Les formes lmentaires de la vie religieuse, p. 79.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
10
de nos rves provient de la mmoire, que les songes sont prcisment des souvenirs que nous ne reconnaissons pas sur le moment, mais que, dans beaucoup de cas, il est possible au rveil d'en retrouver la nature et l'origine. Nous le croyons sans peine. Mais ce qu'il faudrait tablir (et c'est bien ce qui est affirm dans le passage que nous avons cit), c'est que des vnements complets, des scnes entires de notre pass se reproduisent dans le rve tels quels, avec toutes leurs particularits, sans aucun mlange d'lments qui se rapportent d'autres vnements, d'autres scnes, ou qui soient purement fictifs, si bien qu'au rveil nous puissions dire, non pas seulement : ce rve s'explique par ce que j'ai fait ou vu dans telles circonstances, mais : ce rve est le souvenir exact, la reproduction pure et simple de ce que j'ai fait ou vu tel moment et en tel lieu. C'est cela, et cela seulement que peut signifier : remonter le cours du temps et revivre une partie de sa vie. Mais ne sommes-nous pas trop exigeants ? Et, pos en ces termes, le problme ne se rsout-il pas aussitt par l'absurde, ou plutt ne se pose-t-il mme pas, tant la solution en est vidente ? Si l'on voquait en rve des souvenirs ce point circonstancis, comment ne les reconnatrait-on pas, pendant le rve mme ? Alors l'illusion tomberait aussitt, et l'on cesserait de rver. Mais supposons que telle scne passe se reproduise, avec quelques changements trs faibles, juste assez importants pour que nous ne soyons pas mis en dfiance. Le souvenir est l, souvenir prcis et concret ; mais il y a comme une activit latente de l'esprit qui intervient pour le dmarquer, et qui est comme une dfense inconsciente du rve contre le rveil. Par exemple, je me vois devant une table autour de laquelle sont des jeunes gens : l'un parle ; mais, au lieu d'un tudiant, c'est un de mes parents, qui n'a aucune raison de se trouver l. Ce simple dtail suffit pour m'empcher de rapprocher ce rve du souvenir dont il est la reproduction. Mais n'aurai-je pas le droit, au rveil, et quand j'aurai fait ce rapprochement, de dire que ce rve n'tait qu'un souvenir ? Cela revient dire que nous ne pourrions revivre notre pass dans le sommeil sans le reconnatre, et qu'en fait tout se passe comme si nous reconnaissions d'avance ceux de nos rves qui ne sont ou tendent n'tre que des souvenirs raliss, puisque nous les modifions inconsciemment afin d'entretenir notre illusion. Mais d'abord pourquoi un souvenir, mme vaguement reconnu, nous rveillerait-il ? Il y a bien des cas o, tout en continuant rver, on a le sentiment qu'on rve, et mme il y en a o l'on recommence plusieurs fois, intervalles de veille plus ou moins longs, exactement le mme rve, si bien qu'au moment o il reparat on a vaguement conscience que ce n'est qu'une rptition : et pourtant on ne se rveille pas. D'autre part, est-il vraiment inconcevable qu'un souvenir proprement dit, qui reproduit une partie de notre pass en son intgralit, soit voqu sans que nous le reconnaissions ? La question est de savoir si, en fait cette dissociation entre le souvenir et la reconnaissance se ralise : le rve pourrait tre cet gard une exprience cruciale , si elle nous rvlait que le souvenir -non reconnu se produit quelquefois pendant le sommeil. Il y a au moins une conception de la mmoire d'o il rsulterait que le souvenir peut se reproduire sans tre reconnu. Supposons que le pass se conserve sans changement et sans lacunes au -fond de la mmoire, c'est--dire qu'il nous soit possible tout instant de revivre n'importe quel vnement de notre vie. Certains seulement d'entre ces souvenirs reparatront pendant la veille ; comme, au moment o nous les voquerons, nous resterons en contact avec les ralits du prsent, nous ne pourrons point ne pas y reconnatre des lments de notre pass. Mais, pendant le sommeil, alors que ce contact est interrompu, supposons que les souvenirs envahissent notre conscience : comment les reconnatrions-nous comme des souvenirs ? Il n'y a plus de prsent auquel nous puissions les opposer; puisqu'ils sont le pass non pais tel qu'on le revoit distance mais
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
11
tel qu'il s'est droul lorsqu'il tait le prsent, il n'y a rien en eux qui rvle qu'ils ne se prsentent pas nous pour la premire fois . - Ainsi rien ne s'oppose, thoriquement, ce que des souvenirs exercent sur nous une sorte d'action hallucinatoire pendant le sommeil, sans qu'ils aient besoin, pour ne pas tre reconnus, de se masquer ou de se dfigurer. * ** I-i
Retour la table des matires
Depuis un peu plus de quatre annes (exactement depuis janvier 1920) nous avons examin nos rves du point de vue qui nous intresse, c'est--dire afin de dcouvrir s'ils contenaient des scnes compltes de notre pass. Le rsultat a t nettement ngatif. Il nous a t possible, le plus souvent, de retrouver telle pense, tel sentiment, telle attitude, tel dtail d'un vnement de la veille qui tait entr dans notre rve, mais jamais nous n'avons ralis en rve un souvenir. Nous nous sommes adress quelques personnes qui s'taient exerces observer leurs visions nocturnes. M. Kaploun nous a crit : Il n'est jamais arriv que je rve toute une scne vcue. En rve, la part d'additions et de modifications dues au fait que le rve est une scne qui se tient, est considrablement plus grande que la part d'lments puiss dans le rel vcu rcemment, Ou, si l'on veut, dans le rel d'o sont tirs les lments intgrs dans la scne rve. D'une lettre que nous a adresse M. Henri Piron, nous dtachons ce passage : Je n'ai pas, dans mes rves - que j'ai nots systmatiquement pendant une priode - revcu des priodes de vie de la veille sous une forme identique: j'ai retrouv parfois des sentiments, des images, des pisodes plus ou moins modifis, sans plus. M. Bergson nous a dit qu'il rvait beaucoup, et qu'il ne se rappelait aucun cas o il et, au rveil, reconnu dans un de ses rves ce qu'il appelle un souvenir-image. Il a ajout, toutefois, qu'il avait eu parfois le sentiment que, dans le sommeil profond, il tait redescendu dans son pass : nous reviendrons plus tard sur cette rserve. Nous avons lu, enfin, le plus grand nombre qu'il nous a t possible de descriptions de rves, sans y rencontrer exactement ce que nous cherchions. Dans un chapitre sur la Litteratur des problmes du rve 1 Freud crit : Le rve ne reproduit que des fragments du pass. C'est la rgle gnrale. Toutefois il y a des exceptions : un rve peut reproduire un vnement aussi exactement (vollstndig) que la mmoire pendant la veille. Delboeuf nous parle d'un de ses collgues d'Universit (actuellement professeur Vienne) : celui-ci, en rve, a refait une dangereuse excursion en voiture dans laquelle il n'a chapp un accident que par miracle : tous les dtails s'y trouvaient reproduits. Miss Calkins mentionne deux rves qui reproduisaient exactement un vnement de la veille, et moi-mme j'aurai l'occasion de citer un exemple que je connais de la reproduction exacte en rve d'un vnement de l'enfance. Freud ne parat avoir observ directement aucun rve de ce genre.
Die Traumdeutung, ire dit., 1900, p. 13.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
12
Examinons ces exemples. Voici comment Delbuf rapporte le rve qui lui a t racont par son ami et ancien collgue, le clbre chirurgien Gussenbauer, depuis professeur l'Universit de Prague 1. Il avait un jour parcouru en voiture une route qui relie deux localits dont j'ai oubli les noms qui, en un certain passage, prsente une pente rapide et une courbe dangereuse. Le cocher ayant fouett trop vigoureusement les chevaux, ceux-ci s'emportrent, et voiture et voyageur manqurent 100 fois de rouler dans un prcipice, ou de se briser contre les rochers qui se dressaient de l'autre ct du chemin. Dernirement M. Gussenbauer rva qu'il refaisait le mme trajet, et, arriv cet endroit, il se rappela dans ses moindres dtails l'accident dont il avait failli tre victime. Il rsulte de ce texte que Freud l'a trs mal compris, ou en a gard un souvenir inexact : car le professeur en question refait sans doute en rve le mme trajet (il ne nous dit pas d'ailleurs s'il est en voiture, dans la mme voiture, etc.), mais non la mme excursion o il chapperait de nouveau au mme accident. Il se borne, en rve, se rappeler l'accident, une fois arriv au lieu o il s'est produit. Or, c'est tout autre chose que de rver qu'on se souvient d'un vnement de la veille, et de se retrouver, en rve, dans la mme situation, d'assister ou de participer aux mmes vnements que quand on tait veill. Cette confusion est au moins trange. Nous pouvons substituer cet exemple celui-ci qui est rapport par Foucault, galement de seconde main, et que Freud ne pouvait d'ailleurs connatre 2. Il s'agit d' un mdecin qui, ayant t trs affect par une opration o il a d tenir les jambes du patient auquel on ne pouvait administrer le chloroforme, revoit pendant une vingtaine de nuits le mme vnement: Je voyais le corps pos sur une table et les mdecins comme au moment de l'opration. Aprs le rveil l'image restait dans l'esprit, non pas hallucinatoire, mais encore extrmement vive. A peine commenait-il s'endormir que la mme vision le rveillait. L'image revenait aussi quelquefois dans la journe, mais elle tait alors moins vive. Le tableau imaginatif tait toujours le mme, et prsentait un souvenir exact de l'vnement. Enfin l'obsession cessa de se produire. On peut se demander si le fait en question, aprs le moment o il s'est produit, et avant qu'on l'ait revu en rve pour la premire fois, ne s'est pas impos assez fortement la pense du sujet pour que se substitue au souvenir une image peut-tre reconstruite en partie, si bien que nous n'avons plus affaire l'vnement lui-mme, mais une ou plusieurs reproductions successives de l'vnement qui ont pu alimenter quelque temps l'imagination de celui qui le revoit plus tard en songe. Du moment, en effet, qu'un souvenir s'est reproduit plusieurs fois, il n'appartient plus la srie chronologique des vnements qui n'ont eu lieu qu'une fois ; ou plutt, ce souvenir (en admettant qu'il subsiste tel quel dans la mmoire) se superposent une ou plusieurs reprsentations, mais celles-ci ne correspondent plus un vnement qu'on n'a vu qu'une fois, puisqu'on l'a revu plusieurs fois en pense. C'est ainsi qu'il y a lieu de distinguer du souvenir d'une personne, vue en un lieu et un moment dtermine, l'image de cette personne, telle que l'imagination a pu la reconstruire (si on ne l'a pas revue), ou telle qu'elle rsulte de plusieurs souvenirs successifs de la mme personne. Une telle image peut reparatre en rve, sans qu'on puisse dire qu'on voque alors un souvenir proprement dit.
1 2
DELBUF, Le sommeil et les rves, Revue philosophique, 1880, p. 640. FOUCAULT, Le rve, tudes et observations, Paris, 1906, p. 210.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
13
Nous pouvons rapprocher de cette observation. celle que rapporte Brierre de Boismont, d'aprs Abercrombie 1. Un de mes amis, dit Abercrombie, employ dans une des principales banques de Glasgow en qualit de caissier, tait son bureau, lorsqu'un individu se prsenta, rclamant le paiement d'une somme de 6 livres sterling. Il y avait plusieurs personnes avant lui qui attendaient leur tour; mais il tait si bruyant et surtout si insupportable par son bgayement qu'un des assistants pria le caissier de le payer pour qu'on en ft dbarrass. Celui-ci fit droit la demande avec un geste d'impatience et sans prendre note de cette affaire [au lieu de ce dernier membre de phrase, il y a dans Abercrombie : et ne pensa plus, cette affaire]. A la fin de l'anne, c'est--dire huit ou lieu mois aprs, la balance des livres ne put tre tablie; il s'y trouvait toujours une erreur de 6 livres. Mon ami passa inutilement plusieurs nuits et plusieurs jours chercher la cause de ce dficit ; vaincu par la fatigue, il revint chez lui, se mit au lit, et rva qu'il tait son bureau, que le bgue se prsentait, et bientt tous les dtails de cette affaire se retracrent fidlement, son esprit. Il se rveille la pense pleine de son rve, et avec l'esprance qu'il allait dcouvrir ce qu'il cherchait si inutilement. Aprs, avoir examin ses livres, il reconnut en effet que cette somme n'avait point t porte sur son journal et qu'elle rpondait exactement l'erreur. Voil tout ce que dit B. de B... Or, nous reportant au -texte d'Abercrombie, nous voyons que ce que l'auteur trouve surtout extraordinaire, c'est que le caissier ait pu se rappeler en rve un dtail qui n'avait laiss sur le moment aucune impression dans son esprit, et qu'il n'avait pas mme remarqu, savoir qu'il n'avait pas. inscrit le paiement. Mais voici ce qui a pu se passer. Le caissier, les jours prcdant le rve, s'est rappel cette scne qui l'avait frapp : le souvenir, souvent voqu, auquel il a plusieurs fois rflchi, est devenu une simple image. Il a d supposer, d'autre part qu'il avait nglig d'inscrire un paiement. Il est naturel que cette image, et cette supposition qui le proccupait, se soient rejointes dans le rve. Mais ni l'une, ni l'autre n'taient proprement des. souvenirs. Cela n'explique pas, videmment, que le fait ainsi imagin en rve ait t reconnu, exact. Mais il y a des hasards plus tranges., Quant l'observation de Miss Calkins 2 elle est directe. Mais tout ce qu'elle nous en dit se rduit ceci : C. (c'est elle qui se dsigne ainsi) rva deux fois le dtail, exact d'un vnement qui prcdait immdiatement (le rve). C'est un cas de l'espce la plus simple d'imagination mcanique. Elle ajoute, en note, il est vrai : il est inexact de l'appeler, comme fait Maury, souvenir ignor , on: mmoire... non consciente . La mmoire se distingue de l'imagination en ce que l'vnement est rapport consciemment au pass et au moi. Mais ne discutons pas des termes et des dfinitions. Ce qui importe, c'est que les rves auxquels il est fait allusion sont bien ceux que nous avons recherchs en vain jusqu'ici. Malheureusement, aucun d'eux ne nous est dcrit. C'est d'autant plus regrettable que cette enqute a port, en peu de temps, sur un grand nombre de rves. Miss Calkins a pris des notes pendant cinquante-cinq nuits, sur 205 rves, raison de prs de 4 rves par nuit ; le second observateur, S.... a observ, pendant quarante-six nuits, 170 rves, sans en noter du mme genre que ceux qui nous occupent. L'enqute a dur de six , huit sen-laines. De telles conditions sont quelque peu anormales. Il faudrait d'ailleurs que nous sachions, d'une part, ce que Miss Calkins entend par le dtail exact d'un vnement , d'autre part en quoi consistait l'vnement qui prcdait, et enfin s'il n'y a eu rellement aucun intervalle entre l'vnement et la nuit o elle a rv.
BRIERRE DE BOISMONT, dans son livre, Des hallucinations (3e dit., 1852, p. 259) d'aprs ABERCROMBIE, Inquiries concerning the intellectual powers, 11e dit., London, 1841 (la 1re dit. est de 1830). Nous n'avons pu consulter que la 12e dit. The American Journal of Psychology, vol. V, 1893, p. 323, Statistics of dreams.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
14
Il reste le rve dont Freud a eu connaissance. Il n'indique point la page de son livre o il est rapport. Celui-l seul, parmi tous ceux qu'il a dcrits, correspond peu prs ce qu'il laisse prvoir : un de ses collgues lui raconta qu'il avait vu en rve, peu de temps auparavant, son ancien prcepteur en une attitude inattendue. Il tait couch auprs d'une servante (qui tait demeure la maison jusqu' ce que ce collgue et eu 11 ans). L'endroit o se passait la scne apparaissait en rve. Le frre du rveur, plus g, lui confirma la ralit de ce que celui-ci avait vu en songe. Il en possdait un souvenir net, car il avait alors 6 ans. Le couple lui faisait boire de la bire pour l'enivrer, et ne se proccupait pas du plus petit, g de 3 ans, qui dormait cependant dans la chambre de la servante 1. Freud ne nous indique pas si cette reprsentation, tait un souvenir dfini qui se rapportait une nuit dtermine, un vnement dont le rveur n'avait t tmoin qu'une fois, ou plutt une association d'ides d'un caractre plus gnral. Il ne dit point, cette fois, que la scne se soit reproduite dans tous ses dtails. Le fait, s'il est exact, n'en est pas moins intressant. On peut le rapprocher d'exemples du mme genre, pris chez d'autres auteurs. Maury raconte ceci 2 : J'ai pass mes premires annes Meaux, et je me rendais souvent dans un village voisin nomm Trilport. Son pre y construisait un pont. Une nuit, je me trouve en rve transport aux jours de mon enfance, et jouant dans ce village de Trilport. Il y voit un homme qui porte un uniforme, et qui lui dit son nom. Au rveil, il n'a aucun souvenir qui se rattache ce nom. Mais il interroge une vieille domestique, qui lui apprend que c'tait bien ainsi que s'appelait le gardien du pont que son pre a bti. - Un de ses amis lui a racont que, sur le point de retourner Montbrison, o il avait vcu, enfant, vingt-cinq ans plus tt, il rva qu'il rencontrait prs de cette ville un inconnu, qui lui dit qu'il tait un ami de son pre, et s'appelait T... Le rveur savait qu'il avait connu quelqu'un de ce nom, mais ne se rappelait pas son aspect: il retrouva effectivement cet homme, semblable l'image de son rve, encore qu'un peu vieilli. Hervey de Saint-Denis 3 raconte qu'une nuit il se vit en rve Bruxelles, en face de l'glise de Sainte-Gudule. Je me promenais tranquillement, parcourant une rue des plus vivantes, borde de nombreuses boutiques dont les enseignes bigarres allongeaient leurs grands bras au-dessus des passants. Comme il sait qu'il rve, et qu'il se souvient, en rve, de n'avoir jamais t Bruxelles, il se met examiner avec une attention extrme l'une des boutiques, afin d'tre en mesure de la reconnatre plus tard. Ce fut celle d'un bonnetier... J'y remarquai d'abord pour enseigne deux bras croiss, l'un rouge, et l'autre blanc, faisant saillie sur la rue, et surmonts en guise de couronne d'un norme bonnet de coton ray. Je lus plusieurs fois le nom du marchand afin de le bien retenir ; je remarquai le numro de la maison, ainsi que la forme ogivale d'une petite porte, orne son sommet d'un chiffre enlac. Quelques mois aprs il visite Bruxelles, et y cherche en vain la rue des enseignes multicolores et de la boutique rve . Plusieurs annes s'coulent. Il se trouve Francfort o il tait all dj durant ses plus jeunes ans . Il entre dans la Judengasse. Tout un ensemble d'indfinissables rminiscences commena vaguement s'emparer de mon esprit. Je m'efforai de dcouvrir la cause de cette impression singulire. Et il se rappelle alors ses inutiles recherches Bruxelles. La rue o il se trouve est bien la rue de son rve : mmes enseignes capricieuses, mme publie, mme mouvement.
1 2 3
FREUD, op. cit., p. 129. Le sommeil et les rves, 4e dition, 1878, p. 92. Les rves et les moyens de les diriger, Paris, 1867, p. 27.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
15
Il dcouvre la maison, si exactement pareille celle de mon ancien rve qu'il me semblait avoir fait un retour de 6 ans en arrire et ne m'tre point encore veill . Tous ces rves ont un caractre commun ; il s'agit de souvenirs d'enfance, entirement oublis depuis un temps indtermin, et que nous ne pouvons pas ressaisir pendant la veille, mme aprs que le rve les a voqus ; ils reviennent, mls nos songes, et il faut nous aider de la mmoire des autres, ou nous livrer une enqute et une vrification objective, pour constater qu'ils correspondent bien des ralits anciennement perues. Or, sans doute, ce ne sont pas des scnes compltes qui reparaissent, mais un nom, un visage, le tableau d'une rue, d'une maison. Tout cela ne fait cependant point partie de notre exprience familire, des souvenirs que nous ne nous tonnons pas de retrouver, l'tat de fragments, dans nos songes, parce qu'ils sont rcents, ou parce que nous savons qu'veills nous possdons sur eux une certaine prise, parce qu'en somme il y a toutes raisons pour qu'ils entrent dans les produits de notre activit imaginative. Au contraire, il faudrait admettre que les souvenirs de notre enfance se 'sont strotyps, qu'ils sont, ds le dbut, et demeurent, comme dit Hervey de SaintDenis, des clichs-images, dont notre conscience n'a plus rien connu partir du moment o ils se sont gravs sur les tablettes de notre mmoire . Comment contester que, dans les cas o ils reparaissent, c'est bien une partie, une parcelle de notre plus lointain pass qui remonte la surface ? Nous ne sommes pas convaincus que ces rminiscences d'enfance correspondent bien ce que nous appelons des souvenirs. Si nous ne nous rappelons rien de cette priode l'tat de veille, n'est-ce point parce que ce que nous en pourrions retrouver se rduit des impressions trop vagues, des images trop mal dfinies, pour offrir quelque prise la mmoire proprement dite ? La vie consciente des tout petits enfants se rapproche bien des gards de l'tat d'esprit d'un homme qui rve, et, si nous en conservons si peu de souvenirs, c'est peut-tre pour cette raison mme : les deux domaines, celui de l'enfance et celui du rve, ce petit nombre de souvenirs excepts, opposent le mme obstacle nos regards : ce sont les seules priodes dont les, vnements ne soient point compris dans la srie chronologique o prennent place nos souvenirs de la veille. Il est donc bien peu vraisemblable que nous ayons pu, dans la premire enfance, former des perceptions assez prcises pour que le souvenir qu'elles nous ont laiss, lorsqu'il reparat, soit lui-mme aussi prcis, qu'on nous le dit. La ressemblance entre l'image du rve et le visage rel, dans le second rve cit par Maury, n'est tout de mme pas une identit : en vingt-cinq ans, les traits ne peuvent point ne pas se transformer : peut-tre, si la personne ressemble ce point son image, cela tient-il ce que l'image elle-mme est assez brumeuse ? Hervey de SaintDenis croit s'tre assur que la maison vue en ralit tait bien telle que la maison vue en rve, parce que, ds son rveil, il en a dessin les, dtails. avec un grand soin. Ce qu'il faudrait savoir, c'est quel ge exactement il l'a, vue. Si durant ses plus jeunes, ans signifie vers 5 ou 6, ans, il parat invraisemblable qu'il ait pu alors en garder un souvenir aussi dtaill, puisqu' cet ge on ne peroit gure que l'aspect gnral des objets 1. Il ne nous dit pas, d'ailleurs, que lorsqu'il l'a revue, il s'est report son dessin : mais, tout de suite, il lui a sembl qu'il se trouvait exactement dans le mme
1
C'est 7 ans seulement, d'aprs Binet, qu'un enfant peut indiquer des lacunes de figure, c'est--dire qu'il remarque par exemple sur un dessin qu'il manque un oeil, ou la bouche, ou, les bras, ce qu'il reconnat tre un homme. Voir Anne psychologique, XIV, 1908. Nous avons vrifi ce test ngatif pour l'ge de 6 ans.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
16
tat que lorsqu'il rvait six ans auparavant : cette sret de mmoire ne laisse pas, de surprendre. En ralit, nous admettons qu'entre l'impression &'enfance et l'image du rve il y ait eu une troite ressemblance, que celle-ci ait reproduit exactement celle-l, mais non que l'une et l'autre aient t des reproductions dtailles de la maison c'est-dire des, souvenirs vritables. Tout, se passe comme dans ces rves o l'on revoit ce qu'on a vu ou cru voir au cours de rves antrieurs. Et certes il faudrait expliquer pourquoi ces images ne se reproduisent qu'en rve, pourquoi la mmoire de la veille ne les atteint pas directement. Cela tient sans doute ce que ce sont des reprsentations trop grosses, et que notre mmoire est, relativement, un instrument trop prcis, et qui n'a prise d'ordinaire que sur ce qui se place dans son; champ, c'est--dire sur cela seulement qui peut tre localis. D'ailleurs, quand bien mme se reprsenterait nous un visage, un objet, un fait vu autrefois, avec tous ses dtails, du moment que nous-mme nous: nous apparaissons en rve tel que, nous sommes aujourd'hui, le tableau d'ensemble est modifi. On ne peut dire qu'il y a, ici juxtaposition d'un, souvenir, rel, et du sentiment que nous avons prsent de notre, moi, mais ces deux lments se fondent, et comme nous ne pouvons nous reprsenter nous-mme autre que nous ne sommes, il faut bien que le visage, l'objet, le fait soient altrs pour que non& les regardions comme prsents. Sans doute on pourrait concevoir que notre personne non seulement passe l'arrireplan, mais qu'elle s'vanouisse presque entirement, que notre rle devienne ce point passif qu'il soit en dfinitive ngligeable, qu'il se rduise reflter, comme un miroir qui n'aurait point d'ge, les images qui se succdent alors 1. Mais un des traits caractristiques du rve, c'est que nous y intervenons toujours, soit que nous agissions, soit que nous rflchissions, soit que nous projetions sur ce que nous voyons la nuance particulire de notre disposition du moment, terreur, inquitude, tonnement, gne, curiosit, intrt, etc. Trs instructifs; cet gard sont deux exemples, rapports; par, Maury, propos de rves ou apparaissent des personnes; qu'on, sait tre mortes : Il y a quinze ans, une semaine s'tait coule depuis le dcs de M. L.... quand je le vis trs distinctement en rve... Sa prsence me surprit beaucoup, et je lui demandai avec une vive curiosit comment, ayant t enterr, il avait pu revenir en ce monde. M. L... m'en donna une explication: qui, on le devine, n'avait pas le sens commun, et dans laquelle se mlaient des thories vitalistes que j'avais rcemment tudies. Cette fois, il a le sentiment qu'il rve. Mais, une autre fois, il est convaincu qu'il ne rve pas., et cependant il le revoit et il, lui demande comment il se fait qu'il se trouve l 2. Il remarque ailleurs, qu'en songe nous ne nous tonnons pas des plus incroyables contradictions, que nous causons, avec des personnes que nous savons mortes, etc. 3 En tout cas, mme si nous ne cherchons pas rsoudre la contradiction, nous la remarquons, nous en avons au moins le sentiment. - Miss Calkins dit que dans les 375 cas observs par elle et un autre sujet, il n'y a aucun exemple d'un rve o ils se soient vus dans un autre moment que le temps prsent. Quand le rve voquait la maison o il ou elle avaient pass leur enfance, ou une personne qu'ils n'avaient pas vue depuis bien des
1
2 3
Miss CALKINS remarque que, dans certains cas, le sentiment de l'identit personnelle peut disparatre explicitement. On imagine qu'on est un autre, ou qu'on est l double de soi-mme, et alors il, y a, un second. moi qu'on voit ou qu'on entend (op. cit., p. 335). MAURY dit : Je crus un jour, en songe, tre devenu femme, et, qui plus est tre enceinte (op. cit., p. 141, note). Mais, alors, le souvenir est, encore plus dnatur, puisqu'on se reprsente les faits tels qu'un autre aurait pu les voir. MAURY, Le sommeil et les rves, p. 166. Ibid., p. 46.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
17
annes, l'ge apparent du rveur n'tait en rien diminu en vue d'viter un anachronisme ; quel que ft l'endroit ou le caractre du rve, le sujet avait bien son ge actuel, et ses conditions gnrales de vie n'taient point changes 1. Serguieff, aveugle depuis nombre d'annes, se voit en rve Ptersbourg, au Palais d'hiver 2. L'empereur Alexandre Il s'entretient avec lui et l'invite regagner son rgiment. Il obit et rencontre son colonel, qui lui dit qu'il pourra reprendre son service le lendemain. Mais je n'ai pas eu le temps de me procurer un cheval. - Je vous prterai un des chevaux de mon curie. - Mais ma sant est fort chancelante. Le mdecin vous exemptera de service. Alors seulement, c'est--dire en tout dernier lieu, il fait part au colonel d'un obstacle radical, et lui rappelle qu'tant aveugle il est absolument incapable de commander un escadron. Il n'en a pas moins eu ds le dbut le sentiment d'une impossibilit, c'est--dire que, ds le dbut et dans tout le cours du rve, sa personnalit actuelle intervenait. - Ainsi, jamais en rve nous ne nous dpouillons entirement de notre moi actuel, et cela suffirait pour que les images du rve, si elles reproduisaient presque identiquement un tableau de notre pass, fussent tout de mme diffrentes des souvenirs. Mais, jusqu'ici, nous n'avons parl que des rves dont nous nous souvenons au rveil. N'y en a-t-il pas d'autres ? Et, outre tous ceux dont nous ne nous souvenons point, pour des raisons peut-tre en partie accidentelles, n'y en a-t-il point dont la nature est telle que nous ne 'pouvons pas nous en souvenir ? Or, si tels taient prcisment ceux o le sentiment de la personnalit actuelle disparat tout fait, et o l'on revit le pass exactement tel qu'il a t, il faudrait dire qu'il y a en effet des rves o des souvenirs se ralisent, mais qu'on les oublie rgulirement lorsqu'on cesse de rver. C'est bien ce qu'entend M. Bergson, lorsqu'il attribue au sommeil lger les rves dont on se souvient, et incline croire que, dans le sommeil profond, les souvenirs deviennent l'objet unique ou au moins un objet possible de nos rves. Cependant, lorsque Hervey de Saint-Denis, jugeant du plus ou moins de profondeur de son sommeil par le plus ou moins de difficult qu'il prouve s'y arracher, remarque que, dans le sommeil profond, le rve est plus vif , plus lucide , et, en mme temps, plus suivi , d'une part nous aurions ainsi la preuve qu'on se souvient des rves du sommeil profond, d'autre part rien n'indique qu'il y ait plus de souvenirs, et des souvenirs plus exacts, dans ceux-ci que dans les rves du sommeil lger 3. Il est vrai qu'on peut rpondre : entre le moment o on commence rveiller quelqu'un, et celui o il est rveill effectivement, il s'coule un intervalle de temps. Or, si petit soit-il, il suffit, tant donne la rapidit avec laquelle se droulent les rves, pour que se soient produits dans cet intervalle, qui correspond un tat intermdiaire entre le sommeil profond et la veille, les rves rapports tort au sommeil profond qui a
1 2
Op. cit., p. 331. SERGUIEFF S., Le sommeil et le systme nerveux. Physiologie de la veille et du sommeil, Paris, 1892, 2e vol., p. 907 et suiv. On pourrait rapprocher de cet exemple le cas si curieux, dcrit par M. BERGSON (De la simulation inconsciente dans l'tat d'hypnotisme, Revue philosophique, novembre 1886), d'une femme en tat d'hypnose qui, en vue d'excuter un ordre qui suppose chez elle des facults anormales, use d'un subterfuge, parce qu'elle sent trs bien qu'elle ne les possde pas. HEERWAGEN (Friedr.), dans Statistische Untersuchungen ber Trume und Schlaf, Philos. Studien de Wundt., V, 1889, d'une enqute qui a port sur prs de 500 sujets, conclut qu'on a des rves plus vifs et qu'on se les rappelle mieux, quand on dort ordinairement d'un sommeil lger. Mais les femmes feraient exception. Au reste les questions taient poses en des termes bien vagues.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
18
prcd. Si on fait tenir ainsi dans une dure infinitsimale des rves d'une dure apparente trs longue, rien ne prouve, en effet, que nous atteignions jamais les rves du sommeil profond proprement dit. Mais il faut peut-tre se dfier des observations classiques o le sujet croit avoir, en rve, assist des vnements qui demanderaient, pour se produire en ralit, beaucoup de temps, plusieurs jours et mme plusieurs semaines, et qui ont dfil devant son regard en quelques instants. Jusqu' quel point a-t-il assist aux vnements, jusqu' quel point n'en a-t-il eu qu'une vue schmatique ? M. Kaploun dit qu'il lui a t donn de constater plusieurs fois non seulement qu'on ne rve pas plus vite qu'on ne pense en veille, mais que le rve est relativement lent . Sa vitesse lui semble tre peu prs celle de l'action relle 1 . Hervey de Saint-Denis dit qu'ayant eu l'occasion de rveiller souvent une personne qui rvait tout haut, si bien qu'elle lui fournissait ainsi, tout en dormant, des points de repre, il avait constamment observ, en l'interrogeant aussitt sur ce qu'elle venait de rver, que ses souvenirs me remontaient jamais au del d'un laps de cinq six minutes . En tout cas nous sommes loin des quelques secondes que dure le rveil. Un trs grand nombre de fois, ajoute le mme auteur 2, j'ai retrouv toute la filire qu'avait suivie l'association de mes ides durant une priode de cinq six minutes, coules entre le moment o j'avais commenc m'assoupir et celui o j'avais t tir d'un rve dj form, c'est--dire depuis l'tat de veille absolue jusqu' celui du sommeil complet. Ainsi, aux observations sur la rapidit des rves, d'o l'on conclut qu'on ne se rappelle point les rves du sommeil profond, il est facile d'en opposer d'autres qui tendraient prouver le contraire. On pourrait, maintenant, raisonner sur des donnes moins discutables. Parmi nos rves, il y en a qui sont des combinaisons d'images fragmentaires, dont nous ne pourrions que par un effort d'interprtation souvent incertain retrouver l'origine, au rveil, dans une ou plusieurs rgions de notre mmoire. D'autres sont des souvenirs simplement dmarqus. Entre les uns et les autres il y a bien des intermdiaires. Pourquoi ne supposerait-on. pas que la srie ne se termine point l, qu'au del de ces souvenirs dmarqus il y en a d'autres qui ne le sont pas, qu'ensuite vient une catgorie de rves qui contiendraient des souvenirs purs et simples (raliss) ? On interprterait ceci en disant que ce qui empche le souvenir de reparatre intgralement, ce sont des sensations organiques, qui, si vagues soient-elles, pntrent pourtant dans le rve, et nous maintiennent en contact avec le monde extrieur : que ce contact se rduise de plus en plus, la limite, rien d'extrieur n'intervenant pour rgler l'ordre dans lequel les images se succdent, il reste et il ne reste que l'ordre chronologique ancien suivant lequel la srie des souvenirs se droulera nouveau. Mais, quand bien mme on pourrait classer ainsi les images des rves, rien n'autoriserait admettre qu'on passe par des transitions insensibles de la catgorie des rves celle des souvenirs purs. On peut dire du souvenir, tel qu'on le dfinit dans cette conception, qu'il ne comporte pas de degrs : un tat est un souvenir, ou autre chose : il n'est pas en partie un souvenir, en partie autre chose. Sans doute il y a des souvenirs incomplets, mais il n'y a pas, dans un rve, mlange de souvenirs incomplets avec d'autres lments, car un souvenir mme incomplet, lorsqu'un l'voque, s'oppose tout le reste comme le pass au prsent, tandis que le rve, dans toutes ses parties, se confond pour nous avec le prsent. Le rve n'chappe pas plus cette condition qu'une danseuse, alors mme qu'elle ne touche le sol qu'avec les pointes, et donne l'impression qu'elle va s'envoler,
1
KAPLOUN, Psychologie gnrale tire de l'tude du rve, 1919, p. 126. Voir aussi la critique du rve de Maury , dans DELAGE (Yves), Le rve, Nantes, 1920, p. 460 et suiv. M. Delage ne croit pas, au moins en gnral, la rapidit fulgurante des rves. Op. cit., p. 266.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
19
ne se soustrait le moins du monde aux lois de la gravitation. On ne peut donc pas conclure, de ce qu'il y a des rves qui ressemblent plus que d'autres nos souvenirs, qu'il y a des rves qui sont des souvenirs purs. Passer des uns aux autres, ce serait, en ralit, sauter d'un ordre de faits un autre dont la nature est toute diffrente. Si, dans le sommeil profond, l'activit par excellence de l'esprit consistait dans l'vocation des souvenirs, il serait bien trange qu'avant de s'endormir il fallt dtourner son attention non seulement du prsent et des souvenirs immdiats qui nous le reprsentent, mais aussi de toute espce de souvenirs, et suspendre, en mme temps que ses perceptions, l'activit de la mmoire. Or, c'est bien ce qui se ralise. M. Kaploun croit avoir observ qu'au dbut de l'assoupissement on traverse un tat de rverie o l'vocation des souvenirs est facile, continue et fertile . Mais, ensuite, il faut brider l'nergie de veille , et on y arrive en l'occupant par un travail qui produit un vide, un appauvrissement : une mlodie, ou quelque autre image rythmique . Ensuite le mme auteur signale un tat singulier, qu'il n'a russi, dit-il, saisir qu'aprs un long entranement, et qui prcderait immdiatement le vrai rve. Tout motif rythmique disparat, et on se trouve le spectateur passif d'une floraison incessante et rapide d'images simples et courtes... nettement objectives, indpendantes et extriorises... Il semble qu'on assiste la dislocation du systme latent particulier (conscience du rel l'tat de veille), dont les parties agissent vigoureusement avant de disparatre. Les lments de ce systme (notion de l'orientation, des personnes qui nous entourent, ou que nous avons vues) jettent en quelque sorte leur dernire lueur 1. Ainsi les cases dans lesquelles nous rpartissons les images de l'tat de veille doivent disparatre, pour que devienne possible un nouveau mode de systmatisation, celui du rve 2. Mais ces cases sont aussi celles dans lesquelles s'opre, l'tat de veille, l'vocation des souvenirs. Il semble donc que le systme gnral des perceptions et des souvenirs de la veille soit un obstacle l'entre dans le rve. Inversement, si nous hsitons parfois rentrer dans la veille, si l'on reste parfois au rveil, quelques instants, dans un tat intermdiaire qui n'est exactement ni le rve, ni la veille, c'est que l'on n'arrive pas carter les cases dans lesquelles se sont distribues les dernires images vues en songe, et que les cadres de la pense veille ne s'accordent pas avec celles du rve. Nous transcrivons ici un rve o il nous semble que ce dsaccord apparat clairement : Rve triste. Je suis avec un jeune homme qui ressemble un de mes tudiants, dans une salle qui est comme l'antichambre d'une prison. Je suis son avocat, et je dois rdiger avec lui (?) On m'a dit : inscrivez le plus de dtails que vous pourrez. Il doit tre pendu pour je ne sais quel crime. Je le plains, je songe ses parents, je voudrais bien qu'il s'chappe. - Au rveil, je suis encore si triste et proccup que je cherche comment je pourrais l'aider se sauver (s'il se trouvait en une telle situation). Je m'imagine que je suis dans une grande ville, et je me transporte en pense dans des quartiers tendus o il y a de grands massifs de maisons perces de galeries, avec restaurants, etc. (tels qu'il m'est arriv souvent d'en voir en rve, toujours les mmes, auxquels ne correspond aucun souvenir de la veille). Pourtant, je sais en mme temps que dans la ville o je suis en ralit je n'ai jamais visit de tels quartiers, et qu'ils ne sont pas indiqus sur le plan. Cet tat s'expliquait sans doute par l'intensit motive du rve, si bien que, rveill, j'tais encore sous l'empire du sentiment prouv en songe. Je me croyais donc la fois dans deux villes
1 2
Op. cit., p. 180. M. DELACROIX a trs heureusement dfini le mode d'organisation des images de nos songes: Une multitude dsagrge de systmes psychiques. La structure logique du rve, Revue de Mtaphysique et de Morale, 1904, p. 934.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
20
diffrentes, dont l'une tait celle de mon rve, et je m'efforais en vain de trouver dans l'une ce que j'avais vu dans l'autre. * ** I - ii
Retour la table des matires
Entre la pense du rve et celle de la veille il y a en effet cette diffrence fondamentale que l'une et l'autre ne se dveloppent pas dans les mmes cadres. C'est ce que paraissent avoir bien vu deux auteurs, dont les conceptions sont du reste trs loignes, Maury et Freud. Lorsque Maury rapproche le rve de certaines formes de l'alination mentale, il a le sentiment que, dans les deux cas, le sujet vit dans un milieu qui lui est propre, o des relations s'tablissent entre les personnes, les objets, les paroles, qui n'ont de sens que pour lui. Sortir du monde rel, oubliant les lois physiques aussi bien que les conventions sociales, le rveur, comme l'alin, poursuit sans doute un monologue intrieur : mais en mme temps il cre un monde physique et social o de nouvelles lois, de nouvelles conventions apparaissent, qui changent d'ailleurs sans cesse. Mais, lorsque Freud prte aux visions des songes la valeur de signes dont il cherche le sens dans les proccupations caches du sujet, il ne dit au fond pas autre chose. Si l'on s'en tient, en effet, aux donnes littrales du rve, on est frapp de leur insignifiance et de leur incohrence. Mais ce qui est sans intrt pour nous ne l'est certainement pas pour celui qui songe, et il y a une logique du rve qui explique toutes ces contradictions. Sans doute, Freud n'en reste pas l ; il s'efforce de rendre compte du contenu apparent du rve par les proccupations caches du dormeur ; il imagine mme que le sujet, pour se reprsenter en rve l'accomplissement de ses dsirs, doit cependant en dissimuler la nature, par gard pour un second moi, qui exerce sur ce thtre intrieur une sorte de censure, et dont il faut tromper la surveillance et djouer les soupons : de l viendrait le caractre symbolique des songes. Or les interprtations qu'il propose sont la fois trs compliques et trs incertaines : il faut, pour rattacher tel vnement de la veille et tel incident du rve, faire intervenir des associations d'ides souvent bien inattendues, et d'ailleurs Freud ne s'en tient pas en gnral une traduction : il superpose les uns aux autres deux, trois et quatre systmes d'interprtation et, au moment o il s'arrte, il laisse entendre qu'il entrevoit encore bien d'autres relations possibles, et qu'il ne les passe sous silence que parce qu'il faut se borner. C'est dire que, tandis qu' l'tat de veille les images que nous percevons sont ce qu'elle sont, tandis que chacune ne reprsente qu'une personne, qu'un objet n'est qu'en un endroit, qu'une action n'a qu'un rsultat, qu'une parole n'a qu'un sens, sans quoi les hommes ne se retrouveraient pas au Milieu des choses, et ne s'entendraient pas entre eux, dans le rve se substituent aux ralits des symboles auxquels ne s'appliquent plus toutes ces rgles, prcisment parce que nous ne sommes plus en rapport avec les objets extrieurs, ni avec les autres hommes, mais n'avons plus affaire qu' nous-mmes : ds lors tout langage exprime et toute forme reprsente tout ce que nous avons ce moment dans l'esprit, puisque personne ni aucune force physique ne s'y oppose. Il y aurait ds lors entre le monde du rve et de la veille un tel dsaccord qu'on ne comprend mme pas, comment on peut garder, dans l'un, le moindre souvenir de ce qu'on a fait et pens dans l'autre. Comment un souvenir de la veille, nous entendons
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
21
un souvenir complet d'une scne entire exactement reproduite, trouverait-il place dans cette srie d'images-fantmes, qu'on appelle le rve ? C'est comme si on voulait fondre, avec un ordre de faits soumis au pur arbitraire de l'individu, l'ordre des faits rels soumis aux lois physiques et sociales. Mais, inversement, comment gardonsnous, au rveil, un souvenir quelconque de nos rves ? Comment ces visions fugitives et incohrentes trouvent-elles accs dans la conscience veille ? Quelquefois, au rveil, on garde dans l'esprit une image dtermine d'un rve, retenue par la mmoire on ne sait pourquoi : tels ces lacs minuscules demeurs dans les rochers aprs que la mer s'est retire. L'image, quelquefois, n'est spare que de ce qui prcde : elle ouvre toute une histoire, elle est le premier anneau de toute une chane d'autres images ; quelquefois elle se dtache sur un temps vide : ni avant, ni aprs, rien ne se distingue qui s'y rattache. En tout cas, si, aprs, on suit vaguement les traces de ce qui s'est dvelopp dans la conscience partir d'elle, avant, on n'aperoit plus rien. Cependant, on sait qu'elle n'est point ne de rien : on a le sentiment, derrire l'cran qui la spare du pass, qu'il demeure au fond de la mmoire bien des souvenirs. Mais on n'a aucun moyen de les ressaisir. Lorsque, malgr tout, on russit voir au del de l'cran, lorsque, dans l'image elle-mme, d'abord opaque, et qui peu peu devient transparente, lorsqu' travers elle on distingue les contours d'objets ou d'vnements qui, dans notre rve, l'ont prcde, alors s'impose nous le sentiment profond de ce qu'il y a de paradoxal dans un tel acte de mmoire. Dans l'image ellemme, non plus que dans ce qui la suit, on n'avait aucun point d'appui pour se transporter ainsi un moment antrieur : entre l'image et ce qui prcde (et c'est pour cela qu'elle nous apparaissait comme un commencement) n'existait aucun rapport intelligible. Comment alors passe-t-on de ceci cela ? L'image et ce qui l'accompagne, ce qui forme avec elle un tableau plus ou moins cohrent, mais dont les parties se tiennent et se soutiennent, semble un monde clos -nous ne comprenons pas, quand on y est enferm, et quand tous les chemins qui le traversent y ramnent, qu'on puisse en sortir, et pntrer dans un autre. Nous le comprenons aussi peu que le passage d'un plan dans un autre, pour qui semble assujetti se mouvoir dans le premier : cela est aussi obscur pour nous que l'existence d'une nouvelle dimension de l'espace. Mais est-ce bien la mmoire qui intervient, lorsque nous voquons nos rves ? Les psychologues qui ont essay de dcrire les visions du sommeil reconnaissent que ces images sont ce point instables qu'il faut les noter ds le rveil : sinon, on risque de substituer au rve ce qui n'en est qu'une reconstruction et saris doute, bien des gards, une dformation. Voici, en somme, ce qui parat se passer. Lorsqu'au rveil on se retourne ainsi vers le rve, on a l'impression qu'une suite d'images, ingalement vives, sont demeures en suspens dans l'esprit, de mme qu'une substance colorante dans un liquide qu'on vient de remuer. L'esprit en est encore, en quelque sorte, tout imprgn. Si l'on ne se hte point de fixer sur elles son attention, on sait qu'elles vont petit petit disparatre, on sent qu'une partie d'entre elles ont dj disparu, et qu'aucun effort ne permettrait de les ressaisir. On les fixe donc, en les considrant peu prs comme des objets extrieurs que l'on peroit, et c'est ce moment qu'on les fait entrer dans la conscience de la veille. Dsormais, quand on se les rappellera, on voquera non point les images telles qu'elles apparaissaient au rveil, mais la perception qu'on en a eue alors. Et on pourra croire que la mmoire atteint le rve : en ralit, c'est indirectement, par l'intermdiaire de ce qu'on en a pu fixer ainsi, qu'on le connatra ; c'est une image de la veille que la mmoire de la veille reproduira. Sans doute il arrive qu'au milieu de la journe qui suit le rve, ou mme plus tard, certaines parties du rve qu'on n'avait pas fixes ainsi ds le rveil reparaissent. Mais le processus sera le mme : elles taient demeures prsentes l'esprit qui, pour une raison ou une
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
22
autre, ne s'tait pas tourn de leur ct, et l'on s'apercevra que si, au moment o on les aperoit, on ne fait pas l'effort ncessaire pour les fixer, elles disparatront aussi, dfinitivement. Il y a donc lieu de distinguer, dans le processus au terme duquel on possde ce qu'on peut appeler le souvenir d'un rve, deux phases trs distinctes. La seconde est un acte de mmoire pareil aux autres : on acquiert un souvenir, on le conserve, on l'voque, on le reconnat, et enfin on le localise au moment du rveil, o on l'a acquis, et indirectement dans la priode de sommeil prcdente, durant laquelle on sait qu'on a fait ce rve, mais sans pouvoir dire quel moment prcis ; la premire consiste simplement en ceci, qu'il y avait au rveil certaines images qui flottaient dans l'esprit et qui n'taient pas des Souvenirs. Sur ce dernier point, il faut un peu insister. Car un souvenir n'est-il pas cela mme : une image rapporte au pass, et qui cependant subsiste ? Toutefois, si nous acceptons la distinction propose par M. Bergson entre les souvenirs-habitudes ou souvenirs-mouvements, qui correspondent des tats psychologiques reproduits plus ou moins frquemment, et les souvenirs-images, qui correspondent des tats qui ne se sont produits qu'une fois, et dont chacun a une date, c'est--dire peut tre localis un moment dfini de notre pass, nous ne voyons pas que les images du rve, telles qu'elles se prsentent au rveil, puissent entrer dans l'une ou l'autre de ces catgories. Ce ne sont pas des souvenirs-habitudes, car elles ne sont ,apparues qu'une fois : quand nous les apercevons, elles ne provoquent pas en nous ce sentiment de familiarit qui accompagne la perception d'objets ou de personnes avec lesquels nous sommes en rapports frquents 1. Mais ce ne sont cependant pas non plus des souvenirsimages, car elles ne sont pas localises un moment dfini de notre pass . Sans doute, nous les localisons aprs coup ; nous pouvons dire, au moment o nous nous rveillons, qu'elles se sont produites au cours de la nuit qui vient de s'couler. Mais quel moment ? Nous ne savons. Supposons que nous ngligions de dfinir les limites de temps entre lesquelles elles se sont produites, et (comme il arrive exceptionnellement) que nous les voquions cependant aprs plusieurs jours, ou plusieurs semaines, nous n'aurons aucun moyen d'en retrouver la date. Nous manquons en effet, ici, de ces points de repre, sans lesquels tant de souvenirs d'vnements de la veille nous chapperaient aussi. C'est pourquoi nous ne nous rappelons pas de la mme manire ceux-ci, et les images du rve. Si nous avons le sentiment (peut-tre illusoire) que nos souvenirs (j'entends ceux qui se rapportent la vie consciente de la veille), sont disposs dans un ordre immuable au fond de notre mmoire, si la suite des images du pass nous semble, cet gard, aussi objective que la Suite de ces images actuelles ou virtuelles que nous appelons les objets du monde extrieur, c'est qu'elles se rangent en effet dans des cadres immobiles qui ne sont pas notre uvre exclusive et qui s'imposent nous du dehors. Les souvenirs, alors mme qu'ils reproduisent de simples tats affectifs (ce sont d'ailleurs les plus rares, et les moins nettement localiss), mais surtout lorsqu'ils refltent les vnements de notre vie, ne nous mettent pas seulement en rapport avec notre pass, mais nous reportent une poque, nous replacent dans un tat de la socit dont il existe, autour de nous, bien d'autres vestiges que ceux que nous dcouvrons en nous-mmes. De mme que
1
M. KAPLOUN, op. cit., p. 84 et 133, dit que nous reconnaissons les objets et les personnes, dans le rve comme dans la veille, c'est--dire que nous comprenons tout ce que nous voyons. C'est exact. Mais il n'en est pas de mme des scnes du rve dans leur ensemble : chacune d'elles nous parat au contraire, en rve, entirement nouvelle, actuelle.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
23
nous prcisons nos sensations en nous guidant sur celles des autres, de mme nous compltons nos souvenirs en nous aidant, au moins en partie, de la mmoire des autres. Ce n'est pas seulement parce qu' mesure que le temps s'coule, l'intervalle s'largit entre telle priode de notre existence et le moment prsent, que beaucoup de souvenirs nous chappent; mais nous ne vivons plus au milieu des mmes personnes : bien des tmoins qui auraient pu nous rappeler des vnements anciens disparaissent. Il suffit, quelquefois, que nous changions de lieu, de profession, que nous passions d'une famille dans une autre, que quelque grand vnement tel qu'une guerre ou une rvolution transforme profondment le milieu social qui nous entoure, pour que, de priodes entires de notre pass, il ne nous reste qu'un bien petit nombre de souvenirs. Au contraire, un voyage dans le pays o s'est coule notre jeunesse, la rencontre soudaine d'un ami d'enfance a pour effet de rveiller et rafrachir notre mmoire : nos souvenirs n'taient pas abolis ; mais ils se conservaient dans la mmoire des autres, et dans l'aspect inchang des choses. Il n'est pas tonnant que nous ne puissions voquer de la mme manire des images que nous sommes seuls percevoir, du moins dans l'ordre o le rve nous les prsente. Ainsi s'expliquerait ce fait qui a retenu notre attention, savoir que dans nos rves ne s'introduise jamais un souvenir rel et complet, tel que ceux que nous nous rappelons l'tat de veille, mais que nos rves soient fabriqus avec des fragments de souvenirs trop mutils ou confondus avec d'autres pour que nous puissions les reconnatre. Il n'y a pas s'en tonner, pas plus que de ce que nous ne dcouvrons point non plus dans nos rves des sensations vritables telles que celles que nous prouvons quand nous ne dormons pas, qui rclament un certain degr d'attention rflchie, et qui s'accordent avec l'ordre des relations naturelles dont nous et les autres avons l'exprience. De mme, si la srie des images de nos rves ne contient pas des souvenirs proprement dits, c'est que, pour se souvenir, il faut tre capable de raisonner et de comparer, et se sentir en rapports avec une socit d'hommes qui peut garantir la fidlit de notre mmoire, toutes conditions qui ne sont videmment pas remplies quand nous dormons. Cette faon d'envisager la mmoire soulve au moins deux objections. En effet nous voquons quelquefois notre pass, non point pour y retrouver des vnements qu'il nous peut -tre utile de connatre, mais en vue de goter le plaisir purement dsintress de revivre en pense une priode coule de notre existence. Souvent, dit Rousseau, je me distrais de mes malheurs prsents en songeant aux divers vnements de ma vie, et les repentirs, les doux souvenirs, les regrets, l'attendrissement se partagent le soin de me faire oublier quelques instants mes souffrances: Or on voit souvent dans l'ensemble des images passes avec lesquelles nous entrerions ainsi en contact la partie la plus intime de notre moi, celle qui chappe le plus l'action Au monde extrieur, et en particulier de la socit. Et on voit aussi, dans les souvenirs ainsi entendus, des tats sinon immobiles, du moins immuables, dposs le long de notre dure suivant un ordre qu'on ne peut pas non plus modifier, et qui rapparaissent tels qu'ils taient lorsque nous les avons traverss pour la premire fois, sans qu'ils aient t, dans l'intervalle, soumis une laboration quelconque. C'est d'ailleurs parce qu'on croit que les souvenirs sont ainsi donns une fois pour toutes qu'on refuse l'esprit qui se souvient toute activit intellectuelle. Entre rver tout veill et se souvenir, on ne voit gure qu'une nuance. Les souvenirs seraient aussi trangers la conscience tendue vers le prsent, et, quand elle se tourne vers eux, ils dfileraient sous son regard ou ils l'envahiraient en rclamant aussi peu d'effort de sa part que les objets rels, lorsque l'esprit se dtend, et ne les envisage plus sous l'angle pratique. On admettrait volontiers que c'est une facult spciale, inutilise tant que l'on est
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
24
proccup surtout d'agir, qui intervient dans la rverie comme dans le souvenir; ce serait simplement la facult de se laisser impressionner sans ragir, ou en ragissant juste assez pour que cette impression devienne consciente. Alors on ne voit pas en quoi les souvenirs se distingueraient des images de nos rves, et on ne comprend point pourquoi ils ne s'y introduiraient pas. Mais l'acte qui voque le souvenir est-il bien celui qui nous 'fait entrer le plus compltement en nous-mme ? Notre mmoire est-elle bien notre domaine propre, et, lorsque nous nous rfugions dans notre pass, peut-on dire que nous nous vadons de la socit pour nous enfermer dans notre moi ? Comment cela serait-il possible, si tout souvenir est li (alors mme qu'elles n'en constituent point le contenu) des images qui reprsentent des personnes autres que nous-mmes ? Sans doute nous pouvons nous rappeler bien des vnements dont nous seuls avons t les tmoins, l'aspect de pays que nous avons parcourus tout seuls, et, surtout, il y a bien des sentiments et des penses que nous n'avons jamais communiqus personne, et dont nous conservons seuls le secret. Mais nous ne gardons un souvenir prcis des objets vus au cours d'une promenade solitaire que dans la mesure o nous les avons localiss, o nous avons dtermin leur forme, o nous les avons nomms, o ils ont t l'occasion pour nous de quelque rflexion. Or tout cela, lieu, forme, nom, rflexion, ce sont les instruments grce auxquels notre intelligence a prise sur les donnes du pass dont il ne nous resterait sans eux qu'une vague rminiscence indistincte. Un explorateur est bien oblig de prendre des notes sur les diverses tapes de son voyage ; des dates, des reprages sur les cartes gographiques, des mots ncessairement gnraux, ou des croquis schmatiques, voil les clous avec lesquels il fixe ses souvenirs qui, autrement, lui chapperaient comme la plupart des apparitions de la vie nocturne. Qu'on ne nous reproche pas de nous en tenir ce qu'il y a de plus extrieur dans les souvenirs, et de nous arrter la surface de la mmoire. Certes, toutes ces indications de forme impersonnelle ne tirent leur valeur que de ce qu'elles aident retrouver et reproduire un tat interne vanoui. En elles-mmes elles ne possdent point une vertu vocatrice. Quand on feuillette un album de photographies, ou bien les personnes qu'elles reprsentent sont des parents, des amis, qui ont jou un rle dans notre vie, et alors chacune de ces images s'anime et devient le point de perspective d'o nous apercevons brusquement une ou plusieurs priodes de notre pass ; ou bien il s'agit d'inconnus, et alors nos regards glissent avec indiffrence sur ces visages effacs et ces toilettes dmodes, qui ne nous rappellent rien. Il n'en est pas moins vrai que le souvenir des sentiments ne peut se dtacher de celui des circonstances o nous les avons prouvs. Il n'y a point de voie interne directe qui nous permette d'aller la rencontre d'une douleur ou d'une joie abolies. Dans la Tristesse d'Olympio, le pote cherche d'abord, en quelque sorte, les lambeaux de ses souvenirs, qui sont rests accrochs aux arbres, aux barrires, aux haies de la route, avant de les rapprocher, et d'en faire surgir la passion d'autrefois en sa ralit. Si nous voulions faire abstraction des personnes et des objets, dont les images permanentes et immuables se retrouvent d'autant plus facilement que ce sont comme des cadres gnraux de la pense et de l'activit, nous irions en vain la recherche des tats d'me autrefois vcus, fantmes insaisissables au mme titre que ceux de nos songes ds qu'ils ne sont plus sous notre regard. Il ne faut pas se figurer que l'aspect purement personnel de nos anciens tats de conscience se conserve au fond de la mmoire, et qu'il suffit de tourner la tte de ce ct-l pour les ressaisir. C'est dans la mesure o ils ont t lis des images de signification sociale, et que nous nous reprsentons couramment par le fait seul que nous sommes membres de la socit, celle, par exemple, des
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
25
grands chars gmissants qui reviennent le soir , ou de la barrire o l'aumne avait vid nos bourses , que nous gardons quelque prise sur nos anciennes dispositions internes, et que nous pouvons les reconstituer au moins en partie. Il y a une conception de la mmoire d'aprs laquelle les tats de conscience, ds qu'il se sont produits, acquirent en quelque sorte un droit indfini subsister : ils demeureraient tels quels, ajouts ceux qui les ont prcds, dans le pass. Entre eux et le plan ou la pointe du prsent il faudrait se reprsenter que l'esprit se dplace. En tous cas, il ne suffirait pas des images, ides et rflexions actuelles pour reconstituer le tableau des jours couls. Il n'y aurait qu'un moyen d'voquer les souvenirs purs : ce serait de quitter le prsent, de dtendre les ressorts de la pense rationnelle et de nous laisser redescendre dans le pass, jusqu' ce que nous entrions en contact avec ces ralits d'autrefois, demeures telles que lorsqu'elles s'taient fixes dans une forme d'existence qui devait les enfermer pour toujours. Entre le plan de ces souvenirs et le prsent il y aurait une rgion intermdiaire, o ni les perceptions, ni les souvenirs ne se prsenteraient l'tat pur, comme si l'esprit ne pouvait tourner son attention vers le pass sans le dformer, comme si le souvenir se transformait, changeait d'aspect, se corrompait sous l'action de la lumire intellectuelle, mesure qu'il remonte et s'approche de la surface. En ralit, tout ce qu'on constate, c'est que l'esprit, dans la mmoire, s'oriente vers un intervalle de pass avec lequel il n'entre jamais en contact, c'est qu'il fait converger vers cet intervalle tous ceux de ses lments qui doivent lui permettre d'en relever et d'en dessiner le contour et la trace, mais que, du pass lui-mme, il n'atteint rien. Alors, quoi bon supposer que les souvenirs subsistent, puisque rien ne nous en apporte une preuve, et qu'on peut expliquer qu'on les reproduise, sans qu'il soit ncessaire d'admettre qu'ils sont demeurs? L'acte (car c'est bien un acte) par lequel l'esprit s'efforce de retrouver un souvenir l'intrieur de sa mmoire, nous parat prcisment l'inverse de celui par lequel il tend extrioriser ses tats internes actuels. La difficult dans l'un et l'autre cas est en effet inverse galement, et en tout cas, tout autre. Lorsqu'on exprime ce qu'on pense ou ce qu'on sent, on se contente le plus souvent des termes gnraux du langage courant ; quelquefois on se sert de comparaisons ; on s'efforce, en associant des mots qui dsignent des ides gnrales, de serrer de plus en plus prs les contours de son tat de conscience. Mais, entre l'impression et l'expression, il y a toujours un cart. Sous l'influence des ides et faons de penser gnrales, la conscience individuelle prend l'habitude de dtourner son attention de ce qu'il y a en elle d'exceptionnel et qui ne peut se traduire sans peine dans le langage courant. On a expliqu ainsi le caractre inexact des descriptions que certains malades font de ce qu'ils ressentent : mesure que s'intensifient en eux certaines sensations organiques qui existent peine, ou pas du tout chez les hommes normaux, mesure aussi s'impose eux l'obligation d'user de termes impropres pour les traduire, parce qu'il n'y en a point qui leur soient adapts 1. Mais il en est de mme dans un grand nombre d'autres cas. Il y a un vide dans l'expression, qui mesure le dfaut d'adaptation des consciences individuelles aux conditions de la vie normale. Inversement, quand nous nous souvenons, nous partons du prsent, du systme d'ides gnrales qui est toujours notre porte, du langage et des points de repre adopts par la socit, c'est--dire de tous les moyens d'expression qu'elle met notre
1
BLONDEL (Ch.), La conscience morbide, 1914.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
26
disposition, et nous les combinons de faon retrouver soit tel dtail, soit telle nuance des figures ou des vnements passs, et, en gnral, de nos tats de conscience d'autrefois. Mais cette reconstruction n'est jamais qu'approche. Nous sentons bien qu'il y a des lments personnels de nos impressions anciennes que nous ne pouvons voquer par une telle mthode. Il y a un vide dans l'impression, qui mesure le dfaut d'adaptation de la comprhension sociale aux conditions de notre vie consciente personnelle d'autrefois. Mais comment expliquer, alors, que quelquefois nous soyons surpris de ce que ce vide se comble brusquement, de ce qu'un souvenir, que nous croyions perdu, se dcouvre au moment o nous nous y attendions le moins? Au cours d'une rverie triste ou heureuse, telle priode de notre existence, telles figures, telles penses d'autrefois, qui s'accordent avec notre disposition actuelle, semblent revivre sous notre regard intrieur: ce ne sont pas des schmes abstraits, des dessins bauchs, des tres transparents, incolores ; nous avons au contraire l'illusion de retrouver ce pass inchang, parce que nous nous retrouvons nous-mme dans l'tat o nous le traversions. Comment douter de sa ralit, puisque nous entrons avec lui en contact aussi immdiat qu'avec les objets extrieurs, que nous en pouvons faire le tour, et que, loin de n'y retrouver que ce que nous y cherchions, il nous dcouvre en lui bien des dtails dont nous n'avions plus aucune ide ? Cette fois ce n'est plus de notre esprit que partirait l'appel au souvenir : c'est le souvenir qui ferait appel nous, qui nous presserait de le reconnatre, et nous reprocherait de l'avoir oubli. C'est donc du fond de nous-mmes, comme du fond d'un couloir o, seuls, nous pourrions nous engager, que les souvenirs viendraient notre rencontre ou que nous nous avancerions vers eux. Mais d'o vient cette sorte de sve qui gonfle certains de nos souvenirs, jusqu' leur donner l'apparence de la vie relle ? Est-ce la vie d'autrefois qu'ils ont conserve, ou n'est-ce pas une vie nouvelle que nous leur avons communique, mais une vie d'emprunt, tire du prsent, et qui ne durera qu'autant que notre surexcitation passagre ou notre disposition affective du moment ? Lorsqu'on se laisse aller reproduire en imagination une suite d'vnements dont la pense nous attendrit sur nous-mmes ou sur les autres, surtout lorsqu'on est revenu dans les lieux o ils se sont drouls, soit qu'on en croie saisir des vestiges sur les faades des maisons qui nous ont vu passer autrefois, aux troncs des arbres, dans les regards des vieillards, chargs d'ans en mme temps que no-us, mais qui gardent les traces et peut-tre le souvenir du mme pass, soit qu'on remarque surtout quel point tout a chang, combien il est peu rest de l'ancien aspect qui nous tait familier, et qu'alors, sensible surtout l'instabilit des choses, on ait moins de peine abolir par la pense celles qui tiennent aujourd'hui la place du dcor disparu de nos petites ou grandes passions, il arrive que l'branlement communiqu notre organisme psychophysique, par ces ressemblances, ces contrastes, nos rflexions, nos dsirs, nos regrets, nous donne l'illusion que nous repassons rellement par les motions anciennes. Alors, par un change rciproque, les images que nous reconstruisons empruntent aux motions actuelles ce sentiment de ralit qui les transforme nos yeux en objets encore existants, tandis que les sentiments d' prsent, en s'attachant ces images, s'identifient avec les motions qui les ont autrefois accompagnes, et se trouvent du mme coup dpouills de leur aspect d'tats actuels. Ainsi nous croyons en mme temps que le pass revit dans le prsent, et que nous quittons le prsent pour redescendre dans le pass. Cependant, ni l'un ni l'autre n'est vrai : tout ce qu'on peut dire, c'est que les souvenirs, comme les autres images, imitent quelquefois nos tats prsents, lorsque nos sentiments actuels viennent leur rencontre et s'y incorporent.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
27
* ** I - iii
Retour la table des matires
Jusqu' quel point le pass peut-il faire rellement illusion ? Arrive-t-il que les souvenirs imposent la conscience le sentiment de leur ralit comme certaines images hallucinatoires que nous en venons confondre avec des sensations ? Nous avons abord ce problme propos du rve, mais il faut maintenant le poser dans toute son tendue. Il y a des maladies ou exaltations de la mmoire, qu'on appelle paramnsies, et qui consistent en ceci : on arrive pour la premire fois dans une ville, on voit pour la premire fois une personne, et cependant on les reconnat comme si on les avait dj vues. L'illusion que nous voulons examiner est l'inverse de celle-ci : il s'agit de savoir si, revenant ou s'imaginant tre dans une ville o l'on a dj t, on peut se croire l'poque o on y arrivait pour la premire fois, et repasser par les mmes sentiments de curiosit, d'tonnement qu'alors, sans s'apercevoir qu'on les a dj prouvs. 'Plus gnralement, alors que les rves sont des illusions coupes peuttre (si l'on ne rve pas toujours) par des intervalles o la conscience est vide, n'y a-til pas, interrompant le cours des tats de conscience pendant la veille, des illusions dtermines par la mmoire et qui nous font confondre le pass revcu avec la ralit ? Or il y a certainement eu des hommes qui dsiraient se procurer des illusions de ce genre, et qui ont cru y parvenir. Les mystiques qui se remmorent leurs visions paraissent revivre leur pass. Il reste savoir si ce qui se reproduit est bien le souvenir lui-mme, ou une image dforme qu'on lui a petit petit substitue. Si nous cartons ces cas, o l'imagination joue sans doute le principal rle, si nous considrons ceux o, volontairement ou non, nous voquons un souvenir qui a bien gard son intgrit primitive, c'est--dire dont nous n'avons, pas tir dj d'autres preuves, il nous parat inconcevable qu'on prenne le souvenir d'une perception ou d'un sentiment pour cette perception ou ce sentiment lui-mme. Ce n'est pas que ces souvenirs, surgis pendant la veille, se heurtent nos perceptions actuelles qui joueraient, vis-vis d'eux, le rle de rducteurs. Car on pourrait concevoir que nos sensations s'attnuent et s'affaiblissent assez pour que les images du pass, plus intenses, s'imposent l'esprit et lui paraissent plus relles que le prsent. Mais cela n'arrive point. Rien, mme, ne prouve que l'affaiblissement de nos sensations soit une condition favorable au rappel des souvenirs. On prtend que, chez les vieillards, la mmoire se rveille mesure que leurs sensations s'moussent. Mais il suffit, pour expliquer qu'ils voquent plus souvent que les autres un nombre peut-tre plus grand de souvenirs, de remarquer que leur intrt se dplace, que leurs rflexions suivent un autre cours, sans que flchisse d'ailleurs en eux le sentiment de la ralit. Bien au contraire les souvenirs sont d'autant plus nets, prcis et complets, imags et colors, que nos sens sont plus actifs, que nous sommes plus engags dans le monde rel, et que notre esprit, stimul par toutes les excitations qui lui viennent du dehors, a plus de ressort, et dispose pleinement de toutes ses forces. La facult de se souvenir est en rapport troit avec l'ensemble des facults de l'esprit veill : elle diminue en mme temps que celles-ci flchissent. Il n'est donc pas tonnant que nous ne confondions pas nos
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
28
souvenirs avec des sensations relles, puisque nous ne les voquons que lorsque nous sommes capables de les reconnatre, et de les opposer celles-ci. Tout ne se rduit pas, dans le cas de la mmoire, une simple lutte entre des sensations et des images ; mais l'intelligence tout entire est l, et si elle n'intervenait point, on ne se souviendrait pas. Voltaire aurait pu, dans un de ses Contes, imaginer un roi dchu, la merci de ses ennemis, enferm dans un cachot, auquel, par une fantaisie cruelle, celui qui l'a rduit en esclavage voudrait donner pour quelque temps l'illusion qu'il est encore roi, et que tout ce qui s'est pass depuis qu'il ne l'est plus n'est qu'un songe. Il sera plac, par exemple, pendant son sommeil, dans la chambre de son palais o il avait coutume de reposer, et o il retrouvera au rveil les objets et les visages accoutums. On prviendrait ainsi tout conflit possible entre les reprsentations de la veille et du souvenir, puisqu'elles se confondraient. Cependant, quelle condition obtiendra-t-on qu'il ne dcouvre pas tout de suite cette machination ? Il faudra qu'on ne lui laisse pas le loisir de se reconnatre, que des musiques, des parfums, des lumires blouissent et stupfient ses sens, c'est--dire qu'il faudra le maintenir en un tat tel qu'il soit incapable aussi bien de percevoir exactement ce qui l'entoure que d'voquer exactement le temps o l'on a voulu qu'il se croie transport. Ds que son attention pourra se fixer, ds qu'il rflchira, il sera de plus en plus loign de confondre cette fiction qu'on veut lui faire prendre pour son tat prsent avec la ralit de son pass telle que la lui reprsentera sa mmoire. Ce n'est pas en effet dans le spectacle qu'il voit aujourd'hui, qu'il a vu, presque exactement identique, autrefois, qu'il trouverait un principe de distinction. Tant que ce tableau reste en quelque sorte suspendu en l'air, ce n'est vrai dire ni une perception, ni un souvenir, c'est une de ces images du rve qui sans nous transporter dans le pass nous loignent cependant du monde actuel et de la ralit. On ne sait ce qu'il est que lorsqu'on l'a replac dans son entourage, c'est--dire lorsqu'on est sorti du champ troit qu'il dlimitait, qu'on s'est reprsent l'ensemble dont il fait partie, et qu'on a dtermin sa place et son rle dans cet ensemble. Mais pour penser une srie, un ensemble, qu'il s'agisse du pass ou du prsent, une opration purement sensible, qui n'impliquerait ni comparaison, ni ides gnrales, ni reprsentation d'un temps priodes dfinies, jalonn par des points de repre, ni reprsentation d'une socit o notre vie s'coule, ne suffirait pas. Le souvenir n'est complet, il n'est rel (dans la mesure o il peut l'tre) que quand l'esprit tout entier est tendu vers lui. Que cette reprsentation implicite d'une sorte de plan ou schma gnral o les images 1 qui se succdent dans notre esprit prendraient place, soit une condition plus ncessaire encore de la mmoire que de la perception, c'est ce qui rsulte de ce que les sensations se produisent d'elles-mmes avant que nous les ayons rattaches nos perceptions antrieures, avant que nous les ayons claires de la lumire de notre rflexion, tandis que le plus souvent la rflexion prcde l'vocation des souvenirs 2. Alors mme qu'un souvenir surgit d'une faon soudaine, il se prsente d'abord l'tat brut, isol, incomplet : et il est dans doute l'occasion pour nous de rflchir, de faon le mieux connatre et, comme on dit, le localiser ; mais tant que cette rflexion
D'aprs M. KAPLOUN (Psychologie gnrale tire de l'tude du rve, 1919, p. 83, 86) un souvenir ne revient pas d'abord dtach du pass, pour tre reconnu et localis aprs coup ; la reconnaissance et la localisation prcdent son image. Nous le voyons venir . En effet pour reconnatre et localiser, il faut que l'on possde, l'tat latent, le systme gnral de son pass . Un souvenir non reconnu n'est qu'une connaissance incomplte. Idem.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
29
n'a pas eu lieu, on peut se demander si, plutt qu'un souvenir, ce n'est pas une de ces images fugitives qui traversent l'esprit sans y laisser de traces. Dans le rve, au contraire, il y a bien de temps en temps une bauche de systmatisation; mais les cadres logiques, temporels, spatiaux, o se droulent les visions du sommeil sont trs instables. A peine peut-on parler de cadres : c'est plutt une atmosphre spciale, o peuvent clore les penses les plus chimriques, mais dont les souvenirs ne s'accommodent pas. Peut-tre devrions-nous tudier ici plus particulirement le souvenir des sentiments, Le souvenir d'une pense ou d'une sensation, si on les dtache des motions qui ont pu leur tre jointes, ne se distingue gure d'une pense ou d'une sensation nouvelle : le prsent ressemble tellement ici au pass que tout se passe comme si le souvenir n'tait qu'une rptition et non une rapparition de l'tat ancien. Il n'en est pas de mme des sentiments, surtout de ceux o il nous semble que notre personnalit, et un moment, un tat de celle-ci s'est exprim d'une manire unique et inimitable. Pour qu'on se les rappelle, il faut bien qu'ils renaissent en personne, et non sous les traits de quelque substitut. Si la mmoire des sentiments existe, c'est qu'ils ne meurent pas tout entiers, et qu'il subsiste quelque chose de notre pass. Mais les sentiments, pas plus que nos autres tats de conscience, n'chappent cette loi : pour s'en souvenir, il faut les replacer dans un ensemble de faits, d'tres et d'ides qui font partie de notre reprsentation de la socit. Rousseau, dans un passage de l'mile, o il imagine que le matre et l'enfant sont tous deux dans la campagne l'heure o le soleil se lve, dclare que l'enfant n'est pas capable d'prouver devant la nature des sentiments, et ne lui attribue que des sensations : pour que le sentiment de la nature s'veille, il faudra qu'il puisse associer le tableau qu'il a maintenant sous les yeux avec le souvenir d'vnements o il a t ml et qui s'y rattachent mais ces vnements le mettent en rapport avec des hommes la nature ne parle donc notre cur que parce qu'elle est, pour notre imagination, toute pntre d'humanit. Par un curieux paradoxe, l'auteur qui s'est prsent au XVIlIe sicle comme l'ami de la nature et l'ennemi de la socit est aussi celui qui a appris aux hommes rpandre la vie sociale sur un champ de nature plus tendu, et s'il a vibr au contact des choses, c'est qu'en elles et autour d'elles il dcouvrait des tres. capables de sentir et qu'on pouvait aimer. On a montr que l'branlement sentimental qui, l'occasion de la Nouvelle Hlose, ouvrit la socit du XVIIIe sicle une comprhension largie de la nature, fut dtermin en ralit et d'abord par l'lment proprement romanesque de ce roman lui-mme, et que si les lecteurs de Rousseau purent contempler sans aversion, tristesse ou ennui, avec sympathie, attendrissement et enthousiasme, des tableaux de montagnes, de forts, de lacs sauvages et solitaires, c'est que leur imagination les remplissait des personnages que l'auteur du livre avait crs, et qu'ils s'habituaient trouver, comme lui, des rapports entre les aspects de la nature matrielle et les sentiments ou les situations humaines 1. Si, d'ailleurs, les Confessions sont ce point vocatrices, n'est-ce pas parce que l'auteur nous y raconte, suivant l'ordre de leur succession, les faits grands et menus de sa vie, nous nomme et nous dcrit les lieux, les personnes, et que, lorsqu'il a prcise ainsi tout ce qui pouvait l'tre, il suffit qu'il nous indique en termes gnraux les sentiments qui en firent le prix pour lui, pour que nous sachions que tout ce qui
1
MORNET, Le sentiment de la nature en France de J.-J. Rousseau Bernardin de Saint-Pierre, Paris, 1907.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
30
demeurait de ce pass, tout ce qui s'en pouvait retrouver, nous est maintenant accessible ? Mais ce qu'il nous livre, c'est un ensemble de donnes dtaches de la vie sociale de son temps, c'est ce que les autres pensaient de lui, ou ce qu'il pensait des autres, c'est le jugement que tel de ceux qu'il a frquents aurait port sur lui, c'est en quoi il s'apparat semblable aux autres, en quoi diffrent d'eux. Ces diffrences mmes s'expriment par rapport la socit : Rousseau sent qu'il a pouss plus loin que les autres certains vices et certaines vertus, certaines ides et certaines illusions, qu'il nous suffit, pour les connatre, de regarder autour de nous ou en nous. Certes, de plus en plus il nous impose son point de vue sur cette socit, et, partir d'elle, c'est sur lui quo nous sommes toujours rejets : mais comme, hors ce point de vue, nous n'atteignons directement rien de lui-mme, c'est bien par l'ide seule qu'il s'est faite des hommes au milieu ou loin desquels il a vcu, que nous pouvons nous faire une ide de ce qu'il a t lui-mme. Quant ses sentiments, ils n'existaient dj plus au moment o il les dcrivait : comment donc en connatrions-nous rien d'autre que le tableau qu'il nous en prsente, et o il les a reconstitus sans avoir sous les yeux un modle ? On pourrait nous objecter que nous n'avons pas le droit de rduire l'opration de la mmoire une telle reconstruction. Nous nous en tenons aux moyens qui nous permettent, partant du prsent, d'y prparer la place qu'occupera le pass, d'orienter notre esprit d'une manire gnrale vers telle priode de ce pass. Mais, ces moyens mis en uvre, quand les souvenirs apparaissent, il ne sera peut-tre plus ncessaire de les rattacher pniblement les uns aux autres, de les faire sortir les uns des ,autres, par un travail de l'esprit comparable nos raisonnements. On suppose qu'une fois que le flot des souvenirs a pntr dans le canal que nous lui avons ouvert, il s'y engage et s'y coule de son propre mouvement. La srie des-souvenirs est continue. On dit volontiers que nous nous laissons aller au courant de nos souvenirs, au fil de la mmoire. Au lieu d'utiliser ce moment nos facults intellectuelles, il semble prfrable que nous les laissions dormir. Toute rflexion risquerait de faire dvier notre pense et notre attention : il vaut mieux alors tre passif, adopter l'attitude d'un simple spectateur, et couter les rponses qui viennent toutes seules la rencontre de questions que nous n'avons pas mme le temps de poser. Quoi d'tonnant, d'ailleurs, si passant ainsi en revue toute la suite des actes et des vnements qui ont rempli des annes, des mois, des jours couls, nous y retrouvons des traits et des caractres par lesquels ils dpassent le moment considr, et nous invitent les replacer dans des ensembles plus gnraux, la fois plus durables et plus impersonnels ? Comment en serait-il autrement, puisque nous prenons conscience, chaque moment, en mme temps que de ce qui se passe l'intrieur de notre moi, et qui n'est connu que de nous, de tout ce qui nous intresse de la vie des groupes ou des socits dont nous faisons partie ? Est-ce une raison pour croire que nous ne puissions aborder notre pass que par ce biais, et ne sommes-nous pas frapps au contraire de ce qu' mesure que nos souvenirs sont plus prcis et nombreux, ce n'est pas eux que nous replaons dans un cadre gnral et extrieur, mais ce sont ces traits et caractres sociaux qui prennent place dans la srie de nos tats internes, non pour s'en dtacher, mais pour s'y confondre ? En d'autres termes, une date ou un lieu acquiert ce moment pour nous une signification qu'il ne saurait avoir pour les autres. C'est par rflexion, condition de l'isoler de nos autres tats, que nous le penserions abstraitement, et qu'il s'identifierait ce qu'il est pour notre groupe. Mais, prcisment, lorsque nous voquons ainsi nos souvenirs, nous nous abstenons de rflchir sur eux, et d'envisager chacun d'eux isolment. Il y aurait, en d'autres termes, une continuit de souvenirs qui serait incompatible avec la discontinuit des cadres de la rflexion ou de la pense discursive.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
31
Il faut pourtant choisir ici entre deux conceptions. Si l'on entend, par : se souvenir, non pas reconstruire le pass, mais en outre, et mme exclusivement, le revivre, c'est bien un un au contraire, et isolment, que les divers vnements du pass devraient apparatre nouveau dans notre conscience. Alors mme qu'on n'admettrait pas qu'il y a de l'un l'autre une solution de continuit, comment contester en effet que chacun d'eux a occup en ralit un moment, et un seul, de la dure ? S'il est conserv dans la mmoire et s'il peut rapparatre tel qu'il a t, c'est en lui-mme et pour ce qu'il est, non en raison et par le moyen de ses rapports avec les autres, que nous l'voquons. Mais alors quelle diffrence y aurait-il entre un de ces souvenirs, et telles images qui reparaissent en rve, et qui sont manifestement dtaches de la srie de celles que conserve la mmoire ? Et pourquoi les souvenirs ne provoqueraient-ils pas les mmes illusions que les rves ? Ce qui fait prcisment que le rve est confondu avec la ralit, c'est que les images qui le composent, bien qu'elles appartiennent au pass, en sont dtaches ; qu'il s'agisse de l'image d'une personne connue, d'un lieu ou d'une partie d'un lieu o on a t autrefois, d'un sentiment, d'une attitude, d'une parole, elle s'impose nous, et on croit sa ralit, parce qu'elle est seule, parce qu'elle ne se rattache en rien nos reprsentations de la veille, c'est--dire a nos perceptions, et au tableau d'ensemble de notre pass. Il en est tout autrement des souvenirs. Ils ne se prsentent pas isolment. Alors mme que notre attention et notre intrt se concentrent sur l'un d'eux, nous sentons bien que d'autres sont l, qui s'ordonnent suivant les grandes directions et les principaux points de repre de notre mmoire, exactement comme telle ligne, telle figure se dtachent sur un tableau dont la composition gnrale nous est connue. Il est donc possible de choisir aussi entre deux conceptions pour expliquer pourquoi, comment on passe d'un souvenir l'autre. Si, lorsqu'on se souvient, on revivait les vnements passs, il faudrait admettre qu'on se transporte effectivement l'poque o ils se sont drouls, et on comprendrait alors que les mmes raisons qui ont dtermin jadis la succession de ces moments, l'apparition de l'un la suite de l'autre, pussent tre invoques pour expliquer la rapparition, dans le mme ordre, des mmes tats. Puisque nous n'examinerions pas ces tats du dehors, puisque nous serions en eux, nous n'aurions qu' laisser libre jeu la spontanit interne qui fait sortir les uns des autres, et qui ne suppose pas, en effet, tant qu'il ne s'agit pas de rflexions ou de raisonnements anciens et qu'on reproduirait, une activit rationnelle et des reprsentations gnrales. Mais si nous ne revivons pas le pass, si nous nous bornons le reconstruire, il faut expliquer ce qui est non plus ,un rappel l'existence, mais une reprsentation. Or, pour que des reprsentations d'vnements distincts et successifs se produisent dans un ordre donn, il faut que nous ayons sans cesse prsente l'esprit l'ide de cet ordre, tandis que nous allons la recherche des reprsentations qui s'y conforment. En d'autres termes, pour que nous nous rappelions une suite d'vnements, par exemple ceux qui ont occup pour nous le premier mois de la guerre, il faut que nous nous posions des questions comme celles-ci : o tais-je avant la mobilisation, au moment o on a appris l'issue de la bataille de Charleroi, quand Paris tait menac, etc. ? Et il faut que nos souvenirs s'accordent avec ces dates, qui ont une signification sociale, de mme que nos dplacements, nos sjours ici et l, proximit de tels parents, de tels amis, ou loin d'eux, doivent s'accorder avec la distribution gnrale des lieux, telle qu'on se la reprsente dans notre socit. Ou bien, si l'on reproche cet exemple d'tre choisi pour mettre au premier plan des faits d'une porte gnrale, demandons-nous comment nous nous reprsentons, aprs qu'il s'est produit, un fait qui n'intresse que nous, qui n'a peut-tre laiss de traces qu'en nous, la mort d'une personne qui nous est proche. Alors, si nous voulons nous rappeler la tristesse, la douleur, d'une intensit et d'une nuance dtermine, ressentie par
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
32
nous, nous ne pourrons pas l'voquer isolment, mais il nous faudra prendre un dtour : nous ne partirons point de ce qu'il y a de plus personnel dans l'vnement, de notre raction affective, mais nous songerons d'abord la succession de la maladie, des derniers moments, des funrailles, du deuil, ou encore aux parents et aux amis du mourant, ou encore l'endroit o il habitait, la ville o nous avons d nous rendre pour le voir avant sa fin, et, pour l'voquer mieux lui-mme, nous songerons son ge, sa profession, aux traits gnraux de son caractre et de son existence ; ce qui n'empchera pas, bien entendu, que nous nous rappelions aussi tel ou tel dtail plus intime, par exemple qu'il nous avait tenu peu auparavant tel propos, ou plus concret et individuel, par exemple qu'il y avait sur la table une lettre de lui inacheve, et qu'on retrouvait encore sa prsence dans l'ordre ou le dsordre qui y rgnait, etc. ; mais ce dtail ne prendra toute sa valeur que quand nous nous en reprsenterons le lieu et la date, et que nous y penserons dans ses rapports avec l'vnement ; car, en lui-mme, il resterait insignifiant : or, on rve bien de dtails insignifiants, mais on ne s'en souvient pas. On ne se rend pas compte de tout le travail d'esprit qu'exige le rappel d'un souvenir. On croit qu'il suffit qu'il fasse partie d'une srie chronologique pour que l'apparition de ceux qui l'ont prcd l'appelle sur la scne de la conscience. A quel point cela serait insuffisant, c'est bien ce qui rsulte du rve. Nous rvons beaucoup ; or combien de personnes croient qu'elles ne rvent jamais ! Et combien de nos rves dont nous ne nous rappelons que quelques dtails! Or les images du rve obissent peut-tre, lorsqu'elles s'associent, une logique spciale : cri tout cas, elles ne sont point replaces dans le mme temps et dans le mme espace que les objets que nous percevons quand nous sommes veills, et elles ne sont point rattaches l'ensemble de nos ides, qui dtermine chaque moment notre conception du monde et de la socit. Si nous ne les situons point dans le temps de la veille, il n'en reste pas moins vrai qu'elles occupent de la dure, et qu'elles se succdent. Mais si les images se disposaient dans la mmoire les unes la suite des autres au fur et mesure de leur production, il en serait de mme des images du rve, et nous pourrions les retrouver les unes l'occasion des autres, en nous demandant seulement : qu'avons-nous rv avant, ou aprs ? Mais c'est prcisment parce qu'il n'y a gure entre les images du rve qu'un lien de succession chronologique que, pour la plus grande partie, elles nous chappent. Il semble au contraire que celles que nous nous rappelons nous cachent les autres, et qu'il faille nous carter des unes, les oublier, modifier l'orientation de nos penses, pour retrouver, par hasard, une autre srie des tableaux de notre vie nocturne. Il faut donc que, s'il n'en est pas de mme des images de la veille, si nous nous en rappelons un si grand nombre, s'il n'y a rellement pas dans notre vie de lacune que nous ne puissions combler, nous nous guidions sur d'autres rapports que de succession dans le temps, pour passer d'un souvenir l'autre. Comment nous rappellerions-nous de la mme manire telles images vues en rve, si nous pouvons parcourir en pense toutes les parties de l'espace o se sont encadrs les vnements les plus rcents de notre exprience, sans trouver en aucun d'eux quelque amorce de ces images, ni rien qui paraisse en rapport avec notre rve ? Au contraire, lorsque nous voquons une ville, ses quartiers, ses rues, ses maisons, que de souvenirs surgissent, dont beaucoup nous semblaient jamais disparus, qui nous aident leur tour en dcouvrir d'autres ! Ainsi nous allons vers nos souvenirs en dcrivant en quelque sorte autour d'eux des courbes concentriques de plus en plus rapproches, et loin que la srie chronologique soit donne d'abord, c'est souvent aprs bien des alles et venues entre tels points de repre au cours desquelles nous
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
33
retrouvons les uns et les autres, que nous rangeons nos souvenirs dans l'ordre de succession o tout indique qu'ils ont d se produire.
* ** I - iv
Retour la table des matires
Rsumons toute cette analyse et les rsultats o elle nous a conduits. Elle repose tout entire sur un fait, qu'elle oppose une thorie. Ce fait, c'est que nous sommes incapables de revivre notre pass pendant le rve 1, c'est que, si nos songes mettent bien en uvre des images qui ont toute l'apparence de souvenirs, c'est l'tat de fragments, de membres dtachs des scnes rellement vcues par nous, qu'ils s'y introduisent : jamais un vnement accompagn de toutes ses particularits, et sans mlange d'lments trangers, jamais une scne complte d'autrefois ne reparat aux yeux de la conscience durant le sommeil. Nous avons examin les exemples qui prouveraient le contraire. Les uns taient trop inexactement ou incompltement rapports pour qu'on pt en saisir le sens. Dans d'autres cas, on tait fond supposer qu'entre l'vnement et le rve l'esprit avait rflchi, sur ses souvenirs, et, du fait qu'il les avait voqus une ou plusieurs fois, les avait transforms en images. Or, est-ce l'image, estce le souvenir qui l'avait prcde et en avait t l'occasion, qui reparaissait dans le songe ? L'un paraissait aussi vraisemblable que l'autre. On invoquait, enfin, des souvenirs de la premire enfance, oublis pendant la veille, et qui traverseraient certains rves : mais il s'agissait de reprsentations certainement trop vagues chez l'enfant pour qu'elles aient pu donner lieu des souvenirs vritables. Au reste dans tous ces cas, et dans tous les rves imaginables, comme la personnalit actuelle et non celle d'autrefois est activement mle au rve, il ne se peut pas que l'aspect gnral des vnements et des personnes reproduites ne s'en trouve pas altr. Ici, nous rencontrions la thorie de M. Bergson, qui, nous a-t-il sembl, n'admet pas qu'il y ait une incompatibilit si marque entre le souvenir et le rve, qui, sous le nom d'images-souvenirs, dsigne notre pass lui-mme, conserv au fond de notre mmoire, et o l'esprit, alors qu'il n'est plus tendu vers le prsent, et que l'activit de la veille se relche, devrait tout naturellement redescendre. Ceci est une consquence tellement ncessaire de sa conception de la mmoire, que M. Bergson, constatant qu'en fait les souvenirs-images ne reparaissent pas dans les rves, remarque toutefois : Quand on dort profondment, on fait des songes d'une autre nature, mais il n'en reste pas grand'chose au rveil. J'incline croire - mais pour des raisons surtout thoriques, et par consquent hypothtiques - que nous avons alors une vision beaucoup plus tendue et plus dtaille de notre pass 2. C'est qu'en effet, d'aprs lui, le
1
LUCRCE avait dj observ ce fait. Pendant le rve, dit-il, ... meminisse jacet, languetque sopore. La mmoire est ce point inerte et assoupie que le rveur ne se rappelle pas quelquefois qu'une personne qui lui apparat vivante est morte depuis longtemps, De natura rerum, IV, 746. Ce passage nous a t obligeamment signal par M. PRADINES. BERGSON, L'nergie spirituelle, 7e dition, Paris, 1922, p. 115.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
34
moi des rves, c'est la totalit de mon pass 1. Et il ne manque point, d'autre part, de passages o le mme auteur, envisageant la premire des deux mmoires qu'il distingue, celle qui enregistrerait, sous forme d'images-souvenirs, tous les vnements de notre vie quotidienne, et laisserait chaque fait, chaque geste, sa place et sa date, la rapproche du rve. Pour voquer le pass sous forme d'image, il faut pouvoir s'abstraire de l'action prsente, il faut savoir attacher du prix l'inutile, il faut vouloir rver... En se reproduisant dans la conscience (ces images-souvenirs) ne vontelles pas dnaturer le caractre pratique de la vie, mlant le rve la ralit? Sans doute ce sont (les images emmagasines par la mmoire spontane) des images de rve 2. Et, plus loin : Ces images passes, reproduites telles quelles, avec tous leurs dtails et jusqu' leur coloration affective, sont les images de la rverie ou du rve. Plus loin, encore : Un tre humain qui rverait son existence au lieu de la vivre tiendrait sans doute ainsi sous son regard, tout moment, la multitude infinie des dtails de son histoire passe 3. Mais rien ne prouve qu'on puisse passer ainsi par transition insensible du rve au souvenir-image. Comment le rve, mme la limite, se confondrait-il avec de tels souvenirs, si ce qui nous frappe, quand nous y pensons, c'est qu'il a toujours les caractres d'un fait prsent, nouveau, que nous voyons pour la premire fois, s'il nous donne le spectacle d'une cration incessamment continue ? Quand M. Bergson rapproche les deux termes : rve et rverie, il sait bien que le mot rver dsigne deux oprations diffrentes, mais il estime que le langage a raison, puisque, d'aprs lui, dans les deux cas, l'esprit procde de mme, puisque se souvenir, c'est rver veill, puisque rver c'est se souvenir pendant le sommeil. Pourtant, ce rapprochement, si dlibr soit-il, n'en reste pas moins une confusion. Que l'esprit s'observe lorsqu'il passe de la veille au rve, du rve la pense de la veille, et il apercevra que celle-ci se dveloppe dans des cadres sans rapport avec ceux de la pense nocturne, si bien qu'on ne comprend mme pas comment, une fois veill, on ,peut se souvenir de ses rves. Nous avons montr qu'en effet, et si l'on veut parler en 'toute rigueur il faut dire qu'on ne s'en souvient pas, ou plutt qu'on ne se souvient que de ce qu'on en a pu fixer aussitt aprs le rveil. L'opration de la mmoire suppose en effet une activit la fois constructive et rationnelle de l'esprit dont celui-ci est bien incapable pendant le sommeil : elle ne s'exerce que dans un milieu naturel et social ordonn, cohrent, dont nous reconnaissons chaque instant le plan d'ensemble et les grandes directions. Tout souvenir, si personnel soit-il, mme ceux des vnements dont nous seuls avons t les tmoins, mme ceux de penses et de sentiments inexprims, est en rapport avec tout un ensemble de notions que beaucoup d'autres que nous possdent, avec des personnes, des groupes, des lieux, des dates, des mots et formes du langage, avec des raisonnements aussi et des ides, c'est--dire avec toute la vie matrielle et morale des socits dont nous faisons ou dont nous avons fait partie. Quand nous voquons un souvenir, et quand nous le prcisons en le localisant, c'est--dire, en somme, quand nous le compltons, on dit quelquefois que nous le rattachons ceux qui l'entourent : en ralit, c'est parce que d'autres souvenirs en rapport avec celui-ci subsistent autour de nous, dans les objets, dans les tres au milieu desquels nous vivons, ou en nousmmes : points de repre dans l'espace et le temps, notions historiques, gographiques, biographiques, politiques, donnes d'exprience courante et faons de voir
1 2 3
Ibid., p. 110. Matire et mmoire, 2e dition, Paris, 1900, p. 78 et suiv. Ibid., p. 169.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
35
familires, que nous sommes en mesure de dterminer avec une prcision croissante ce qui n'tait d'abord que le schma vide d'un vnement d'autrefois. Mais, puisque le souvenir doit ainsi tre reconstruit, on ne peut pas dire, sinon par mtaphore, qu' l'tat de veille nous le revivons ; il n'y a pas non plus de raison d'admettre que tout ce que nous avons vcu, vu et fait, subsiste tel quel, et que notre, prsent trane derrire lui tout notre pass. Ce n'est pas dans la mmoire, c'est dans le rve, que l'esprit est le plus loign de la socit. Si la psychologie purement individuelle cherche un domaine o la conscience se trouve isole et livre elle-mme, c'est dans la vie nocturne, c'est l seulement qu'elle aura le plus de chance de le trouver. Mais, loin d'tre alors largie, dbarrasse des limitations de la veille, et de regagner en tendue ce qu'elle perd en cohrence et en prcision, la conscience parait alors singulirement rduite et rtrcie : dtaches presque entirement du systme des reprsentations sociales, les images ne sont plus que des matriaux bruts, capables d'entrer dans toute espce de combinaisons, et entre elles il ne s'tablit que des rapports fonds sur le hasard, en ralit sur le jeu dsordonn des modifications corporelles. Sans doute elles se droulent suivant un ordre chronologique : mais entre la file des images successives du rve, et la srie des souvenirs, il y a autant de diffrence qu'entre un tas de matriaux mal dgrossis, dont les parties superposes glissent l'une sur l'autre, ou ne restent en quilibre que par accident, et les murs d'un difice maintenus par toute une armature, et tays d'ailleurs ou renforcs par ceux des difices voisins. C'est que le rve ne repose que sur lui-mme, alors que nos souvenirs s'appuient sur ceux de tous les autres, et sur les grands cadres de. la mmoire de la socit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
36
Chapitre II
Le langage et la mmoire
Retour la table des matires
Nous disions dans le chapitre prcdent que, lorsqu'il rve, l'homme cesse d'tre en contact avec la socit de ses semblables. N'allions-nous pas trop loin, et, mme dans le sommeil, une partie des croyances et des conventions des groupes au milieu desquels il vit ne s'imposent-elles pas encore lui ? Sans doute, il doit y avoir un grand nombre de notions communes au rve et la veille. S'il n'existait aucune communication entre ces deux mondes, si l'esprit ne disposait pas des mmes instruments pour comprendre ce qu'il aperoit dans l'un et dans l'autre, il se rduirait dans le rve au genre d'activit consciente qu'on peut attribuer certains animaux, et peut-tre aux tout petits enfants, il ne donnerait pas aux objets, aux personnes et aux situations peu prs les mmes noms, il ne leur prterait pas le mme sens que lorsqu'il les rencontre pendant la veille, et il ne serait pas en mesure de raconter ses songes. Examinons de ce point de vue l'analyse dtaille d'un rve assez complexe qu'on trouve dans un ouvrage de Freud 1 : nous n'en retiendrons que les parties qui nous
1
Die Traumdeutung, 1re dition, 1900, p. 67. On trouvera un expos du rve en question, qui suit de trs prs le texte de Freud et reproduit tout l'essentiel de son analyse, dans le livre du Dr Ch. BLONDEL, La psychanalyse, Paris, Alcan, 1924, pp. 160-192. Ce chapitre tait crit quand nous
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
37
intressent, et nous nous arrterons d'ailleurs au moment o les hypothses de l'auteur nous paraissent un peu aventures, c'est--dire bien en de du point jusqu'o Freud poursuit son interprtation. Freud raconte qu'il avait trait prcdemment une jeune femme qu'il croyait hystrique. Leurs deux familles taient intimement lies. Comme elle tait presque entirement gurie, on interrompit le traitement, non sans que Freud et essay de faire accepter la malade une solution qu'elle refusa. L-dessus, il reoit la visite d'un jeune collgue, Otto, qui lui dit, d'un ton qui lui dplat, qu'elle va mieux, mais n'est pas tout fait bien. Il croit qu'Otto s'est laiss influencer par des parents de la malade, qui ne voyaient pas d'un bon oeil le traitement. Le mme soir, pour se justifier, il crit l'histoire de la maladie d'Irma un ami commun, le Dr M... La nuit suivante, il se voit, en rve, dans un grand hall, o ils reoivent beaucoup d'invits. Irma est l : Je la prends aussitt part, pour rpondre sa lettre, et lui faire des reproches de ce qu'elle n'a pas encore accept la solution . Je lui dis : Si tu as encore des douleurs, c'est vraiment ta faute. Elle rpond : Si tu savais comme je souffre maintenant dans le cou, l'estomac et le corps, je suis comme dans un tau. Je m'inquite et je la regarde. Elle parat ple et bouffie : je me dis qu'il y a l quelque chose d'organique. Je la conduis prs de la fentre, et j'examine l'intrieur de sa gorge... J'appelle vite le Dr M... qui reprend l'examen et confirme... Le Dr M... parat tout autre que d'ordinaire ; il est ple, il boite et n'a pas de barbe... Mon ami Otto est maintenant aussi ct d'elle... M... dit : Il n'y a aucun doute, c'est une infection, mais cela ne fait rien, elle va avoir de la dysenterie et le poison s'vacuera... Nous devinons immdiatement d'o vient l'infection. L'ami Otto lui a fait, il n'y a pas longtemps, une injection avec un compos propylique, du propylne... de l'acide propionique, de la trimthylamine (dont je crois voir la formule imprime en caractres gras). On ne fait pas si la lgre de telles injections... Il est vraisemblable que la seringue n'tait pas propre. Freud interprte ce rve comme la ralisation d'un vu dgager sa responsabilit, tablir que si le traitement n'a pas russi, c'est qu'Irma tait atteinte d'une maladie organique, expliquer qu'elle aille plus mal par l'intervention maladroite et imprudente d'Otto. Mais, ce qui nous intresse, c'est moins l'explication qu'en donne l'auteur que certaines donnes qu'on y retrouve, et dont on ne peut contester la ralit. C'est le groupe dont font partie Irma, Otto, le Dr M..., Freud lui-mme, avec les rivalits qui s'y dveloppent, les jugements que chacun porte sur les autres (le Dr M..., la personnalit la plus coute de leur cercle ; Otto et d'autres collgues, qui ne connaissent pas l'hystrie, et dont Freud se moque, etc.) ; ce sont les relations intimes entre la famille d'Irma et la sienne, qui expliquent qu'il la tutoie, et qu' propos d'elle il pense, comme nous le verrons, sa femme, sa fille ; c'est tout un ensemble de notions mdicales, chimiques, etc., qui dfinissent une profession; c'est un cas de conscience professionnelle, avec toutes les rgles et principes qu'il met en cause : toutes donnes collectives, qui ont pntr dans la conscience isole du rveur, et qui ne pouvaient provenir que du milieu social de la veille. Il suffit d'ailleurs de noter ses rves, de les passer ensuite en revue et de les comparer : on s'apercevra que, dans la plupart d'entre eux, entrent des notions d'un caractre plus ou moins gnral, qui permettraient de les classer suivant qu'ils se rapportent tels groupes de parents, d'amis, de collgues, telles particularits de notre existence professionnelle, tel ordre de faits, sentiments, occupations, tudes, distractions, voyages, et, encore, tels ou tels lieux qui ont une signification sociale dfinie,
l'avons lu. il nous a permis du moins de rendre avec plus d'exactitude un certain nombre d'expressions, dans les passages de Freud que nous avions traduits.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
38
notre maison, certains quartiers ou certaines rues d'une ville, certaines rgions, enfin telles ou telles catgories d'tres humains, enfants, vieillards, marchands, gens du monde, savants, etc. Bien entendu, le mme rve entre la fois dans plusieurs de ces catgories ; mais c'est une raison de plus pour croire que les images du rve ne sont point comme autant de crations individuelles o nous ne retrouverions que nous. Il y aurait donc, au moins l'tat latent, dans notre conscience, derrire les images de nos rves, des penses qui nous permettraient de les reconnatre, de les rattacher d'autres qui nous sont familires, en d'autres termes, de les comprendre. Cependant, le rapport entre la pense et l'image parat moins prcis, plus lche, dans le rve qu' l'tat de veille. L'analyse qu'a donne Freud du rve que nous avons reproduit plus haut nous permet dj de le reconnatre. Voici d'abord Irma : la manire dont elle se tient, accoude la fentre, lui rappelle une de ses amies, qui est hystrique comme elle : en ralit il a remplac, dans son rve, Irma par son amie. Elle lui parat ple, comme la femme de Freud : n'a-t-il pas substitu sa femme Irma ? Mais Irma se confond aussi avec sa fille ane, puisque celle-ci prsente les symptmes qu'on relve chez Irma pendant le rve 1. Le Dr M... est ple, sans barbe, il boite (dans le rve) : ces deux derniers traits se rapportent au frre an de Freud ; il en veut d'ailleurs en ce moment l'un et l'autre : le Dr M... est donc son frre ; il met, en outre, dans la bouche du Dr M... des paroles qui lui ont t dites par un autre de ses collgues : nouvelle substitution. Ainsi, derrire un mme nom, il faut chercher plusieurs personnages, qui sont tout prts d'ailleurs a se transformer l'un dans l'autre. Mais il en est de mme de la plupart des vnements et des objets de nos songes. Souvent, nous retrouvons sans peine, au rveil, un vnement des jours prcdents dont notre rve reproduit tel dtail : nous ne nous y trompons pas, semble-t-il ; il s'agit d'un geste trop expressif, d'une nuance de sentiment trop dfinie, d'une image trop pittoresque, et surtout d'un souvenir trop rcent, pour que nous attribuions au hasard une telle rencontre. Toutefois, rflchissons-y quelque temps, et nous dcouvrirons que le mme dtail se rapporte aussi quelque autre scne de la veille, fort diffrente. Et nous demeurerons perplexe. Je me vois, en rve, auprs d'un mt ou d'un poteau, dress pour quelque ,opration aronautique. C'est termin, et je l'emporte sur mon paule. Rveill, je me souviens que j'ai lu, la veille, dans le Rameau d'Or, de Frazer, des histoires de ftes de mai, o l'on portait en procession et o l'on dressait des arbres, des pins, des mts. C'est bien cela, j'y suis, c'est cette lecture qui explique mon rve. Mais il me revient aussi que, le mme jour, on a mont des meubles dans notre appartement : des hommes portaient sur leurs paules les pices dmontes d'une armoire, des planches, des ais. Tel pourrait tre aussi le point de dpart de ce que j'ai imagin en songe. Et il se pourrait, enfin, qu'aucune de ces deux explications ne ft exacte, et qu'un dtail plus insignifiant encore, et qui lui chappe en ce moment, ait orient la pense du rveur de ce ct. De ces cas et ils sont nombreux, o l'on ne sait si, de tels faits et de telles situations de la veille, c'est celui-ci, ou celui-l, ou tel autre qui s'est reproduit dans le rve, on pourrait conclure qu'il y a effectivement, derrire l'image aperue en rve, une notion plus ou moins gnrale, et que l'image elle-mme, parce qu'elle se borne
1
La plaque diphtrique d'Irma rappelle les inquitudes causes Freud par sa propre fille, et Irma en vient reprsenter celle-ci, derrire laquelle se dissimule son tour, grce la similitude des prnoms, une malade morte d'intoxication... Toutes ces personnes qui se rvlent ainsi l'analyse d'Irma n'interviennent pas directement dans le rve. Elles se cachent derrire Irma, qui devient la reprsentante de ces autres personnes sacrifies au cours du travail de condensation. BLONDEL, Op. cit., p. 182.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
39
figurer la notion, parce qu'elle se confond en partie avec elle, ressemble plus un symbole simplifi qu' une peinture vivante et qui ne reproduirait qu'un seul aspect des choses 1. Dans les exemples que nous avons dj tudis, que reprsente Irma, si ce n'est une malade en gnral, avec peut-tre telle particularit physique, tel trait de caractre, mais qui ne suffisent pas l'individualiser ? Qu'est-ce qu'Otto, sinon un homme de la mme profession que le rveur, un mdecin que celui-ci considre sans bienveillance, parce que c'est un concurrent, et que leurs diagnostics ne concordent pas quelquefois : mais plusieurs individus rpondent cette description, qui n'est pas un portrait. Otto n'est ici qu'un symbole. Les appareils d'aviation que j'ai vus en rve offraient simplement l'aspect d'agrs, faits pour tre dresss et ports ; les mmes proprits appartiennent beaucoup d'autres dispositifs matriels de destination varie : piquets sur un champ de course, croix dans une glise, chafaudages, potence, aussi bien qu'arbres et mts ; mon rve n'est que la transposition image d'une pense qui comprenait peut-tre toute cette catgorie d'objets. La Bible nous raconte ce que le Pharaon vit, dans son sommeil : Il me semblait que j'tais debout sur le bord d'un fleuve et 7 vaches montaient de ce fleuve, belles et pleines d'embonpoint, qui paissaient dans les pturages d'un marais , etc., et plus loin: Je vis un songe: 7 pis pleins, et d'une merveilleuse beaut, sortaient d'une seule tige. Des ides de fcondit, de richesse, d'une nature qui donne des fruits en abondance viennent tout de suite l'esprit. Certainement, si le Pharaon a eu ce rve, ce n'est point parce qu'il a vu, les jours prcdents peut-tre, des vaches monter dans un pturage (sauf leur nombre, rien n'individualise vraiment une telle scne), et ce n'est pas ncessairement (comme l'expliquerait Freud) qu'il portait dans son esprit une proccupation cache que Joseph se serait born lui rvler. Il suffit que, par hasard, l'ide de l'abondance et l'ide de la disette, l'ide de la richesse et l'ide de la pauvret se soient succd dans sa pense, pour qu'elles s'y soient traduites sous cette forme symbolique. Qu'il se mle, aux images de nos rves, beaucoup de rflexions, que nous passions insensiblement et sans cesse, tandis que nous dormons, de penses pures et simples des images, et inversement, c'est ce qui explique que, parfois, on ne sait pas trs bien si on a raisonn ou suivi une ide en rve, ou dans un ,tat de demi-somnolence, ou mme alors qu'tant veill on s'absorbait en quelque mditation. Lorsqu'on va s'endormir, dans les instants qui prcdent le sommeil, il arrive qu'une pense, pense d'un acte, d'un vnement, paraisse se dtacher de la suite de nos rflexions, et se transposer demi, lorsque nous nous endormons, en un acte ou un vnement rel. Si nous nous rveillons brusquement alors, ou si nous luttons encore confusment contre le sommeil, quelquefois nous ressaisissons cette pense au moment o l'image allait se dissiper et s'vanouir. Nous nous apercevons alors que celle-ci n'tait rien d'autre que la figuration d'une pense que la conscience n'atteignait plus, de mme que certains corps ne brillent nos yeux qu'au moment o nous ne percevons plus le foyer lumineux qui les claire.
On en trouverait la preuve dans certains rves qui se suivent immdiate-ment, ou dans plusieurs parties d'un mme rve, o la mme ide, concrte ou abstraite, se ralise sous des formes assez diffrentes. Par exemple : Rve absurde : je suis sur la plate-forme de l'orgue, dans une glise, En bas, il y a des gens qui semblent d'un autre ge (Second Empire ?) Je suis oblig de des cendre dans une sorte de boyau, tir par quelqu'un qui me dit qu'il est (ou je pense qu'il est) mon corps, tandis que je suis mon me, qui le rejoint (j'ai parl hier de la mtempsycose avec un de mes amis). Plus tard, je me trouve avec des ouvriers en pays de montagne, sur une plate-forme : il y a un trou que n'entoure aucune barrire, qui regarde sur un abme, et un ouvrier se penche au-dessus. il devait y avoir dans l'esprit une reprsentation schmatique qui se ralise sous la forme successivement d'un escalier en boyau et d'un trou ou d'une crevasse de montagne.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
40
On a remarqu souvent qu'un sentiment ou une sensation organique peut pendant le rve se dvelopper en une srie d'images qui le symbolisent : les figures difformes qui peuplent quelquefois nos cauchemars, et par lesquelles on a voulu expliquer les monstres et gnies malfaisants rencontrs dans les superstitions populaires, figureraient nos oppressions et nos malaises. Entre la vision du cauchemar et l'impression organique pnible il y a pntration rciproque : quelquefois, quand nous nous rveillons brusquement aprs un rve douloureux ou terrifiant, il nous reste un sentiment d'angoisse, qui nous semble caus par le rve, jusqu' ce que nous nous apercevions que l'angoisse tient un tat organique pnible, qu'elle devait exister avant le rve, de mme qu'elle lui survit, et que l'angoisse tait la cause, et le rve, l'effet. Il est plus difficile de retrouver, au rveil, une pense dont le rve n'a t que la figuration : la pense, plus instable que le sentiment, disparat en gnral en mme temps que les scnes qui l'ont illustre. Cependant, dans le rve lui-mme, le caractre symbolique de l'image se dcouvre quelquefois, quand la pense est trop abstraite pour se fondre avec l'image jusqu' se perdre en elle, et nous apercevons en mme temps les lments de sensation dont la pense s'est empare, et auxquels elle a tent d'imposer sa forme, lorsqu'elle s'efforait de s'extrioriser. Voici deux exemples o, nous semble-t-il, on peut saisir cette opration sur le vif : Cela commence par une sorte de calcul appliqu mes mouvements, comme si je me posais le problme : bouger le moins possible, de faon carter cependant telle couverture, etc. Et la solution se prsente sous la forme de celle d'un problme d'algbre que j'ai trait ces jours-ci. L'attitude intellectuelle de la veille (recherche d'un problme) avait pntr dans le rve : mais ce n'tait qu'une attitude, elle ne s'encadrait pas dans un ensemble de notions mathmatiques comme lorsque je rflchissais ce problme durant la veille. Il a suffi qu'une ,autre notion, le sentiment de ma position dans le lit, dtache d'ailleurs, elle aussi, du tableau o elle est comprise dans la conscience de l'homme veill, la rencontre, pour que l'une et l'autre se pntrent, et que leur combinaison s'exprime par l'image d'un acte ou d'une opration ce point bizarre. Autre exemple : J'ai pass la matine corriger des prouves. Je rve que je lis mon article avec un philosophe idaliste et que nous changeons nos rflexions. Nous examinons ensemble mon point de vue, nous le dominons : notre pense s'lve. Et voil que, soudain, nous nous levons, je ne sais comment, jusqu' une lucarne ; nous passons au travers, et nous grimpons, le long de la pente du toit, toujours plus haut. L'ide d'une pense qui s'lve ne peut tre qu'une ide. Si elle s'est ainsi figure, et si j'ai pris la figure au srieux, peut-tre est-ce parce que le sentiment que j'tais en un lieu dfini, en tout cas dans l'espace, se trouvait en mme temps dans ma pense. veill, j'aurais replac l'une et l'autre dans les cadres (extrieurs l'un l'autre, mais simultans et juxtaposs) qui enferment d'une part mes penses, d'autre part mes sensations. Dtaches de leur cadre, ces deux notions se sont fondues comme elles l'ont pu : d'o cette mtaphore vcue. Si les psychologues n'ont pas remarqu d'ordinaire la place considrable que la rflexion et la pense toute nue occupent dans notre vie nocturne, c'est d'abord qu'ils se sont borns, lorsqu'ils dcrivaient leurs rves, raconter simplement ce qu'ils ont vu ou fait, comme si le contenu de nos songes se ramenait des sries d'images telles que celles qui dfilent dans notre esprit quand nous sommes veills et que nous percevons le monde sensible. La littrature du rve consiste presque tout entire en histoires d'vnements qui ne diffrent de ceux que nous prsente la veille que par leur incohrence et leur tranget. Il semble, les lire, que l'homme endormi se borne vivre une autre existence, comme s'il lui tait donn, pendant la nuit, de se ddoubler : le monde du rve serait aussi color et aussi sensible, dans toutes ses parties,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
41
que le monde de la veille. Cependant, ct des images illusoires, mais vives et assez nette-ment dessines, et, quelquefois, dans l'intervalle de celles-ci, ou engages en elles, il y a dans le rve bien des reprsentations mal dfinies, qui imitent le jeu de la pense, la rflexion, le raisonnement. Pourquoi nous les rappelons-nous moins facilement au rveil, si bien que ce qui nous reste d'un rve, ce sont des scnes comparables celles de la veille, et pourquoi supposons-nous qu'entre ces scnes, entre les tableaux qui les composent, il n'y a eu que des lacunes, et non une continuit de pense ? C'est que, dj, nous avons de la peine nous rappeler le cours de nos penses pendant la veille. A dfaut de vivacit sensible, le lien plus ou moins logique qui les rattache nous aide cependant les reconstituer. Mais les penses du rve sont incohrentes, comme les images du rve : elles manquent de logique (ou du moins elles obissent une logique assez dconcertante), en mme temps que de couleur et de dessin, puisque ce sont des penses : de tous les tats psychologiques, du rve aussi bien que de la veille, ce sont elles qu'il est le plus difficile de se rappeler. Mais, surtout, on s'est trop aisment figur que lorsque l'homme a ferm les yeux, lorsque son appareil nerveux a cess, d'une faon ou de l'autre, de ragir aux excitations venues du dehors, il ne peut parvenir a sa conscience que de vagues impressions visuelles, tactiles, olfactives, organiques, trop rudimentaires pour apporter avec elles une notion de l'objet ou de l'ensemble d'objets dont elles manent. A la rencontre de ces impressions discontinues, nullement lies les unes aux autres, et qui n'ont en elles-mmes aucun sens, viendraient automatiquement, du fond de la mmoire, les images qui s'accordent avec elles, qui, comme dit M. Bergson, peuvent le mieux s'insrer dans l'attitude corporelle correspondante . Les impressions offriraient ces images un corps, c'est--dire le moyen de s'actualiser ; ainsi s'expliquerait que des images nous apparaissent, et aussi qu'elles se succdent d'une faon incohrente. Parmi les souvenirs-fantmes, dit M. Bergson, qui aspirent se lester de couleur, de sonorit, de matrialit enfin, ceux-l seuls y russiront qui pourront s'assimiler la poussire colore que j'aperois, les bruits du dehors et du dedans que j'entends, etc., et qui, de plus, s'harmoniseront avec l'tat affectif gnral que mes impressions organiques composent. Quand cette jonction s'oprera entre le souvenir et la sensation, j'aurai un rve 1. Ainsi les souvenirs ressembleraient ces ombres qui viennent de tous cts, du fond de l'rbe, se pressent autour de la fosse creuse par Ulysse, et cherchent boire le sang des victimes pour reprendre quelque apparence de vie. Seulement, ces ombres tirent en ralit toute leur substance des croyances religieuses qu'Ulysse a apportes avec lui du monde des vivants. Et il en est sans doute de mme de ces souvenirsfantmes. Les lments de sensation qui pntrent en nous pendant le sommeil leur donnent peut-tre plus de consistance. Mais ils tirent leur tre et leur vie des ides ou des rudiments d'ides que nous apportons du monde de la veille. Si le rve rsultait en effet d'une rencontre et d'une jonction entre le souvenir conserv tel quel dans la mmoire et un rudiment de sensation, il faudrait que, pendant le rve, nous apparaissent des images que nous reconnatrions comme des souvenirs, et non pas, seulement, dont nous comprendrions le sens. Les conditions sont des plus favorables, puisque ces impressions vagues, taches colores mouvantes, bruits confus, ouvrent l'accs de la conscience tous ceux des souvenirs qui s'accommodent d'un cadre aussi large. Or, nous l'avons vu, on ne trouve point parmi les images du rve de souvenirs proprement dits, c'est--dire qu'on puisse, au rveil, reconnatre et
1
BERGSON, L'nergie spirituelle, pp. 102-103.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
42
localiser, mais seulement des fragments de souvenirs, mconnaissables parce qu'ils correspondent des notions trop familires. Dira-t-on que, prcisment parce qu'ils affluent en grand nombre la conscience, les souvenirs se brisent, si bien que leurs membres pars se groupent un peu au hasard; dans ces associations nouvelles, ils perdraient leur originalit individuelle : ainsi s'expliquerait que nous ne les identifions plus. Mais pourquoi se brisent-ils de cette manire, c'est--dire suivant les divisions mmes auxquelles la vie sociale et la pense commune nous a accoutums ? Ce qui dfinit les souvenirs conservs, nous dit-on, au fond de la mmoire, c'est qu'ils n'entrent pas dans ces cadres, c'est qu'ils forment une continuit chronologique : toutes les distinctions logiques qu'on y introduit, toutes les significations gnrales qu'on leur attribue, toutes les appellations intelligibles qu'on leur applique sont le fait de la pense de la veille, et rsultent de ses cadres. S'il ne subsiste rien de ces cadres dans la conscience de l'homme endormi, on ne comprend point pourquoi les visions du rve nous renvoient l'image au moins de certains d'entre eux. Car, arbitraires et mal lies, elles n'en prsentent pas moins dans la plupart des cas et dans le dtail un sens immdiatement saisissable. Allons plus loin. Pour expliquer comment des sensations vagues, filtres travers nos sens pendant le sommeil appellent les souvenirs, M. Bergson invoque les modifications physiques qu'elles produisent dans le corps. Ce sont, dit-il ailleurs, les mouvements d'imitation par lesquels la perception se continue qui prsident la slection des images, et qui serviront de cadre commun la perception et aux images remmores . Ce sont de mme les mouvements, plus diffus sans doute, qui accompagnent ou suivent ces impressions vagues, qui expliquent donc la reproduction des souvenirs dans le rve. Mais, entre ces impressions, et, par suite, entre ces mouvements successifs, il n'y a pas de rapport : c'est une suite discontinue d'impressions ou de mouvements entre lesquels il n'y a aucun lien direct. Alors comment s'expliquent ces rves bien lis, qu'on peut raconter ensuite comme autant d'histoires ? On dira que l'image voque par une impression appelle sa suite d'autres images; le rle de l'impression est de mettre en mouvement l'imagination. celle-ci, une fois veille, oprerait librement, jusqu' ce qu'une nouvelle impression voque une nouvelle image, qui barre la route la srie ouverte par la prcdente. Mais comment une image en peut-elle appeler une autre ? Si le corps n'intervient plus il faut invoquer l'ordre de rapports qu'on tudie dans la thorie de l'association des ides. Mais, puisque ces images sont des souvenirs (au sens de souvenirs-images), il n'y a entre eux que des rapports chronologiques : partir de chacun d'eux, c'est donc une priode de notre pass qui devrait se reproduire. Or le pass ne se reproduit pas en rve. Dirat-on que nous restreignons l'extrme le sens du terme : souvenir-image, qu'un grand nombre de ces souvenirs correspondent des perceptions accompagnes de rflexion, des jugements, des penses abstraites, et que, du simple rapprochement de souvenirs de ce genre, se dgagent bien des rapports. Toutes les liaisons de la veille, en ce sens, se reproduiraient pendant le rve, sous forme de souvenirs. Il faut cependant choisir entre deux thses : ou bien ces notions familires d'objets et de rapports qui interviennent sans cesse dans la vie des groupes, et que nous sommes libres de nous rappeler chaque instant, sont l'objet d'une mmoire distincte de celle qui retient l'aspect original de chacun des vnements et de leur succession, mesure qu'ils se produisent : et alors il faut maintenir qu'entre les souvenirs conservs par la deuxime mmoire il ne peut exister que des relations Chronologiques; or c'est bien cette catgorie de souvenirs qu'a en vue M. Bergson lorsqu'il parle de ces souvenirsfantmes qui doivent attendre, pour reparatre, quelque occasion favorable. Ou bien les notions gnrales ont la vertu exceptionnelle non seulement de se trouver toujours la disposition de notre pense, pendant la veille, mais encore d'exercer une action,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
43
rduite peut-tre, mais cependant relle, sur les images du rve qui ne nous apparaissent, en effet, que sur un fond demi effac de notions schmatiques. Cela revient dire que ces notions demeurent dans notre esprit pendant le sommeil, que nous continuons en faire usage, et les sentir notre porte. Mais c'est cela mme que nous nous efforons d'tablir. Il y a cependant, entre les cadres de la veille et du rve, bien des diffrences : ceux-ci proviennent certainement de ceux-l, et il n'y a pas lieu de poser que l'esprit, pendant le sommeil, cre de toutes pices tout ce qu'il trouve d'intelligible dans ce droulement kalidoscopique ou dans cette danse tourbillonnante de formes, de sens, de figures, de mouvements, qui tantt se dtachent de nous, tantt se confondent avec le mouvement, la forme, le son et la figure de notre sensibilit du moment, Mais les notions de la veille, en pntrant dans la conscience endormie, doivent s'y rtracter, s'y parpiller, et laisser en route une partie de leur contenu ou de leur forme : telles des figures gomtriques traces sur une surface o la craie glisse, et qui perdent une partie de leurs contours, un ct, un angle, etc. On s'en aperoit dj, lorsqu'on observe ce que deviennent en rve le temps et l'espace, c'est--dire les cadres qui maintiennent en contact et en accord les penses d'hommes spars par la distance, et qui veulent rgler leurs mouvements et leurs dplacements sur ceux des autres membres de leur groupe. Nous ne savons pas bien ce que peut tre l'espace pour un tre qui n'a pas appris des autres s'y orienter, en distinguer les diverses parties et en embrasser l'ensemble : reconnat-il ce, que signifient : en avant, en arrire, au fond, en haut, le long de, gauche, droite, avancer, tourner, etc. ? Le rveur comprend tout cela. Voici un fragment de rve o des termes semblables se multiplient : Je venais de traverser une grande ville, je sortais de vastes quartiers bas qui m'loignaient de la gare, et je suivais une route assez populeuse (cafs, etc.), trs longue, qui faisait un dtour brusque derrire une usine en briques rouges, suivent une pente qui descendait, et faisait un nouveau dtour si soudain qu'en me retournant je faillis tomber en arrire. Plus bas il y avait comme une vaste ouverture de puits, ferme par des blocs massifs de pierre rouge dcoups en relief : il fallait descendre encore pour trouver la porte de ce qui avait t la chambre coucher du marchal de Saxe... Seulement, si le rveur comprend qu'il change de direction ou d'altitude, s'il situe les objets par rapport lui et mme les uns par rapport aux autres, il subsiste bien des lacunes dans ces tableaux, et bien des incohrences. Quelquefois c'est parce que nous savons o nous sommes, dans un restaurant, dans un salon, dans un laboratoire, qu'une vague ide de l'aspect et de la disposition intrieure de telles pices ou de telles salles flotte dans notre imagination. Bien souvent d'ailleurs, nous ne savons pas o nous sommes, fit nous ne nous tonnons pas de passer de plain-pied d'un caf dans une chapelle, ou bien, arriv un palier dans un escalier, ouvrant une porte, de nous trouver dans la rue, ou sur un chafaudage, ou, encore ayant travers une enfilade de pices, et revenant sur nos pas, d'en trouver de fort diffrentes, tant descendu de l'impriale ciel ouvert d'un omnibus, et y remontant parce que nous y avons oubli quelque chose, de constater que l'impriale est couverte, etc. 1 Toutes ces confusions et ces incohrences viennent de ce que nom ne possdons pas, dans le rve, une reprsentation d'ensemble de l'espace (d'une ville, d'un pays), non plus qu'une reprsentation de l'endroit o nous sommes rellement et de l'ensemble plus ou moins tendu dont il fait partie. Il suffit, pour que nous ne nous sentions pas perdus, que nous nous voyions en rve dans un coin d'espace dent
1
Voir d'autres exemples chez RIGNANO, Psychologie du raisonnement, 1920, p. 410 sq,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
44
nous apprcions vaguement l'tendue et l'orientation, ou plutt dans lequel nous localisons grossirement quelques objets, peu prs comme si on allumait une torche dans la nuit juste assez pour entrevoir les formes les plus voisines, et sans qu'on sache d'ailleurs o, en quel endroit d'un pays familier on est plac. Cette sensation d'espace suffirait un homme isol et qui ne vivrait que dans le prsent ; elle lui permettrait de se tenir debout, de faire quelques pas sans avoir le vertige, et quelques gestes utiles sans trop ttonner : en revanche, rduit elle, il ne pourrait ni expliquer aux autres o il s'est dirig, ni rgler ses alles et venues sur les leurs, et sur la position des principaux points de repre de la socit. Il en est de mme du temps. Peut-tre le rveur sort-il encore plus compltement du temps que de l'espace de la veille, En gnral on ignore quel moment, nous ne dirons pas mme (le l'anne ou de la semaine, mais du jour, on est, quand on rve : ou bien, si on le sait, c'est que tel clairage, ou tel acte de la vie quotidienne, voque le temps auquel il correspond : si on se voit sur une route au coucher du soleil, ou dans une chambre que la lumire lectrique inonde de clart, si l'on se met table pour djeuner, en remarquant que midi est pass depuis longtemps, on sait que c'est le soir, la nuit ou le milieu de la journe. Mais mme s'il arrive qu'on pense une date particulire, qu'elle soit choisie au hasard, ou qu'elle corresponde un vnement historique, ou une fte, ou simplement un rendez-vous, un examen, une obligation, on ne pense qu' cette date, et on ne la replace point parmi les autres; c'est une formule, analogue un nom propre, qui dsigne, plutt qu'une division du temps, l'acte ou l'vnement auquel on la rattache d'une faon quelquefois arbitraire : comme si, pour corser une situation, on prouvait le besoin de lui attribuer une date fictive. Peut-on mme dire qu'on se reprsente tout au moins la succession chronologique des divers vnements d'un rve, alors que la pense est tout entire absorbe par le prsent, et songe plus anticiper l'avenir qu' voquer le pass ? Cependant on a bien, au cours du rve, le sentiment de la succession : n'est-on pas capable de se souvenir, en rve, du rve lui-mme ? Non seulement on se rappelle alors ce qui vient de se passer, puisqu'une scne se droule o prennent part plusieurs personnages, et qu'on y tient compte de ce qu'ils viennent de dire ou de faire, mais, propos d'un fait, d'une figure, on se souvient qu'on les a vus antrieurement, on imagine mme des vnements fictifs qui ont d se passer autrefois, et qui expliquent la situation prsente. En revanche, ce qui manque, c'est tout l'ensemble des points de repre que nous apporte la mmoire de la Veille, c'est l'enchanement des faits rels au milieu desquels nous replaons d'ordinaire un fait, nouveau ou remmor : on comprend bien ce que c'est qu'avant et aprs, on distingue des priodes o les vnements se prcipitent, d'autres o ils se ralentissent et o on est en un tat d'attente et d'impatience, on a mme le sentiment d'un pass lointain, on pense des vnements ou des personnages historiques qui appartiennent un autre sicle ; mais toutes ces donnes temporelles ne se raccordent pas entre elles : elles sont discontinues, arbitraires, quelquefois fausses. Si nous croyons toujours tre dans le prsent, quand nous rvons, il s'agit d'un prsent imaginaire, et qui ne se situe en un point donn du temps par rapport rien : dtermination toute ngative, et qui se ramne ceci que, n'tant point capable de revivre par l'imagination ou la mmoire une priode quelconque de notre pass, non plus que de nous transporter dans l'avenir, nous ne sommes ni dans l'avenir, ni dans le pass; mais nous ne sommes pas non plus dans le prsent rel, c'est--dire dans un moment que nous et nos semblables puissions situer par rapport aux autres divisions et priodes du temps. Ainsi, des cadres de l'espace et du temps o nous rangeons nos perceptions et nos souvenirs pendant la veille, on retrouve bien des lments dans le rve, mais frag-
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
45
mentaires et bizarrement dcoups, tels les morceaux irrguliers du dessin d'une porcelaine brise. Les images du rve sont spatiales et temporelles, mais ne prennent point place dans un espace et un temps o nous pourrions les localiser et les coordonner. Or, comme la pense du rve n'est capable ni de se souvenir (c'est--dire de revivre le pass intgralement), ni de percevoir, n'est-ce pas que ce qui lui manque alors, c'est cette force de cohsion qui tient troitement rapprochs ces fragments du cadre spatial et temporel pendant la veille ? Nous avons l une occasion peut-tre unique de mesurer l'intervalle qui spare un esprit domin et disciplin par l'ensemble des notions labores par le groupe, et un esprit momentanment et partiellement affranchi d'une telle influence. Et nous pouvons vrifier aussi quel point l'action de la conscience collective est forte, quel point elle s'exerce en profondeur, et conditionne toute notre vie psychique puisque, jusque dans l'isolement du rve, on la peroit encore, amortie et brise, mais bien reconnaissable. * ** II - ii
Retour la table des matires
L'espace, le temps, et les autres cadres qui clairent et ordonnent en quelque mesure nos visions nocturnes sont autant d'images dformes et tronques des notions qui permettent aux hommes veills de se comprendre. Or, les hommes pensent en commun par le moyen du langage. Nous sommes donc amens nous demander quel est le rle du langage dans le rve. On a souvent observ qu'un homme qui dort parle quelquefois tout haut, articule des mots et des syllabes plus ou moins perceptibles; mais il ne s'ensuit pas que, quand on ne peroit du dehors ni des sons profrs, ni des mouvements des lvres, le dormeur poursuive cependant une sorte de monologue silencieux. Quelquefois, lorsqu'on le rveille au moment o il vient de prononcer un mot, un membre de phrase, et qu'on lui demande quoi il rvait, il rpond qu'il ne rvait pas, ou il raconte un rve qui ne prsente aucun rapport apparent avec ce qu'il disait. Une personne dort, d'autre part : ses traits sont calmes, sa respiration rgulire, sur son visage on. ne remarque aucune crispation, ses lvres ne bougent pas: elle se rveille, et raconte qu'elle tait en proie un affreux cauchemar. De ces faits on ne peut conclure que l'homme parle toujours quand il dort, mais, non plus, qu'il ne parle pas. L'homme veill, en effet, parle intrieurement, voque des mots, des propositions, des phrases, et les rpte ou les profre mentalement, l'occasion des objets qui passent sous ses yeux, ou de quelque rflexion qu'il poursuit, sans que rien le traduise au dehors. Mais il n'est pas certain, d'ailleurs, que ces mots, quand il les prononce rellement, rvlent aux auditeurs le sens qu'il y attachait, la pense qu'ils traduisaient pour lui-mme et non pour les autres, et, quand il est, sorti d'un tat de distraction o il a laiss chapper sans le savoir des lambeaux de phrase ou, des interjections, si on les lui rpte, il peut trs bien n'en pas retrouver le sens. Si, d'ailleurs, il tait tabli qu'on ne comprend le sens d'un mot qu' condition de le rpter mentalement, et si, aprs avoir prononc l'oreille du rveur un nom ou un ensemble de mots, on provoquait un rve qui dveloppt l'ide voque par, le mot, on saurait que Je rveur a parl intrieurement, et il y aurait bien des raisons de croire que cette parole intrieure a donn
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
46
naissance aux images du rve : mais il ne s'ensuivrait pas qu'il en soit ainsi de tous nos rves. Peut-on invoquer, maintenant, les cas o l'on s'entend parler, o l'on a le sentiment qu'on parle en rve 1 ? En d'autres termes, est-il possible d'atteindre par l'observation directe, pendant qu'on dort, ce langage mental qui courrait, comme une trame ordinairement invisible, travers les formes colores mouvantes prsentes la conscience pendant la nuit ? Nous avons dit qu'il se mle ces, formes bien des rflexions, et qu'on passe quelquefois insensiblement des unes aux autres, si bien qu'on ne peut dire ensuite avec assurance si on a pens un acte, un vnement, une vision, une conversation, ou si on a cru qu'on agissait, qu'on voyait et qu'on parlait rellement. Mais, quand les formes perdent de leur clat, que leurs contours s'effacent, il semble qu'il n'en demeure plus dans l'esprit qu'une reprsentation schmatique, et alors, quelquefois, cette reprsentation elle-mme se rsout en une srie de mots ou de phrases, auxquelles ne correspondent d'ailleurs ni des images visuelles (de mots imprims par exemple) ou auditives ( supposer qu'il y ait de telles images) ; nous ne nous en reprsentons pas moins ces mots : or, penser qu'on parle, n'est-ce point la mme chose que parler mentalement ? Jusqu'ici, nous ne sommes pas trs avancs. Il est possible qu'un homme qui dort parle intrieurement sans que rien le rvle au dehors : mais cette parole intrieure est-elle, continue, et, lorsqu'elle se droule, exerce-t-elle quelque influence sur le cours de nos songes ? Il est possible et mme vraisemblable qu'un homme qui rve qu'il parle, parle intrieurement ; mais le langage intrieur se rduit-il eus quelques paroles dont il prend conscience, et qui se perdent en gnral au milieu d'une foule d'images surtout visuelles qui forment la matire principale de nos, rves ? Certes, si la succession de ces images elles-mmes s'expliquait par une succession de mots ou de sons articuls, nous comprendrions mieux certains caractres du rve 2. D'abord, si les images du rve dfilent avec une extrme rapidit, s'il semble qu'elles se prcipitent comme pour nous empcher de fixer, assez longtemps sur chacune d'elles notre attention, n'est-ce point parce que la parole intrieure se prcipite ellemme ? On est quelquefois tonn, lorsqu'on se rappelle une srie d'vnements vus, en rve, de ce que les images sortent en quelque faon les unes des autres instantanment, de ce qu'un tableau se complte soudain, et parfois aussi de ce que telle figure se mtamorphose sans transition, si bien que le rve ressemble quelque course haletante, d'un objet un autre, sans ces priodes d'arrt o la pense: se retourne vers ce qu'elle vient de passer en revue, o l'on rflchit, o l'on se dtache un moment de l'image pour reprendre conscience de soi. Mais rien ne donne mieux l'ide de ce rythme acclr, que la volubilit de la parole, telle qu'on l'observe chez certains paraphasiques, certains maniaques, ou mme au cours d'une conversation dont on est proccup de combler les lacunes possibles. Il y a un dlire verbal 3, qui,
1
Peut-tre aussi ceux o l'on entend parler les autres. Disons seulement que, dans les rves, ces voix que nous croyons entendre sont sans doute souvent notre voix mme, les cris, nos propres cris, les chants, nos propres chants. L'auteur des Propos d'Alain, Quatre-vingt-un chapitres sur l'esprit et les passions, p. 45, Paris, 1917. Les rves sont essentiellement des processus visuels (visualing achievements), et Freud remarque qu'ils transforment des liaisons entre des mats (verbal connexions), en des liaisons entre des images (Traumdeutung; chap. Vl). JOSUA (C. Gregory), Visual images, words and dreams, Mind, July 1922. KUSSMAUL, Les troubles de la parole, trad. fr., 1884, p. 244.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
47
dans l'ordre de la parole, est symtrique du dlire visuel, et auditif dans le rve : comment, ne pas penser que celui-ci n'est peut-tre que la transposition de celui-l ? Un tel rapprochement ferait comprendre aussi bien pourquoi certaines parties de nos rves forment des tableaux bien lis, pourquoi le rve se construit souvent autour d'un thme central qu'il dveloppe, et pourquoi, dans d'autres cas, on saute brusquement d'un thme un autre, d'une image une autre entre lesquels on ne dcouvre aucun rapport. Malgr leur incohrence, bien des rves offrent une suite d'vnements, de paroles, de gestes qu'il est possible de raconter ensuite comme des histoires dtaches. L'imagination du rveur les construit suivant des rgles logiques particulires. En tout cas, tels quels, ils prsentent d'un bout l'autre un sens suivi. Ce ne sont pourtant pas, nous l'avons montr prcdemment, des pisodes de notre pass : les lments de l'histoire viennent peut-tre de notre mmoire, mais nous les fondons de telle sorte qu'ils produisent une impression de nouveaut. Dira-t-on qu'une image initiale en appelle sa suite d'autres qui s'organisent les unes avec les autres, et avec elle ? Mais, puisque ces images successives sont distinctes, lorsque l'une parat, pourquoi nous rappellerions-nous les prcdentes ? Dira-t-on que certains lments de celles-ci subsistent dans celles qui viennent aprs, ce qui assure une certaine continuit entre elles toutes ? C'est donc que le rve se dveloppe dans un certain cadre, et n'voque que les images qui y peuvent entrer, cadre mobile, d'ailleurs, qui se transforme, et quelquefois se brise. Mais comment expliquer qu'il se constitue, que certaines images ou parties d'images, et mme certaines penses ou attitudes psychiques gnrales se fixent ainsi, tandis que d'autres ne paraissent que pour disparatre, s'il n'y a pas dans la conscience ou dans le corps du rveur un point d'attache pour elles 1 ? D'aprs M. Bergson, toutes les images qui s'voquent dans le rve s'accompagnent de mouvements qui les prolongent dans le corps : mouvements d'articulation, en particulier, ou modifications crbrales qui les prparent. Il est naturel d'admettre qu'aux mouvements les plus sensibles et qui durent le plus longtemps correspondent les images stables, qui constituent le cadre phmre de nos rves. Ainsi il suffit, quand nous dormons, que nous rptions intrieurement un mot, une suite de mots, peut-tre mme une ou plusieurs phrases : nos penses s'orienteront dans le mme sens que nos paroles, et il y aura entre les images de notre rve la mme continuit qu'entre les mots; quant aux dtails, ils s'expliqueront par d'autres mots ou d'autres phrases, mais incomplets, mal rpts, et qui, d'ailleurs, pourront reproduire les premiers comme un cho affaibli et bris. Quant l'incohrence des rves, elle correspondrait au dsordre du langage intrieur. L'homme qui dort chappe au contrle de la socit. Rien ne l'oblige s'exprimer correctement, puisqu'il ne cherche pas se faire comprendre par les autres. On a signal chez certains maniaques une confusion de penses telle que la construction des phrases n'est mme plus possible. Un mlange insens de mots relis par assonance, allitration, rime, tourbillonne dans l'esprit ; les alins se livrent des centaines, des milliers de rapprochements ; des penses surgissent veilles par un
1
Je rve, par exemple, que je suis dans une cathdrale. En l'air, sur la galerie qui fait le tour de l'glise, il y a des personnes : quelques-unes d'entre elles franchissent la balustrade de pierre. Je me demande ce qu'elles vont faire. Sont-elles folles ? Vont-elles se jeter dans le vide, ou se livrer quelque acrobatie ? Peut-tre y a-t-il une corde tendue, invisible, sur laquelle elles vont danser ? En voici une, en effet, qui se balance dans le vide. Mais soudain une passerelle s'tend en travers de l'glise, telle un jub, si lgre qu'on ne l'aurait pas aperue, si ces personnes ne s'y taient pas engages. - On conoit que la reprsentation dominante de l'glise serve de cadre aux autres, qui se succdent comme autant de tableaux distincts, qui correspondent des situations ou des penses trs diffrentes, et qui semblent lies toutefois, qui s'organisent entre elles, parce qu'elles doivent s'accorder avec celle-ci.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
48
mot, une rime, et immdiatement aprs disparaissent, supplantes par un autre 1. Ne se produit-il pas, dans le sommeil, des perturbations du langage telles que celles qui ont de bonne heure attir l'attention chez les aphasiques ? La paraphasie : les mots sont rveills dans la mmoire par une parent de signification ou de forme, sans que, dans la phrase, ils soient leur place. L'achoppement des syllabes : les mots, comme units organiques, sont atteints dans leur structure, se dsagrgent dans leurs articulations de sons et de syllabes ; il arrive mme qu'il s'introduise dans le mot des syllabes qui n'y appartiennent pas 2. On trouverait, dans certaines descriptions de rves, bien des exemples de mots dforms que le rveur croyait prononcer correctement, et qu'il s'est rappels au rveil. Un autre caractre du rve enfin demeure assez nigmatique, si l'on suppose qu'il se rduit des images visuelles ou auditives qui s'appelleraient sans intermdiaire. A ct de ces cadres plus ou moins durables qui nous permettent de dcouper les visions d'une nuit en un petit nombre de tableaux, et en quelque sorte derrire eux, il en est un qui les enveloppe tous et dans lequel toutes ces, images doivent prendre place: c'est le sentiment de notre identit. Nous assistons ou prenons part toutes ces scnes, nous, c'est--dire l'tre que nous sommes au moment actuel, et nous nous distinguons des objets qui nous apparaissent. Or, comme les rves ne se confondent pas avec de simples souvenirs personnels reproduits tels quels, on ne voit pas pourquoi des images, tires peut-tre, de la mmoire, mais dmarques et impersonnelles, nous apporteraient la mme impression d'extriorit que, les objets vus pendant la veille ? Pourquoi ne nous confondrions-nous pas avec elles, pourquoi n'aurions-nous, pas le sentiment que des tres, objets ou personnes autres que nous, se sont substitus nous-mmes ? Si nous gardions ainsi dans le sommeil la notion de notre moi, si, en un certain sens, nous restons toujours au centre de ces scnes images, c'est qu'il y a un lment commun tous nos rves : ce ne peut tre un lment des images elles-mmes, ce ne peut tre que le sentiment de l'activit continue, automatique la fois et constructive, que nous exerons sur ces images. Si l'on suppose que celles-ci sont voques par les paroles que nous prononons intrieurement, ou, du moins, que nous sentons chaque instant qu' ces images nous pourrions appliquer des noms, et qu' cette condition seule nous nous les reprsentons, il n'est plus difficile d'expliquer que la personnalit du rveur, et la conscience qu'il conserve de lui-mme, rattache, et rattache seule, comme un fil continu, tant d'vnements et de tableaux sans autre rapport apparent que celui-l. Ainsi notre hypothse, savoir que les hommes endormis ne cessent point, de parler intrieurement, rendrait compte de quelques-unes des proprits les plus caractristiques du rve. Mais en quoi consiste exactement ce langage mental, qui n'est peru ni du dedans (au moins de faon claire et consciente), ni du dehors ? Nous ne l'avons, en effet, pas dfini jusqu' prsent. Mais si nous lui attribuons une telle influence, si c'est par lui surtout que nous essayons d'expliquer la, succession des images du rve, c'est qu'il quivaut en somme, pour nous, tout ce qu'il entre d'intelligence rudimentaire dans le rve, c'est qu'il nous semble que nous ne comprenons nos rves que dans la mesure o nous pouvons les formuler l'aide de mots, et o, par consquent, nous sentons que ces mots sont notre disposition : comment cela
1
KUSSMAUL, Op. cit., p. 280. Classiques sont les trois rves de Maury dans lesquels les vnements s'associent et se succdent par simple association des noms respectifs: plerinage, Pelletier, pelle; jardin, Chardin, Janin; kilomtre, kilos, Gilolo, loblia, Lopez, loto. RIGNANO, Psychologie du raisonnement, 1920, pp. 421-422. KUSSMAUL, op. cit., p. 240 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
49
serait-il possible, si nous ne nous sentions pas en mme temps disposs les rpter, et si nous ne, nous les, reprsentions pas sous une forme quelconque ? On s'expliquera pour quelle raison nous insistons, , ce point sur la part d'intelligence comprhensive qui se mle aux reprsentations du rve, et qui, d'aprs nous, les conditionne, et cri rgle la succession, si l'on observe que l'homme est dress comprendre ce qu'il voit et ce qu'il prouve par la discipline sociale, et que son intelligence est faite d'ides (presque toutes en partie verbales) qui lui viennent de son entourage humain immdiat ou lointain. Certes, comme il rsulte du chapitre prcdent, pendant le sommeil cette discipline se relche extrmement ; l'individu chappe la pression de ces groupes. Il n'est plus sous leur contrle. Mais il est priv en mme temps d'une partie des lumires qu'il en recevait. C'est pourquoi il ne peut se rappeler, sous la forme de suites cohrentes d'vnements bien localiss, telles ou telles priodes ou scnes de sa vie passe. En d'autres termes, la mmoire de l'homme. endormi ne fonctionne plus avec le mme degr de prcision, et elle ne peut s'appliquer des ensembles de souvenirs aussi complexes que la mmoire de l'homme veill, qui dispose de toutes ses facults intellectuelles, et, par elles, peut s'appuyer sur l'exprience collective, bien plus stable et mieux organise et bien plus tendue que la sienne. Pourtant, il nous semble que, mme dans le sommeil, dans la vie psychologique que poursuit l'homme endormi, l'action de la socit se lait sentir, mais son& d'autres formes. Nous ne crons pas de toutes pices les hommes et les objets non plus que les situations du rve : ils sont emprunts notre exprience de la veille, c'est--dire que nous revoyons, dans l'tat d'isolement o le sommeil nous enferme, ce qui a frapp nos regards ou modifi nos sens alors que nous tions en contact avec nos semblables. Bien plus, non seulement nous revoyons, ces images, mais nous les reconnaissons. Non seulement nous reconnaissons les objets habituels, les visages familiers, mais si des vnements entirement inattendus, ou des figures bizarres ou monstrueuses se prsentent nous dans le sommeil, nous les reconnaissons encore, puisque nous leur attribuons un, sens, et pouvons en rendre compte au rveil, c'est-dire les interprter l'aide des notions communes aux hommes, de notre groupe. C'est donc qu'une partie au moins des habitudes de pense de la vie sociale subsistent dans la vie, du rve, en particulier l'aptitude comprendre au moins dans le dtail ce que nous voyons. Mais cette reconnaissance ou cette comprhension se distinguent de ce qu'elles sont pendant la veille, en ce qu'elles ne s'accompagnent pas d'un sentiment de vraisemblance ou de cohrence, en ce qu'en particulier le temps et le lieu o nous situons ces formes et incidents nocturnes ne sont point replacs dans le temps et l'espace de la veille, ou de la socit. Lorsqu'il s'agit de visions ce point flottantes et instables, qu'est-ce que comprendre ou reconnatre ? Cela signifie que nous pouvons, aprs coup, les dcrire comme nous dcrivons de pures fictions, c'est--dire qu'elles offrent prise l'expression verbale : et cela ne peut gure rien signifier d'autre. Prcisons notre point de vue, en examinant s'il serait possible d'expliquer, dans une autre hypothse, la succession des images du rve. Il faudrait alors admettre que les images s'voquent directement l'une l'autre, qu'un tableau purement visuel se complte par l'adjonction d'autres lments de mme nature, ou appelle sa suite un autre tableau purement visuel, de mme que des images se succdent sur l'cran d'un cinmatographe. M. Bergson a combattu cette conception : les images d'aprs lui ne sont point comparables des molcules qui s'attireraient en raison de leurs affinits 1.
1
WUNDT, de son ct, reproche aux thoriciens de l'association des ides d'oublier que les tats psychiques associs rsultent eux-mmes de phnomnes lmentaires : on ne comprendrait pas, d'aprs lui, que ces tats complexes s'associent, si les lments des uns et des autres ne se prtaient point de tels rapprochements. Mais ces phnomnes lmentaires se rapprochent des mouvements envisags sous leur aspect psychique, et les a fusions , assimilations , complications
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
50
Si des images sont associes d'autres images et paraissent les voquer, c'est, d'aprs lui, parce qu'elles sont lies les unes et les autres aux mmes mouvements du corps. Si je comprends une conversation, si cette conversation n'est pas simplement pour moi un bruit, c'est que les impressions, auditives organisent en moi des mouvements naissants, capables de scander la phrase coute et d'en marquer les principales articulations . Donc, si je comprends une phrase qu'on m'adresse si bien que, n'en ayant peru que le commencement, je devine ce qui suit, ce n'est pas parce que les impressions auditives voquent directement le souvenir d'autres impressions auditives, mais c'est parce que je me sens capable d'articuler les mots correspondants. M. Bergson appelle ce sentiment : schme moteur de la parole entendue. Si ce schme ne se droulait pas dans notre conscience, nous ne pourrions passer d'un mot entendu un autre mot entendu, non plus que d'un mot que nous entendons un mot que nous attendons, c'est--dire une image ou un souvenir auditif. Nous nous demanderons maintenant si les mouvements qui scandent ainsi intrieurement la parole entendue se produisent naturellement, en dehors de l'action de la volont, d'une habitude acquise, aussi bien que de l'influence de la socit. Aprs tout, on peut entendre longtemps parler autour de soi une langue trangre : si on n'a ni le dsir, ni le besoin de l'apprendre, on n'y fera pas attention, de mme que quelqu'un qui n'est pas musicien pourra assister bien des concerts sans perfectionner son oreille. Que de progrs on fera, au contraire, si, avant d'entendre une confrence ou d'assister une conversation en langue trangre, on a dj lu ce qu'on entend, ou, du .moins, si l'on a dj appris, par la lecture, ou parce qu'on vous les a fait rpter un un, les mots et les expressions essentielles, et la grammaire de cette langue ! Alors on recherchera ces mots et ces formes dans la suite continue des sons, et on les retrouvera bien plus frquemment et bien plus vite. Ce n'est pas spontanment, et l'aide des ractions naturelles que provoque en nous l'audition des paroles, c'est du dehors, et par des moyens en somme artificiels, qu'on russira construire ce schme moteur, c'est--dire qu'on se mettra en tat de comprendre les phrases et les mots qui frappaient d'abord notre oreille comme un bruit confus. Nous n'avons envisage jusqu'ici que les images verbales auditives 1 des psychologues, qui jouent un rle en somme secondaire dans l'ensemble des images du rve. Mais, le mme genre d'explication ne s'impose-t-il pas, quand il s'agit des images auditives non verbales, et des images visuelles, les plus nombreuses ? Certes, M. Bergson admet que toutes ces images se prolongent aussi en modifications corporelles. Mais peut-on parler ici de schme moteur ? Il le faut bien, si ces images, comme les images verbales auditives, se prsentent nous d'abord sous la forme confuse d'une continuit. Un homme qui aurait vcu jusqu' prsent dans un monde constitu tout autrement que le ntre serait, en prsence d'un tel flux d'images, dans le mme embarras que, tout l'heure, celui qui entendait parler dans une langue qu'il ignorait. Pour distinguer ces tableaux, et leurs parties les unes des autres, il faut les dcomposer, en souligner les traits saillants. Y parvient-on par le seul fait que, spontanment, au fur et mesure qu'ils se reproduisent, les mouvements ou gestes bauchs par lesquels nous reproduirions telles formes, ou repasserions sur leurs contours,
auxquelles ils sont soumis se ramnent sans doute des liaisons entre des mouvements. Ainsi, l'association de deux images visuelles ne serait jamais directe ou immdiate : elle rsulterait du jeu des tendances lmentaires qui accompagnent ces images, en particulier des mouvements et fonctions diverses des yeux, et des sensations correspondantes. Grundriss der Psychologie, 10e dition, 1911. Nous entendons par l, pour notre compte, le sentiment que nous prouvons quand nous entendons ou nous figurons que nous entendons des paroles.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
51
s'organisent entre eux? On pourrait admettre en effet que nous ayons acquis l'habitude de nous reprsenter intrieurement, propos de chaque objet ou de chaque tableau, une sorte de dessin simplifi qui en reproduirait le schma. Peut-tre certains systmes d'criture et de langage n'ont-ils pas une autre origine 1. Mais d'o vient cette habitude, comment s'est-elle forme ? Peut-on ngliger ici l'influence des leons qu' cet gard nous donne sans cesse, et de bonne heure, la socit ? N'est-ce pas elle qui nous apprend manier les objets, nous en servir, qui attire notre attention sur leurs ressemblances et leurs diffrences, et nous aide, par les dessins artificiels qu'elle met sous nos yeux (quand bien mme elle ne nous enseignerait pas les reproduire), retrouver dans les ensembles naturels qui frappent nos yeux des formes, des assemblages de traits, et des combinaisons ou oppositions de couleurs avec lesquels elle nous a familiariss ? Quand les philosophes pragmatistes disent que l'homme ne peroit que les objets ou les aspects de la ralit qui intressent son action, c'est--dire sur lesquels il peut agit, tiennent-ils compte suffisamment de ce que les modes d'action de l'homme sont dtermins non pas seulement par sa nature organique, mais un degr bien plus lev par les habitudes de la vie sociale ? Ds lors, s'il est vrai qu'on ne voit rellement un tableau que lorsqu'on le comprend, et qu'on ne le comprend qu' condition de le dcomposer, comme les lignes suivant lesquelles cette d composition s'opre nous sont indiques par la socit, c'est elle aussi qui nous aide comprendre et voir 2. Au reste, mme lorsqu'il s'agit d'images visuelles, les mots jouent un rle plus grand que les dessins schmatiques, que les reprsentations bauches de gestes, car il est plus simple, le plus souvent, de dcrire un tableau avec des mots que de le figurer avec des traits ou des mouvements. Bien plus, lorsqu'on apprend excuter un mouvement un peu complexe, il ne suffit pas d'observer l'attitude et les gestes d'un escrimeur ou d'un danseur, mais on ne voit rellement leurs volutions que lorsqu'on est capable de les dcrire, c'est--dire que lorsqu' chaque mouvement simple on a fait correspondre un mot, et qu'on a rattach les mots, qu'on les a organiss, de faon reproduire les rapports qui lient en fait ces gestes lmentaires. Ainsi, de quelque espce d'image qu'il s'agisse, verbale, auditive ou visuelle (toutes rserves faites sur l'existence relle et distincte de telles images), l'esprit est toujours astreint, avant de les voir, les comprendre, et, pour les comprendre, se sentir tout -au moins en mesure de les reproduire, de les dcrire, ou d'en indiquer les caractres essentiels l'aide de mots.
1
Pour tre des dessins, dit M. Granet, tous les caractres chinois ne sont pas ncessairement des idogrammes au sens strict du mot... Mais 41 y en a un bon nombre qui sont ou des dessins vritables, nu des reprsentations symboliques soit simples, soit composes. Il ajoute que la gesticulation figurait primitivement aux yeux l'image que la voix dessinait oralement . Parlant des expressions redoubles, ou auxiliaires descriptifs, dans les vieilles chansons du Che-King, il y dcouvre une disposition trs marque saisir les ralits sous forme d'images synthtiques et particulires au plus haut degr, et traduire ces images en les transposant sous for-me vocale. Ce qui est surtout remarquable, c'est que cette transposition se lait sans crue l'image traduite perde en rien de sa complexit, et de telle faon que le son qui la reproduit est lui-mme non pas un signe, mais une image . Toute la vertu mimique du geste aurait pass dans le mot articul. GRANET, Quelques particularits de la langue et de in pense chinoise. Revue philosophique, 1920, 2 articles, p. 117. Tandis que nos langues nous transmettent tout un hritage de penses, mais nous laissent remarquablement libres pour enregistrer les sensations, leur langue impose aux Chinois une immense varit d'images toutes faites l'aide desquelles ils sont forcs de se reprsenter les choses; loin de partir de donnes personnelles, ils partent de donnes intuitives trs particulires et nettement dtermines paria tradition ; quand ils voquent, une image l'aide d'un mot, elle se trouve dfinie de la faon la plus expresse, non seulement par le pouvoir vocateur du mot pris en lui-mme, mais par son emploi traditionnel... On peut dire que, dans des spectacles analogues, les Chinois voient tous les mmes donnes particulires : tmoin l'extraordinaire homognit de leur posie et de leur peinture. GRANET, p. 194, note.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
52
* ** II - iii
Retour la table des matires
Mais la meilleure vrification de cette thse ne se trouverait-elle pas dans l'tude de ces troubles si curieux et qui ont t l'objet de tant de recherches, qu'on groupe sous le nom d'aphasie, et qu'on dfinit quelquefois : l'abolition des souvenirs verbaux ? Il y a sans doute d'autres cas o manque la reconnaissance ou la connaissance des mots. Nous pourrions nous demander par exemple si l'enfant qui ne sait pas encore parler peut distinguer et identifier les objets. Mais la psychologie de l'enfant n'est qu'bauche. D'ailleurs, il est bien difficile, puisqu'en dehors de la parole l'enfant ne dispose que de moyens d'expression trs rudimentaires, de se rendre compte de ce qu'il peroit et de ce qu'il pense. Au contraire, dans l'aphasie, nous le verrons, les souvenirs des mots ne disparaissent pas intgralement : ces malades quelquefois peuvent crire ; il arrive qu'ils ne comprennent pas les mots, mais qu'ils les prononcent, et soient capables de parler spontanment; ils usent de priphrases; souvent la parole est seulement trouble, etc. En outre, ils ont vcu jusqu' prsent dans la socit, ils ont appris parler, ils ont t mis, par le langage, en relation continue avec les autres hommes. Si la perte ou l'altration du langage leur rend plus ou moins difficile d'voquer et de reconnatre des souvenirs de toute nature, nous pourrons dire que la mmoire en gnral dpend de la parole. Puisque la parole ne se conoit qu' l'intrieur d'une socit, nous aurons en mme temps dmontr que dans la mesure o il cesse d'tre en contact et en communication avec les autres, un homme devient moins capable de se souvenir. Or on peut se demander en premier lieu si l'aphasie, entendue comme la perte des souvenirs des mots, qu'elle porte sur les souvenirs des sons qui les voquent ou qui les expriment, des caractres imprims qui les traduisent, ou des mouvements de la main au moyen desquels on les crit, entrane ou n'entrane pas un trouble ou un affaiblissement de l'intelligence, et, plus prcisment, si, en mme temps que nous oublions les mots, nous ne devenons pas incapables, au moins en partie, de penser et d'enchaner nos ides suivant les conventions admises autour de nous. Deux conceptions semblaient devoir s'opposer trs nettement cet gard. Si l'on insistait sur la localisation de l'aphasie, c'est--dire sur l'aspect physiologique du phnomne, on tait amen distinguer des images visuelles, auditives, tactiles, etc., motrices ou d'articulation, et assigner chaque catgorie d'images un centre distinct. Or, comme on distinguait, d'autre part, un centre de l'idation, ou de l'intelligence, il tait concevable qu'une lsion pt dtruire un ou plusieurs centres d'images sans que le centre de l'idation ft atteint. Ainsi, d'aprs la thorie des localisations, il convenait de multiplier les formes distinctes de l'aphasie qui correspondaient la destruction d'un ensemble d'images seulement, si bien que, dans chacune de ces formes, on conservait les souvenirs dont le centre n'tait pas ls, et on disposait de
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
53
toutes ses facults proprement intellectuelles, si le centre d'idation n'tait pas touch 1. Telle est la thorie classique dont Djerine a maintenu tout l'essentiel. En particulier, il soutient que l'aphasie suppose la conservation de l'intelligence 2. Mais, d'abord, il ne l'affirme d'une manire absolue que pour certaines catgories d'aphasie. Dans l'aphasie motrice pure 3, il peut y avoir intelligence parfaite , dit-il. Or, remarquons que cette varit n'est rien d'autre que l'anarthrie, laquelle Pierre Marie refuse le nom d'aphasie. En revanche, il reconnat que dans les aphasies sensorielles ou de comprhension, l'intelligence est presque toujours touche... l'affaiblissement intellectuel est, en gnral, plus marqu que chez l'aphasique moteur... souvent la mimique est moins expressive que chez l'homme sain , et que, dans l'aphasie totale, le dficit intellectuel est souvent plus marqu, que dans l'aphasie sensorielle ou motrice . Dans la ccit verbale pure, il est vrai, o le malade perd la comprhension de la lecture, intelligence et langage intrieur sont toujours intacts, et la mimique est parfaite . Mais (et c'est notre seconde observation sur la thse de Djerine), il n'entend pas trouble ou diminution de l'intelligence au mme sens que Broca ou Trousseau : pour ceux-ci, l'intelligence tait altre lorsque le sujet perdait le pouvoir de lire, ou d'crire, ou l'un et l'autre ; pour Djerine, une altration du langage conventionnel n'entrane pas ncessairement un affaiblissement intellectuel ; au contraire les altrations du langage naturel (troubles de la mimique en particulier) ne se rencontrent que dans des cas d'aphasie de nature trs complexe, par le fait qu'elles s'accompagnent d'un dficit marqu de l'intelligence 4. C'est pourquoi l'abolition de J'aptitude dchiffrer les mots imprims ne lui parat pas porter atteinte nos facults intellectuelles : conception d'autant plus singulire que le mme auteur, signalant l'affaiblissement de l'intelligence chez les sujets atteints d'aphasie sensorielle, l'explique par le fait que ces malades se trouvent spars de tout commerce avec leurs semblables . Or la lecture, au moins chez ceux qui lisaient avant leur maladie, met les hommes en rapport avec leur groupe de bien des manires : affiches, journaux, manuels d'cole, romans populaires, livres d'histoire, etc., leur permettent de s'ouvrir en peu de temps une quantit de courants de pense collective, et leur horizon social et par consquent intellectuel sera bien rduit, si toutes ces portes se ferment devant eux.
1
2 3
Dans presque tous les schmas imagins pour rendre compte de la fonction des centres et de leur rapport, on trouve un centre d'idation: notamment dans celui de Baginski (1871), un centre principal de la construction des ides; dans celui de Kussmaul (1876), un centre idogne; dans celui de Broadbent (1879), deux centres suprieurs distincts qu'il appelle naming et propositioning centres ; dans celui de Litchtheim (1884), un centre d'laboration des concepts; dans celui de Charcot (1885), un centre d'idation, ainsi que dans ceux de Brissaud, Grasset, Moeli, Goldscheider, etc. Dans le schma de Wernicke (1903) on ne trouve pas de centre d'idation. Tous ces schmas et d'autres encore sont reproduits dans MOUTIER, L'aphasie de Broca, Paris, 1908, p. 32 sq. DJERINE, Smiologie des affections du systme nerveux, Paris, 1914, p. 74. Djerine distingue : 1 L'aphasie de Broca : altration de tous les modes du langage, avec prdominance [de l'altration] du ct de la parole articule ; 2 L'aphasie motrice pure: le sujet ne peut prononcer les mots, mais a conserv leurs images motrices d'articulation: la lecture mentale est normale, ainsi que l'vocation spontane des images auditives ; 3 L'aphasie sensorielle ou de comprhension, dont la ccit verbale et la surdit verbale sont des reliquats , avec paraphasie ou jargonaphasie. Les aphasies sensorielles pures, comprises sous cette rubrique, sont la ccit verbale pure, dcouverte par Kussmaul et localise par Djerine, et la surdit verbale pure (avec conservation de l'criture spontane et de l'criture d'aprs copie) dcrite par Lichtheim, assez rare ; enfin 4 L'aphasie totale, la plus frquente de toutes. DJERINE, op. cit., p. 74.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
54
Mais surtout, Djerine, tout en reconnaissant qu'il y a un dficit intellectuel dans beaucoup de ces cas, soutient que c'est l non pas la cause, mais l'effet de la suppression des images du langage. Le sujet pense avec des images d'objets, et non avec des images de mots. Il ne peut plus se tenir au courant de rien 1. Le trouble, sous sa forme primitive, serait sensoriel et consisterait dans l'incapacit de reconnatre ou d'imaginer les mots crits on entendus : mais l'intelligence, au dbut au moins, resterait intacte. Il nous semble que nous traduirons exactement cette thse en comparant l'aphasique un ouvrier qui ne sait plus se servir de certains outils, mais dont les forces demeurent d'abord ce qu'elles taient. Si elles paraissent cependant, amoindries, si mme la longue elles diminuent, c'est que l'ouvrier, incapable de s'acquitter de sa tche par d'autres moyens, donne l'impression d'un homme affaibli, et que, faute d'exercer ses forces, il les perd en effet. Mais on peut envisager l'aphasie d'un tout autre point de vue. Si, au lieu de partir de la thorie des localisations, on recherche, dans les faits, les diverses formes tranches d'abolition des souvenirs que l'cole classique distinguait, on constate d'abord qu'il n'est pas exact que l'oubli porte seulement sur une catgorie bien dtermine de souvenirs, images visuelles, auditives, souvenirs des mouvements d'articulation : l o on constate la disparition des souvenirs d'une catgorie, presque toujours la mmoire prsente d'autres altrations. Il n'est donc pas possible de constituer en entits cliniques telle ou telle forme d'aphasie (sauf, peut-tre, la ccit verbale pure ou alexie) 2 : il existe tant de varits individuelles, les souvenirs des diverses espces tmoignent, dans leur disparition, d'une solidarit ou d'affinits si capricieuses, qu'on a beau compliquer les schmas primitifs, et imaginer, ct du trouble principal,. des troubles accessoires qui n'en seraient que le retentissement, on est oblig de s'en tenir un seul cadre, sans qu'on puisse y distinguer quelques grandes catgories 3. Mais si, dans l'aphasie, ce n'est pas telle ou telle forme du langage qui disparat, si, comme dit Pierre Marie, le langage intrieur est pris dans son ensemble , c'est l'intelligence en gnral qui se trouve atteinte. Que l'on considre, par exemple, la paraphasie : on ne peut dire que le sujet soit incapable de prononcer des mots, telle catgorie de mots ; mais les ides ne rpondent plus leurs images vocales, si bien qu'au lieu de mots conformes au sens surgissent des mots d'un siens contraire, compltement trangers et incomprhensibles 4. D'autre part un malade qui l'on montre divers, objets, les parties du corps, etc., en nommera correctement quelques-uns ; puis, sans doute quand son attention faiblit,il se produit ce qu'on appelle l'intoxication par le mot : un des mots qu'il vient de prononcer s'impose lui, et il le rpte dsormais pour dsigner n'importe quel objet. Dans ces deux. cas, la fonction qui flchit, n'est-ce pas l'intelligence attentive ? Mais il en est de mme, ajoute Pierre Marie, de l'incom1 2
Ibid., p. 105. D'aprs M. PIRON lui-mme, qui n'abandonne pas tout fait la thorie des localisations, la surdit verbale ne se rencontre l'tat pur que tout fait exceptionnellement... elle est rarissime . Le cerveau et la pense, p. 204, Paris, 1923. C'est la thse de Pierre MARIE, prsente pour la premire fois dans trois articles de la Semaine mdicale de 1906 : Rvision de la question de l'aphasie. Mais, ds 1897, dans Matire et mmoire, M. Bergson avait dj aperu et indiqu trs nettement les insuffisances de la thorie classique. Voir aussi Pierre Marie, Foix, etc., Neurologie, t. 1, L'aphasie. On sait que Pierre MARIE distingue: l'anarthrie, qui rsulte de la perte du langage extrieur, et qui n'est pas une aphasie ; ces troubles anarthriques sont entirement distincts des troubles rsultant de la perte du langage intrieur... rien n'est moins dmontr que l'existence d'images motrices d'articulation ; et l'aphasie de Wernicke (dont l'aphasie de Broca n'est qu'une varit, avec mlange d'anarthrie) ; l'aphasie de Wernicke rsultant de l'altration de tout le langage intrieur, il, est inexact de dire qu'elle rsulte de la perte des images sensorielles . KUSSMAUL, Op. cit., p. 240.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
55
prhension de la parole (ou surdit verbale) : ce n'est pas un symptme, proprement sensoriel. Car le malade peroit ordinairement tous les mots isols, c'est l'ensemble de la phrase qui lui chappe, et ceci est beaucoup plus de l'ordre de la comprhension intellectuelle que de l'audition mme spcialise... Bien plus, les troubles de l'aphasie de Wernicke ne sont pas strictement limits au langage, ils frappent l'ensemble de l'intelligence, plus spcialement les choses didactiquement apprises . Nous reviendrons sur cette dernire remarque 1. De toute cette discussion il rsulte, puisque ces altrations du langage produisent un trouble permanent et profond de l'intelligence, que le langage n'est pas simplement un instrument de la pense, qu'il conditionne tout l'ensemble de nos fonctions intellectuelles. Si on ne s'en est pas aperu tout d'abord, c'est qu'on s'obstinait traduire en langage physiologique l'activit et les troubles de la mmoire. Mais les faits psychiques s'expliquent par des faits psychiques, et on complique inutilement l'tude de ces faits, lorsqu'on y mle des considrations d'un autre ordre. Lorsqu'on parle de ractions motrices conscutives des reprsentations, de mouvements ou d'branlements nerveux qui prolongent des images, d'une part on construit des-hypothses (puisque, de ces ractions et branlements physiques, nous ne connaissons presque rien par observation directe), d'autre part on dtourne son attention de ce qu'on pourrait appeler l'aspect psychique de ces faits dont l'aspect matriel ou physique nous chappa. Or, nous ne savons pas en quoi consiste le mcanisme crbral du langage, mais nous sentons, lorsque nous parlons, que nous attribuons aux mots et aux phrases une signification, c'est--dire que notre esprit n'est pas vide, et nous sentons, d'autre part, que cette signification est conventionnelle. Nous comprenons les autres, nous savons qu'ils nous comprennent, et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous nous comprenons nous-mmes : le langage consiste donc en une certaine attitude de l'esprit, qui n'est d'ailleurs concevable qu' l'intrieur d'une socit, fictive ou relle : c'est la fonction collective par excellence de la pense. Le langage , a dit M. Meillet, est minemment un fait social. En effet, il entre exactement dans la dfinition qu'a propose Durkheim ; une langue existe indpendamment de chacun des individus qui la parlent, et, bien qu'elle n'ait aucune ralit en dehors de la somme de ces individus, elle est cependant, de par sa gnralit, extrieure chacun d'eux; ce qui le montre, c'est qu'il ne dpend d'aucun d'entre eux de la changer, et que toute dviation individuelle de l'usage provoque une raction 2. Or l'aphasie consiste en un ensemble de dviations de ce genre, et, si l'on reconnat son existence, c'est aux ractions du groupe dont l'aphasique fait partie, et qui s'tonne de ce qu'un de ses membres n'attache plus aux mots le sens conventionnel que les autres membres leur attribuent. On se trompe, lorsqu'on cherche la cause d'un tel trouble dans une lsion crbrale, ou dans une perturbation psychique limite la conscience individuelle du malade. Supposons une socit dans laquelle le sens des mots soit indtermin, et change sans cesse, soit que chaque innovation linguistique due un membre quelconque du groupe soit immdiatement adopte, soit que la langue soit incessamment modifie par une srie ininterrompue de dcrets : les hommes d'esprit trop lent et de mmoire trop paresseuse pour se prter une pareille gymnastique mentale, et ceux qui rentreraient dans le groupe aprs une absence momentane,
1
Citons aussi, dans le mme sens, cette comparaison propose par MOUTIER. op. cit., p. 211. L'aphasique est dans la situation d'un homme en pays tranger, parlant difficilement [Moutier ne dit pas : incapable de parler] la langue indigne. Dira-t-on que cet homme est atteint de surdit verbale, parce qu'il ne comprend point l'interlocuteur parlant trop vite, faisant des phrases trop longues, employant des mots aux syllabes trop nombreuses ? videmment non. MEILLET, Linguistique historique et linguistique gnrale, 1921, p. 230.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
56
seraient, bien des gards, dans le mme tat que l'aphasique. Inversement, si l'individu ne subissait pas la contrainte continue des habitudes linguistiques du groupe, il en viendrait vite modifier le sens des termes qu'il emploie, et crer des termes nouveaux pour dsigner des objets familiers. Comme le dit encore M. Meillet : le mot, soit prononc, soit entendu, n'veille presque jamais l'image de l'objet ou de l'acte dont il est le signe, mais, seulement, des tendances de toute nature, celles qu'veillerait la perception de cet objet ou de cet acte, d'ailleurs assez faibles. Une image aussi peu voque, et aussi peu prcisment, est par l mme sujette se modifier sans grande rsistance . Un tel homme serait, par rapport au groupe, dans les mmes conditions qu'un aphasique. Les mots, en effet, les expressions et les phrases d'une langue, du jour o les forces qui les pressaient en quelque sorte les uns contre les autres ne s'exercent plus, o ils ne sont plus soutenus les uns par les autres, sont exposs subir l'action des influences diverses qui tendent en modifier le sens 1 . La cause de l'aphasie ne se trouve donc pas dans une lsion crbrale, puisqu'elle pourrait se produire chez un sujet cet gard parfaitement sain 2. C'est un trouble intellectuel qui s'explique par une altration profonde des rapports entre l'individu et le groupe. En d'autres termes, il y aurait dans l'esprit de tout homme normal vivant en socit une fonction de dcomposition, de recomposition et de coordination des images, qui lui permet d'accorder son exprience et ses actes avec l'exprience et les actes des membres de son groupe. Dans les cas exceptionnels o cette fonction se drgle, s'affaiblit ou disparat de faon durable, on dit que l'homme est aphasique, parce que le symptme le plus marqu de cette perturbation, c'est que l'homme ne peut plus se servir des mots. Nous avons trouv une confirmation prcieuse de cette thse dans les observations si remarquables d'aphasiques de guerre qui ont t publies par M. Head. Jusqu' prsent, soit que les sujets ne s'y fussent gure prts, soit que les observateurs n'eussent pas jug intressant de pousser l'enqute en ce sens, on possdait fort peu de renseignements prcis sur la faon dont les aphasiques accomplissent (ou n'accomplissent pas) ces oprations un peu complexes qui supposent l'intelligence des conventions pratiques admises dans leur groupe 3. Or, M. Head a pu tudier 11 aphasiques par blessure de guerre, c'est--dire des jeunes gens atteints en pleine sant, trs intelligents, euphoriques plutt que dprims ( mesure que la gurison progresse), trs diffrents cet gard des aphasiques ordinaires atteints de dgnration artrielle, et plus capables qu'eux de s'analyser et de se prter des preuves assez longues et quelquefois complexes. D'autre part, l'auteur a prcisment tudi chez ces aphasiques le rle des mots et des autres modes de reprsentation symbolique dans l'vocation et la coordination des images ou souvenirs visuels : c'est dire qu'en vue de la solution du problme qui nous intresse il a utilis de nouveaux tests,
1 2
Ibid., p. 236 sq. Un candidat qui, un examen, se trouble au point de perdre momentanment la mmoire des mots, ou d'un ensemble de notions didactiques, ou de l'un et l'autre, prsente les mmes symptmes qu'un aphasique. Or ce trouble s'explique non par une lsion crbrale, mais par des causes videmment sociales. Dans une des descriptions les plus dtailles cet gard qu'a publies MOUTIER, voici, par exemple, comment il apprcie l'intelligence gnrale : le malade connat la valeur exacte des pices de monnaie. Il copie correctement le modle simple de traits assembls. La copie du modle complexe est excute trs maladroitement, mais sans oubli. La mimique est satisfaisante. Salut militaire, pied de nez, capture d'une mouche, tout cela est bien excut. Op. cit., p. 655.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
57
et a su tirer un parti inattendu de ceux qu'on connaissait dj. Nous n'hsiterons donc pas rapporter ici en dtail quelques-unes de ses expriences 1. On savait dj qu'un aphasique est souvent incapable de reproduire certains mouvements plus ou moins complexes ,qu'on excute devant lui, et on l'expliquait quelquefois par la disparition des images ou souvenirs correspondants. Mais cette incapacit ne rsulte-t-elle pas directement de l'oubli des mots ? C'est ce que M. Head a essay d'tablir de la manire que voici. L'preuve de l'il et de l'oreille , qui consiste faire reproduire par le malade des gestes tels que : touchez votre oreille droite avec votre main gauche, etc., tait excute dans les conditions suivantes : d'abord l'observateur se plaait face au sujet et excutait les mouvements sans dire un mot ; puis le sujet tait devant un miroir, et l'observateur se plaait derrire lui, tous deux face au miroir. Or, on a constat qu'en gnral l'preuve donnait de bien meilleurs rsultats, quand il s'agissait d'imiter en miroir 2. Il en tait de mme, quand on prsentait ensuite au sujet, de face, un dessin reproduisant le geste excuter, et qu'on lui montrait le mme dessin reflt dans un miroir : il se trompait dans le premier cas, non dans le second. Enfin, lorsque le commandement tait fait oralement, ou lorsque, sans dire un mot, on montrait au sujet une carte sur laquelle il tait indiqu en caractres imprims, on obtenait peu prs les mmes rsultats que lorsque le sujet ou le dessin reproduisant le geste et l'observateur, se refltaient dans un miroir 3. D'aprs M. Head, on peut en conclure que l'incapacit d'excuter ou de reproduire le geste, quand elle existe, rsulte non pas de la destruction des images, mais du manque de mots . Sans doute, lorsque le sujet reproduit le geste vu dans le miroir, l'imitation est automatique, il n'y a rien comprendre, il n'a pas besoin de distinguer la droite de la gauche, son bras est en quelque sorte attir par le bras de l'observateur 4. C'est, dans le domaine visuel, l'analogue de l'cholalie. Mais quand un sujet en face de moi essaie d'imiter les mouvements de ma main droite ou gauche mise en contact avec un de mes yeux ou une de mes oreilles, la parole interne est une phase de l'acte normal . Alors, en effet, il faut au
1
HEAD (Henry), Aphasla and kindred disorders of speech, Brain, 1920, July, pp. 87-165. D'aprs M. Head, les changements de structure produits par un choc local sur la surface externe du cerveau non seulement produisent des manifestations crbrales moins graves et tendues [que le ramollissement en suite de trombose], mais donnent mieux occasion l'apparition d'une perte de fonction sous forme dissocie . Sur 9 sujets qui se trompaient plus ou moins dans le premier cas, 4 reproduisaient correctement les mouvements dans le second, un ne les reproduisait qu'imparfaitement, deux se trompaient lgrement, un trs lgrement, un seul, qui s'tait tromp compltement dans le premier cas, se trompait, mais moins, dans le second. M. HEAD distingue 4 catgories de sujets suivant que l'aphasie est verbale (difficult de trouver les mots, soit oralement, soit par crit), nominale (emploi incorrect des mots, dfaut de comprhension de leur valeur nominale), syntactique (jargon : l'articulation des mots et le rythme de la phrase, ainsi que l'accord grammatical sont altrs), et smantique (le sujet ne reconnat pas la signification entire des mots et des phrases, ne comprend pas le but final d'une action qu'on lui dit d'accomplir, ne comprend pas qu'on lui donne un ordre). Les sujets de la dernire catgorie ne russissent aucune de ces preuves. Ceux qui sont atteints d'aphasie nominale se trompent moins gravement, lorsqu'ils reproduisent en miroir , mais ne peuvent excuter un ordre oral ou imprim. Les observations ci-dessus volent donc surtout pour les aphasiques verbaux et pour les aphasiques syntactiques (bien que ceux-ci se trompent quelquefois, quand ils excutent un ordre oral ou imprim). A supposer qu'il sache qu'il doit lever le mme bras, et le diriger du mme ct (les aphasiques smantiques seuls paraissent ne point le savoir : c'est pourquoi ils ne reproduisent pas en miroir ) et, aussi, qu'il garde le sentiment familier de la correspondance symtrique entre ses mouvements et leur reflet (mais certains animaux le possdent).
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
58
pralable comprendre le geste, c'est--dire l'exprimer ou le reprsenter d'une manire conventionnelle : il faut au moins formuler des mots tels que : droite, ou gauche, et traduire en quelque mesure le geste vu en langage intrieur. J'ai toujours dit, dclare ce propos un des sujets, que c'est comme si je traduisais une langue trangre que je ne sais pas bien. D'une manire gnrale tout acte qui exige l'intervention de l'aspect nominal de la pense ou de l'expression symbolique [conventionnelle] est mal excut . C'est pourquoi, titre de contre-preuve, on constate que les mmes sujets excutent le commandement oral ou imprim - en effet, les mots articuls ou crits, et, avec eux, les symboles ncessaires leur sont alors donns. Et c'est pourquoi, enfin, le sujet ne peut que trs difficilement indiquer par crit le geste, rel ou dessin, mme lorsqu'il le voit reflt dans un miroir : crire ncessite l'interpolation de mots dans ce qui aurait t autrement un acte d'imitation non verbale 1. Entre l'ide claire d'un geste ou d'un ensemble de gestes, et la comprhension d'un dessin, ou sa reproduction, il n'y a pas grande diffrence. On peut s'attendre ce que les aphasiques prouvent quelque peine dessiner, en soient mme presque incapables. Mais pourquoi? Est-ce parce qu'ils n'ont plus dans l'esprit, quand ils dessinent, l'image ou le souvenir dtaill et concret du modle ? M. Bergson, parlant des malades atteints de ccit verbale, c'est--dire d'une perte de la reconnaissance visuelle limite aux caractres de l'alphabet, remarquait que souvent ils ne sont point capables de saisir ce qu'on pourrait appeler le mouvement des lettres quand ils essaient de les copier. Ils en commencent le dessin en un point quelconque, vrifiant tous moments s'ils restent d'accord avec le modle . Et cela est d'autant plus remarquable qu'ils ont souvent conserv intacte la facult d'crire sous la dicte ou spontanment. Ce ne sont donc pas les images correspondantes qui ont disparu, mais le sujet a perdu l'habitude de dmler les articulations de l'objet aperu, c'est--dire d'en complter la
1
Ce chapitre tait termin avant que nous ayons pu lire, sur les preuves qu'il a bien voulu nous communiquer, la partie du livre de M. DELACROIX, Le langage, qui est consacre l'aphasie. Parlant du test imagin par Head et que nous dcrivons ci-dessus, M. Delacroix dit : Sans contester aucunement ces faits, on peut les interprter autrement que Head. Et il renvoie aux articles de MOURGUE, Disorders of symbolic thinking, British journal of Psychology, 1921, p. 106, et de VAN WOERKOM, Revue neurologique, 1919, et Journal de Psychologie, 1921. Il dit plus bas : Dans le test du miroir de Head, il n'est pas ncessaire que le sujet plac en face du mdecin se dise qu'il doit transposer les mouvements perus de la droite la gauche, mais il faut qu'il ait une vision de l'espace et de l'orientation dans l'espace; il faut qu'il puisse renverser un schma spatial, il faut qu'il analyse, qu'il dcoupe, qu'il recompose. Une telle opration peut se compliquer de langage ou se prsenter sans langage. Plus loin encore : Comme le disent trs bien Van Woerkom et Mourgue, le test de Head, chez les adultes, suppose beaucoup moins langage intrieur que manipulation de l'atlas spatial, orientation... C'est la fonction de construire dans l'espace dont il dcle la lacune. - Mais M. Delacroix ne mentionne pas la contre-preuve imagine par Head, et qui consiste en ce que le mme sujet est capable d'excuter l'ordre, lorsqu'il lui est donn oralement ou par crit. Il semble bien ds lors que ce qui lui manquait pour comprendre le geste propos son attention, c'taient les mots ncessaires pour le formuler. Dirat-on cependant qu'il s'agit l de deux oprations entirement diffrentes, et que, si la sujet ne peut formuler le geste qu'il voit, ce n'est pas seulement parce que les mots lui manquent, c'est aussi, et surtout, parce qu'il ne peut pas renverser un schma spatial ? Bornons-nous rpondre que, du moment qu'un sujet comprend un ordre oral ou crit, il sait la fois 3 choses: qu'il lui vient du dehors, que celui qui le donne le comprend aussi, et qu'il pourrait l'excuter. Or l'effort de transposition est le mme, qu'il se reprsente un geste qu'il va faire, excut par un autre, ou un geste qu'un autre excute, reproduit par lui-mme. La formule verbale, Condition qu'il en saisisse le sens, c'est--dire qu'il y reconnaisse une convention, suffit donc faire comprendre au sujet ce genre d'inversion. Nous verrons d'ailleurs qu'il y a des raisons de penser qu'elle est non seulement suffisante, mais ncessaire, pour s'orienter dans l'espace, ou, en d'autres termes. que le symbolisme spatial suppose un ensemble de conventions, sur l'espace. mais comment former des conventions sans mots ?
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
59
perception visuelle par une tendance motrice en dessiner le schme 1. Nous pouvons, au lieu d'une tendance motrice le dessiner, supposer que ce qui manque au sujet, c'est la notion mme du schme, qu'il s'agisse d'un dessin simplifi, de mots (par exemple : une barre pour un i ; un rond pour un o, etc.), ou de la position des traits et des lettres l'un par rapport l'autre. De plusieurs observations disperses dans l'tude de M. Head, il rsulte bien que les sujets ne russissent pas dessiner certains objets parce qu'ils ne se les reprsentent pas sous forme schmatique, alors mme qu'ils, peuvent les reproduire sans les voir, spontanment. Mais il tait intressant d'inviter les aphasiques dessiner en quelque sorte le schme lui-mme : c'est ce que M. Head a imagin. A l'un d'eux, on demanda, par exemple, d'indiquer sur une feuille de papier la position relative des objets dans la salle o tait son lit. Il n'y russit pas. M. Head dessina alors un rectangle au milieu de la feuille, et lui dit : C'est l qu'est votre lit. Il put retrouver alors la position des autres lits, et plusieurs dtails, avec exactitude : mais il tait incapable d'en marquer l'emplacement sur la feuille. Ainsi, tout d'abord, il ne savait par o commencer, et quel point de repre choisir. Ensuite, quand, en dessinant un rectangle, on fixait son attention sur son lit, il se rappelait bien les objets environnants : sans doute il se reprsentait ce qu'il voyait lorsqu'il tait couch, et pouvait dcrire une une les images qui lui apparaissaient lorsqu'il tournait la tte de gauche droite par exemple. Mais il ne lui tait pas possible de les rduire une formule symbolique . Il lui manquait la notion du plan schmatique, et sans doute des mots qui lui eussent permis de fixer la position relative des objets. Un autre sujet commenait dessiner un plan de sa chambre, mais le remplissait de dtails en lvation : il n'tait donc point capable de se reprsenter abstraitement des positions et des distances dans un plan, l'occasion d'objets dont il gardait d'ailleurs le souvenir 2. Un troisime sujet n'prouvait pas de difficult, les yeux ferms, indiquer l'emplacement de la fentre, du foyer, du lavabo, de la commode, de la porte et des autres meubles. Mais si on lui demandait de dire comment le lavabo tait plac par rapport au foyer, ou le foyer par rapport la porte, il chouait compltement. Si on lui permettait toutefois de dire : le feu est l, la porte est l , il donnait ces indications trs exactement . Il sait trs bien o ils sont, il est certain qu'il peut les voir dans son esprit, mais il ne peut exprimer leur position relative 3. Ainsi, dans tous ces cas, les images des objets ne sont certainement pas dtruites, c'est--dire que le sujet n'a pas perdu la facult de les reconstruire, puisqu'il peut les dcrire et mme les dessiner telles qu'il les voit : il indique leur emplacement par rapport lui, mais non des uns par rapport aux autres. Ce qui lui manque, pour y russir, c'est la facult de se reprsenter schmatiquement des distances et situations relatives dans le plan, parce qu'il lui manque aussi les mots qui le lui permettraient. A la diffrence des aphasiques atteints de ccit psychique (cas d'ailleurs rares), qui perdent souvent le sens de l'orientation au point qu'ils ne peuvent, mme aprs des mois d'exercice, s'orienter dans leur propre chambre 4, et des aphasiques de
1 2
3 4
Matire et mmoire, p. 99. Dans le groupe des aphasiques smantiques (voir ci-dessus, p. 97, n 1) aucun sujet ne pouvait dessiner le plan d'une chambre familire. L'un d'eux, -excellent dessinateur avant sa blessure, commenait bien, amis oubliait les fentres et les portes; de plus il plaait sa chaise ct du foyer, tandis qu'elle tait au milieu de la chambre. Il oubliait la table en face de lui, mais indiquait plusieurs dtails, tels que ma machine peser et ma machine crire, de peu d'importance relative. Ibid., p. 147. Ibid., p. 146. BERGSON, Matire et mmoire, p. 98.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
60
guerre observs par Pierre Marie et Foix 1, chez qui on a constat souvent des troubles de l'orientation : difficult se guider dans les rues, dans une pice, perte du souvenir des directions simples , ceux de M. Head trouvent leur chemin sans difficult : propos seulement de deux ou trois, les plus atteints, il nous dit que le mouvement de la rue les trouble beaucoup. Pourtant, ceux-mmes qui s'orientent parfaitement ne peuvent point, souvent, expliquer comment ils se proposent d'aller d'un endroit un autre. Un de ces sujets se rappelle bien l'aspect de quelques-uns des difices qui se trouvent sur son chemin, il a mme gard le souvenir de la distance qui les spare ; mais il ne peut plus dsigner les rues qu'il doit suivre. C'est, dit-il, par petits morceaux que je dois exprimer ce que je veux dire... Il faut que je saute, comme ceci , et il marque une ligne paisse entre ,deux points avec son crayon, comme un homme qui saute d'une chose la suivante. Je peux voir, niais je ne peux pas exprimer. En ralit, c'est que je ne possde pas assez de noms. Pratiquement je n'ai plus de noms 2. Il est donc capable encore d'voquer les images, mais, pour qu'il se les reprsente d'ensemble et dans leurs rapports, il lui faudrait les formuler verbalement. En d'autres termes, les images se dispersent, s'parpillent, si bien que chacune ne reprsente qu'elle-mme ; un mot, au contraire, voque d'ordinaire d'autres mots. Quand on ne dispose plus de mots, c'est comme si les articulations de la pense s'taient, rompues. Il y a d'ailleurs peut-tre lieu de distinguer, des mots eux-mmes, et des phrases et propositions qu'ils forment, des schmes plus gnraux encore : reprsentations symboliques de formes, d'attitudes, de distances et de dures, qui constitueraient comme les lments d'un langage ou systme de signes la fois abstrait et visuel. M. Head a russi isoler ce genre de symboles, lorsqu'il a examin comment les aphasiques rglent une horloge. S'agit-il de la rgler d'aprs une autre ? C'est un acte d'imitation machinale, que tous les aphasiques accomplissent correctement. Mais s'agit-il de rgler ainsi une horloge sur commandement crit ou imprim ? Certains le peuvent, ds qu'ils ont entendu ou lu les mots, alors mme qu'ils ont quelque difficult (parce qu'ils ne trouvent pas tout de suite les mots) lire l'heure. D'autres sont nettement incapables aussi bien de marquer l'heure en dplaant les aiguilles que de la lire. Ce n'est pas la connaissance du temps qui leur manque (ils peuvent dire : c'est quand vous mangez, ou quand nous tions l), mais les moyens symboliques d'exprimer, mme pour eux-mmes, ce qu'ils savent. Ils confondent la grande aiguille et la petite, ou bien ne savent pas distinguer entre moins un quart, et un quart, ou bien ne savent pas que la petite aiguille doit tre une distance de l'heure proportionnelle au nombre de minutes qui s'y ajoutent : ils comprennent les noms qui dsignent les heures, mais n'ont plus l'ide de la convention par laquelle on les reprsente. Ainsi dans le second cas, les mots, mme quand on les entend, et qu'on les comprend isolment ou en gros, ne suffisent pas recrer la reprsentation symbolique de l'heure, dont le sujet n'est plus capable. Dans le premier cas, cette notion restait intacte, puisque les sujets russissaient lire l'heure, et les mots, lorsqu'ils sont parvenus du dehors la conscience, n'ont t compris et bien interprts que parce qu'elle tait l. Toutes ces observations nous laissent supposer que ce qui manque l'aphasique ce sont moins les souvenirs que le pouvoir de les replacer dans un cadre, c'est ce cadre lui-mme, sans lequel il ne peut rpondre en termes impersonnels et plus ou moins objectifs une question prcise qui lui est pose par le milieu social : pour que
1 2
Les aphasies de guerre, Revue neurologique, fvrier-mars 1917. Ibid., pp. 134-135.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
61
la rponse soit adapte la demande, il faut en effet que le sujet se place au mme point de vue que les membres de son groupe qui l'interrogent ; or, il semble bien que, pour cela, il faut qu'il se dtache de lui-mme, que sa pense s'extriorise, ce qu'elle ne peut qu'au moyen d'un de ces modes de reprsentation symbolique qui font dfaut dans l'aphasie. Certes, il est rare qu'un aphasique non seulement ne comprenne pas la signification d'un ordre crit ou parl, mais mme ne comprenne pas que c'est un ordre. En tout cas, la difficult d'excuter un ordre ou de rpondre s'explique trs souvent par l'espce d'inversion de point de vue qu'impliquent l'ordre et la demande, l'excution et la rponse, et dont le sujet n'est pas toujours ni entirement capable. Pour qu'on puisse sortir de soi et se placer momentanment la place d'un autre, il faut avoir l'ide distincte de soi, des autres, et des rapports qui existent entre nous et eux : c'est un premier degr de reprsentation la fois symbolique et sociale, le plus bas, sans doute, et qui ne disparat jamais entirement, mais qui peut tre trs affaibli et rtrci, de faon n'intervenir que pour un trs petit nombre d'actions. Dans tous les exemples tudis ci-dessus, quelque altration .de ce pouvoir se dcouvre. Si le sujet imite en miroir des gestes qu'il ne peut reproduire directement, c'est sans doute parce que dans un cas il n'a pas besoin de distinguer, par un effort de rflexion, la droite de l'observateur et sa gauche, mais c'est aussi parce que, dans ce mme cas, peine a-t-il besoin de se distinguer de l'observateur, qui se confond avec lui dans la double image solidaire renvoye par la glace. S'il n'est point capable de lire l'heure, ou, mme lorsqu'il saisit le sens des mots, de rgler correctement l'horloge lorsqu'on l'y invite oralement ou par crit, c'est que le rapport entre la position des aiguilles et les divisions du temps rsulte d'une convention sociale, que, pour comprendre celleci, il faut se placer au point de vue des membres du groupe, ce qui lui est difficile ou impossible. Si, alors mme qu'il garde le souvenir des objets isols, des maisons et monuments isols, il ne russit pas les situer l'un par rapport l'autre, et en marquer l'emplacement sur un plan qu'il dessine, c'est qu'il lui faudrait, au-dessus et au del des images particulires, se reprsenter l'ordre des situations sous forme impersonnelle ; une telle notion, indispensable aux hommes d'une socit s'ils veulent se comprendre entre eux, lorsqu'ils parlent des lieux et des positions dans l'espace, dcidment le dpasse ; il n'est plus capable d'accorder les sensations qui lui viennent des objets sensibles avec celles qu'en reoivent les autres, ou qu'ils en pourraient recevoir ; en ralit, il ne peut plus se mettre leur place 1. La perte des mots, soit qu'il ne les trouve plus ou ne les forme plus volont, soit que, lorsqu'il les entend, il n'en saisisse plus le sens et l'enchanement, n'est qu'une manifestation particulire d'une incapacit plus tendue : tout le symbolisme conventionnel, fondement ncessaire de l'intelligence sociale, lui est devenu plus ou moins tranger. Plus on tudie les aphasiques, plus on s'aperoit que la diversit de leurs aptitudes ou inaptitudes, et des catgories o on peut les ranger, s'explique par les modes variables de dislocation, destruction et conservation partielle de ces cadres. Parlant de ces formes dissocies de la pense et de l'expression symboliques , M. Head a fait
1
On le voit bien dans certaines preuves classiques, telles que celle des 3 papiers. Elle consiste remettre au sujet 3 papiers de grandeur ingale, et lui dire, par exemple, de jeter le moyen, de garder le grand, et de donner le petit l'observateur, lorsqu'on lui fera signe de commencer. Le sujet, tandis qu'on lui donne ces ordres qu'il devra excuter plus tard, s'efforce d'esquisser l'avance le geste qu'il doit excuter: s'il n'y avait que 2 papiers et 2 gestes, ou s'il possdait un 3e bras, il y russirait sans doute. Mais il est bien oblig de se reprsenter l'un des 3 gestes comme s'il devait tre accompli par une autre personne (par un autre lui-mme) et, comme il en est incapable, il ne russit pas.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
62
observer qu'elles nous rvlent non les lments, mais les composants en lesquels le processus psychique complet peut tre spar . Suivant la comparaison trs ingnieuse qu'il propose: Quand un homme a reu un grave choc au pied, tout d'abord il peut tre entirement incapable de marcher. Mais, aprs quelque temps, on observe qu'il marche, d'une manire particulire, suivant que la blessure affecte son talon ou son orteil. La marche qu'il adopte n'est pas un lment de sa mthode normale de marcher , mais un autre mode de marche, conditionn par le fait qu'il ne peut poser une partie de son pied sur le sol. Supposons maintenant que la marche lui ait t enseigne par ceux qui l'entourent ; s'il ne peut plus marcher comme les autres, c'est qu'il a perdu le pouvoir d'associer ses mouvements et d'assurer son quilibre comme eux : si on lui demande de marcher comme les autres, non seulement il s'en rvlera incapable, mais encore il faudra qu'il oublie qu'on lui a command d'imiter ses semblables, pour qu'il russisse marcher par ses propres Moyens, en faisant appel d'autres muscles, d'autres points d'appui, c'est--dire en s'inspirant d'un autre plan, qui ne vaut d'ailleurs que pour lui.
C'est pourquoi l'examen des aphasiques mnage aux observateurs plus d'une surprise. Ce trouble se caractrise-t-il parla disparition d'une certaine catgorie d'images, verbales ou autres, auditives ou visuelles ? On l'a cru longtemps. Mais comment se fait-il que les mots, qui paraissaient absents en effet lorsqu'il fallait les prononcer ou les comprendre en se conformant certaines conditions, reparaissent quand ces conditions ne s'imposent plus 1 ? N'est-il pas remarquable que le mme sujet qui ne peut ni copier un texte, ni dchiffrer une phrase, ni dessiner, ni faire un plan, ni dire l'heure, lorsqu'on le lui demande, soit capable de lire, d'crire, de dessiner, de s'orienter dans l'espace et le temps, spontanment, c'est--dire quand on ne le lui commande pas, qu'il puisse lire des phrases lorsqu'on, ne l'astreint pas les dcomposer en mots, ou les crire sans articles ni conjonctions, et non autrement ? L'aphasie consiste-t-elle dans l'affaiblissement de l'intelligence gnrale ? On l'a cru galement. En ralit l'intelligence n'est pas atteinte tout entire, mais il se prsente des combinaisons d'aptitudes et inaptitudes assez tranges. Un sujet ne pourra indiquer la valeur des pices de monnaie, mais fera correctement le change ; un autre oublie les nombres, mais non la rgle d'addition et de soustraction ; un autre est au-dessus de la moyenne aux checs, mais ne peut plus jouer au bridge ; un autre encore peut crire son nom et son adresse, mais non ceux de sa mre, bien qu'il vive dans la maison de celle-ci ; un officier, qui suivait les mouvements du front sur une grande carte (ce qui implique l'intelligence d'un certain nombre de reprsentations conventionnelles) ne pouvait suivre (bien qu'il comprt les mots et les membres de phrase) une conversation sur le mme sujet. C'est qu'en effet ils ne peuvent plus comprendre certaines conventions, tandis que d'autres ont gard pour eux toute leur valeur.
Nous avons vu la Salptrire un sujet qui ne pouvait lire et qui, pour, nous expliquer qu'il tait n au mois de juin, cachait avec sa main, sur un calendrier, les dernires lettres du mois de juillet. Head dit qu'un aphasique incapable de lire peut montrer une carte imprime qui correspond une des, couleurs qu'on lui prsente.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
63
* ** II - iv
Retour la table des matires
En rsum, il n'y a pas de mmoire possible en dehors des cadres dont les hommes vivant en socit se servent pour fixer et retrouver leurs souvenirs. Tel est le rsultat certain o nous conduit l'tude du rve et de l'aphasie, c'est--dire des tats les plus caractristiques o le champ de la mmoire se rtrcit. Dans les deux cas, ces cadres se dforment, s'altrent, se dtruisent en partie, mais de deux faons trs diffrentes, si bien que la comparaison du rve et de l'aphasie nous permet de mettre en lumire deux aspects de ces cadres, et comme deux sortes, d'lments dont ils sont composs. Il y a bien des formes diffrentes d'aphasie, bien des degrs, dans la rduction des souvenirs qu'elle dtermine. Mais il est rare qu'un aphasique oublie qu'il fait partie d'une socit. L'aphasique sait bien que ceux qui l'entourent et qui lui parlent sont des hommes comme lui. Il prte une attention intense leurs paroles : il manifeste, vis-vis d'eux, des sentiments de timidit, d'inquitude, il se sent diminu, humili, il s'afflige, et quelquefois il s'irrite, parce qu'il n'arrive pas tenir ou reconqurir sa place dans le groupe social. Bien plus, il reconnat les personnes, et leur prte une identit dfinie. Il peut, en gnral, se rappeler les vnements principaux de son propre pass ( la diffrence des amnsiques), et le revivre en quelque mesure, alors mme qu'il ne russit pas en donner aux autres une ide suffisamment dtaille. Toute une partie de sa mmoire, celle qui retient les vnements et garde le souvenir des personnes, reste donc en contact avec la mmoire collective et sous son contrle. Il s'efforce de se faire comprendre des autres, et de les comprendre. Il est comme un homme qui, dans un pays tranger, ne parle pas la langue, mais connat l'histoire de ce pays, et n'a pas oubli sa propre histoire. Mais un grand nombre de notions courantes lui manquent. Plus prcisment, il y a un certain nombre de conventions dont il ne comprend plus le sens, bien qu'il sache qu'elles existent, et qu'il s'efforce en vain de s'y conformer. Un mot entendu ou lu ne s'accompagne pas, chez lui, du sentiment qu'il en saisit le sens; des images d'objets dfilent devant ses yeux sans qu'il mette un nom sur eux, c'est--dire sans qu'il en reconnaisse la nature et le rle. Il ne peut plus, dans certaines circonstances, identifier sa pense avec celle des autres, et s'lever cette forme de reprsentation sociale qu'est une notion, un schme ou un symbole d'un geste ou d'une chose. Sur un certain nombre de points de dtail, le contact est interrompu entre sa pense et la mmoire collective. Au contraire, pendant le sommeil, les images qui se succdent dans l'esprit du rveur, chacune prise part, sont reconnues , c'est--dire que l'esprit comprend ce qu'elles reprsentent, qu'il en saisit le sens, qu'il se sent le pouvoir de les nommer. D'o il rsulte que, mme quand il dort, l'homme conserve l'usage de la parole, en tant que la parole est un instrument de comprhension. Il distingue les choses et les actes, et se place au point de vue de la socit pour les distinguer. On peut supposer qu'un homme veill se trouve au milieu de rveurs qui diraient tout haut ce qu'ils voient en rve : il les comprendrait, et il y aurait donc l comme une bauche de vie sociale. Il est vrai que l'homme veill ne russirait pas mettre d'accord la suite des
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
64
penses d'un rveur avec celles d'un autre, et faire en sorte, comme dit Pascal, qu'ils pussent rver en compagnie 1. De deux monologues de rveurs il ne russirait pas faire un dialogue. Pour cela, en effet, il faudrait que l'esprit des rveurs ne se borne pas oprer sur des notions empruntes au milieu social, mais que leurs penses se suivent conformment l'ordre o se suivent les penses de la socit. La socit, effectivement, pense par ensembles : elle rattache ses notions les unes aux autres, et les groupes en reprsentations plus complexes de personnes et d'vnements, comprises elles-mmes dans des notions plus complexes encore. Or le rveur imagine bien des hommes et des faits qui ressemblent ceux de la veille, mais il n'voque pas, propos de chacun d'eux, tous ces dtails caractristiques qui, lorsqu'il est veill, constituent pour lui la personnalit des hommes et la ralit des faits. Ceux qu'il construit, au gr de sa fantaisie, n'ont ni consistance, ni profondeur, ni cohrence, ni stabilit. En d'autres termes la condition du rve semble bien tre telle que le rveur, tout en observant les rgles qui dterminent le sens des mots, le sens aussi des objets et des images envisags isolment, ne se souvient plus des conventions qui fixent, dans l'espace et le milieu social, la place relative des lieux et des vnements ainsi que des personnes, et qu'il ne s'y conforme pas. Le rveur ne peut pas sortir de luimme, en ce sens qu'il n'est pas capable d'envisager du point de vue collectif ces ensembles, hommes et faits, rgions et priodes, groupes d'objets et d'images en gnral, qui sont au premier plan de la mmoire de la socit. Htons-nous d'ajouter que cette distinction est toute relative, et que ces deux aspects de la mmoire, qui se prsentent ainsi dissocis dans l'aphasie et dans le rve, n'en sont pas moins troitement solidaires. Dans les cas d'aphasie trs prononce, il est bien difficile de savoir si la mmoire des vnements subsiste, et jusqu' quel point le malade reconnat les personnes. Les aphasiques moins atteints, du fait qu'ils ne peuvent, faute de mots, raconter leur pass, et que leurs relations avec les autres hommes se rduisent, ne doivent garder qu'un sentiment assez vague des temps, des lieux et des personnes. D'autre part, si l'on reconnat en gros Les images qui se succdent dans le rve, on n'en a cependant qu'une vue superficielle et confuse : il entre dans nos rves tant de contradictions, nous nous y affranchissons tel point des lois physiques et des rgles sociales, qu'entre les ides que nous nous faisons des objets mme isols, et les notions que nous en aurions l'tat de veille, il n'existe qu'un rapport assez lointain. Au reste, entre une notion simple et une notion complexe, entre un objet isol et un ensemble, o est la limite, et, suivant les points de vue, le mme groupe de faits ou de caractres ne pourra-t-il pas tre envisag comme l'un ou comme l'autre ? Il n'en est pas moins vrai que s'il arrive qu'on perde contact avec la mmoire collective de deux manires aussi diffrentes, il doit bien exister, dans celle-ci, deux systmes de conventions qui, d'ordinaire, s'imposent en mme temps aux hommes, et mme se renforcent en s'associant, mais qui peuvent aussi se manifester sparment. Le rveur, nous l'avons montr, n'est plus capable de reconstituer le souvenir des vnements complexes, qui occupent une dure et une tendue spatiale apprciables; c'est qu'il a oubli les conventions qui permettent l'homme veill d'embrasser dans sa pense de tels ensembles. En revanche il est capable d'voquer des images fragmentaires, et de les reconnatre, c'est--dire d'en comprendre la signification; c'est qu'il a retenu les conventions qui permettent l'homme veill de nommer les objets, et de les distinguer les uns des autres au moyen de leurs noms. Les conventions verbales ,constituent donc le cadre la fois le plus lmen1
Et qui doute que, si on rvait en compagnie, et que par hasard les songes s'accordassent, ce qui est assez ordinaire, et qu'on veillt en solitude, on ne crt les choses renverses ? Pascal a barr cet alina qu'il avait ajout l'article 8, t. I., dit., Havet, p. 228, note.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
65
taire et le plus stable de la mmoire collective : cadre singulirement lche, d'ailleurs, puisqu'il laisse passer tous les souvenirs tant soit peu complexes, et ne retient que des dtails isols et des lments discontinus de nos reprsentations,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
66
Chapitre III
La reconstruction du pass
Retour la table des matires
Lorsque nous tombe entre les mains un des livres qui firent la joie de notre enfance, et que nous n'avons plus ouvert depuis, ce n'est pas sans une certaine curiosit, sans l'attente d'un rveil de souvenirs, et d'une sorte de rajeunissement intrieur, que nous en commenons la lecture. Rien que d'y penser, nous croyons nous retrouver dans l'tat d'esprit o nous tions alors. Que demeurait-il en nous, avant ce moment, et ce moment mme, de nos impressions d'autrefois ? La notion gnrale du sujet, quelques types plus ou moins bien caractriss, tels pisodes particulirement pittoresques, mouvants ou drles, parfois le souvenir visuel d'une gravure, ou mme d'une page ou de quelques lignes. En ralit, nous nous sentions bien incapables de reproduire par la pense toute la suite des vnements dans leur dtail, les diverses parties du rcit, avec leurs proportions par rapport l'ensemble, et toute la srie des traits, indications, descriptions, propos et rflexions qui gravent progressivement dans l'esprit du lecteur une figure, un paysage, ou le font pntrer au cur d'une situation. C'est bien parce que nous sentons quel cart subsiste entre le souvenir vague d'aujourd'hui et l'impression de notre enfance qui, nous le savons, a t vive, prcise et forte, que nous esprons, en relisant le livre, complter celui-l, et faire renatre celle-ci.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
67
Or, le plus souvent, voici ce qui se passe. Il nous semble lire un livre nouveau, ou tout au moins remani. Il doit y manquer bien des Pages, des dveloppements, ou des dtails qui y taient autrefois, et, en mme temps, on doit y avoir ajout, car notre intrt se porte ou notre rflexion s'exerce sur une quantit d'aspects de l'action et des personnages que, nous le savons bien, nous tions incapables alors d'y remarquer, et, d'autre part, ces histoires nous paraissent moins extraordinaires, plus schmatiques et moins vivantes, ces fictions sont dpouilles d'une grande partie de leur prestige ; nous ne comprenons plus comment ni pourquoi elles communiquaient notre imagination un tel lan. Notre mmoire, sans doute, ressaisit, au fur et mesure que nous avanons, une bonne partie de ce qui paraissait s'en tre coul, mais sous une forme nouvelle. Tout se passe comme lorsque un objet est vu sous un angle diffrent, ou lorsqu'il est autrement clair : la distribution nouvelle des ombres et de la lumire change ce point les valeurs des parties que, tout en les reconnaissant, nous ne. pouvons. dire qu'elles soient restes ce qu'elles taient. Ce qui est le plus apparent, et que nous allons d'abord examiner, ce sont les ides et rflexions suggres parla nouvelle lecture, et dont nous sommes bien assur qu'elles n'auraient pu accompagner la premire. Nous supposons qu'il s'agit d'un livre crit pour des enfants, et o il ne se trouve point des dveloppements trop abstraits et qui dpassent leur porte. Pourtant, si c'est une histoire ou un rcit de voyage racont des enfants, ce n'est pas une histoire raconte par des enfants. L'auteur est une grande personne, qui arrange et combine les faits, les actions des personnages et leurs discours de faon ce que l'enfant comprenne et s'intresse, mais de faon aussi lui offrir un tableau vraisemblable du monde et de la socit o il se trouve et o il est appel vivre. Il est donc invitable que, s'exprimant comme une grande personne, bien qu'il s'adresse des enfants, il ait introduit dans son rcit, moins qu'il y ait sous-entendu toute une conception des hommes et de la nature qui ne lui est sans doute point propre, qui est commune et courante, mais laquelle les enfants ne sont point capables ni n'ont le dsir ou le besoin de se hausser. S'il sait son mtier, il conduit insensiblement son lecteur de ce qu'il connat ce qu'il ne connat pas. Il fait appel aux expriences et aux imaginations courantes de l'enfant, et, de proche en proche, il lui ouvre ainsi de nouveaux horizons. Mais il ne le transporte pas moins d'emble un niveau o celui-ci ne se serait pas lev tout seul, et il l'oblige lire beaucoup de mots et de phrases dont il ne comprend que trs incompltement le sens. Peu importe : l'essentiel est que son lecteur ne se laisse point arrter par ce qui lui chappe, que ce qu'il comprend suffise l'entraner toujours plus loin et plus avant. On a souvent remarqu quel point les enfants acceptent les situations et explications les plus dconcertantes, les plus choquantes pour la raison, simplement parce qu'elles s'imposent eux avec la ncessit des choses naturelles. Il suffit donc, lorsqu'un fait ou un objet rellement nouveau leur est prsent, qu'on les fasse rentrer dans des catgories connues, pour que leur curiosit soit satisfaite, et qu'ils ne posent plus ou ne se posent plus de questions. Plus tard seulement l'existence mme de ces catgories les tonnera, et il faudra, de chaque fait, leur apporter une explication : pour le moment ils se contentent de retrouver, dans ce qu'ils voient ou dans ce dont on leur parle pour la premire fois, une forme nouvelle ou une nouvelle combinaison de ralits familires. La passivit et l'indiffrence des enfants est bien plus marque lorsqu'il s'agit des lois et coutumes de la socit, que quand on les met en contact avec les faits de la nature. Une ruption volcanique, un cyclone, une tempte, et mme les phnomnes les plus frquents, la pluie, la succession des saisons, la marche du soleil, la vgtation, les diverses formes de la vie animale, les tonnent ; ils veulent qu'on leur en
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
68
donne une explication assez claire et assez complte ; ils multiplient les questions et ne se fatiguent point des dtails dont se peuvent charger les rponses ; bien plus ils rattachent, en un systme rudimentaire, tout ce qu'ils ont appris et observ cet gard. Au contraire ils acceptent sans difficult la diversit des usages et des conditions sociales, et, peut-tre, n'y appliquent-ils mme pas leur attention. Il est bien difficile d'expliquer aux enfants ce qu'est un tranger, un riche, un pauvre, un ouvrier. Ds qu'on leur parle d'une institution telle que les impts, les tribunaux, le commerce, ils coutent plus distraitement, et l'on sent que cela ne les intresse pas. Rousseau ne s'est pas tromp, lorsqu'il considrait que l'enfant n'est qu'un petit sauvage, qui doit tre mis l'cole de la nature, et que tout ce qu'on lui dit de la socit n'est, pour lui, que mots vides de sens. Les distinctions sociales ne l'intressent que si elles se traduisent sous une forme pittoresque. Un moine, un soldat, par leur costume et leur uniforme, un boucher, un boulanger, un cocher, par ce qu'il y a de matriel dans leur activit, frappent l'imagination de l'enfant. Mais toute la ralit de ces situations et mtiers s'puise, pour lui, dans ces figures extrieures, dans ces apparences concrtes. Ce sont des espces dfinies, au mme titre que les espces animales. L'enfant admettrait volontiers qu'on nat soldat ou cocher, comme on nat renard ou loup. Le costume, les traits physiques font partie de la personne, et suffisent la dterminer. L'enfant croit qu'il lui suffirait de porter les armes et les bottes d'un trappeur ou la casquette d'un officier de marine pour s'identifier avec l'un ou l'autre, et possder en mme temps les qualits idales qu'il prte chacun d'eux. Or, cet ordre des relations sociales, qui passe l'arrire-plan chez l'enfant, est peut-tre ce qui proccupe et intresse le plus l'homme adulte. Comment en serait-il autrement puisqu' l'occasion de tous ses contacts avec ses semblables il prend conscience, sous une quantit d'aspects toujours changeants, de ce qu'est sa situation dans son groupe, et des variations qu'elle comporte ? Mais cela est sans doute le plus grand obstacle ce que l'adulte, lorsqu'il emprunte l'enfant un volume de Jules Verne par exemple, et essaie de se remettre, en le feuilletant, dans les dispositions d'autrefois, y parvienne et retrouve exactement l'enthousiasme et l'intrt passionn dont il a cependant gard le souvenir. Ds que nous sommes mis en prsence des personnages, nous ne nous contentons pas de les accepter, mais nous examinons jusqu' quel point ils sont ressemblants , quelle catgorie sociale ils appartiennent, et si leurs paroles et leurs actes s'accordent avec leur condition. Comme vingt et trente ans se sont couls depuis que nous lisions ce livre, nous ne pouvons manquer d'tre frapps de ce qu'il y a de dmod et de dsuet dans leur costume, leur langage, leurs attitudes. Certes, ces rflexions sont hors de saison, car l'auteur n'a pas crit une tude de murs ou un roman psychologique pour des grandes personnes, mais un rcit d'aventures pour des enfants. Nous nous en doutons ,bien, et nous ne lui reprochons pas de s'tre inspir simplement de ce qui se disait et se faisait dans les milieux relativement cultivs de son pays et de son temps, d'avoir lgrement idalis 'les hommes et leurs relations, dans le sens o l'inclinait l'opinion courante. Mais nous remarquons ce qu'il y a de conventionnel en eux. Plus prcisment, nous confrontons les grandes personnes qu'on nous dcrit avec nos ides et nos expriences de grandes personnes, tandis que les enfants, n'ayant que des critres d'enfants, ne les confrontent avec rien, et s'en tiennent ce qu'on leur en dit. Ainsi, ce qui nous empcherait surtout, en laissant dfiler devant nos yeux et dans notre pense les paroles crites et tout ce qu'elles voquent immdiatement, de redcouvrir les impressions qu'elles durent graver en nous autrefois, serait tout l'ensemble de nos ides actuelles, en particulier sur la socit, mais aussi sur les faits de la nature. Comme le dit Anatole France dans la prface de sa Vie de Jeanne d'Arc :
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
69
Pour sentir l'esprit d'un temps qui n'est plus, pour se faire contemporain des hommes d'autrefois... la difficult n'est pas tant dans ce qu'il faut savoir que dans ce qu'il faut ne plus savoir. Si vraiment nous voulons vivre au XVe sicle, que de choses nous devons oublier : sciences, mthodes, toutes les acquisitions qui font de nous des modernes! Nous devons oublier que la terre est ronde et que les toiles sont des soleils, et non des lampes suspendues une vote de cristal, oublier le systme du monde de Laplace pour ne croire qu' la science de saint Thomas, de Dante et de ces cosmographes du Moyen ge qui nous enseignent la cration en sept jours et la fondation des royaumes par les fils de Priam, aprs la destruction de Troye la Grande. De mme, pour relire un livre dans la mme disposition que quand on tait enfant, que de choses il faudrait oublier! L'enfant ne juge pas d'un livre comme d'une oeuvre d'art, il ne cherche pas chaque instant quelles intentions dirigent l'auteur, il ne s'arrte pas aux invraisemblances, il ne se demande pas si tel effet n'est point forc, tel caractre artificiel, telle rflexion banale et plate. Il n'y cherche pas non plus l'image d'une socit : les figures, les actes et les situations des acteurs lui paraissent aussi naturels que les figures des arbres et des btes, et les situations des pays. Bien plus, il entre sans aucune difficult dans le dessein de l'auteur, qui n'a choisi ses personnages, et ne les oblige parler et agir comme ils font, qu' seule fin d'aider l'enfant se mettre leur place ; il suffit qu'ils aient le degr de ralit ncessaire pour que l'imagination du lecteur puisse se poser sur eux. Toute l'exprience sociale et psychologique de l'adulte lui manque. Mais aussi elle ne le gne point. Elle pse sur l'adulte au contraire, et, s'il parvenait s'en dgager, peut-tre l'impression d'autrefois reparatrait-elle en son intgrit. Suffirait-il, cependant, d'carter provisoirement cette masse de notions acquises depuis l'enfance, pour que surgissent les souvenirs d'autrefois ? Supposons que, ce livre, nous ne le lisions pas aujourd'hui pour la seconde fois seulement, que nous l'ayons souvent feuillet, et mme entirement relu plusieurs fois, dans l'intervalle, diffrentes poques. Alors, on pourrait dire qu' chacune de ces lectures correspond un souvenir original, et que tous ces souvenirs, joints la lecture dernire, ont dplac celui qui nous restait de la premire, et que si on russissait les refouler tous, les oublier successivement, on remonterait ainsi la lecture initiale, disparue jusqu' prsent derrire les autres, mais que cela est d'ailleurs bien impossible, parce qu'ils sont enchevtrs les uns dans les autres, et qu'on ne peut plus les distinguer. Mais le cas o nous nous plaons est privilgi, en ce que le souvenir est unique, et si nettement diffrenci de la lecture actuelle, qu'il est facile d'liminer de ce mlange d'actuel et d'ancien ce qui est actuel, et de retrouver, par contraste, ce qui est ancien. Si donc le souvenir tait l, il devrait reparatre. Pourtant, il ne reparat pas. Sans doute, de temps en temps, nous prouvons assez vivement le sentiment du dj vu : mais nous ne sommes pas srs que l'pisode ou la gravure qui nous parat ce point familire, n'avait pas fait sur nous ds le dbut une telle impression que nous y avons repens souvent depuis, et qu'elle n'a point pris place dans l'ensemble des notions qui nous accompagnent toujours, parce que nous nous sommes mis en mesure de les voquer quand nous le voudrions. Est-ce donc que le souvenir (celui qui correspondrait une lecture et une impression unique, et laquelle on n'a jamais plus repens) en ralit n'est pas l ? Il y aurait bien (nous en avons obscurment le sentiment) un moyen de nous rappeler, plus exactement que maintenant, ce qui a travers notre esprit quand ce rcit tait entirement nouveau pour lui, et lui ouvrait tout un monde ignor. Il ne suffit pas d'oublier tout ce que nous avons appris depuis : mais il faudrait connatre exactement ce que nous savions alors. En effet, nous ne sommes pas victimes d'une illusion,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
70
quand il nous semble que nous ne retrouvons point dans ce livre bien des dtails et des particularits qui y taient autrefois. L'esprit de l'enfant a ses cadres, ses habitudes, ses modles, ses expriences, qui ne sont pas ceux de l'adulte, mais sans lesquels il ne comprendrait pas ce qu'il lit, n'en comprendrait pas, tout au moins, ce qui peut se ramener ce qu'il connat. Il ne suffirait pas d'observer des enfants de mme ge que celui o nous tions alors pour retrouver notre tat d'esprit disparu. Il faudrait connatre avec prcision notre entourage d'autrefois, nos intrts et nos gots l'poque o l'on mettait entre nos mains un tel ouvrage, nos lectures antrieures, celles qui ont immdiatement prcd ou accompagn celle-l. Peut-on dire que nous avions, ds ce moment, une conception de la vie et du monde ? En tout cas notre imagination tait alimente par des spectacles, des ,figures, des objets qu'il faudrait connatre, pour se faire une juste ide de la faon dont nous tions capables de ragir tel rcit, ce moment mme. Si nous possdions un journal o quotidiennement auraient t inscrits tous nos faits et gestes, nous pourrions tudier cette priode dfinie de notre enfance en quelque sorte du dehors, rassembler en un faisceau fragile encore, mais assez pais, les menues branches de nos notions contemporaines, et reconstruire ainsi exactement l'impression qui dut tre la ntre lorsque nous pntrmes, dans tel ou tel domaine de fiction. Bien entendu, un tel travail suppose qu'il nous reste une ide au moins confuse de ce que nous tions alors intrieurement. De chaque poque de notre vie, nous gardons quelques souvenirs, sans cesse reproduits, et travers lesquels se perptue, comme par l'effet d'une filiation continue, le sentiment de notre identit. Mais, prcisment parce que ce sont des rptitions, parce qu'ils ont t engags successivement dans des systmes de notions trs diffrents, aux diverses poques de notre vie, ils ont perdu leur forme et leur aspect d'autrefois. Ce ne sont pas les vertbres intactes d'animaux fossiles qui permettraient eux seuls de reconstituer l'tre dont ils firent jadis partie ; mais, plutt, on les comparerait ces pierres qu'on trouve encastres dans certaines maisons romaines, qui sont entres comme matriaux dans des difices d'ges trs loigns, et qui, seulement parce qu'elles portent encore en traits effacs les vestiges de vieux caractres, certifient leur anciennet que ni leur forme, ni leur aspect ne laisserait deviner. Une telle reconstitution du pass ne peut jamais tre qu'approche. Elle le sera d'autant plus que nous disposerons d'un plus grand nombre de tmoignages crits ou oraux. Que tel dtail extrieur nous soit rappel, par exemple que nous lisions ce livre le soir, en cachette, jusqu' une heure trs avance, que nous avons demand des explications sur tel terme, ou tel passage, qu'avec de petits amis nous reproduisions, dans nos jeux, telle scne ou imitions tels personnages du rcit, que nous avons lu telle description de chasse en traneau, un soir de Nol, alors qu'il neigeait dehors, et qu'on nous avait permis de veiller, alors, par la convergence des circonstances extrieures, et des vnements du rcit, se recre une impression originale qui doit tre assez voisine de ce que nous ressentmes alors. Mais, de toute faon, ce n'est qu'une reconstruction. Comment en serait-il autrement, puisque, pour nous replacer exactement dans notre ancien tat d'me, il nous faudrait voquer en mme temps, et sans exception, toutes les influences qui s'exeraient alors sur nous, du dedans aussi bien que du dehors, de mme que, pour restituer en sa ralit un vnement historique, il faudrait tirer de leurs tombeaux tous ceux qui en ont t les acteurs et les tmoins ? Nous avons insist sur cet exemple, parce qu'on y saisit sur le vif, nous semble-til, les conditions qui favorisent ou qui empchent le rappel des souvenirs. On dira peut-tre que, dans ce cas, l'intervalle est trop grand entre l'impression qu'on cherche voquer, et le moment actuel, qu'en rgle gnrale un souvenir s'affaiblit mesure
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
71
qu'il recule dans le pass, et qu'ainsi s'explique la difficult plus grande qu'il y a l'voquer, mais qu'il ne s'ensuit pas du tout qu'il ne subsiste pas l'tat inconscient. Mais, si les souvenirs sont des images aussi relles les unes que les autres, on ne voit pas en quoi leur loignement dans le temps constituerait un obstacle leur retour la conscience. Si c'est parce qu'ils subsistent tels quels, et non parce que nous possdons la facult de les reproduire l'aide de nos notions actuelles, qu'ils reparaissent, comme ils subsistent tous alors au mme degr, ils devraient tre tous galement capables de resurgir. Si le temps coul joue cependant un rle, ce n'est point parce que s'augmente la masse des souvenirs interposs. La mmoire n'est pas tenue de passer, d'une faon continue, de l'un l'autre. Comme le dit M. Bergson : S'il faut, pour que ma volont se manifeste sur un point donn de l'espace, que ma conscience franchisse un un ces intermdiaires ou ces obstacles dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle la distance dans l'espace, en revanche il lui est utile, pour clairer cette action, de sauter par-dessus l'intervalle de temps qui spare la situation actuelle d'une situation antrieure analogue... elle s'y transporte ainsi d'un seul bond 1. Si les souvenirs sont des images simplement juxtaposes dans le temps, et si c'est en vertu d'une pousse interne propre chacune d'elles qu'elles tendent reparatre, il n'y a pas plus de raison pour que les plus anciennes se drobent que pour que, de plusieurs objets de mme densit jets au fond de l'eau, ceux qu'on a jets les premiers y restent seuls tandis que les autres remontent. On dira qu'il faut du moins que la situation prsente se prte leur vocation. Comme le dit encore M. Bergson : Les appareils sensori-moteurs fournissent aux souvenirs impuissants, c'est--dire inconscients, le moyen de prendre corps, de se matrialiser, enfin, de devenir prsents. Mais pourquoi, du fait seulement qu'ils sont anciens, certains souvenirs seraient-ils empchs de s'introduire dans le cadre ou de passer travers la fissure (suivant les termes dont se sert le grand psychologue) que leur prsentent ou que leur ouvrent les dits appareils sensori-moteurs ? Les conditions, cependant, dans le cas que nous avons envisag, paraissent favorables : c'est le mme livre, ce sont les mmes pages, les mmes gravures ; les influences qui viennent du dehors sont les mmes ; notre rtine et notre nerf visuel sont impressionns de la mme faon ; la parole intrieure, qui reproduit ou bauche en phonations demi conscientes les mots lus, est la mme ; d'autre part nous dtournons notre attention de toutes ides et notions que nous ne possdions pas alors, si bien que nous faisons tout notre possible pour que du dedans, ne s'exerce aucune influence, sur notre cerveau et nos nerfs, qui n'aurait pu s'exercer autrefois. L'image ne reparat cependant pas. C'est donc, que nous n'avons pas russi communiquer notre organisme nerveux et crbral exactement l'attitude qu'il avait alors. Mais peut-tre n'est-ce l qu'une manire d'exprimer, en termes physiologiques, que ce qui manque, c'est tel autre souvenir, telle autre notion, tel ensemble de sentiments et d'ides qui occupaient alors notre conscience, qui ne l'occupent plus, ou plus que trs partiellement, aujourd'hui. Nous pouvons substituer la notion d'attitude physique, et de systme sensori-moteur, celle de systme de notions. La pense de M. Bergson reviendrait alors ceci : si certains souvenirs ne reparaissent pas, ce n'est point parce qu'ils sont trop anciens et qu'ils se sont lentement vanouis., ; mais ils taient encadrs autrefois dans un systme de notions qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui. Cependant il n'est pas indiffrent de parler ici, non plus de modifications corporelles, mais de reprsentations psychiques. Les appareils sensori-moteurs, dans l'hypothse o se place M. Bergson, ne contribuent pas directement produire ou
1
Matire et mmoire, pp. 158-l59.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
72
reproduire l'tat pass. Tout ce qu'il y a de psychique dans le souvenir, ne drive pas du corps, mais doit tre suppos donn d'avance, comme quelque chose de tout fait et d'achev, dans l'inconscient. Le rle du corps est purement ngatif. C'est l'obstacle qui doit s'carter, pour laisser passer le souvenir. Or notre prise sur lui est incomplte, ttonnante, incertaine. Les modifications qui s'y produisent sont dans une large mesure J'effet du hasard. On pourra donc toujours soutenir que, si les souvenirs ne se reproduisent pas, c'est qu'il dpend d'une trs petite variation dans l'tat crbral qu'ils demeurent dans l'ombre. Ils sont l, mais ils ne russissent pas franchir ou contourner l'obstacle, et il n'est pas en notre pouvoir de les y aider. Supposons maintenant que l'obstacle ne soit pas le corps, mais l'ensemble des notions qui occupent actuellement notre conscience. Il devient difficile d'admettre que les souvenirs, S'ils se sont rellement conservs, soient entirement arrts et intercepts par une semblable barrire psychique. Certes, il y a incompatibilit entre certains aspects de ces souvenirs, et les notions actuelles. Mais, puisque les unes et les autres sont faites de la mme matire, que ce sont des reprsentations au mme titre, on conoit qu'il s'tablisse, entre celles-ci et celles-l, comme une sorte de compromis. Cela est d'autant plus vraisemblable que nous nous efforons de rduire la rsistance que les notions actuelles opposent aux tats anciens, d'liminer, d'oublier celles-l, et que, d'ailleurs, il y a bien des intervalles de distraction relative, o nous chappons la pression de nos ides d'adultes : c'est--dire qu'il y a dans cette barrire des lacunes, des ouvertures et des fentes, par o il ne serait pas possible que nous n'apercevions point ce qui est derrire elle, s'il s'y trouvait rien d'autre : il suffirait d'ailleurs qu'une partie du souvenir russit passer, pour que le reste suivit, et que la barrire, sur une certaine tendue au moins, ft renverse. Mais nous l'avons vu, il n'en est rien. Nous n'avons aucun moment l'impression de nous retrouver exactement dans l'tat d'esprit d'autrefois. C'est donc qu'en ralit ces souvenirs ne subsistent pas.
Nous nous disons il est vrai, par moments, en tournant les pages : Voici un pisode, ou une gravure, que je reconnais, et que j'avais oublie. Nous entendons par l que cela s'accorde bien avec la notion gnrale que nous avions garde du livre, et que, partant de cette notion, nous aurions t peut-tre capables d'imaginer la gravure ou l'pisode, ou, encore, qu'il y avait l un souvenir dtach qui, pour une raison ou l'autre, nous est rest toujours prsent, en ce sens que nous n'avons jamais perdu la facult de le reproduire. Mais reproduire n'est pas retrouver : c'est, bien plutt, reconstruire. Ce qui tait vrai du corps, savoir qu'on n'en peut tirer un souvenir, ne l'est plus du systme de nos reprsentations actuelles : celles-ci, combines avec telles notions anciennes dont le livre lui-mme nous apporte une riche provision, suffisent, dans certains cas, sinon recrer un souvenir, du moins en dessiner le schma, qui, pour l'esprit, en est l'quivalent. Il n'est donc pas ncessaire que le souvenir soit demeur, puisque la conscience actuelle possde en elle-mme et retrouve autour d'elle les moyens de le fabriquer. Si elle ne le reproduit pas, c'est que ces moyens sont insuffisants. Ce n'est pas qu'elle fasse obstacle un souvenir rel qui voudrait se montrer : c'est qu'entre les conceptions d'un adulte et d'un enfant il y a trop de diffrences.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
73
* ** III - ii
Retour la table des matires
A l'ge o l'on s'intresse aux rcits d'aventure, l'imagination ,est la fois plus active et plus libre que chez l'homme fait. La nature sensible de l'enfant le dispose, en effet, se passionner pour des histoires imaginaires qui le font passer par des alternatives de crainte, d'espoir, d'impatience, et par toutes les nuances et formes extrmes d'motions dont il est capable. L'homme fait, plus lent s'mouvoir, lorsqu'il sera question, dans un livre, d'un voyage prilleux entreprendre, ne cdera pas tout de suite l'apptit d'aventures qui se serait empar de lui 12 ans ; il ne sent plus en lui l'exubrance de forces de l'enfant qui n'a pas le besoin ni l'ide de se limiter, et se croit capable de poursuivre en mme temps plusieurs actions, d'entrer dans plusieurs caractres. C'est pourquoi l'enfant s'identifie sans peine avec les acteurs de l'histoire : il est successivement et presque en mme temps le capitaine du navire, charg de responsabilits, qui organise et doit tout prvoir, le savant tantt distrait, tantt joyeux et expansif, le major silencieux, sarcastique, qui observe tout et ne perd jamais la tte, et le jeune homme qui, 16 ans, se conduit dj comme un hros : il les suit sans hsiter dans toutes leurs prgrinations, attend comme eux sur un arbre gant que la crue qui couvre la plaine d'une nappe d'eau indfinie soit termine, s'embourbe avec eux dans un chariot au cur des forts australiennes, fait naufrage ,en mme temps qu'eux et tombe entre les mains des sauvages : chaque tape, il oublie les prcdentes, et, quand le rcit est termin, il le recommence, sans fatigue et sans que son attention et sa curiosit soient ralenties. Il est en effet ce moment de son dveloppement physique et mental o ce qui l'intresse passionnment, c'est la lutte de l'homme contre les forces de la nature, les engins et instruments qu'il y emploie, les qualits et vertus qu'elles exigent de lui. Plus tt, l'poque o il croyait aux contes, il n'avait pas une juste, ide ni de ce qu'il y a de ncessaire et de brutal dans le jeu des forces naturelles, ni de la limitation des forces, physiques de l'homme, puisqu'il imaginait sans peine une prodigalit excessive de la nature et une extension indfinie des forces de l'homme par l'intervention de pouvoirs surnaturels. A prsent, son imagination est dj limite de ce ct. Mais elle ne l'est pas d'un autre. Il sait ce dont est capable un homme isol au milieu de la nature, aux prises avec les intempries, les btes sauvages, et mme les hommes sauvages. Il ne sait pas encore dans quelles limites les ncessits de la vie sociale enferment l'activit des individus. Les rapports entre l'homme et les choses, qui, pour l'adulte, sont la condition et comme le support des rapports des hommes entre eux, paraissent au contraire l'enfant possder leur fin en eux-mmes. Les choses l'intressent et vivent ses yeux parce qu'elles sont pour lui la fois des obstacles et des auxiliaires : elles font partie de la socit enfantine au mme titre que les grandes personnes. Celles-ci, il les apprcie exclusivement d'aprs l'ordre de qualits qui comptent le plus ses yeux. La notion sociale de classe n'est pas encore venue s'interposer entre lui et les hommes, et ne l'oblige pas mettre au premier rang l'ordre des qualits que la socit apprcie le plus. C'est pourquoi un ouvrier jouit, auprs de l'enfant, d'un prestige qui disparat en gnral ds qu'il est devenu lui-mme membre adulte d'un groupe o les ouvriers ne sont pas admis. Quant la richesse, il y
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
74
voit le moyen d'tendre l'action de l'homme sur les choses, soit qu'elle permette d'entreprendre de lointains et coteux voyages, d'organiser des expditions et des explorations, soit qu'un homme riche soit capable de fonder des fermes, des exploitations, et mme des villes, dans des pays neufs et non dfrichs. Ainsi, dans l'esprit d'un enfant de 12 ans s'tablit une conception originale des hommes et du monde, qui le prpare comprend-Te d'emble un rcit d'aventure ou de voyage bien compos, s'identifier avec les personnages du livre, partager tous leurs sentiments, s'intresser aussi passionnment qu'eux leurs entreprises, envisager les choses, phnomnes naturels, pays, navires, btes, arbres, etc., comme si troitement associes aux voyageurs, leur activit et leurs motions, qu'elles deviennent quelque chose de l'homme , de mme que l'homme n'est jamais reprsent que comme une activit tourne vers tel aspect des choses, que comme l'homme de certaines choses . Tout autre est le point de vue de l'adulte ; celui-ci dfinit chaque espce d'hommes par leur situation dans la socit, il distingue sans doute les diverses catgories d'artisans d'aprs leur genre d'activit, mais, plus qu'il ne les distingue, il les rapproche et les confond sous l'appellation commune d'ouvriers. Quant aux choses, tantt il ne les apprcie qu'en tant qu'elles reprsentent une richesse : toutes celles que l'homme a pu s'approprier perdent du mme coup leur aspect pittoresque pour acqurir les caractres plus ou moins abstraits d'une valeur conomique. Tantt son attention se porte sur leurs caractres purement physiques, c'est--dire qu'au del de l'utilit qu'elles prsentent pour nous, de l'action que nous pouvons exercer sur elles, et des dangers dont elles nous menacent,nous nous reprsentons ce qui, dans la nature, est tranger l'homme : vue abstraite encore, et semblable celle o s'lve la science. Notions conomiques et notions scientifiques passent ainsi au premier plan. S'il s'y mle le sentiment de la beaut des choses, c'est le plus souvent qu'on projette sur la nature des ides et des images qui sont le produit de la vie sociale, et auxquelles l'enfant est, videmment, tout aussi tranger. Voil quelques-uns des traits gnraux qui distinguent le point de vue de l'enfant et celui de l'adulte. Pour retrouver ses impressions d'enfance il ne suffit donc point que celui-ci se dgage, par un effort violent, et souvent impossible, de cet ensemble d'ides qui lui viennent de la socit : il lui faudrait rintroduire en lui les notions de l'enfant, et mme renouveler sa sensibilit qui n'est plus la mesure des impressions spontanes et pleines du premier ge. Si un grand crivain ou un grand artiste nous donne l'illusion d'un fleuve qui remonte vers sa source, s'il croit lui-mme revivre son enfance en la racontant, c'est que, plus que les autres, il a gard la facult de voir et de s'mouvoir comme autrefois. Mais ce n'est pas un enfant qui se survit lui-mme ; c'est un adulte qui recre, en lui et autour de lui, tout un monde disparu, et il entre dans ce tableau plus de fiction que de vrit. Si la pense, chez l'enfant et l'adulte, s'oriente ainsi en des sens opposs, cela tient en partie, nous l'avons vu, leur nature physique et sensible. Mais, en outre, les conditions extrieures, et sociales o l'un et l'autre sont placs sont trop diffrentes pour qu'un adulte puisse se refaire volont une me d'enfant. Bien qu' 10 ou 12 ans on n'ait encore qu'une ide vague de la socit au sens large, on n'en fait pas moins partie de groupes restreints, tels que la famille, et le cercle des amis d'cole ou de jeu. On habite dans un appartement, on passe la plus grande partie de la journe dans certaines chambres, dans tel jardin, dans telles rues ; il se produit, dans ce cadre troit, des vnements sensationnels. Ainsi, par l'effet du contact habituel o nous sommes avec tels objets, telles personnes, aussi bien que des suggestions rptes de notre entourage, des images dominantes finissent par se graver plus profondment que les autres dans notre esprit. Dans Wahrheit und Dichtung Gthe dj g voque ses impressions d'enfance. Quand on veut, dit-il, se rappeler ce qui vous est arriv
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
75
aux premiers temps de votre enfance, l'on confond assez souvent ce qu'on a entendu dire par les autres avec ses propres souvenirs... J'ai cependant le sentiment trs net que nous habitions dans une vieille maison ,compose de deux btiments, mais en communication l'un avec l'autre. Un escalier en tourelle conduisait des chambres qui n'taient pas de plain-pied, si bien que par suite de leur niveau ingal on passait de l'une l'autre par des marches. Pour nous, enfants, une plus jeune sur et moi, notre endroit favori tait le vaste vestibule. A ct de la porte, il y avait un grand treillis de bois, par lequel on communiquait directement avec la rue et l'air libre. Cette sorte de cage se rencontrait dans plusieurs maisons... Les femmes s'asseyaient l pour coudre et tricoter; la cuisinire y pluchait sa. salade : travers la grille on se parlait d'une maison voisine l'autre ; cela donnait aux rues, dans la belle saison, un aspect. mridional. Et il dcrit la chambre de sa grand'mre, qui ne quittait pas son fauteuil, la vue qu'on avait, derrire la maison, sur les jardins voisins qui s'tendaient jusqu'aux murs de la ville, la chambre du deuxime tage, o il apprenait ses leons, et d'o il regardait se coucher le soleil, et tous les recoins obscurs de la vieille demeure qui inspiraient aux enfants une terreur superstitieuse. Tel est l'horizon de ses premires annes. Puis il dcouvre la ville, le pont du Mein, la place du Rmer, etc. Il rapporte les vnements domestiques les plus marquants, comment il lut amen s'intresser des vnements plus importants, le tremblement de terre de Lisbonne, l'entre de Frdric II en Saxe et en Silsie, et l'impression qu'en ressentit sa famille. Tel est le cadre o s'est coule toute une priode de sa vie dont il ne lui reste, en dfinitive, que bien peu de souvenirs 1. Jusqu' quel point, d'ailleurs, la nettet de contour des images, l'ordre mthodique de la description, rpondent-ils la vision de l'enfant, ou la conception claire et toute en relief de l'crivain ? Ce que l'on garde souvent dans la mmoire, d'une maison o l'on a vcu, c'est moins la disposition des pices telle que l'on pourrait la marquer sur un plan d'architecte que des impressions qui, si on voulait les mettre en rapports, ne se rejoindraient peut-tre pas, et se contrediraient quelquefois. Quoi qu'il en soit, il y a un monde limit dans l'espace o la conscience de l'enfant s'est veille, et dont, pendant une longue priode, elle n'a point franchi les limites. Pour l'adulte, il est vrai, la maison o il habite, les endroits de la ville o il se rend le plus souvent constituent aussi comme un cadre : mais il sait que ce n'est qu'une partie dfinie d'un plus vaste ensemble, et il a une ide des proportions de la partie l'ensemble, et de l'ensemble lui-mme : le cadre spatial qui enferme la pense de l'adulte est donc beaucoup plus vaste. L'importance qu'il attache au cercle plus restreint o se meut sa personne physique peut tre grand, il peut aimer d'une prdilection particulire sa maison, sa rue, son quartier ; ce n'est pourtant point pour lui le monde clos auquel se rapportent toutes ses penses, ses proccupations, ses motions : son activit s'exerce au del, et d'au del aussi s'exercent sur lui bien des influences. L'enfant, au contraire, pendant longtemps, ne sent pas le besoin de replacer ce petit monde dans le grand : son imagination et sa sensibilit s'y panouissent l'aise. Quand nous parlons d'ailleurs d'un cadre spatial, nous n'entendons rien qui ressemble une figure gomtrique. Les sociologues ont montr que, dans beaucoup de
1
Un homme de 80 ans se rappelle un bien petit nombre des vnements qui ont t uniques dans sa vie, except ceux des 15 derniers jours. Il ne se rappelle que quelques incidents et l, qui ne couvriraient gure qu'un espace de six semaines ou de deux mois en tout, si tout ce dont il se souvient tait reproduit avec la mme pauvret de dtails avec laquelle il s'en souvient. Pour ce qui est des incidents qui se sont souvent rpts, son esprit tablit la balance de ses souvenirs passs, se rappelle les 2 ou 3 dernires rptitions, et la faon habituelle dont la chose a lieu ou dont il agit lui-mme, - mais rien de plus... Nous sommes incapables de nous rappeler la cent millime partie de ce qui nous est arriv pendant notre enfance. Samuel BUTLER, La vie et l'habitude, trad. fr., p. 148, voir ci-dessous, la prochaine note de bas de page.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
76
tribus primitives, on ne se reprsente pas l'espace comme un milieu homogne, mais on distingue ses parties par les qualits de nature mystique qu'on leur attribue : telle rgion, telle direction est sous l'empire de tel esprit, s'identifie avec tel clan de la tribu. De mme les diffrentes chambres d'une maison, tels recoins, tels meubles, et, aux environs de la maison, tel jardin, tel coin de rue, parce qu'ils veillent d'habitude chez l'enfant des impressions vives, et se trouvent associs dans son esprit avec certaines personnes de sa famille, avec ses jeux, avec des vnements dtermins, uniques ou rpts, parce que son imagination les a anims et transfigurs, acquirent en quelque sorte une valeur motive : ce n'est pas seulement un cadre, mais tous ces aspects familiers font partie intgrante de la vie sociale de l'enfant, rduite peu prs la vie familiale ; ils l'alimentent, en mme temps qu'ils la limitent. Sans doute, il en est un peu de mme pour l'adulte. Quand celui-ci quitte une maison o il a longtemps vcu, il lui semble qu'il abandonne derrire lui une partie de lui-mme : de fait, ce cadre disparu, tous les souvenirs qui s'y rattachaient risquent aussi de se dissoudre : cependant, comme l'adulte n'enferme pas sa pense aux limites de sa demeure, de la priode qu'il y a vcu beaucoup de souvenirs subsisteront, qui se rattachent d'autres objets, d'autres lieux, des rflexions qui s'tendent au del du domicile : de sa demeure elle-mme il a chance de garder un souvenir plus ou moins riche, car il retrouvera peut-tre ailleurs ceux qu'il y a rencontrs, et, puisque la maison tait, ses yeux, un petit cadre dans un grand, le grand cadre, qui subsiste, lui permettra d'voquer le petit, L'enfant aurait beaucoup plus de raison de sattrister, lorsqu'il quitte assez jeune encore la maison o il a pass de longues annes, car toute sa vie y tait enferme, et ce sont tous ses souvenirs qui y taient attachs : le nombre de ceux qui y ont vcu avec lui, et qu'il pourra retrouver plus tard, diminue vite : la maison disloque, la famille disperse ou teinte, il ne peut plus compter que sur lui-mme pour conserver l'image du foyer, et de tout ce qui s'y rattache : image d'ailleurs suspendue dans le vide, puisque sa pense s'est arrte au cadre qui la dlimitait, puisqu'il n'a qu'une ide trs imparfaite de la place qu'elle occupait dans l'ensemble des autres images, et qu'il n'a connu cet ensemble que quand elle n'existait dj plus. * ** III - iii
Retour la table des matires
Arrtons-nous un peu, maintenant, pour expliquer en quel sens la disparition ou la transformation des cadres de la mmoire entrane la disparition ou la transformation de nos souvenirs. On peut faire en effet deux hypothses. Ou bien, entre le cadre et les vnements qui s'y droulent il n'y aurait qu'un rapport de contact, mais l'un et l'autre ne seraient pas faits de la mme substance, de mme que le cadre d'un tableau, et la toile qui y prend place. On pensera au lit d'un ,fleuve, dont les rives voient passer le flot sans y projeter rien d'autre qu'un reflet superficiel. Ou bien, entre le cadre et les vnements il y aurait identit de nature : les vnements ment des souvenirs, mais le cadre aussi est fait de souvenirs. Entre les uns et les autres il y aurait cette diffrence que ceux-ci sont plus stables, qu'il dpend de nous chaque instant de les apercevoir, et que nous nous en servons pour retrouver et reconstruire ceux-l. C'est cette seconde hypothse que nous nous rallions.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
77
M. Bergson, qui a formul la premire, s'appuie sur la distinction de deux mmoires, l'une qui conserverait le souvenir des faits qui n'ont eu lieu qu'une fois, l'autre qui porterait sur les actes, les mouvements souvent rpts, et sur toutes les reprsentations habituelles 1. Si ces deux mmoires sont ce point diffrentes, il faudrait qu'on pt, sinon voquer (car ils ne reparaissent peut-tre jamais tels quels, d'aprs lui) du moins qu'on pt concevoir des souvenirs purs, c'est--dire qui, dans toutes leurs parties, seraient distincts de tous les autres, et o ne se mlerait absolument rien de ce que M. Bergson appelle la mmoire habitude. Or, dans le passage o il oppose le souvenir d'un des moments (chacun unique en son genre) o on a lu, ou relu, une leon qu'on apprenait, et le souvenir de cette leon sue par cur aprs toutes les lectures, M. Bergson dit : Chacune des lectures successives me revient alors l'esprit avec son individualit propre : je la revois avec les circonstances qui l'accompagnaient et qui l'encadrent encore; elle se distingue de celles qui prcdent et de celles qui suivent par la place mme qu'elle a occupe dans le temps; bref chacune de ces lectures repasse devant moi comme un vnement dtermin de mon histoire... Le souvenir de telle lecture particulire, la seconde ou la troisime, par exemple, n'a aucun des caractres d'une habitude. L'image s'en est, ncessairement, imprime du premier coup dans la mmoire, puisque les autres lectures constituent, par dfinition mme, des souvenirs diffrents. C'est comme un vnement de ma vie ; il a pour essence de porter une date, et de ne pouvoir par consquent se rpter. Nous avons soulign nous-mme : avec les circonstances qui l'accompagnaient et qui l'encadrent encore , parce que, suivant le sens o l'on entend ces termes, on sera conduit sans doute des consquences assez diffrentes. Pour M. Bergson, il s'agit certainement des circonstances qui distinguent une lecture de toutes les autres : elle intressait davantage par sa nouveaut, par exemple, elle n'a pas t faite au mme endroit, on a t interrompu, on s'est senti fatigu, etc. Mais, si nous laissons de ct les mouvements musculaires qui correspondent la rptition et toutes les modifications qui se sont produites dans notre systme nerveux, mouvements et modifications sinon identiques, du moins qui tendaient vers un rsultat identique travers toutes les lectures, il reste qu' ct des diffrences il y a eu bien des ressemblances entre toutes ces lectures : on les a faites au mme endroit, dans la mme journe, parmi les mmes camarades, ou dans la mme chambre, prs de ses parents, de ses frres et surs.
1
Cette distinction des deux mmoires, fondamentale dans la psychologie de M. BERGSON (op. cit., p. 75) a t entrevue vingt ans auparavant, par l'auteur d'Erewhon, Samuel BUTLER, dans La vie et l'habitude (paru en 1877, traduit en franais en 1922). D'aprs Butler les impressions profondes qu'enregistre notre mmoire sont produites de deux manires... par des objets ou des combinaisons qui ne nous sont pas familiers, se prsentent nous des intervalles relativement loigns et produisent leur effet, peut-on dire, d'un seul coup, violemment... et par la rptition plus ou moins frquente d'une impression faible qui, si elle ne s'tait pas rpte, serait vite sortie de notre esprit... Nous nous souvenons le mieux des choses que nous avons faites le moins souvent... et des choses que nous avons faites le plus souvent, et qui par suite nous sont le plus familires. Car notre mmoire est surtout affecte par deux forces, celle de la nouveaut et celle de la routine... Mais la manire dont nous nous souvenons des impressions qui ont t graves en nous par la force de la routine est toute diffrente de celle dont nous retenons une impression profonde ressentie une seule fois... Pour ce qui est de celles-l (routine), les plus nombreuses et les plus importantes de celles dont notre mmoire est pourvue, ce n'est souvent qu'en agissant que nous nous apercevons nous-mmes et que nous montrons aux autres que nous nous souvenons. Trs souvent, en effet, nous ne savons plus o, ni comment, ni quand nous avons acquis notre savoir. Traduction franaise, pp. 146-150. Et, plus loin : Bien des gens qui se sont familiariss avec les odes d'Horace au point de les savoir par cur - rsultat produit par de frquentes rptitions - seront capables, aprs bien des annes, de rciter une ode donne, bien qu'ils ne puissent se souvenir d'aucune des circonstances dans lesquelles ils l'ont apprise... ils reviennent l'ode connue avec si peu d'efforts qu'ils ne sauraient pas qu'ils s'en souviennent si leur raison ne le leur disait pas : tant cette ode semble tre quelque chose d'inn en eux. lbid., p. 155.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
78
Sans doute, chaque lecture, l'attention ne s'est point porte galement sur toutes ces circonstances. Mais qu'on adopte la vue thorique de M. Bergson ; qu'on suppose qu' chaque lecture correspond bien un souvenir dfini, et nettement distinct de tous les autres, qu'on mette bout bout les souvenirs de toutes ces lectures : qui ne voit qu'en les rapprochant on aura du mme coup reconstitu le cadre o elles se sont droules, et qu'en ralit c'est ce cadre qui permet sinon de faire revivre les tats anciens, du moins d'imaginer, ce qu'ils ont d tre, en raison des circonstances (auxquels correspondent des souvenirs stables) o ils se sont produits, et, par consquent, de les reproduire dans la mesure o nous le pouvons, au moyen de ces reprsentations dominantes? Objectera-t-on que l'exemple choisi ne doit pas tre pris la lettre ? On se proposait de dfinir deux formes extrmes de la mmoire. Mais nous ne les rencontrerions pas dans la ralit qui ne nous en prsenterait que des formes intermdiaires. Il ne serait donc pas tonnant que, mme dans un souvenir o les images (au sens d'images uniques) tiennent la plus grande place, on trouve aussi des notions plus gnrales que l'habitude et la rptition ont fixes dans notre esprit. Essayons alors de nous reprsenter des images dont tout le contenu serait effectivement nouveau et unique, dans un lieu sans rapport avec ceux que nous connaissons par d'autres expriences, dans un temps que nous ne situons point l'intrieur d'un temps gnral, ou d'une priode dfinie de notre existence. C'est bien jusque l qu'il faudrait aller, et il faudrait aussi que ne se mlent pas notre impression des notions qui la prcdent et la suivent, et subsistent d'une faon plus stable qu'elle dans notre conscience : la notion de livre, de caractres imprims, de table, de matre, de parents, de leon, etc. A supposer que de semblables tats de conscience se produisent, quelle possibilit gardons-nous de nous les rappeler plus tard ? Par o les ressaisir ? Ces images seront comparables celles du rve, suspendues dans un espace et un temps indtermins, et, qui, parce qu'on ne peut les localiser, ne peuvent tre non plus rappeles, ds qu'elles sont sorties de cette zone demi consciente o elles demeurent pendant quelque temps aprs le rveil. On nous rpondra qu'il y a lieu prcisment de distinguer deux choses : il y a d'une part un cadre spatial, temporel, et, plus gnralement social. Cet ensemble de reprsentations stables et dominantes nous permet en effet, aprs coup, de nous rappeler volont les vnements essentiels de notre pass. Mais, d'autre part, il y a ce qui, dans l'impression initiale elle-mme, permettrait de la situer, une fois qu'elle est reproduite, dans tel espace, tel temps, tel milieu. Nous serions victime d'une illusion souvent dnonce par M. Bergson, quand, rapprochant une srie d'tats successifs et nettement distincts, nous transformerions en une reprsentation continue et unique d'espace, de temps, de choses homognes en gnral, ce qui n'est qu'une somme de vues qualitatives troitement fondues avec nos impressions. Nos souvenirs ne seraient pas comme autant d'images spares, enfiles les unes la suite des autres comme les perles d'un collier : il y aurait continuit de l'une l'autre. Et c'est bien, si l'on veut, d'un espace, d'un temps, d'un milieu social continu qu'elles nous prsenteraient en quelque sorte le reflet mouvant. Mais, en dpit de leur continuit, entre cette srie de points de vue et un ensemble de notions stables il y aurait toute la diffrence qui spare des tats psychiques individuels, qualitativement distincts les uns des autres, et les cadres de la pense gnrale qui demeurent identiques travers le temps. Mais on arrive alors un rsultat assez paradoxal : au moment o les impressions se sont produites, il y avait en elles, si l'on veut, deux sortes d'lments : d'une part, tout ce que nous en pouvions exprimer, tout ce qui nous permettait de connatre leur place dans le temps, et leurs ressemblances et leurs diffrences avec d'autres impres-
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
79
sions perues par nous ou par les autres ; d'autre part, ce qui, en elles, tait inexprimable, ou, comme dit M. Bergson, leur nuance unique , leur coloration affective , que nous seuls pouvions prouver. Ce qui subsisterait de ces impressions, sous forme de souvenirs-images , dans l'inconscient de la mmoire, ce serait uniquement cette nuance ou cette coloration. Or, c'est l, prcisment, ce que nous ne nous rappelons jamais. Tout le reste, sauf cela, peut reparatre. De cela, nous ne gardons qu'un souvenir analogue celui d'un rve... oubli. Comment, d'ailleurs, des images-souvenirs ( supposer qu'elles subsistent) pourraient-elles, lorsqu'on les voque, rejoindre le cadre de notions qui les accompagnait autrefois, et qui fait partie de notre conscience actuelle, si, entre ces images et ce, cadre il n'y a aucun point de contact, aucune communaut de substance ? Lorsque nous parlions du rve, nous remarquions que ce qui explique la disparition du plus grand nombre des images nocturnes, c'est que, comme elles n'ont pas t localises dans le monde de la veille, ce monde et les reprsentations que nous en avons n'ont aucune prise sur elles : seules deviennent des souvenirs vocables les images ,du rve sur lesquelles, au rveil, notre attention et notre rflexion se sont fixes, et que nous avons ainsi rattaches, avant qu'elles ne s'vanouissent, aux images et penses de la veille. Or si l'on envisage un de ces tats que M. Bergson dfinit thoriquement comme des vnements uniques de notre histoire, si on le dgage de tous ces lments de reprsentation qui, communs lui et d'autres, introduisent entre eux un commencement d'organisation, on ne peut plus le distinguer d'une image du rve, mais on ne comprend plus, d'ailleurs, s'il se conserve, comment il pourrait se reproduire, et comment on russirait le localiser. Certainement, pour M. Bergson, c'est l une limite que les tats rels n'atteignent pas. Il pense que ce qui permet certaines images de se reproduire, ce sont les mouvements accomplis ou simplement naissants [qui rsultent de notre perception actuelle]... Si d'anciennes images trouvent aussi bien se prolonger en ces mouvements, elles profitent de l'occasion pour se glisser dans la perception actuelle et s'en faire adopter 1. Il y a donc dans toute image, si unique soit-elle, un aspect moteur par lequel elle tient une attitude corporelle. Mais, nous l'avons dit, on complique peut-tre inutilement et on rend plus obscur tout ce problme, si on parle du corps, si on ne s'en tient pas ,aux tats de conscience : L'attitude corporelle correspond, en dfinitive, un assemblage, dfini de reprsentations exprimes, par des mots, dont chacun a un sens, en mme temps qu'il dterminer dans l'organisme certains mouvements,. Nous dirons alors qu'il y a dans toute image, si unique soit-elle, un aspect gnral, par lequel elle se rattache un ensemble de notions prsentes la conscience. On retrouve ainsi et on rtablit la continuit entre l'imager et le cadre, et l'on s'explique, puisque celui-ci est fait tout entier d'tats psychiques, qu'entre le cadre et l'image il puisse s'tablir un change de substance, et mme que le cadre suffise pour reconstituer l'image.
Matire et mmoire, p. 96.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
80
* ** III - iv
Retour la table des matires
Il semble assez naturel que les adultes, absorbs par leurs proccupations actuelles, se dsintressent de tout ce qui, dans le pass, ne s'y rattache pas. S'ils dforment leurs souvenirs d'enfance, n'est-ce point, prcisment, parce qu'ils les contraignent entrer dans les cadres du prsent ? Mais il n'en est plus de mme des vieillards. Ceux-ci, fatigus de l'action, se dtournent au contraire du prsent, et sont dans les conditions les plus favorables pour que les vnements passs reparaissent tels quels. Mais, s'ils reparaissent, c'est qu'ils Marient toujours l. 'N'est-ce point l une preuve frappante de la conservation de souvenirs que nous pouvions croire abolis ? Prs de trente ans se sont passs depuis ma sortie de Bossey, crit Rousseau dans Les confessions, sans que je m'en sois rappel le sjour d'une manire agrable par des souvenirs un peu lis : mais depuis qu'ayant pass l'ge mr je dcline vers la vieillesse, je sens que ces mmes souvenirs renaissent tandis que les autres s'effacent, et se gravent dans ma mmoire avec des traits dont le charme et la force augmentent de jour en jour ; comme si, sentant dj la vie qui s'chappe, je cherchais la ressaisir par ses commencements. S'il y a, au sens o M. Bergson l'a dit, deux mmoires, l'une, faite surtout d'habitudes et tourne vers l'action, l'autre, qui, implique un certain dsintressement de la vie prsente, on sera en effet tent de penser que le vieillard, en mme temps qu'il se dtourne de l'aspect pratique des objets et des tres, et qu'il se sent libr des contraintes qu'imposent la profession, la famille, et d'une manire gnrale l'existence active dans la socit, devient capable de redescendre dans son pass et de le revivre en imagination. Si notre pass, dit M. Bergson, nous demeure presque tout entier cach parce qu'il est inhib par les ncessits de l'action prsente, il retrouvera la force de franchir le seuil de la conscience dans tous les cas o nous nous dsintresserons de l'action efficace pour nous replacer, en quelque sorte, dans la vie du rve 1. Mais le vieillard, en ralit, au moment o il voque ainsi son pass d'enfant, ne rve pas. C'est de l'adulte qu'on peut dire que, lorsque son esprit, tendu vers les ralits prsentes, se relche et se, laisse aller suivant la pente qui le ramne ses premiers jours, il ressemble un homme qui rve, parce qu'il y a en effet un vit contraste entre ses proccupations habituelles et ces images sans rapport avec ce qui sollicite aujourd'hui son activit. Ni l'un, ni l'autre, ne rve (au sens o nous avons dfini ce terme) : mais ce genre de rverie, qui, chez l'adulte, est une distraction, devient, chez le vieillard, une vritable occupation. Il ne se contente pas, d'ordinaire, d'attendre passivement que les souvenirs se rveillent, il cherche les prciser, il interroge d'autres vieillards, il compulse ses vieux papiers, ses anciennes lettres, et,
1
Matire et mmoire, pp. 167-168.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
81
surtout, il raconte ce dont il se souvient, quand il ne se soucie pas de le fixer par crit. En somme, le vieillard s'intresse au pass bien plus que l'adulte, mais il ne s'ensuit pas qu'il soit en mesure d'voquer plus de souvenirs de ce pass que quand il tait adulte, ni, surtout, que des images anciennes, ensevelies dans l'inconscient depuis son enfance, retrouvent la force de franchir le seuil de la conscience alors seulement. On comprendra mieux quelles raisons veillent en lui cet intrt nouveau pour une priode de sa vie longtemps nglige, si on le replace dans la socit, dont il n'est plus un membre actif, mais o un rle lui est cependant assign. Dans les tribus primitives, les vieillards sont les gardiens des traditions, non seulement parce qu'ils les ont reues plus tt que les autres, mais aussi sans doute parce qu'ils disposent seuls du loisir ncessaire pour en fixer les dtails au cours d'entretiens avec les autres vieillards, et pour les enseigner aux jeunes gens partir de l'initiation. Dans nos socits aussi on estime un vieillard en raison de ce qu'ayant longtemps vcu il a beaucoup d'exprience et est charg de souvenirs. Comment ds lors les hommes gs ne s'intresseraient-ils point passionnment ce pass, trsor commun dont ils sont constitus dpositaires, et ne s'efforceraient-ils pas de remplir en pleine conscience la fonction qui leur confre le seul prestige auquel ils puissent dsormais prtendre ? Certes, nous ne contestons pas qu'il y ait, pour un homme parvenu au terme de la vie, une douceur, accompagne d'un peu d'amertume et de regrets, mais d'autant plus pntrante qu'il s'y mle l'illusion d'chapper aux atteintes du temps et de reconqurir par l'imagination ce que la ralit ne peut plus donner, se rappeler ce qu'on a t, les joies et les peines, les gens et les choses qui furent une partie de nousmme. Mais ce genre de satisfaction, d'illusion et de transfiguration, tous en sont capables, quel que soit leur ge, et ce ne sont pas. seulement les vieillards qui ont besoin de temps en temps de ce refuge qu'offre le souvenir. Nous aurons d'ailleurs rechercher comment s'explique cette prdilection particulire pour le pass laquelle personne n'chappe certains moments, et qui dtermine une exaltation apparente et temporaire de la mmoire chez le jeune homme et l'adulte comme chez le vieillard. Il n'en est pas moins vrai que la socit, en attribuant aux vieillards la fonction de conserver les traces de son pass, les encourage consacrer tout ce qu'il leur demeure d'nergie spirituelle se souvenir. Si l'on se moque quelquefois de ceux qui prennent leur rle trop au srieux, et abusent du droit qu'a la vieillesse de se raconter, c'est que toute fonction sociale tend s'exagrer. Si l'on coutait trop les conseils de l'exprience, on n'irait pas de l'avant. Mais les hommes gs qui, sensibles de telles railleries, craignent qu'on ne les croie sur le point de retomber en enfance, s'ils parlent de ce qu'ils ont vu tant enfants, qui se taisent alors, et ne sont proccups que de se mettre ou de rester au pas des adultes, remplissent mal une fonction laquelle ils ne sont plus adapts, et, vritablement, manquent leur tche, Ils mriteraient qu'on leur adresst, en le transposant, le mme reproche que Callicls Socrate : Quand je vois un enfant qui cela convient encore bgayer ainsi en parlant et badiner, j'en suis fort aise, je trouve cela gracieux, noble et sant cet ge... Si c'est un homme qu'on entend ainsi bgayer ou qu'on voit jouer, la chose est juge ridicule, indcente cet ge, et digne du fouet. Ainsi, en rsum, si les vieillards sont penchs sur le pass plus que les adultes, ce n'est pas parce qu'il y a cet ge comme une mare montante de souvenirs : ils n'ont pas plus de souvenirs de leur enfance que quand ils taient adultes : mais ils sentent que, dans la socit, ils n'ont rien de mieux faire maintenant que d'utiliser, pour reconstituer le pass, tous les moyens, dont ils ont toujours dispos, mais qu'ils n'ont eu ni le temps, ni le dsir d'y employer. Il est naturel ds lors que le tableau qu'ils nous offrent de ce pass soit quelque peu. dfigur, puisqu'au moment o ils le reconstituent, ils ne jugent peut-tre pas trs
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
82
impartialement le prsent. Ce travail de reconstruction s'effectue, en mme temps que sous l'influence de la socit tout entire-, sous la pression des prjugs et prfrences de la socit des vieillards. Mais ce n'est l qu'un aspect d'un fait beaucoup plus gnral qu'il nous faut maintenant aborder. Non seulement les vieillards, mais l'ensemble des hommes (ingalement, bien entendu, suivant l'ge, le temprament, etc.) adopte instinctivement, vis--vis du temps coul, l'attitude des, grands philosophes grecs qui mettaient l'ge d'or non la fin du monde, mais au commencement. Bien qu'il y ait des priodes de notre existence que nous en aurions retranches volontiers, bien que nous ne soyons pas srs que nous aimerions recommencer telle quelle notre vie dans sa totalit, par une sorte de mirage rtrospectif un grand nombre d'entre nous se persuadent que le monde, aujourd'hui, est plus incolore, moins intressant qu'autrefois, en particulier qu'aux jours de notre enfance et de notre jeunesse. Presque tous les grands crivains qui ont dcrit les impressions de leurs quinze ou vingt premires annes parlent des gens et des ,choses qu'il voyaient et connaissaient alors, et d'euxmmes, d'eux surtout, avec attendrissement. Tous n'ont pas eu une enfance heureuse, soit qu'ils aient connu de bonne heure la misre abjecte, la brutalit des hommes, leur mchancet et leur injustice, soit qu'ils aient t durement comprims dans leurs aspirations, ou, encore, dvis et dforms par une ducation absurde. Il y en a qui parlent de leurs parents sans indulgence, et mme avec une hostilit et une haine non dguises. Rousseau lui-mme, aprs le rcit d'une injustice dont il fut victime moins de 10 ans, dclare : L fut le terme de la srnit de ma vie enfantine. Ds ce moment je cessai de jouir d'un bonheur pur, et je sens aujourd'hui mme que le souvenir des charmes de mon enfance s'arrte l. Mais, en gnral, et malgr des plaintes, regrets et rvoltes tenaces, malgr ce qui dans les vnements qu'ils rapportent, considrs dans leur nue ralit, nous attriste, nous indigne, ou mme nous terrifie, il semble que tout cela, l'effet que tout cela produisait devait tre singulirement attnu par l'atmosphre plus vivifiante qu'on respirait alors. Sur les aspects les plus sombres de l'existence il semble que tranaient des nuages qui les enveloppaient a demi. Ce monde loign, o l'on se souvient d'avoir souffert, n'en exerce pas moins une attraction incomprhensible sur celui qui y a pass et qui semble y avoir laiss et y rechercher prsent la meilleure partie de lui-mme. C'est pourquoi, et sous rserve de quelques exceptions, nous pouvons dire que la grande majorit des hommes est sensible, des instants plus ou moins frquents, ce qu'on pourrait appeler la nostalgie du pass. D'o vient cette apparence illusoire ? Mais d'abord, est-ce une illusion ? Comme l'a dit Rousseau, l'enfant et le jeune homme, faibles absolument, sont forts relativement, et plus forts que l'adulte, tant que leurs forces dpassent leurs besoins. Cette plnitude de vie entrane une plnitude d'impressions. Lorsque nous sommes plus gs, et alors mme que nous sentons en nous un suffisant ressort organique, sollicits en divers sens par tous les intrts qui naissent de la vie sociale, nous devons nous limiter. Aux contraintes du dehors s'ajoutent celles qu'il nous faut nous imposer nous-mme. Nos impressions ne se plient aux formes que leur impose la vie sociale qu' condition de perdre une partie de leur matire. Le regret de la nature au sein de la socit, voil quoi se ramnerait essentiellement le regret de l'enfance chez l'adulte. Mais, d'abord, ceci suppose que le souvenir de nos impressions organiques anciennes est assez fort pour que nous puissions le rapprocher de nos sensations organiques d' prsent. Or rien n'chappe davantage la prise de notre mmoire que le sentiment que nous avions autrefois de notre corps. Par rflexion, par une srie de comparaisons objectives, nous russirions nous assurer d'une diminution de notre ton vital. Mais une comparaison abstraite n'expliquerait point ce qui n'est pas un
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
83
regret rflchi, mais un tat affectif profond, un sentiment vif et souvent poignant. D'autre part, dans l'ordre des apprciations sociales, l'exubrance des forces physiques, la spontanit et la richesse des sensations ne passent pas au premier plan : ct de ce que nous avons perdu, la socit nous reprsenterait ce que nous avons acquis par elle, et nous obligerait le prfrer. On dira, alors, que le regret du pass repose, en effet, sur une illusion, qui est luvre de la mmoire, ou plus exactement, de l'imagination. D'aprs M. Bergson, les souvenirs reparaissent dans la mesure o ils peuvent guider notre action : en ce sens il nous serait aussi utile de nous rappeler les vnements malheureux que les circonstances agrables de notre vie passe. Toutefois, dans le cas de la rverie, ce n'est pas l'action, c'est le sentiment qui appellerait les souvenirs. Or, il y a bien des sentiments tristes, et d'autres, doux et joyeux. Mais il nous est utile de nourrir et d'accrotre ceuxci, de rduire et de dissiper ceux-l. C'est pourquoi nous aurions pris l'habitude, toutes les fois que nous nous trouvons dans Une disposition affective heureuse, de choisir dans notre mmoire les images qui lui sont conformes, de ne retenir de ces images que ce qu'il nous est agrable de considrer : c'est pourquoi la rverie est une suite d'ides et d'images agrables, le plus souvent. Il y a bien des rveries tristes., et il arrive qu'un sentiment pnible nous conduit voquer des souvenirs qui l'entretiennent ; mais nous russissons le plus souvent en distraire assez vite notre pense, par une sorte d'instinct vital qui nous carte de tout ce qui diminue ou absorbe inutilement nos forces, sauf dans des cas presque pathologiques. Ainsi s'expliquerait que nous oublions les aspects pnibles du pass ; c'est ainsi que la passion amoureuse transfigure le souvenir de l'tre aim, et n'en retient que ce qui peut l'entretenir ellemme. Mais la rverie, mme lorsqu'y entrent surtout ou exclusivement des souvenirs, ne se confond pas avec la mmoire. Ou plutt, la rverie telle que nous venons de la dfinir se distingue de la forme de la mmoire que M. Bergson dsigne quelquefois du mme nom. Il entend en effet par l non point un arrangement et une slection des images-souvenirs, mais la srie chronologique de ces images, telle qu'elle se conserve, d'aprs lui, dans la mmoire. Ds que l'imagination s'empare de ces souvenirs, et les modifie pour en faire la matire d'une rverie agrable, elle les transforme dj en souvenirs-habitudes, elle les dtache en tout cas de leur srie chronologique : elle n'atteint pas en ralit (dans l'hypothse de M. Bergson) jusqu' cette srie, qui demeure immuable, et contient tous nos tats, heureux ou tristes, quel que soit le travail d'limination ou d'puration auquel l'imagination se livre au-dessus d'elle. Si l'on dclare, maintenant, que cette distinction importe peu, que les hommes, en effet, lorsqu'ils voquent le pass, non pour l'utiliser, mais pour le revivre, n'atteignent pas non plus cette couche dernire des images-souvenirs, qu'ils s'en tiennent rver le pass (au sens ,que nous venons de dire), nous rpondrons qu'il n'y a, ds lors, pas de raison d'admettre la conservation des images-souvenirs au dernier plan de la mmoire, puisqu'elle ne sert rien, et que la rverie n'est qu'un cas, entre autres, de reconstruction des souvenirs partir du prsent, et par le jeu des notions et perceptions qui remplissent actuellement la conscience. Nous comprendrons mieux la nature de cette opration dformatrice qui s'exerce sur le pass, peut-tre, en effet, l'occasion de la rverie, si nous n'oublions pas que, mme au moment o notre imagination le reproduit, elle demeure sous l'influence du milieu social prsent. En un sens, la mmoire contemplative ou la mmoire-rverie nous aide sortir de la socit : c'est un des rares moments o nous russissions nous isoler compltement, puisque nos souvenirs, en particulier les plus anciens, sont
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
84
bien nous, et que ceux qui pourraient les lire en nous aussi bien que nous-mme ou bien ont disparu, ou bien sont disperss. Toutefois, si nous nous drobons ainsi la socit des hommes d'aujourd'hui, c'est pour nous retrouver au milieu d'autres tres et dans un autre milieu humain, puisque notre pass est peupl des figures de ceux que nous avons connus. En ce sens, on n'chappe une socit qu' condition de lui en opposer une autre. On aura beau gagner les solitudes, chercher dans la nature les consolations ou mme l'indiffrence que nos semblables nous refusent : elle ne nous attachera et ne nous retiendra, elle ne nous livrera ce que nous attendons d'elle, que si nous croyons retrouver en elle des traces d'humanit, soit que ses aspects s'accordent avec nos sentiments, soit que nous la peuplions d'tres demi rels, demi imaginaires. Ainsi, lorsque l'homme croit se retrouver seul, face face avec lui-mme, d'autres hommes surgissent, et, avec eux, les groupes dont ils sont dtachs. Nos socits modernes imposent l'homme beaucoup de contraintes. Sans exercer sur lui, avec la mme force, la mme pression unilatrale que les tribus primitives sur leurs membres, elles pntrent cependant et s'insinuent plus au fond de lui-mme, par la multiplicit et la complexit des rapports de toute nature o elles l'enveloppent. Elles affectent, il est vrai, de respecter sa personnalit individuelle. Pourvu qu'il s'acquitte de ses devoirs essentiels, il est libre de vivre et de penser sa guise, de former ses opinions comme il l'entend. La socit semble s'arrter sur le seuil de sa vie intrieure. Mais elle sait bien que, mme alors, il ne s'vade d'elle qu'en apparence, et que, peut-tre, c'est ce moment, o il parat penser le moins elle, qu'il dveloppe le mieux en lui les qualits de l'homme social. Quels sont les traits principaux qui distinguent de la socit actuelle celle o nous nous replongeons ainsi en pense ? D'abord elle ne s'impose pas nous, et nous sommes libres de l'voquer quand nous le voulons, de choisir, dans le pass, la priode o nous nous transportons. Puisque les personnes que nous avons connues aux diffrentes poques ou n'taient pas les mmes, ou ne nous prsentaient pas le mme aspect d'elles-mmes, il dpend de nous de choisir la socit au milieu de laquelle il nous convient de nous retrouver. Tandis que, dans la socit actuelle, notre place est bien dtermine, et, avec elle, le genre de contraintes que nous subissons, la mmoire nous donne l'illusion de vivre au sein de groupes qui ne nous emprisonnent pas, et qui ne s'imposent nous qu'autant et aussi longtemps que nous l'acceptons. Il nous reste toujours la ressource, si certains souvenirs nous gnent et nous sont charge, de leur opposer le sentiment de ralit insparable de notre vie d' prsent. Mais on peut aller plus loin. Non seulement nous pouvons nous mouvoir ainsi volont au sein de ces groupes, et de l'un l'autre, mais l'intrieur de chacun d'eux, alors mme que nous dcidons d'y demeurer en pense, nous ne retrouvons pas au mme degr ce sentiment de contrainte humaine que nous. prouvons si fort aujourd'hui. Cela vient de ce que les hommes, dont nous nous souvenons n'existent plus, ou, s'tant loigns, plus ou moins de nous, ne reprsentent nos yeux qu'une socit morte, et en tout cas une socit tellement distincte de celle o nous vivons, que la plupart des commandements en sont prims. Il y a incompatibilit bien des gards entre les contraintes, d'autrefois et celles d' prsent. Il s'ensuit que nous ne nous, reprsentons plus qu'incompltement et imparfaitement celles-l. Nous pouvons voquer des lieux et des temps diffrents du lieu et du temps o nous sommes, parce que nous replaons les uns et les autres dans un cadre qui les enferme tous. Mais comment. pourrions-nous sentir en mme temps des contraintes d'ordre social qui ne s'accordent pas ? Ici, il n'y a qu'un cadre qui compte, celui qui est constitu par les commandements de la socit d' prsent, et qui exclut ncessairement les autres. Entre les, hommes se nouent et
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
85
s'entretiennent des rapports d'amiti et de solidarit. Ils sont aussi, les uns vis--vis des autres, des concurrents : de l bien des souffrances, des craintes, des hostilits, des haines. Mais la concurrence d'aujourd'hui a remplac celle d'autrefois ; nous savons bien que l'une et l'autre sont incompatibles. Les hommes d'aujourd'hui nous proccupent pour l'avenir immdiat ou lointain : nous pouvons en attendre beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal, bien et mal, d'ailleurs, indfinis. Des hommes d'autrefois, dont la vie et les actes sont immobiliss maintenant dans un cadre bien dfini, nous avons pu prouver la bonne et la mauvaise volont : mais nous n'en attendons plus rien : ils n'voquent dans notre esprit ni inquitude, ni rivalit, ni envie : nous pouvons ne pas les aimer; nous ne pouvons pas les dtester. En dfinitive, les aspects les plus pnibles d la socit d'autrefois sont oublis, parce que la contrainte n'est sentie que tant qu'elle s'exerce, et que, par dfinition, une contrainte passe a cess de s'exercer. Mais nous croyons que l'esprit reconstruit ses souvenirs sous la pression de la socit. N'est-il pas trange que celle-ci le dtermine transfigurer ainsi le pass au point de le regretter ? Rousseau a dit de la religion chrtienne : Loin d'attacher les curs des citoyens l'tat, elle les en dtache comme de toutes les choses de la terre : je ne connais rien de plus contraire l'esprit social. Ne dirons-nous pas notre tour : le culte du pass, loin d'attacher les curs des hommes la socit, les en dtache : il n'est rien de plus contraire l'intrt de la socit ? Mais, d'abord, tandis qu' la vie terrestre le chrtien en prfre une autre qui, pour lui, est au moins aussi relle que c'elle-l et qu'il place dans l'avenir, l'homme sait bien que le pass n'existe plus, et il est bien oblig de s'adapter au seul monde rel, qui est celui o il vit maintenant. Il ne se retourne vers le temps disparu que par intermittences, et il n'y demeure jamais longtemps. D'autre part, comment ne pas voir que si l'homme tait, dans la socit, comme un ressort toujours tendu, si son horizon, se limitait l'ensemble de ses contemporains, et mme de ceux de ses contemporains qui l'entourent si le souci s'imposait perptuellement lui de se conformer leurs coutumes, leurs gots, leurs croyances et leurs intrts, il pourrait bien s'incliner devant les lois sociales, mais il les subirait comme une dure et continue ncessit, et, n'envisageant dans la socit qu'un instrument de contrainte, aucun lan gnreux et spontan ne le porterait vers elle ? Il n'est donc pas mauvais que, lorsqu'il se repose de l'action et se retourne, la manire d'un voyageur, pour reconnatre le chemin qu'il a parcouru, il y dcouvre tout ce que la fatigue, l'effort, la poussire souleve, et le souci d'arriver temps et au but, l'empchait de contempler. Dira-t-on qu'une telle vision, d'un point de perspective un peu plus loign, est plus conforme la ralit ? Il se peut. Lorsque nous jugeons ainsi aprs coup ceux qui furent nos compagnons, nos amis, nos parents, nous sommes peut-tre plus justes pour eux. La socit, au moment prsent, ne nous rvle peut-tre que ses aspects les moins attirants : ce n'est qu' la longue, par la rflexion et le souvenir, que notre impression se modifie. Nous dcouvrons que les hommes nous aimaient, en mme temps qu'ils nous contraignaient. L'ensemble des tres humains n'est pas seulement une ralit plus forte que nous, une sorte de Moloch spirituel qui rclame de nous le sacrifice de toutes nos prfrences individuelles : nous y apercevons le source de notre vie affective, de nos expriences et de nos ides, et nous y dcouvrons une tendue et une profondeur d'altruisme que nous ne souponnions pas. Durkheim a bien vu et bien distingu ces deux aspects de la socit. S'il a insist d'abord sur l'aspect contrainte, c'est qu'au dbut d'une science, il faut dfinir provisoirement les faits par des signer, extrieurs faciles saisir. Comme le sentiment de joie exprime, lorsqu'il rsulte chez l'homme de l'action de la socit, qu'il y a concidence et fusion partielle entre les tendances individuelles et la coutume sociale, et le sentiment de peine ou de contrainte, au contraire, qu'il y a entre elles une opposition au moins partielle, il a dit qu'on reconnatrait les faits sociaux ce qu'ils s'imposent nous et nous contraignent. Mais il a
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
86
reconnu qu'il n'y a pas de pratique collective qui n'exerce sur nous une double action, que les forces sociales s'orientent souvent dans le sens de nos dsirs, qu'en tout cas elles accroissent et enrichissent notre tre individuel de tous les modes de sensibilit et de toutes les formes de pense que nous empruntons aux autres hommes. Il est assez naturel que, lorsque le sentiment de contrainte a disparu, tout ce qu'il y avait de bienfaisant dans notre contact avec les groupes humains ressorte, au point qu' ces moments nous dcouvrons l'tendue de notre dette vis--vis des hommes qui furent mls notre vie, et nous regrettons presque de ne l'avoir pas reconnue lorsqu'il en tait temps. Ainsi, en un sens, le tableau que nous reconstruisons du pass nous donne une image de la socit plus conforme la ralit. Mais, en un autre sens, et en tant que cette image devrait reproduire la perception ancienne, elle est inexacte : elle est la fois incomplte, puisque les traits dplaisants en sont effacs ou attnus, et surcharge, puisque des traits nouveaux que nous ne remarquions pas y sont ajouts. En tout cas la socit est intresse nous dcouvrir ainsi, d'une vue rtrospective, les trsors de bienveillance qu'elle porte en elle, mais qu'elle doit y laisser renferms, tant qu'elle a besoin d'affirmer son autorit. On comprend qu'elle nous invite oublier l'pret de la concurrence aussi bien que les rigueurs des lois dans le pass, prsent que ni les concurrents, ni les obligations ne sont plus les mmes. Car bien que les hommes dont on se souvient ne se confondent pas avec ceux auxquels nous nous heurtons et que nous ctoyons chaque jour, ils participent les uns et les autres de la nature humaine, et c'est une mme socit continue qui les comprend. On se plie ses durets et on les lui pardonne, dans la mesure o on croit se souvenir qu'elle nous les a autrefois pargnes. Elle saisit les hommes d'une prise quelquefois si brutale, qu'ils peuvent tre tents de se dsintresser et se dtourner. Ils la respecteront au contraire et s'y attacheront d'autant plus qu'ils en retrouveront l'image idalise dans les coutumes et faons de vivre anciennes, aujourd'hui disparues. Des hommes qui ne demanderaient la mmoire que d'clairer leur action immdiate, et pour qui le plaisir pur et simple d'voquer le pass n'existerait pas, parce qu'il se peindrait leurs yeux des mmes couleurs que le prsent, ou, simplement, parce qu'ils en seraient incapables, n'auraient aucun degr le sens de la continuit sociale. C'est pourquoi la socit oblige les hommes, de temps en temps, non seulement reproduire en pense les vnements antrieurs de leur vie, mais encore les retoucher, en retrancher, les complter, de faon ce que, convaincus cependant que nos souvenirs sont exacts, nous leur communiquions un prestige que ne possdait pas la ralit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
87
Chapitre IV
La localisation des souvenirs
Retour la table des matires
Les psychologues distinguent d'ordinaire ce qu'ils appellent la reconnaissance et la localisation des souvenirs. Localiser, c'est avoir l'ide du moment o l'on a acquis un souvenir. Reconnatre, c'est avoir le sentiment qu'une personne qu'on voit ou qu'une image qui traverse l'esprit se sont prsentes nous auparavant, sans que nous puissions dire quel moment. Quand cette ide s'ajoute ce sentiment, le souvenir est la fois reconnu et localis. Ainsi, d'une part, il n'y a pas de souvenir localis qui ne soit reconnu, mais beaucoup de souvenirs sont simplement reconnus, et non localiss. D'autre part, seule la localisation met en jeu l'activit intellectuelle de l'esprit, puisque, pour retrouver la place d'un souvenir dans le temps, il faut un effort de rflexion. La reconnaissance au contraire s'oprerait automatiquement : le sentiment de familiarit, qui accompagne par exemple le souvenir des mots d'une langue qu'on connat, et le sentiment du dj vu, qui nat l'occasion d'une image, objet ou figure, ne sont pas des ides et ne supposent aucune rflexion. D'o il rsulte qu'il entrerait bien une part de raisonnement dans la mmoire, mais dans la mesure seulement o nous localisons nos souvenirs. Si nous entendons par raisonnement le genre d'activit de l'esprit qui nous permet de comprendre ce que pensent les autres, et de penser en commun avec eux, nous
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
88
dirons que, suivant la plupart des psychologues, tout l'essentiel de la mmoire, de l'acquisition jusqu' la reconnaissance inclusivement, s'explique par des oprations psychiques et physiologiques purement individuelles. La socit n'interviendrait, il ne faudrait tenir compte des ides et habitudes de pense que nous devons au milieu social, que pour expliquer comment l'esprit localise ses souvenirs. Nous sommes bien obligs de chercher, dans l'espace et dans le temps tels qu'ils sont dfinis dans notre groupe, le moment ou le lieu o s'est produit tel fait qui nous a impressionns. Nos souvenirs, jusque-l enferms en nous, en sortiraient alors seulement, pour s'accorder avec les souvenirs des autres. Mais cet accord serait en somme tout accessoire, puisqu'il suppose des mmoires individuelles dj existantes; il nous aiderait sans doute coordonner nos souvenirs, mais il ne les produirait pas. On pourrait objecter ces psychologues qu'ils ont tort d'opposer ainsi la reconnaissance la localisation, comme un sentiment une ide, et de concevoir que l'une puisse se produire sans l'autre. Certes, si l'on entend par localisation l'acte par lequel nous retrouvons trs exactement la date d'un souvenir, il existe beaucoup de souvenirs qu'on ne russira et qu'on ne songera mme pas localiser. Mais ce n'est l qu'un cas particulier d'une opration beaucoup plus vaste. A propos de tout souvenir, nous pouvons dire, sinon exactement quand et o, du moins dans quelles conditions nous l'avons acquis, c'est--dire quelle catgorie de souvenirs, acquis dans les mmes conditions, il se rattache. Je ne sais pas exactement quand j'ai appris tels mots d'une langue, mais je sais bien que c'est quand je me trouvais en rapport avec l'ensemble des hommes qui la parlent. Je ne sais pas exactement quand j'ai entendu telle sonate, mais je sais que c'est dans un concert, ou chez des amis musiciens, c'est--dire dans un groupe form en raison de proccupations artistiques. En d'autres termes je peux toujours indiquer dans quelle zone de la vie sociale ce souvenir a pris naissance. Je dis: Je puis indiquer... ; car, si on prouve le besoin de localiser ainsi ses souvenirs, c'est pour rpondre une question qui vous est pose ou qu'on se pose soi-mme, c'est qu'on ex-amine ces souvenirs du dehors et comme s'ils taient ceux des autres. Si on tait seul, non seulement on ne rechercherait jamais la date prcise d'un souvenir, mais encore on ne se demanderait pas d'une manire gnrale dans quelles conditions, dans quelle situation, dans quel milieu il nous reporte, c'est--dire, au fond, qu'on ne le reconnatrait pas. Quand nous rencontrons une personne dont le visage ne nous est pas inconnu, et que nous cherchons vainement nous rappeler o nous l'avons vue, ce n'est pas une curiosit dsintresse qui nous tourmente, mais nous voudrions savoir si nous devons la saluer, et, au cas o elle s'arrterait pour causer avec nous, au cas o nous la retrouverions chez des amis, nous voudrions ne point la confondre avec une autre, et lui tmoigner l'intrt auquel elle a droit de notre part. Dans le sentiment du dj vu, des proccupations de ce genre interviennent toujours. C'est dire que la reconnaissance s'accompagne d'un premier essai de localisation : nous nous tournons en pense vers divers groupes sociaux, parents, amis, compagnons de voyage, camarades d'enfance, etc., et nous nous demandons auquel d'entre eux appartient cette personne, nous cherchons d'o vient l'ordre de la reconnatre, qu'elle nous transmet, mais qui mane certainement d'une collectivit dont nous avons fait ou dont nous faisons encore partie. N'est-il pas vrai, d'ailleurs, qu'il suffira quelquefois de nous rappeler : c'est un camarade de lyce, c'est une relation mondaine, c'est un collgue, pour que nous n'allions pas plus avant ? Nous savons en effet tout ce qu'il est ncessaire pour que nous nous comportions correctement avec lui. Entre cette localisation gnrale, qui se confond presque avec le sentiment du dj vu, et la localisation rigoureuse dont parlent les psychologues, il n'y a donc qu'une diffrence de degr. Il n'y a pas de reconnaissance qui ne soit un commen-
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
89
cement de localisation, c'est--dire o ne se mlent dj des rflexions, sous forme, au moins, d'interrogations. D'autre part, le schma classique, o l'on distingue le rappel, la reconnaissance, la localisation des souvenirs, comme des phases successives et qui se succdent toujours suivant cet ordre, est souvent, et peut tre le plus souvent, en dfaut. Existe-t-il une reconnaissance immdiate, en ce sens que ds que certaines images se prsenteraient notre esprit, sans que nous rflchissions le moins du monde, nous sentirions que nous les avons dj vues ? Hffding l'a soutenu. Il en a donn plusieurs exemples : Un visage, ou, pour prendre quelque chose de plus simple, un trait d'un visage. Ou je vois dans le ciel, le soir, une couleur (Farbennuance) rare, mais qu'il me semble connatre. Ou on dit un mot tranger que je ne peux pas traduire, mais qui a un son que je connais. Ou, pour prendre des exemples dans l'exprience interne, une impression organique, le sentiment d'un certain ton vital (Stimmung des Lebensgefhls), qui surgissent en moi, m'apparaissent avec un cachet de familiarit 1. Il s'agit, on le voit, de sensations extrmement simples, non composes , si bien que nous ne pouvons rflchir leurs lments, et la faon dont ils sont combins, avant que la sensation ne se soit produite : le sentiment du dj vu ne s'expliquerait donc point par la rflexion : en d'autres termes la reconnaissance du souvenir prcderait tout essai et tout commencement de localisation. D'aprs Lehmann, un seul des exemples cits par Hffding serait rigoureusement simple : c'est la nuance colore vue au ciel, le soir ; mais mme dans ce cas, il estime que la reconnaissance immdiate s'explique par l'intermdiaire d'un nom : un homme cultiv, et qui n'est pas aveugle aux couleurs, il est impossible de voir une nuance, mme si rare, sans qu'un nom au moins approximativement juste se prsente 2. Lehmann a montr par une srie d'expriences qu'on reconnat bien plus facilement les couleurs lorsqu'on leur a associ des noms 3. Avant de lire ces articles, nous avions observ sur nous-mme un acte de reconnaissance de ce genre ; voici comment nous le dcrivions : Il y a quelques jours, dans une valle du Vorarlberg, vers 6 heures du soir, je regardais le massif de la Vallula ; les cimes denteles se dcoupaient sur le ciel d'un bleu trangement cru, o taient suspendus deux ou trois nuages ross. Brusquement j'ai pens un paysage de montagne contempl un autre soir, au retour d'une excursion solitaire. Pendant un moment je n'ai pas pu situer cette image, puis je me suis vu, observant un ciel de mme nuance, au coucher du soleil, Saint-Gervais, non loin du col de Bionassay ; je me suis rappel que j'ai repass plusieurs fois par le mme endroit, etc. J'ai eu l'impression d'une image, suspendue un instant dans le vide, et qui concidait presque exactement avec le tableau qui se droulait devant moi. Tout s'est pass comme si un souvenir surgissait, sans qu'aucune circonstance de temps, de lieu, de milieu m'ait aid l'voquer: et il m'a fallu prs d'une minute pour explorer, en pense, les lieux et les temps o il pouvait se placer, et pour retrouver son cadre.
2 3
Ueber Wiedererkennen, Association und psychische Activitt, Vierteljahrschrift fr wissenschaffliche Philosophie, 1897; rponse Lehmann qui opposait la thorie de la reconnaissance par la ressemblance que dfendait Hffding l'explication de la reconnaissance par la contigut : Alf. LEHMANN, Kritische und experimentelle Studien ber das Wiedererkennen. Philosophische Studien de Wundt, 5e vol., 1889, et 7e vol., 1892 : ce second article est la rponse de Lehmann aux critiques de Hffding. Ibid., 7e vol., p. 189. Ibid., 5e vol., p. 142.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
90
On dira, avec M. Bergson, que la perception actuelle a attir l'image en raison, simplement, de leur ressemblance. En effet, parmi nos images-souvenirs, celles dont la forme pourrait s'encadrer dans notre attitude prsente rencontreront un moins grand obstacle que les autres ; et si, ds lors, quelqu'une d'entre elles peut franchir l'obstacle, c'est l'image semblable la perception prsente qui le franchira 1. Seulement nous avons convenu de ne point parler d'attitude physique, d'obstacle corporel, mais de considrer seulement le cadre psychique actuel. Ds lors, il se pourrait que la ressemblance qui nous a frapp portt moins sur l'impression actuelle et l'impression ancienne dont on suppose qu'elle reparat, que sur le cadre psychique actuel et un autre cadre constitu, lui aussi, par des notions relativement stables, et qu'il dpendait de nous d'envisager chaque moment, par ce qu'il faisait partie de l'ensemble de nos reprsentations familires. En d'autres termes, supposons que nous ayons pens en gnral, l'occasion du spectacle actuel, aux circonstances o il nous a t donn d'prouver, en regardant le ciel quelques moments avant le coucher du soleil, une impression d'tranget : cette simple rflexion aura suffi nous persuader que cet aspect du ciel a dj frapp nos regards ; d'autres rflexions nous auront renseign sur les circonstances de temps et de lieu o cela s'est produit. M. Bergson a observ qu' une perception renouvele ne peut suggrer les circonstances concomitantes de la perception primitive que si celle-ci est voque d'abord par l'tat actuel qui lui ressemble 2. C'est exact, si ces circonstances sont aussi uniques que l'impression, et ne peuvent tre associes qu' elle. Ce ne l'est plus, s'il s'agit d'un cadre ou d'une attitude gnrale qui, outre cette impression, ont pu en accompagner d'autres. Sans doute on demandera alors pourquoi cette attitude, dtermine au moins en partie par la perception actuelle, nous a rappel prcisment telle impression ancienne plutt que toute autre. Mais rien ne prouve qu'elle n'aurait pas pu en rappeler en effet une autre : seulement, notre rflexion nous a conduits celle-l. Au reste ces cas de reconnaissance apparemment soudaine et immdiate sont rares. On dit que, pour qu'on songe retrouver la date d'un souvenir, il faut qu'au pralable celui-ci soit donn. Mais n'arrive-t-il pas bien plus souvent que nous voquions des souvenirs, en rflchissant des dates, et en repassant en pense des priodes qui se prsentent nous comme des cadres vides ? Le plus sr moyen de faire s'envoler ainsi le plus grand nombre de souvenirs, n'est-ce pas de battre les buissons, de suivre les fosss, et d'explorer les routes du pass, c'est--dire de parcourir les grandes divisions du temps, de remonter d'anne en anne, de mois en mois, de jour en jour, et de reconstituer heure par heure tout ce que nous avons fait dans une journe ? Ainsi, dans bien des cas, la localisation prcde non seulement la reconnaissance, mais l'vocation des souvenirs, et il semble qu'elle la dtermine : c'est donc que la localisation toute seule contient dj une partie de ce qui sera la substance du souvenir reconnu : c'est une rflexion, mais qui, sous forme d'ides, renferme dj des faits concrets et sensibles. En ce sens, dans bien des cas, c'est la localisation qui expliquerait le souvenir. Il tait naturel que les psychologues qui ont vu dans la mmoire une forme d'activit purement individuelle aient soutenu le contraire. Pour eux ce sont les souvenirs qui expliquent, et qui suffisent expliquer la localisation. Donnez-vous l'ensemble des souvenirs d'un individu. Supposez maintenant qu'ayant voqu un de ces souvenirs, il cherche sa place dans cet ensemble. Il lui suffira de considrer l'ensemble, de passer en revue tous ses lments, pour qu'il y retrouve le souvenir
1 2
Matire et mmoire, p. 97. Ibid., p. 89.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
91
mme et qu'il puisse ds lors en reconnatre la place. Il n'est pas ncessaire, et d'ailleurs il ne serait pas possible de se reprsenter les places et leur ordre, indpendamment des souvenirs : ce qui est donn la conscience individuelle, ce sont les souvenirs. Quant leurs places, leurs rapports, leur ordre, ce sont l autant de notions abstraites, auxquelles on peut bien s'lever l'occasion des souvenirs, et quand on les a sous les yeux, mais qui, dtaches d'eux, ne s'appuient sur rien, et ne sont plus rien. Ce n'est donc pas de l qu'on peut partir. Mais il faut se transporter au sein mme de la masse des souvenirs. M. Bergson a prsent sa thorie de la localisation en l'opposant celle de Taine. Il a dit : Le processus de localisation d'un souvenir dans le pass... ne consiste pas du tout, comme on l'a dit, plonger dans la masse de nos souvenirs comme dans un sac, pour en retirer des souvenirs de plus en plus rapprochs entre lesquels prendra place le souvenir localiser. Par quelle heureuse chance mettrions-nous justement la main sur un nombre croissant de souvenirs intercalaires ? Le travail de localisation consiste en ralit dans un effort croissant d'expansion, par lequel la mmoire, toujours prsente tout entire elle-mme, tend ses souvenirs sur une surface de plus en plus, large et finit par distinguer ainsi, dans un amas jusque-l confus, le souvenir qui ne retrouvait pas sa place 1. Pour comprendre cette thorie, il faut rappeler que M. Bergson a reprsent la vie mentale par une sorte de schma : soit un cne qui repose sur son sommet, le sommet tant lui-mme en contact avec un plan : le plan reprsente l'espace ou le prsent, et le point de contact entre la vie mentale et l'espace, c'est la perception actuelle que j'ai de mon corps, c'est--dire d'un certain quilibre sensori-moteur. On supposera d'autre part que, sur la surface de la base du cne, sont disposs nos souvenirs dans leur totalit. L se dessinent dans leurs moindres dtails tous les vnements de notre vie coule . L il n'y a pas de souvenir qui ne soit li, par contigut, la totalit des vnements qui le prcdent et aussi de ceux qui le suivent . Mais entre ces deux limites extrmes qui, en fait, ne sont jamais atteintes , notre vie psychologique oseille suivant une srie de plans intermdiaires, qui reprsentent une multitude indfinie d'tats possibles de la mmoire 2. Comment se constituent ces plans ou ces coupes, et quoi correspondent-elles au juste ? D'une manire gnrale, la mmoire elle-mme, avec la totalit, de notre pass exerce une pousse en avant pour insrer dans l'action prsente la plus grande partie possible d'elle-mme . Suivant que cette pousse est forte ou qu'au contraire l'esprit se dtache du prsent moins ou plus, la mmoire se resserre plus ou moins, sans d'ailleurs se diviser. Nos souvenirs prennent une forme plus banale, quand la mmoire se resserre davantage, plus personnelle quand elle se dilate. Pourquoi ? C'est que, plus on se rapproche de l'action, plus la conscience s'attache ceux de nos souvenirs qui ressemblent la perception prsente au point de vue de l'action accomplir. Alors, voici en quoi consiste cette dilatation de la mmoire qui serait ncessaire pour que nous localisions un souvenir. Dans chacune des coupes distingues, il y a une systmatisation originale, caractrise par la nature des souvenirs dominants auxquels les autres souvenirs s'adossent comme des points d'appuis 3. Localiser un souvenir c'est ou bien dcouvrir en lui un de ces souvenirs dominants, vritables points brillants autour desquels les autres forment une nbulosit vague , ou dcouvrir un souvenir dominant sur lequel il s'appuie immdiatement. Or ces points brillants se multiplient mesure que se
1 2 3
Matire et mmoire, p. 187. Ibid., p. 176. Ibid., p. 186.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
92
dilate notre mmoire 1. C'est donc en nous dtournant de l'action, en redescendant progressivement dans notre pass, que nous rencontrerons un plan assez vaste pour que notre souvenir s'y dtache, comme mesure que la nuit tombe on distingue un plus grand nombre d'toiles. Mais, l'explication qu'carte M. Bergson, parce qu'elle fait une trop grande place au hasard, et la sienne, qui suppose que nous embrassons d'un seul regard tous nos souvenirs seule fin de retrouver l'un d'entre eux, ne sont pas les seules qu'on puisse concevoir. D'un observateur qui monte sur une hauteur afin de reprer la position d'un village, dira-t-on que ce qui lui permet de localiser ce village, c'est que le tableau qui s'tend sous ses yeux est plus vaste, et contient, et lui dcouvre un plus grand nombre de dtails ? N'est-ce pas plutt que, parce qu'il domine ainsi le pays, les dtails prcisment disparaissent, et seules les grandes lignes ressortent, si bien qu'il a devant lui un dessin schmatique o il retrouve les lignes gnrales du plan qu'il a pu tudier ? Et localiser le village, n'est-ce point retrouver sa place par une srie de raisonnements, par exemple : s'il est au midi, si ceci est l'est, alors cette route s'en va dans telle direction, et ce n'est pas l qu'il doit se trouver; S'il est au confluent de deux cours d'eau, si je ne vois qu'une rivire, je dois la suivre jusqu' ce que j'en rencontre une autre, etc. Et de mme, lorsqu'on cherche-dans quelles conditions on a connu quelqu'un, on se rappelle les principaux vnements et les grandes priodes de son existence, et l'on fait les rflexions suivantes : il est trop jeune pour que je l'aie rencontr avant telle poque ; ce ne peut tre non plus tel moment, parce que j'tais l'tranger, et que cela m'aurait frapp ; c'est peut-tre dans telles circonstances, parce qu'il a telle profession, ou tels amis, et que j'ai exerc ce moment la mme fonction ou que j'ai frquent les mmes gens. Sans doute M. Bergson reconnatra que, dans certains cas, et peut-tre le plus souvent, on localise de cette manire. Mais il y en a d'autres, d'aprs lui, o le raisonnement n'interviendrait plus du tout, par exemple lorsqu'il s'agit d'un souvenir isol, pareil un inconnu qui a perdu la parole, et qui ne porte sur lui aucun signe qui permette de savoir d'o il est venu, quand nous ne possdons aucun point de repre, et qu'alors il nous semble parcourir en pense avec une rapidit vertigineuse des priodes entires de notre vie, en repassant par tous les moments en lesquels elles se sont dcomposes. Mais peut-tre n'est-ce l qu'une illusion : d'une part il n'y a pas de souvenir qui se rduise une image ce point pauvre et fugitive qu'il n'offre aucune matire la rflexion, et qu'il ne soit pas possible de saisir en lui des caractres gnraux de compatibilit ou d'incompatibilit avec tels lieux, tels temps, telles circonstances. D'autre part ce n'est pas un un, mais sous une forme schmatique et en tant que groupes ou ensembles que nous nous reprsentons les vnements les moins importants de notre pass. M. Bergson a rappel lui-mme que nous ne voyons pas toutes les lettres quand nous lisons, que nous n'entendons pas tous les mots quand nous conversons, et qu'il suffit que nous en distinguions quelques traits, partir desquels, si nous le voulions, nous pourrions les complter et reconstituer : pourquoi n'en serait-il pas de mme des souvenirs ? Comment russirions-nous, autrement, parcourir avec une rapidit vertigineuse des priodes entires de notre vie ? M. Ribot a cit, d'aprs Abercrombie, le cas du Dr Leyden 2, qui, lorsqu'il voulait se rappeler un point particulier dans quelque chose qu'il avait lu, ne pouvait le faire qu'en se rptant lui-mme la totalit du morceau depuis le commencement, jusqu' ce qu'il arrivt au point dont il dsirait se souvenir . Encore, lorsqu'on rcite par
1 2
Ibid., p. 187. Maladies de la mmoire, p. 45, note.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
93
cur, russit-on prcipiter le dbit, puisqu'en somme tout se ramne des mouvements ou des bauches de mouvement : mais pour percevoir dans tous leurs dtails les images successives qui reprsentent les vnements de notre pass, il faudrait le mme temps qu'ils ont dur. Comme le dit M. Ribot : Si, pour atteindre un souvenir lointain, il nous fallait suivre la srie entire des termes qui nous en sparent, la mmoire serait impossible cause de la longueur de l'opration 1. Ainsi, ce n'est pas un souvenir entirement perdu dont il s'agit de retrouver la place, et ce n'est pas la masse indfinie de nos souvenirs que nous en devons rapprocher avant de l'identifier : le souvenir porte toujours sur lui quelques marques qui aident retrouver sa place, et le pass se reprsente nous sous une forme plus ou moins simplifie. En d'autres termes encore, d'aprs M. Bergson, il n'y aurait, dans bien des cas, pas d'autre moyen de localiser un souvenir que de s'arranger de faon ce que reparaisse la srie chronologique des souvenirs o il tait compris, ou du moins la partie de cette srie qui le comprenait. Il en serait ainsi s'il n'existait entre les souvenirs d'autres rapports que de succession chronologique. Peut-tre, quelquefois, remontons-nous ou redescendons-nous en effet, partir d'un vnement, le long du temps qui l'a prcd ou suivi, ce qui nous permet de retrouver sa place parmi tous ceux que nous recueillons ainsi, au fur et mesure de notre exploration. Mme alors il se pourrait, d'ailleurs, que l'opration de la mmoire ne consistt pas simplement passer d'un souvenir un autre, en raison de leur contigut, mais plutt, retrouver par voie de rflexion tout un ensemble systmatique de souvenirs bien lis, l'occasion de tel d'entre eux. De mme, lorsqu'on examine un fragment d'une mosaque ancienne, sa forme, et les lignes qui s'y croisent permettent quelquefois de reconstituer le dessin de la mosaque tout entire ou d'une de ses parties o tait compris ce fragment. Mais on peut aussi, partant des points de repre dont nous disposons chaque moment, et qui, lis l'un l'autre comme les termes d'un raisonnement, reprsentent comme un tableau schmatique du pass, dterminer avec une prcision de plus en plus grande la place qu'y occupait tel souvenir, sans qu'il soit ncessaire d'voquer ce propos tous ceux qui se trouvaient en contigut avec lui, et, puisqu'on suit les lignes du cadre, sans chercher au hasard des souvenirs intercalaires . Relisons, ce propos, une page o Taine a essay de suivre sur un exemple le travail de l'esprit lorsqu'il reconnat et localise un souvenir. Je rencontre par hasard dans la rue une figure de connaissance, et je me dis que j'ai dj vu cet homme. Au mme instant cette figure recule dans le pass et y flotte vaguement sans se fixer encore nulle part. Elle persiste en moi quelque temps et s'entoure de dtails nouveaux. Quand je l'ai vu, il tait tte nue, en jaquette de travail, peignant dans un atelier ; c'est un tel, telle rue. Mais quand l'ai-je vu ? Ce n'est pas hier, ni cette semaine, ni rcemment. J'y suis ; il m'a dit ce jour-l qu'il attendait pour partir les premires pousses des feuilles. C'tait avant le printemps. A quelle date juste ? Ce jour-l, avant de monter chez lui, j'avais vu des branches de buis aux omnibus et dans les rues : c'tait le dimanche des Rameaux! - Remarquez le voyage que vient de faire la figure intrieure, ses divers glissements en avant, en arrire, sur la ligne du pass ; chacune des phrases prononces mentalement a t un coup de bascule. Confronte avec la sensation prsente et avec la population latente d'images indistinctes qui rptent notre vie rcente, la figure a recul tout d'un coup une distance indtermine. A ce moment, complte par des dtails prcis, et confronte avec les images abrviatives par lesquelles nous rsumons une Journe, une semaine, elle a gliss une seconde fois en arrire, au del de la journe prsente, de la journe d'hier, de la
1
Ibid., p. 45.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
94
journe d'avant-hier, de la semaine, plus loin encore, au del de la masse mal dlimite que constituent nos souvenirs prochains. Alors un mot du peintre nous est revenu, et l-dessus elle a recul encore, au del d'une limite presque prcise, celle que marque l'image des feuilles vertes et que dsigne le mot printemps. Un peu aprs, grce un nouveau dtail, le souvenir des branches de buis, elle a gliss de nouveau, cette fois non plus en arrire, mais en avant, et, rapporte au calendrier, elle s'est situe en un point prcis, une semaine en arrire de Pques, 5 semaines en avant des jours gras, par le double effet de deux rpulsions contraires qui, l'une en avant, l'autre en arrire, se sont -annules l'une par l'autre un moment donn 1. C'est ainsi que l'image se situerait, par intercalation et embotement . Il peut sembler, comme le dit M. Bergson, qu'un tel procd consiste, en effet, chercher au hasard dans le pass des souvenirs de plus en plus rapprochs entre lesquels prendra place le souvenir localiser . Mais n'est-ce point parce que la description de Taine est incomplte ? Un mot du peintre nous est revenu. Est-ce par hasard, ou la suite d'un raisonnement ? Certes, si c'est par hasard, on ne voit pas de raison en effet pour qu'un dtail de cette visite, plutt qu'une multitude d'autres, l'ait frapp. Mais il suffit que ce dtail en ralit n'en soit pas un, qu'il entre, titre de trait essentiel, dans l'ide que j'ai d'un peintre (d'un paysagiste) en gnral, et de tel peintre, ou encore que ce soit une image ou une notion sur laquelle je reviens volontiers, pour qu'il n'y ait plus lieu de s'tonner qu' propos du peintre, ou qu'en mme temps qu'au peintre, nous ayons pens au printemps, aux feuilles, la fte des Rameaux, etc. Qui sait si le raisonnement n'a pas t le suivant : Ce peintre passe le plus de temps qu'il peut la campagne donc, quand je l'ai vu dans son atelier, c'est qu'il tait oblig d'y rester, parce que ce n'tait pas encore le printemps ; donc, c'tait avant le printemps. Et, ensuite : Quel jour ai-je pu aller le voir ? Un dimanche, car je suis assez occup les autres jours. Un dimanche avant Pques, puisque c'tait avant le printemps, par exemple le jour des Rameaux. Et alors, le souvenir des branches de buis surgit, nullement par hasard, mais la suite d'une srie de penses assez logiquement enchanes. Paris le jour des Rameaux, et le printemps, sont, pour un Parisien, et pour un observateur aussi sensible que l'tait Taine aux aspects changeants de la campagne, et en mme temps aussi intress par le spectacle des foules urbaines, des notions qui, familires parmi les autres, doivent ressortir et fixer l'attention. D'aprs M. Ribot, reconnatre un souvenir, c'est le situer entre des points de repre. J'entends, dit-il, par point de repre un vnement, un tat de conscience dont nous connaissons bien la position dans le temps, c'est--dire l'loignement par rapport au moment actuel, et qui nous sert mesurer les autres loignements. Ces points de repre sont des tats de conscience qui, par leur intensit, luttent mieux que d'autres contre l'oubli, ou par leur complexit, sont de nature susciter beaucoup de rapports, augmenter les chances de reviviscence. Ils ne sont pas choisis arbitrairement, ils s'imposent nous 2. Il faut donc que ces tats de conscience se dtachent sur la masse des autres de faon relativement durable : comment n'admettrait-on pas, ds lors, que leur ensemble constitue comme un systme de rapports stables, et qu'on passe de l'un l'autre non point par hasard, mais par une opration plus ou moins logique, et qui ressemble un raisonnement ? Sans doute ils ont une valeur toute relative, Ils sont tels pour une heure, tels pour un jour, pour une semaine, pour un mois ; puis, mis hors d'usage, ils tombent dans l'oubli . Il reste savoir quoi et
1 2
Intelligence, t. II, livre I, chap. II, 6. Op. cit., p. 37.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
95
pour qui ils sont relatifs, et s'ils tirent toute leur importance des jugements subjectifs que nous pourrions porter sur eux. M. Ribot dit, ce sujet : Ils ont en gnral un caractre purement individuel ; quelques-uns, cependant, sont communs une famille, une petite socit, une nation. Mais, lorsqu'il cherche donner une ide de ces points de repre individuels , il distingue diverses sries rpondant peu prs aux divers vnements dont notre vie se compose : occupations journalires, vnements de famille, occupations professionnelles, recherches scientifiques, etc. . C'est dire que ces vnements dfinissent notre situation, non seulement pour nous, mais pour les autres, dans divers groupes. C'est en tant que membres de ces groupes, que nous nous reprsentons nous-mme, et la plupart des points de repre auxquels nous nous reportons ne sont que les vnements saillants de leur vie. Sans doute il faut tenir compte du retentissement que ces faits ont eu en chacun de nous. Un mariage ou un deuil, un succs ou un chec un examen, dterminent, dans notre conscience individuelle, des sentiments plus ou moins forts. Et il arrive mme que des vnements tout intrieurs passent au premier plan de notre mmoire, et restent nos yeux les signes brillants ou obscurs qui marquent les lignes de division essentielles et les tournants dcisifs de notre existence. En ce sens, il y aurait autant de sries de points de repre que d'individus, au moins considrer ceux qui sont capables de penser et de sentir par eux-mmes. Mais, mme alors, pour retrouver ces tats de conscience, il faut y rflchir, y avoir rflchi souvent, et il n'est point possible qu'on ne les ait pas rattachs alors aux divisions fondamentales qui valent pour les autres aussi. Lorsque Pascal parle de ses conversions, il en indique trs exactement la date, et il rappelle l'endroit o elles ont eu lieu (le pont de Neuilly, etc.). C'est souvent moins en raison de son aspect sentimental que de ses consquences extrieures, qu'un vnement de ce genre se grave dans notre pense. En effet, il a t le signal, par exemple, d'une transformation profonde de notre caractre : mais, de cela, nos amis, les autres hommes sont avertis par le changement de notre conduite : pour eux aussi, c'est une date dans l'histoire de leurs rapports avec nous : le jugement qu'ils portent cet gard ragit sur notre souvenir et lui communique une fixit et en quelque sorte une objectivit qu'il n'aurait pas sans lui. D'une manire gnrale, un vnement interne de ce genre ne devient un point de repre pour nous que dans la mesure o nous le mettons en rapport avec des poques ou des lieux qui sont des points de repre pour le groupe. Voici un exemple de localisation o il nous a sembl que des souvenirs affectifs, qui semblaient jouer le premier rle, n'taient en ralit retrouvs et ne reprenaient toute leur valeur qu'au cours d'une srie de rflexions qui s'appuyaient sur des points de repre collectifs (dans l'espace ou dans le temps). Je suis Strasbourg, et dois partir prochainement pour Paris o je fais partie d'un jury d'examen. Je cherche me rappeler en quel endroit l'anne dernire, pareille poque, j'avais habit, pendant les mmes examens. tais-je descendu seul dans le quartier des Gobelins, o est l'appartement de ma mre, ou avec ma femme et mes enfants chez mes beaux-parents, qui demeurent prs de la rue de Rennes ? Un souvenir surgit : je me vois djeunant un matin de cette priode, dans un caf des environs de la gare Montparnasse. C'est au cur de l't ; mais, cette heure matinale, un souffle frais agite la tente du caf, et donne l'illusion que la mer est proche. Sous le ciel o ne flotte aucun nuage, les devantures des magasins, un tas de pavs, des fruits dans des petites voitures ont les mmes tons que dans telle ville du Midi ou de l'Algrie. La rue s'anime peu peu, les gens vont leur travail sans hte, comme pour jouir plus longtemps de cette fracheur et de cette lumire. Le cur se dilate,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
96
l'esprit est alerte. C'est un des rares moments, dans cette priode de surmenage et de proccupation, o je me sois senti tout fait dispos. Est-ce en raison de son caractre affectif trs marqu que ce souvenir s'est grav en moi ? En tout cas, c'est un point de repre individuel, qui me permet de dire qu' ce moment j'habitais chez mes beauxparents (prs de la rue de Rennes) et que j'y habitais seul, puisque tout le monde, y compris la bonne, tant parti, je ne pouvais djeuner la maison. Ma femme me rappelle, en effet, que A... tant fatigu, toute la famille est partie avec lui pour la Bretagne, tandis que je restais Paris jusqu' ce que le concours ft termin. Mais, avant leur dpart, o habitais-je ? Un autre souvenir, affectif galement, nouveau point de repre individuel, se prsente mon esprit. Un soir, je suis arriv chez mes beaux-parents aprs dner. J'tais fatigu et surtout proccup par la sant de A... J'ai essay de le distraire, puis je me suis accoud sur le balcon. Les grandes maisons modernes qu'on a leves dans notre quartier dressaient leurs masses sombres, et produisaient sur moi un effet d'oppression. Du 5e tage, je plongeais sur la rue troite comme sur un gouffre de silence et d'ennui. En face de moi une fentre ouverte laissait voir, dans une salle manger brillamment claire, un vieux monsieur physionomie maussade qui lisait un journal, seul en face de la table demi desservie. Tout ce que je voyais s'accordait avec la disposition triste o je me trouvais. En tout cas, je me rappelle bien maintenant, que, dans cette priode, je prenais mes repas chez ma mre, qui n'tait pas encore partie, et revenais chaque soir chez mes beauxparents o je restais jusqu'au lendemain matin. Mais est-ce rellement ainsi que mes penses se sont associes ? Est-ce parce que, de cette priode, me sont rests deux souvenirs, l'un joyeux, l'autre triste, particulirement vifs, que j'ai pu localiser dans l'espace les deux priodes de ce sjour Paris, coupes par le dpart de toute ma famille ? Je ne le crois pas. Car, avant d'voquer le souvenir de ce djeuner du matin prs de la gare Montparnasse, je me demandais si j'habitais alors chez mes beaux-parents, prs de la rue de Rennes. N'estce pas la rue de Rennes, et l'image de ce quartier, qui m'a rappel la gare Montparnasse et cette terrasse de caf ? N'ai-je pas rflchi plutt, ou en mme temps, la chaleur qu'il devait faire alors, au sentiment de soulagement que devait m'apporter l'approche de la fin de ces examens, et la pense que je me retrouverais bientt au bord de la mer, au milieu des miens. C'est peut-tre tout cet ensemble de penses que j'ai retrouv par une opration purement logique, qui m'a permis d'voquer ce souvenir affectif, et non l'inverse. De mme, quand je me demandais o j'habitais dans la premire priode, j'envisageais deux hypothses : que j'aie habit chez ma mre, et pris mes repas chez mes beaux-parents, ou l'inverse. Dans le second cas, je devais arriver, le soir, chez mes beaux-parents. Je devais y retrouver A.... et je me rappelais qu'il tait malade. Je me reprsentais la salle manger, la fentre ouverte, le balcon. Cette srie de reprsentations familires tait bien le cadre dans lequel s'voquait naturellement le souvenir de cette soire o je m'tais senti particulirement triste. Ici encore, c'est la suite d'une srie de raisonnements que j'arrivais reconstituer un tat affectif dont toute la substance tait faite, en ralit, de ses rapports avec ces autres circonstances. Il est d'ailleurs probable que j'ai plusieurs fois pens, depuis, tout cela, et que si, parmi tant de souvenirs prcis possibles de cette priode, ces deux-l seulement se dtachent avec tant de force, c'est que, par la rflexion, ils ont t rattachs mieux que tous les autres aux conditions gnrales o je me trouvais alors : c'est pourquoi il m'a suffi de me rappeler ces conditions pour les retrouver. Et, inversement, comme ils se trouvaient l'un et l'autre au point de croisement de ces sries de rflexions, ils m'ont aid les prciser. Mais je ne les aurais pas voqus eux-mmes, si je n'avais point possd les cadres qui ont assur leur survivance.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
97
* ** Si l'on hsite expliquer ainsi la localisation des souvenirs, et plus gnralement la mmoire, c'est que ces cadres paraissent trop transparents, trop schmatiques, et les notions qu'ils rattachent trop peu nombreuses, pour qu'ils nous permettent de serrer d'assez prs tout le dtail de notre pass. Comment retrouver l'emplacement d'un village sur une carte de gographie o ne sont indiques que les trs grandes villes ? Et comment deux grandes villes assez loignes, par exemple Paris et Lyon, nous rappelleront-elles un village plutt qu'un autre parmi tous ceux qui les sparent ? De mme, entre deux points de repre dans le temps, comment localiserons-nous tel vnement, moins que nous n'voquions au hasard une quantit d'autres vnements jusqu' ce que nous tombions sur l'un d'entre eux qui soit presque en contigut avec le premier ? Il en serait ainsi, si nous entendions par cadre un systme en quelque sorte statique de dates et de lieux, que nous nous reprsenterions dans son ensemble chaque fois que nous songeons localiser ou retrouver un fait. Mme en admettant que la mmoire puisse se dilater extraordinairement, le nombre des points de repre n'en serait pas moins limit, sans rapport avec ce qu'il devrait tre pour que nous puissions y dterminer immdiatement le lieu et la date d'un vnement pass. M. Bergson s'en est rendu compte, puisqu'il admet que c'est la totalit ou la presque totalit des vnements de notre vie que la mmoire fait dfiler devant nous, quand nous recherchons l'un d'entre eux, ou sa date. Mais il n'est peut-tre pas ncessaire d'aller jusque-l. Par cadre de la mmoire nous entendons, non pas seulement l'ensemble des notions qu' chaque moment nous pouvons apercevoir, parce qu'elles se trouvent plus ou moins dans le champ de notre conscience, mais toutes celles o l'on parvient en partant de celles-ci, par une opration de l'esprit analogue au simple raisonnement. Or, suivant qu'il s'agit de la priode la plus rcente que nous venons de traverser, ou d'un temps plus loign, le nombre de faits qu'on peut retrouver de cette manire varie beaucoup. Il y a, en d'autres termes, des cadres dont les mailles sont plus ou moins serres, suivant qu'on s'approche ou qu'on s'loigne de l'poque actuelle. La mmoire, en effet, retient avec une trange prcision les vnements les plus rcents, ceux qui se sont passs ce matin, hier, avant-hier : je puis en retrouver tous les dtails et les circonstances ; je suis en mesure de reconstituer heure par heure, presque minute par minute, la suite de mes actes, de mes penses et de mes impressions, lorsqu'il s'agit d'un jour trs rapproch. Mais, quelques jours de distance, il n'en est plus ainsi il y a bien des lacunes dans mes souvenirs, et des confusions quelquefois, tout semble avoir disparu, ou, plutt, les journes, les semaines ne se diffrencient pas : quelques faits dominants, quelques figures caractristiques se dtachent seuls sur ce fond gris effac, intervalles plus ou moins loigns ; si je me rappelle une suite d'vnements, c'est sous une forme abrge, sans qu'il me soit possible de repasser par tous les termes qui les constituaient ou qui les sparaient comme je l'aurais pu si je me les tais rappels ds le lendemain.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
98
Dira-t-on que la perception actuelle n'est que le dernier terme de la srie chronologique des images les plus rcentes, et qu'il est possible, par consquent, de remonter, par un mouvement continu de pense, du prsent cette partie du pass qui en est le plus proche, de mme que le tlgraphiste peut relire immdiatement la partie de la bande o est inscrite la suite des traits qui prcdent, tandis que d'autres continuent s'inscrire ? Mais pourquoi s'arrterait-on en tel endroit plutt qu'en un autre, et pourquoi le ruban semble-t-il se dchirer un certain moment ? Si toutes les images subsistaient dans la mmoire, disposes l'une aprs l'autre dans l'ordre o elles se sont produites, il n'y aurait pas de raison pour qu'on ne puisse passer indfiniment, en revenant en arrire, de l'une l'autre. Si on n'y russit pas, c'est que cette comparaison n'est pas exacte, c'est que la possibilit d'voquer ainsi, en son dtail, tout le pass rcent, et celui-l seul, s'explique autrement que par la simple subsistance des souvenirs. Mais plaons-nous un autre point de vue. Les cadres dont nous parlons, et qui nous permettraient de reconstruire nos souvenirs aprs qu'ils ont disparu, ne sont pas, nous l'avons dit, purement individuels : ils sont communs aux hommes d'un mme groupe. Si donc ils s'tendent tous les vnements rcents, s'ils les comprennent tous, si bien qu'on peut prendre indiffremment l'un de ceux-ci, n'importe lequel, comme point de repre, si tous se trouvent sur le mme plan, c'est que le groupe dans son ensemble les retient tous, c'est que les faits les plus rcents prsentent tous, pour lui, une importance peu prs quivalente. On en aperoit bien les raisons. D'abord, comme les groupes n'ont, dans l'espace, qu'une stabilit relative, comme sans cesse certains de leurs membres s'loignent d'eux, un fait qui concerne un individu n'intresse le groupe que pendant un certain temps, tant que les individus sont rapprochs, et que l'acte ou l'tat de l'un ragit ou peut ragir sur la manire d'tre et les dmarches des autres. Les transformations du groupe ne rsultent d'ailleurs pas seulement de ce qu'il se spare de tels ou tels de ses membres : mais le rle et la situation des individus changent sans cesse dans une mme socit. Qu'un fait se produise, qui dtermine un branlement notable dans l'tat perceptif ou affectif de l'un d'eux. Tant que les consquences matrielles ou les rpercussions psychiques de ce fait se font sentir dans le groupe, celui-ci le retient, le met en bonne place dans l'ensemble de ses reprsentations. Du moment o l'vnement considr, a en quelque sorte puis son effet social, le groupe s'en dsintresse, alors mme que l'individu en ressent encore le contre-coup. Un deuil, tant qu'il est rcent, n'est en ce sens un fait social qu'aussi longtemps que d'autres proccupations plus importantes ne rclament point l'attention du groupe. Lorsque le deuil est ancien, il ne compte plus que pour l'individu qui en a t affect: il sort de la conscience immdiate de la socit. Mais il en est de mme de faits beaucoup moins importants. Je viens de faire un voyage, et je me rappelle avec une grande prcision les visages et les propos des personnes qui taient avec moi en chemin de fer, et tous les incidents du trajet. Dans quelques jours, la plupart de ces souvenirs rejoindront dans l'oubli tous ceux qui les ont prcds, et qui n'taient pas moins insignifiants. S'ils me demeurent ainsi prsents pendant une courte dure, c'est que mes compagnons et moi formions une petite socit, qui a survcu notre sparation jusqu'au moment o chacun de nous s'est confondu dans d'autres groupes, et mme un peu au del: nous pouvions nous rencontrer, ou retrouver des amis communs, dans la ville o nous avons dbarqu ; nous nous sommes observs, nous avons chang (les paroles : nos actes et notre conduite, dans les jours qui suivent, ont pu en tre modifis ; eux, comme nous, avons donc (les raisons positives de nous intresser encore quelque temps les uns aux autres. Qu'on songe, ce propos, la multitude de faits individuels qu'enregistrent chaque jour les journaux, et qui seront si vite et si compltement oublis : pendant un jour, 'pendant quelques heures, ils n'en
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
99
auront pas moins t dans l'esprit de tous les membres du groupe, c'est--dire dans la conscience sociale, au premier plan, au mme titre que des vnements beaucoup plus graves, tels qu'une guerre, une crise politique, une dcouverte qui transforme les murs, etc., mais qui sont beaucoup plus anciens. Il y a, comme disait Ruskin, des. livres qu'il est bon de lire une heure dtermine, parce qu'ils perdent trs vite leur intrt, et d'autres qu'on peut relire tout le temps, et toute heure : books for the hour, and books for all time. Remarquons que l'on n'apportera pas moins d'attention et de curiosit parcourir un journal qu' se plonger dans la lecture d'un livre d'histoire : c'est que, sur le moment, et pour une trs courte priode, les vnements rapports dans l'un et dans l'autre peuvent aussi bien conditionner nos actes, altrer notre condition, et qu'il importe donc au mme degr de les connatre. Dans le cas des faits rcents, d'ailleurs, la socit n'a pas assez de perspective pour les classer par ordre d'importance : elle les accueille donc et les retient tous, et ne peut ds lors les ranger que suivant l'ordre o ils se sont produits. Ainsi, si l'individu retient si fidlement toute la suite et le dtail des vnements qui remplissent les derniers jours, les dernires heures qu'il vient de vivre, ce n'est point parce que les images correspondantes n'ont pas encore eu le temps de s'loigner de la conscience, et de passer dans cette rgion de l'esprit o se conserveraient, l'tat inconscient, et hors de la prise directe de notre volont, tous les souvenirs antrieurs, c'est, plutt, parce que tous ces vnements sont rattachs par des rapports logiques, c'est que nous pouvons passer de l'un l'autre par une srie de raisonnements, comme toutes les fois qu'il s'agit de faits qui intressent l'ensemble de notre groupe. Nous sommes tellement habitus opposer les faits sensibles et les oprations intellectuelles que nous n'apercevons pas tout (le suite dans quel ensemble de remarques, rapprochements, classifications, prvisions et vues gnrales, est prise et en quelque sorte dcoupe toute perception. Au fur et mesure que de nouveaux objets se dcouvrent, et que nous passons de l'un l'autre, nous poursuivons, leur occasion, tout un travail d'interprtation. Au cours de nos rflexions, nous tablissons ainsi une quantit de liens extrieurs entre nos impressions, et, c'est ce qui explique que, sans que les impressions se reproduisent, nous pouvons repasser mentalement sur les traces relativement durables qu'elles ont laisses dans notre esprit,. Mais comment se fait-il que nous ne retrouvions pas aussi facilement les rflexions dont les impressions plus anciennes ont t l'objet, puisque, par hypothse, toutes nos impressions nous avons ainsi substitu une srie de schmas ou de dcalques intellectuels ? Il semble que nous nous retrouvions en prsence de la mme difficult que tout l'heure, et que nous n'ayons rien gagn remplacer les images par le cadre de nos rflexions. Pourquoi ce cadre semble-t-il s'interrompre, une certaine distance du prsent, lorsqu'on remonte dans le pass ? J'habite en un point dtermin d'une ville. Chaque jour mes promenades me conduisent en un quartier diffrent, plus ou moins loign : je parcours ainsi toutes les parties de la ville, et je peux maintenant me diriger o je veux. Pourquoi, cependant, ne puis-je me reprsenter d'une faon continue l'aspect des rues, des maisons, toutes les particularits des boutiques, des faades, etc., que jusqu' une certaine limite, d'ailleurs flottante ? Pourquoi, tandis que, jusque l, je pouvais me guider d'aprs ces images successives, faut-il qu'au del je m'oriente par rapport des points de repre plus discontinus, qui, pour une raison ou l'autre, ressortent sur la masse indistincte des autres images inaperues ? C'est que j'ai travers bien souvent, et dans tous les sens, la rgion qui avoisine ma maison ; c'est que, par une srie de rflexions, j'ai rattach ces images familires les unes aux autres de beaucoup de manires, si bien que je puis les reconstruire mentalement de beaucoup de manires aussi et
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
100
partir de beaucoup d'autres. Plaons-nous prsent dans le temps : il semble que le cas soit trs diffrent, et peut-tre inverse. Les vnements les plus rapprochs ont eu sans doute beaucoup moins d'occasions de se reproduire, ma pense a d se reporter sur eux beaucoup moins souvent que sur les vnements anciens. Pourtant, de mme que les images des maisons voisines de ma demeure, ils me sont beaucoup plus familiers je les revois en pense, quand je veux, dans tout leur dtail je peux reproduire la srie continue des faits d'hier, comme la suite ininterrompue des maisons, faades et boutiques de ma rue. Au contraire, pour retrouver les vnements plus anciens auxquels j'ai eu beaucoup plus d'occasions de penser, il faut que je me reporte des points de repre dans le temps qui se dtachent sur la masse inaperue des autres vnements. On dira que nous confondons ici la vivacit des images et leur familiarit. Quand je reproduis mentalement l'image de la rue o je passe le plus souvent, je substitue aux objets un schma o toutes les particularits qui m'intressent sont comprises, mais qui n'est pas du tout l'quivalent de la sensation ne en moi la premire fois que je les ai aperus. Ce schma est incolore et sans vie : au contraire, l'image de tel monument que je n'ai vu qu'une fois reparat avec sa fracheur initiale, et quivaut la sensation. La notion de la rue voisine est plus familire, mais c'est une notion. L'image du monument loign l'est moins, mais c'est une image vivante. S'agit-il, maintenant, d'vnements plus ou moins loigns dans le temps : les plus rapprochs n'ont pas eu l'occasion d'tre souvent voqus, et c'est pourquoi, lorsque nous y repensons, ils frappent plus vivement notre imagination. Mais ils ne sont point familiers, comme le sont des souvenirs plus anciens: ceux-ci ont t voqus plusieurs fois dans la mmoire : chaque fois, ils ont perdu une partie de leur contenu original : ils sont moins vifs, mais plus clairs, plus maniables : ils sont plus familiers. Dans les deux cas on retrouverait les mmes conditions et les mmes lois. Il ne nous semble pas, cependant, qu'un vnement ou qu'une figure laisse dans notre mmoire une image plus vive, et qui la reproduise plus exactement, quand on ne l'a vu qu'une fois, que lorsqu'on l'a revu plusieurs fois ou qu'on y a souvent repens. Il se peut que, comme le cadre qui permettrait de la reconstruire (cadre de rflexions, de dterminations objectives) est plus rduit, l'image reconstruite paraisse elle-mme plus riche, mais riche de virtualits, plutt que de contenu rel : c'est une image qu'il dpend de nous d'idaliser, parce qu'elle n'a vritablement que peu de matire ; nous pouvons projeter sur elle, faire entrer dans son cadre une foule de qualits et de dtails emprunts nos sensations ou nos autres images, et mme lui prter des traits contradictoires : elle n'en aura pas plus de ralit. D'autre part il n'est pas exact que les images soient moins vives lorsqu'elles ont t reproduites plus souvent, et qu'elles perdent en contenu ce qu'elles gagnent en prcision. Sans doute, lorsque nous nous retrouvons plusieurs fois, et frquemment, en prsence du mme objet, il arrive que nous le considrions avec moins d'attention ; notre curiosit est mousse. Mais il ne s'ensuit pas que, lorsque nous y pensons, nous soyons moins capables de le reproduire en tous ses dtails, et d'en voquer une image quivalente l'objet lui-mme. Autant dire qu'un peintre, qui a longuement contempl chaque partie du tableau qu'il compose, en a une vision moins colore et plus incomplte que telle personne qui ne l'a regard que quelques secondes. De ce que nous avons vu trs rapidement il ne nous reste, au contraire, que fort peu de chose 1. On dit qu'une
1
BUTLER, contrairement M. Bergson, pense que bien que nous nous figurions que nous nous souvenons de presque tous les dtails d'une impression soudaine, en ralit nous nous en rappelons beaucoup moins [au sens de : nous nous rappelons beaucoup moins de dtails de cette impression] que nous ne croyons. Et il insiste sur la pauvret de dtails avec laquelle on s'en souvient. A
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
101
impression nouvelle, soudaine, et qui ne se reproduit pas, laisse un souvenir plus vif et dtaill, parce qu'elle correspond un fait unique. Mais est-ce parce qu'elle est unique, n'est-ce pas plutt parce qu'elle nous a intress et qu'elle a provoqu en nous, sous forme au moins naissante, une quantit de rflexions que nous la retenons ? Lorsque nous nous trouvons pour la premire fois dans une ville, nous examinons avec une attention aiguise par la curiosit les maisons, les monuments, etc. Nous en gardons un souvenir plus vif que si nous y tions demeures longtemps sans regarder d'un peu prs ce qui nous entoure. Mais ici une contemplation prolonge, avec toutes les rflexions qui l'accompagnent, quivaut certainement une perception renouvele : ce n'est pas une impression unique, un vnement qui n'a occup qu'un instant. Enfin, si l'on dfinit la familiarit du souvenir par la facult que nous aurions de le reproduire volont, comment contester que les vnements les plus rcents se prsentent notre esprit avec un tel caractre ? Les souvenirs qui leur correspondent sont donc la fois plus vifs et plus familiers. Nous devons insister sur ce dernier point, et revenir la question que nous avons pose. Comment se peut-il que les souvenirs rcents soient plus familiers, s'ils reproduisent les vnements qui n'ont eu lieu qu'une fois, et auxquels il semble que nous ayons moins eu l'occasion de repenser qu'aux vnements anciens ? En effet, les vnements rcents ne se sont pas reproduits : mais il en est de mme des vnements anciens. Reste savoir si on n'y a point repens, et si on n'y a point repens plutt et plus souvent qu' ceux-ci. Mais il y a tout lieu de croire que, sans voquer nouveau les souvenirs rcents eux-mmes, on est revenu plusieurs fois tout au moins sur certaines rflexions qui les ont accompagns. Chaque fois que nous replaons une de nos impressions dans le cadre de nos ides actuelles, le cadre transforme l'impression, mais l'impression, son tour, modifie le cadre. C'est un moment nouveau, c'est un lieu nouveau, qui s'ajoute notre temps, notre espace, c'est un aspect nouveau de notre groupe, qui nous le fait voir sous un autre jour. D'o un travail de radaptation perptuel, qui nous oblige, l'occasion de chaque vnement, revenir sur l'ensemble de notions labores l'occasion des vnements antrieurs. S'il s'agissait de passer simplement d'un fait antcdent un fait consquent, nous pourrions tre perptuellement dans le moment prsent, et en lui seul. Mais il faut en ralit passer sans cesse d'un cadre un autre, qui diffre sang doute trs peu du prcdent, mais qui en diffre : c'est pourquoi nous devons sans cesse nous reprsenter nouveau presque tous les lments de ce cadre, puisque tout changement, si lger soit-il, modifie les rapports de l'lment transform avec tous les autres. C'est ainsi qu' l'occasion d'une visite, d'une promenade, d'une lecture que je fais aujourd'hui, je repense ce matin, hier, pour fixer leur place dans le temps ; je repense d'autres endroits o j'ai t ces derniers jours, pour situer par rapport eux ceux o je me rends, ou bien o je demeure, aujourd'hui ; et je me reprsente les amis que j'ai vus, les gens que j'ai rencontrs dans les rues, et les questions qui intressent des groupes plus ou moins tendus, dont nous avons parl, dont j'ai su ou vu qu'on s'occupait, ces derniers temps, pour me faire une ide plus prcise de la porte actuelle des propos que nous allons tenir, de l'article ou du livre que j'ai sous les yeux. De ces souvenirs rcents, je sais qu'ils tiennent beaucoup d'autres de la mme priode, et je sais aussi que ceux-l me permettraient de retrouver ceux-ci, de mme que, lorsqu'on repasse rapidement les principaux termes d'un raisonnement mathmatique un peu long, on sait qu' partir de chacun d'eux on
moins qu'il ne s'agisse d'une impression qui nous touche , par les rflexions qu'elle provoque en nous, et d'une impression simple, qui n'enferme que peu de dtails secondaires. Ibid., pp. 148-149.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
102
en reconstituerait encore beaucoup d'autres qui sont compris dans le mme enchanement d'ides. Ainsi s'explique que notre pense repasse sans cesse sur les vnements de la priode la plus rcente, que nous ayons du moins le sentiment qu'elle s'en approche chaque instant, et qu'il dpendrait d'elle de les reproduire. Ainsi s'explique que les vnements les plus rcents soient aussi, en ce sens, les plus familiers. Si les images rapproches dans le temps se tiennent ce point, il en est de mme de celles qui, dans l'espace, autour de nous, forment une srie continue. Ce n'est point parce que la proximit dans le temps ou l'espace agirait la manire d'une force d'attraction, c'est plutt qu'en gnral elle exprime une solidarit plus troite. Les hommes et les objets que nous avons vus le plus rcemment, ceux qui nous entourent, qui vivent et se trouvent dans nos environs immdiats, forment avec nous une socit au moins temporaire. Ils agissent ou peuvent agir sur nous, et nous sur eux. Ils font partie de nos proccupations quotidiennes. C'est pourquoi nous nous souvenons si bien du pass le plus rcent, malgr les ruptures d'quilibre inattendues et les brusques changements d'orientation qui interrompent la continuit de la vie sociale. Au lendemain d'un deuil dans une famille, d'une dclaration de guerre dans une nation, le champ de nos penses et de nos rflexions sans doute se dplace, mais nous n'en demeurons pas moins capables d'voquer les images des jours prcdents et de remonter de l'une l'autre d'une faon continue. Quelle que soit la gravit de la crise que traverse une socit, les hommes continuent se rencontrer, s'entretenir, les familles ne sont pas tout coup dissoutes. La destruction et la dispersion d'une socit n'empche pas ses membres de se comporter comme s'ils en faisaient encore partie, tant que dure l'impulsion dernire qu'ils en ont reue : or l'impulsion dernire, c'est la plus rcente. Pour qu'il en ft autrement, il faudrait que la socit dispart un jour, pour reparatre le lendemain sous une autre forme, qu'un de ses membres mourt un genre de vie sociale pour renatre un autre. Ainsi s'explique que les derniers souvenirs qui disparaissent, ceux qui, chaque moment, forment la trame la plus solide de notre pense, sont ceux qui, peut-tre, distance, nous paratront le plus insignifiants, mais qui ne l'taient pas, alors que nous nous en trouvions le plus prs. Si les souvenirs les plus rcents demeurent quelque temps dans l'esprit, si la mmoire ne choisit pas entre eux, ils ne nous intressent cependant pas tous pour les mmes raisons. Il y en a qui ne se rattachent en rien, apparemment au moins, au cours actuel de nos penses : par exemple, le costume et la physionomie de gens que je ne connais pas et que je croise par hasard, la visite d'un tranger, une suite de propos sur des sujets qui ne me concernent pas, et que je perois au passage, dans la rue, dans un bureau, ou que j'coute distraitement, dans un salon. D'autres rpondent des proccupations latentes, besoins ou curiosits qui ne se rveillent que par instants, et ne sont pas au premier plan de ma conscience : par exemple, je remarque, un talage, des fruits, ou des denres quelconques, et je me promets de repasser l un autre jour pour en acheter. Un spectacle comique retient mon regard, un gros cheval attel ct d'un petit ne, une enseigne baroque, un dguisement bouffon : je me dis que je le dcrirai mes enfants pour qu'ils s'en amusent. Je reois une lettre o l'on m'engage faire partie d'une socit que je ne connaissais pas : il s'agit d'une uvre sociale, d'une organisation politique, ou scientifique : je ne suis pas encore dispos y adhrer, mais ce genre d'activit m'intresse, je me souviendrai de ce que j'ai lu, pour y rflchir quand j'en aurai le temps. Enfin, au milieu de ces faits insignifiants ou secondaires dans le tableau de ces dernires journes, nous en retenons d'autres qui comptent pour nous bien plus que tous ceux l : par exemple, j'ai reu des nouvelles
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
103
de ma famille, ou d'amis dont la vie est troitement mle la mienne; ou bien j'ai fait une dmarche prpare depuis longtemps, obtenu un rsultat longtemps attendu, ressenti tel chagrin, etc. Entra ces diverses catgories de faits on croirait volontiers qu'il n'y a pas de commune mesure. Cependant il arrive que les moins importants nous fassent oublier les autres, et nous en distraient momentanment : par exemple on sort d'une chambre de malade, on est triste ou dsespr, et cependant l'animation de la rue, la proccupation de ne point nous faire craser, les nouvelles que les journaux portent en manchette, se gravent dans notre mmoire ct des images pnibles qui nous obsdent, et presque sur le mme plan. Cette lgret apparente cache une conviction bien fonde : c'est qu'aucun des faits qui se produisent autour de nous ne peut nous tre indiffrent, tant que nous ne savons pas quelles en sont les consquences pour nous. Celles-ci, sans doute, se font voir assez vite, et il ne nous faut pas beaucoup de temps pour tre fixs : le plus souvent nous constatons au bout de quelques heures, d'un ou deux jours, que nous n'avions rien en attendre. Mais, au moment o les faits se produisent, ou viennent de se produire, tout est possible, et nous pouvons nous attendre tout. Ainsi, lorsqu'une assemble parlementaire se runit pour la premire fois, tout ce qui occupe les premires sances, toutes les questions discutes, toutes les paroles prononces ont de l'importance, et tous les dputs aussi, chacun pris part, veillent la curiosit : car on ne sait encore ni quelles questions passeront au premier plan, ni quels membres se distingueront de la masse par leur sens politique, leur loquence, ou simplement par leur originalit. De fait, les exemples que nous avons numrs changent quelquefois de case : je peux apprendre par hasard, au cours d'une conversation banale avec des inconnus, des faits de nature modifier mes projets les plus anciens, transformer mes sentiments les plus profonds ; un commerant, un spculateur trouvera, en regardant les talages, une ide qui l'enrichira, un artiste, un crivain, de ce qui amuse ou meut un moment le passant, tirera les lments d'une tude, d'un tableau, d'une caricature, d'une nouvelle. Ainsi se brise et se renoue sans cesse le cours de nos intrts. De l'impression que laisse en nous le pass immdiat on trouverait une image assez exacte dans ces romans o l'auteur note et dcrit minutieusement toutes nos rflexions au cours d'une soire mondaine, ou au cours d'vnements qui s'espacent sur quelques jours, si bien que, les faits principaux sont noys et submergs sous une foule de penses accessoires et parasitaires, et qu'on perd chaque instant le fil de l'histoire principale, en admettant qu'il y en ait une. Si l'ensemble des souvenirs rcents, ou plutt des penses qui s'y rapportent, forme un cadre qui perptuellement se dfait et se refait, c'est qu' mesure que nous remontons plus loin dans ce pass immdiat, nous nous rapprochons de la limite au del de laquelle nos rflexions, au lieu de nous ramener au prsent, nous en cartent, et cessent de se rattacher troitement nos proccupations actuelles. De tels faits remarqus il y a quelques jours, ou bien j'ai tir tout le parti qu'il me convenait, ou bien je suis convaincu maintenant que je n'ai rien en tirer. Mais cet effacement progressif ne se produit pas galement et la mme distance dans toutes les directions. La proximit dans le temps, nous l'avons dit, n'intervient ici qu'en tant qu'elle exprime l'unit d'une priode ou d'une situation de la socit. Mais nous faisons partie, simultanment, de plusieurs groupes, et il faut dire qu'en gnral plus ils nous tiennent troitement, plus nous sommes capables, comme s'il s'agissait de souvenirs trs rcents, de remonter d'un mouvement continu dans leur pass, jusqu'assez loin. Le cadre dont nous avons parl jusqu'ici, outre ses transformations perptuelles qui tiennent ce que le prsent se dplace, doit donc s'adapter de faon durable ces cadres plus troits mais plus allongs, de mme que dans la communaut trs large et trs changeante que constituent autour de nous tous ceux que nous rencontrons ou
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
104
pouvons rencontrer sont engags des groupes plus restreints et plus stables, amis, compagnons de travail, hommes de mme croyance, membres d'une mme classe, habitants d'un mme village, famille large, famille troite, sans oublier la socit originale que chaque individu forme en quelque sorte avec lui-mme. Dans les villes, les hommes qui se croisent s'ignorent le plus souvent. La masse des tres qui circule dans les rues de nos grandes cits reprsente une socit qui s'est dsintgre et un peu mcanise . Les images de la rue glissent sur nous sans laisser de traces bien durables, et il en est de mme de la plupart des impressions ou souvenirs qui ne se rattachent point la partie de notre vie sociale la plus importante. Celle-ci suppose l'existence de groupes continus avec lesquels nous avons fait ou faisons corps, soit que nous les traversions intervalles plus ou moins loigns, soit que nous ne cessions pas d'y adhrer. Nous retrouvons le pass de ces groupes, les vnements et les personnes qui les dfinissent pour nous, parce qu'il semble que notre pense oriente de faon constante une de ses faces de leur ct. Qu'on songe une maison, construite au milieu d'un parc : aux environs immdiats, des alles se sparent, se rejoignent, serpentent et s'entrecroisent et ramnent toutes peu prs au mme endroit : ainsi la plupart de nos rflexions sur les vnements les plus rcents ne s'cartent gure du prsent, et ne nous conduisent pas bien loin ; mais supposons que la maison soit au point de dpart ou sur le passage de plusieurs routes (lui conduisent d'un bourg un autre, d'une ville une autre ville : ces grands chemins traversent le rseau des alles, sans (lue leur direction s'inflchisse : si nous les suivons, ils nous conduiront toujours plus loin ; et on peut imaginer aussi qu'autour de la maison des claircies nous permettent d'apercevoir entre les arbres, au del du pare, et mme au del d'autres parcs, de bois, de collines, une partie de ces routes, ou d'autres que nous avons suivies quelque temps, et qui font partie du mme ensemble. C'est ainsi que la srie de nos souvenirs de famille, l'histoire de nos relations anciennes et rcentes avec tel ou tel de nos amis d' prsent, les groupes d'images successives qui dessinent les grandes lignes de notre activit continue et les courants de notre vie motive ou passionnelle, traversent la couche superficielle des souvenirs rcents, et nous conduisent par une voie directe, c'est--dire par une suite de rflexions qui, dans la masse des autres, forment un systme mieux li et en quelque sorte plus rigide, dans des rgions plus loignes du pass. Quand nous disons, d'ailleurs, que ces voies sont directes, nous entendons qu'elles traversent les pays, valles et montagnes, sans s'y garer, sans en faire le tour, sans en suivre toutes les sinuosits, ni envelopper dans leurs replis tout ce qui mriterait d'tre vu : tendues d'un point un autre, elles nous transportent en quelque sorte par-dessus ce qui est, dans l'intervalle : notre attention se fixe seulement sur les endroits qu'elles relient. En d'autres termes la mmoire, lorsqu'elle s'applique non plus au -pass immdiat, mais, par exemple, au pass de notre famille, ne reproduit pas tout le dtail des vnements et des figures, et ne passe point par une srie continue d'images juxtaposes dans le temps. Tandis que, nous l'avons vu, les faits du pass immdiat nous paraissent tous -importants, aussi longtemps que nous ne nous en sommes pas loigns, il y a des poques, des incidents, des dates, des personnes que la famille met au premier plan dans son histoire, et qu'elle impose avec le plus de force l'attention de ses membres. Ainsi se constituent d'autres cadres, bien diffrents des prcdents en ce qu'ils ne comprennent qu'un nombre limit de faits saillants, spars par des intervalles quelquefois assez larges, et qui leur ressemblent toutefois en ceci : comme eux ils rsultent de ce que la mmoire des hommes dpend des groupes qui les enveloppent et des ides ou des images auxquelles ces groupes s'intressent le plus.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
105
* ** En rsum, comme l'a bien vu M. Bergson, ce n'est point par hasard, lorsque nous recherchons la place d'un souvenir dans le pass, que nous tombons sur certains autres souvenirs voisins de celui-l, qui l'encadrent et qui nous permettraient de le localiser. Mais, d'autre part, il n'est pas non plus ncessaire de supposer que nous voquons tous les souvenirs qui reproduiraient tous les vnements et toutes les images de ce pass, jusqu' ce que nous le rencontrions. M. Bergson a parl lui-mme de ces souvenirs dominants qui jalonnent le temps coul comme d'autant de supports sur lesquels reposeraient tous les autres, partir desquels, de proche en proche, en passant en revue tous ceux qui se succdent entre eux, nous arriverions celui qui nous occupe. Mais, dans sa pense, ces souvenirs dominants ne sont pas exactement des points de repre. Ils servent plutt dterminer l'ordre de grandeur ou d'intensit des souvenirs que nous devons voquer pour que reparaisse le souvenir cherch. Tout se passe comme si, ayant retrouver une ville et son emplacement, nous prenions successivement des cartes d'une chelle de plus en plus grande, jusqu' ce que l'une d'entre elles contienne la ville en question, C'est bien cela qu'il entend par l'expansion ou la dilatation de la mmoire. Les souvenirs dominants correspondraient telles ou telles villes caractristiques par leur grandeur ou le nombre de leurs habitants, et qui nous permettraient de distinguer les diffrentes chelles, si bien que nous serions assurs de retrouver, sur la mme carte qu'elles, d'autres villes proches, et d'une importance quivalente. A cela se bornerait leur rle. Sinon, s'il suffisait d'voquer ces villes caractristiques pour dcouvrir celle que nous cherchons, il suffirait aussi que notre attention se porte sur elles, et sur les rapports qu'elles peuvent avoir avec celle-ci, mais il serait inutile de reproduire en mme temps toutes les autres, c'est--dire de regarder la carte et tout ce qu'elle contient. Mais il nous semble qu'une telle mthode nous donnerait la fois trop, et pas assez. D'une part, elle suppose qu' propos d'un souvenir il faut reproduire tous les autres souvenirs de mme importance, ou, plus exactement, tous les souvenirs correspondant des vnements qui, dans le pass, eurent la mme importance. Mais, nous l'avons vu, d'une foule de faits ou de figures qui, autrefois, nous parurent en effet tous importants, le plus grand nombre ont assez vite disparu de telle sorte qu'il ne soit plus possible aujourd'hui, au moyen de nos ides et de nos perceptions actuelles, de nous les rappeler. Est-ce l une illusion? Ces souvenirs subsistent-ils l'arrire-plan de la mmoire ? Mais, si nombreux que soient les souvenirs qui dfilent dans notre esprit, quand nous en cherchons un qui se dissimule, nous savons bien qu'ils le sont beaucoup moins que ceux qui nous demeuraient prsents autrefois, alors qu'ils faisaient partie de notre pass immdiat. Dira-t-on qu'il s'agit en ralit des souvenirs qui nous paraissent en ce moment les plus importants ? C'est donc qu'on les envisage du point de vue du prsent. Mais alors ce n'est plus le pass tout entier qui exerce sur nous une pression en vue de pntrer dans notre conscience, Ce n'est Plus la srie chronologique des tats passs qui reproduirait exactement les vnements anciens, mais ce sont ceux-l seuls d'entre eux qui correspondent nos proccupations actuelles, qui peuvent reparatre. La raison de leur rapparition n'est pas en eux, mais dans leur rapport nos ides et perceptions d'aujourd'hui: ce n'est donc pas d'eux que nous partons, mais de ces rapports.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
106
D'autre part, une telle mthode ne suffirait pas : elle ne nous permettrait pas de retrouver la place d'un souvenir. En effet, il s'agit d'abord, de chercher ce souvenir dans telle rgion du pass. Mais pourquoi dans telle rgion plutt que dans toute autre ? Pourquoi dans telle section de la carte petite ou grande chelle, en la supposant unique, plutt que dans telle autre ? Choisirons-nous cette section au hasard ? Admettons que nous passions mthodiquement des cartes moins dtailles aux cartes plus dtailles, plus les cartes s'agrandiront, ou plus se multiplieront les villes, plus nous serons perdus. Pourquoi partirions-nous de telle ville connue, de tel souvenir dominant, plutt que d'une autre ? Et pourquoi, partir d'elle, suivrionsnous telle direction, plutt que toute autre ? Si nous ne voulons pas procder au hasard, il faut bien que nous ayons d'avance dans l'esprit quelque notion gnrale des rapports qu'il y a entre le souvenir cherch et les autres, et il faut que nous rflchissions sur ces rapports. Pourquoi est-il si malais de retrouver une personne dans les rues d'une ville ? C'est que la foule qui remplit les rues est mouvante, c'est que les units qui la composent se dplacent sans cesse l'une par rapport l'autre, c'est qu'il n'y a aucun rapport dfini et stable entre cette personne et aucune de ces units. Il faudrait que j'aie le temps et la possibilit de dvisager une une toutes les personnes de cette ville, au moins celles qui, par leur taille, leur costume, etc., correspondent celle que nous cherchons. Je la dcouvrirai plus certainement si je vais dans les htels o elle a pu descendre, la poste, dans les muses, etc., parce qu'il y a, en effet, des raisons pour qu'elle s'y trouve ou qu'on l'y ait vue. Qu'on rflchisse d'un peu prs l'exemple que nous avons donn, la recherche d'une petite ville sur une carte trs dtaille : on s'apercevra que, dans bien des cas, si on la trouve, ce n'est point parce qu'on a aperu son nom perdu au milieu de beaucoup d'autres : c'est qu'on a, par une srie de remarques et de recoupements, dtermin l'endroit prcis o elle devait tre, et o on tait en mesure d'indiquer son emplacement, sans mme lire son nom. Par exemple, au lieu d'une carte trs dtaille, je puis avoir ma disposition plusieurs cartes d'un pays, trs schmatiques, l'une o sont dessins les fleuves et les chanes de montagne, une autre qui indique la division en dpartements ou provinces, une troisime, celle du rseau des chemins de fer, avec les grandes stations. Si je sais qu'une ville donne se trouve dans telle grande subdivision administrative, sur telle ligne de chemin de fer, proximit de tel fleuve, j'en reprerai de faon trs approche l'emplacement. Or il nous semble bien que la mmoire, en gnral, ne procde, gure autrement. Elle dispose de cadres qui sont assez simples, et auxquels elle se rfre assez souvent, pour qu'on puisse dire qu'elle les porte toujours avec elle. Elle peut, en tout cas, les reconstruire tout moment, car ils sont faits de notions qui interviennent sans cesse dans sa pense et celle des autres, et qui s'imposent elle avec la mme autorit que les formes du langage. Pour localiser un souvenir, il faut, en dfinitive, le rattacher un ensemble d'autres souvenirs dont on connat la place dans le temps. Les psychologues associationnistes ont soutenu que, pour oprer ce rapprochement, on n'a besoin que d'voquer, partant de ce souvenir, ceux qui ont t en contigut dans le temps ou l'espace avec lui. A quoi on a object qu'on ne peut penser un rapport de contigut entre deux termes que si on les connat dj l'un et l'autre ; cela revient dire que l'attention se porte alors sur ces deux termes, parmi beaucoup d'autres, et qu'il n'est pas possible de localiser un souvenir si la suite chronologique des termes dont il fait partie ne se prsente pas nous. Mais, nous l'avons vu, ce qui rattache les uns aux autres des souvenirs rcents, ce n'est point qu'ils sont contigus dans le temps, c'est qu'ils font partie d'un ensemble de penses communes un groupe, au groupe des hommes avec
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
107
lesquels nous sommes en rapport en ce moment, ou nous avons t en rapport le jour ou les jours prcdents. Il suffit donc, pour que nous les voquions, que nous nous placions au point de vue de ce groupe, que nous adoptions ses intrts, et que nous suivions la pente de ses rflexions. Mais il en est exactement de mme lorsque nous cherchons localiser des souvenirs anciens. Nous devons les replacer dans un ensemble de souvenirs communs d'autres groupes, groupes plus troits et plus durables, tels que notre famille. Pour voquer cet ensemble, il suffit, l encore, que nous adoptions l'attitude commune aux membres de ce groupe, que notre attention se porte sur les souvenirs qui sont toujours au premier plan de sa pense, et partir desquels il est habitu, au moyen d'une logique qui lui est propre, retrouver ou reconstruire tous ses autres souvenirs. Il n'y a pas de diffrence, cet gard, entre les souvenirs rcents et les souvenirs anciens. Il n'y a pas plus lieu de parler ici d'association par ressemblance que, dans le cas des souvenirs rcents, d'association par contigut. Certes, les souvenirs de famille se ressemblent en ce qu'ils se rapportent une mme famille. Mais ils diffrent sous beaucoup d'autres rapports. La ressemblance n'est, dans ce cas, que le signe d'une communaut d'intrts et de penses. Ce n'est point parce qu'ils sont semblables qu'ils peuvent s'voquer en mme temps. C'est plutt parce qu'un mme groupe s'y intresse, et est capable de les voquer en mme temps, qu'ils se ressemblent. Ce qui fait que les psychologues ont imagin d'autres thories pour expliquer la localisation des souvenirs, c'est que, de mme que les hommes font partie en mme temps de beaucoup de groupes diffrents, de mme le souvenir d'un mme fait peut prendre place dans beaucoup de cadres, qui relvent de mmoires, collectives distinctes. S'en tenant l'individu, ils ont constat que les souvenirs pouvaient s'associer, dans sa pense, de bien des manires. Alors, ou bien ils ont class ces associations en quelques groupes trs gnraux, sous les rubriques de la ressemblance et de la contigut, ce qui n'tait pas une explication. Ou bien ils ont rendu compte de la diversit des associations par la diversit des individus, telle qu'elle rsulte de leurs dispositions physiologiques naturelles ou acquises: hypothse trs complique, difficilement vrifiable, qui nous carte du domaine psychologique, et qui n'est en somme, elle aussi, qu'une constatation. En ralit il est exact que les souvenirs se prsentent sous forme de systmes. C'est parce qu'ils sont associs dans l'esprit qu'ils s'voquent, et que les uns permettent de reconstruire les autres. Mais ces divers modes d'association des souvenirs rsultent des diverses faons dont les hommes peuvent s'associer, On ne comprend bien chacun d'eux, tel qu'il se prsente dans la pense individuelle, que si on le replace dans la pense du groupe correspondant. On ne comprend bien quelle est leur force relative, et comment ils se combinent dans la pense individuelle, qu'en rattachant l'individu aux groupes divers dont il fait en mme temps partie. Certes chacun, suivant son temprament particulier et les circonstances de sa vie, a une mmoire qui n'est celle d'aucun autre. Elle n'en est pas moins une partie et comme un aspect de la mmoire du groupe, puisque de toute impression et de tout fait, mme qui vous concerne en apparence le plus exclusivement, on ne garde un souvenir durable que dans la mesure o on y a rflchi, c'est--dire o on l'a rattach aux penses qui nous viennent du milieu social. On ne peut en effet rflchir sur les vnements de son pass sans raisonner propos d'eux ; or, raisonner, c'est rattacher en un mme systme d'ides nos opinions, et celles de notre entourage ; c'est voir dans ce qui nous arrive une application particulire de faits dont la pense sociale nous rappelle tout moment le sens et la porte qu'ils ont pour elle. Ainsi les cadres de la mmoire collective enferment et rattachent les uns aux autres nos souvenirs les
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
108
plus intimes. Il n'est pas ncessaire que le groupe les connaisse. Il suffit que nous ne puissions les envisager autrement que du dehors, c'est--dire en nous mettant la place des autres, et que, pour les retrouver, nous devions suivre la mme marche qu' notre place ils auraient suivie.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
109
Chapitre V
La mmoire collective de la famille
Retour la table des matires
Il a t souvent question, dans les pages prcdentes, de la mmoire collective et de ses cadres, sans qu'on l'ait envisage du point de vue du groupe ou des groupes dont elle serait une des fonctions les plus importantes. Nous nous en sommes tenu jusqu'ici observer et signaler tout ce qu'il entre de social dans les souvenirs individuels, c'est--dire dans ceux o chaque homme retrouve son propre pass, et croit souvent ne retrouver rien que cela. A prsent que nous avons reconnu quel point l'individu est, cet gard comme tant d'autres, dans la dpendance de la socit, il est naturel que nous considrions le groupe lui-mme comme capable de se souvenir, et que nous attribuions une mmoire la famille, par exemple, aussi bien qu' tout autre ensemble collectif. Ce n'est pas l une simple mtaphore. Les souvenirs de famille se dveloppent, vrai dire, comme sur autant de terrains diffrents, dans les consciences des divers membres du groupe domestique : mme lorsqu'ils sont rapprochs, plus forte raison lorsque la vie les tient loigns l'un de l'autre, chacun d'eux se souvient sa manire du pass familial commun. Ces consciences restent certains gards impntrables les unes aux autres, mais certains gards seulement. En dpit des distances que mettent entre eux l'opposition des tempraments et la varit des circonstances, du fait qu'ils ont t mls la mme vie quotidienne, et qu'entre eux des changes
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
110
perptuels d'impressions et d'opinions ont resserr des liens dont ils sentent quelquefois d'autant plus vivement la rsistance qu'ils s'efforcent de les briser, les membres d'une famille s'aperoivent bien qu'en eux les penses des autres ont pouss des ramifications qu'on ne peut suivre et dont on ne peut comprendre le dessin, dans son ensemble, qu' condition de rapprocher toutes ces penses et, en quelque sorte, de les rejoindre. Un enfant, dans une classe d'cole, est comme une unit humaine complte, tant qu'on ne l'envisage que sous l'angle de l'cole ; le mme enfant, si on songe alors ses parents, si sans quitter le milieu scolaire, il parle ses camarades ou son matre de sa famille, de sa maison, n'apparat plus que comme une partie et un fragment dtach d'un tout ; c'est que ses gestes et ses paroles d'colier s'accordent si bien, tant qu'il s'y trouve, avec le cadre de l'cole, qu'on le confond avec l'cole ellemme ; mais on ne le confond pas avec sa famille, tant qu'il en est loign, car les penses qui le ramnent vers ses parents et qu'il peut exprimer ne trouvent pas de point d'attache l'cole personne ne les comprend, personne ne peut les complter et elles ne se suffisent certainement pas. Si l'on s'en tenait la mmoire individuelle, on ne comprendrait pas en particulier que les souvenirs de famille reproduisent rien d'autre que les circonstances o nous sommes entrs en contact avec tel ou tel de nos parents. Continus ou intermittents, ces rapprochements donneraient lieu des impressions successives, dont chacune sans doute peut durer et demeurer pareille elle-mme pendant une priode plus ou moins longue, mais qui n'auraient pas d'autre stabilit que celle que leur communiquerait la conscience individuelle qui les prouve. D'ailleurs, puisque, dans un groupe d'individus, il y en a toujours quelques-uns qui changent, l'aspect de l'ensemble changerait aussi sans cesse pour chacune de ses parties. Les souvenirs familiaux se rduiraient ainsi une suite de tableaux successifs : ils reflteraient avant tout les variations de sentiment ou de pense de ceux qui composent le groupe domestique. La famille obirait l'impulsion de ses membres, et les suivrait dans leurs mouvements. Sa vie s'coulerait comme la leur, dans le mme temps qu'elle, et les traditions de famille ne dureraient qu'autant qu'il pourrait leur convenir. Mais il n'en est rien. De quelque manire qu'on entre dans une famille, par la naissance, par le mariage, ou autrement, on se trouve faire partie d'un groupe o ce ne sont pas nos sentiments personnels, mais des rgles et des coutumes qui ne dpendent pas de nous, et qui existaient avant nous, qui fixent notre place. Nous le sentons bien, et nous ne confondons pas nos impressions et ractions affectives en prsence des ntres, et les penses et sentiments qu'ils nous imposent. Il faut, a dit Durkheim, distinguer radicalement de la famille le rapprochement d'tres unis par un lien physiologique, d'o drivent des sentiments psychologiques individuels qu'on retrouve aussi chez les animaux 1. Dira-t-on que les sentiments que nous prouvons pour nos parents s'expliquent par des rapports de consanguinit, rapports individuels, si bien qu'eux-mmes seraient des sentiments individuels ? Mais, d'abord, J'enfant, chez qui ces sentiments se forment et se manifestent avec tant d'intensit, ne comprend pas la nature de tels rapports. D'autre part, il y a bien des socits o la parent ne suppose pas la consanguinit. Cependant, les sentiments de famille ne s'expliquent pas non plus par les soins de la mre, par l'ascendant physique du pre, par la cohabitation habituelle avec les frres et surs. Derrire tout cela, dominant tout cela, il y a bien un sentiment la fois obscur et prcis de ce qu'est la parent, qui ne peut prendre naissance que dans la famille, et qui ne s'explique que par elle. Que nos sentiments et nos attitudes nous soient inculqus ou enseigns cet gard par des individus, peu
1
DURKHEIM, Cours indit sur la famille.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
111
importe : ne s'inspirent-ils pas eux-mmes d'une conception gnrale de la famille ? Et il en est de mme des relations d'ordre familial qui s'tablissent entre poux. Dans l'antiquit le mariage n'a jamais t la simple conscration d'un rapprochement fond sur un sentiment mutuel. La fille grecque ou romaine entrait dans une famille nouvelle dont elle devait accepter le culte et les traditions. Dans nos socits, ni l'homme, ni la femme ne savent bien, avant le mariage, dans quel rapport ils vont se trouver, et quel ordre d'ides et de sentiments s'imposeront eux, du fait qu'ils fondent une famille nouvelle. Bien, dans leur pass individuel, ne peut le leur faire prvoir. Aucun d'eux, mme aprs le mariage, ne pourra enseigner l'autre, cet gard, ce qu'il croit ignorer lui-mme. Mais tous deux obiront des rgles traditionnelles, qu'ils ont apprises inconsciemment dans leur famille, comme leurs enfants les apprendront aprs eux. C'est ainsi que nous savons, sans nous en douter, tout ce qu'il nous est ncessaire de mettre en oeuvre, en quelque situation familiale que les circonstances puissent nous placer. Ds lors, il faut bien admettre que les impressions et expriences des individus qu'unissent des rapports de parent reoivent leur forme et une large partie de leur sens de ces conceptions que l'on comprend et dont on se pntre du seul fait qu'on entre dans le groupe domestique ou qu'on en fait partie. De bonne heure l'enfant adopte vis--vis de son pre, de sa mre et de tous les siens une attitude qui ne s'explique pas seulement par l'intimit de la vie, par la diffrence d'ge, par les sentiments habituels d'affection pour ceux qui nous entourent, de respect vis--vis d'tres plus forts que nous et de qui nous dpendons, et de reconnaissance en raison des services qu'ils nous rendent. De tels sentiments, si spontans soient-ils, suivent des chemins tracs d'avance, et qui ne dpendent point de nous, mais dont la socit a pris soin d'arrter la direction. Il n'y a rien de moins naturel, vrai dire, que ce genre de manifestations affectives, rien qui se conforme davantage des prceptes et rsulte plus d'une sorte de dressage. Les sentiments, mme modrs, subissent bien des fluctuations, et se transportent ou se transporteraient souvent, si on ne leur faisait pas obstacle, d'une personne l'autre. Il est dj bien extraordinaire que la famille russisse si gnralement obtenir de ses membres qu'ils s'aiment tout le temps, en dpit de l'loignement et des sparations, et qu'ils dpensent dans son sein la plus grande part des ressources affectives dont ils disposent. Sans doute, l'intrieur mme de la famille, les sentiments ne se rglent pas toujours sur les rapports de parent. Il arrive qu'on aime des grands-parents, et mme des oncles, des tantes, autant et plus que son pre ou sa mre, qu'on prfre un cousin un frre. Mais peine se l'avoue-t-on soi-mme, et l'expression des sentiments ne s'en rgle pas moins sur la structure de la famille : or c'est ce qui importe, sinon pour l'individu, du moins pour que le groupe conserve son autorit et sa cohsion. Sans doute aussi, hors de la famille, on a des amis ; on peut aimer d'autres que les siens. Mais alors, ou bien la famille russit s'agrger ces relations et liaisons, soit que de tels amis, par le privilge que leur confre l'anciennet de nos rapports, ou parce que nous leur ouvrons l'intimit de notre maison, deviennent presque des parents, soit que le mariage transforme en parent ce qui n'tait que le rapprochement de deux individus. Ou bien elle s'en dsintresse, comme si, entre ce genre d'affectivit capricieuse, drgle, imaginative, et les sentiments bien dfinis et permanents sur lesquels elle repose il n'existait aucune commune mesure. Ou bien, enfin, elle prend acte de ce qu'un de ses membres a pass dans un autre groupe et s'est spar d'elle, soit qu'elle attende le retour du fils prodigue, soit qu'elle lasse mine de l'avoir oubli. Ainsi, ou bien nos sentiments se dveloppent dans les cadres de notre famille et se conforment son organisation, ou bien ils ne peuvent tre partags par ses autres membres qui, tout au moins en droit, refusent de s'en mouvoir ou de s'y intresser.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
112
C'est surtout lorsqu'on compare divers types d'organisation familiale qu'on s'tonne de tout ce qu'il y a d'acquis et de rapport, dans ceux de nos sentiments que nous pourrions croire les plus simples et les plus universels. Dj, suivant que la filiation s'tablit en ligne masculine ou utrine, le fils reoit, ou ne reoit pas le nom de son pre, il fait ou ne fait point partie de sa famille. Dans une socit descendance maternelle, l'enfant non seulement quand il est petit, mais de plus en plus mesure qu'il prend mieux conscience de sa situation au milieu des autres hommes, considre sa mre et les parents de celle-ci comme sa famille troite, et nglige d'autant son pre dont les anctres ne sont pas les siens. Dans nos socits, un frre estime qu'il y a entre lui et sa sur des rapports aussi troits qu'entre lui et son frre : nous considrons comme nos parents au mme titre nos oncles et nos cousins paternels ou maternels ; en Grce, o la famille ne comprenait que les descendants issus d'un mle par les mles, il en tait tout autrement. La famille romaine constituait un vaste corps qui, par l'adoption, s'agrgeait de nouveaux membres, et se rattachait un grand nombre d'esclaves et de clients 1. Comment, dans nos socits o la famille tend de plus en plus se rduire au groupe conjugal, les sentiments qui unissent les poux et qui, avec les sentiments qui les unissent leurs enfants, suffisent presque constituer l'atmosphre affective de la famille, ne tireraient-ils pas une partie de leur force de ce qu'ils sont presque l'unique ciment qui tient assembls les membres du groupe ? Au contraire dans la famille romaine, l'union conjugale n'est qu'un des nombreux rapports qui unissent au pre de famille non seulement ceux qui ont le mme sang que lui, mais ses clients, ses affranchis, ses esclaves, et ses enfants d'adoption : les sentiments conjugaux ne jouent ds lors qu'un rle de second plan ; la femme considre surtout son mari comme le pater familias, et le mari, de son ct, voit dans sa femme non point une moiti de la famille, mais un de ses lments parmi beaucoup d'autres, et qu'on en pourrait d'ailleurs liminer sans atteindre sa vitalit ni rduire sa substance. On a expliqu l'instabilit des mariages et la frquence des divorces Rome par l'intervention des parents, parents du mari et parents de la femme, qui auraient eu le pouvoir de dissoudre une union conclue avec leur consentement 2 ; mais on n'et pas tolr cette intervention si le divorce et menac l'existence mme de la famille, comme dans nos socits. S'il est exact qu' en admettant Rome une moyenne de 3 ou 4 mariages pour chaque personne, dans le cours de son existence , nous restions en de plutt qu'au del de la ralit , en sorte que ce rgime matrimonial correspondrait une polygamie successive , les sentiments des poux se devaient distinguer du genre d'attachement qu'accompagne l'ide du mariage indissoluble. Outre ces rgles communes toute une socit, il existe des coutumes et faons de penser propres chaque famille, et qui imposent galement, et mme plus expressment encore, leur forme aux opinions et sentiments de leurs membres. Dans la Rome antique, nous dit Fustel de Coulanges, il n'y avait pour la religion domestique ni rgles, ni formes, ni rituel commun. Chaque famille avait l'indpendance la plus complte. Nulle puissance extrieure n'avait le droit de rgler son culte ou sa croyance. Il n'y avait pas d'autre prtre que le pre. Comme prtre il ne connaissait aucune hirarchie. Le pontife de Rome pouvait bien s'assurer que le pre de famille accomplissait tous ses rites religieux, mais il n'avait pas le droit de lui commander la
1 2
L'esclave et le client faisaient partie de la famille et taient enterrs dans le tombeau commun. FUSTEL DE COULANGES, La cit antique, 20e dition, p. 67, note, et aussi p. 127 sq. LACOMBE (Paul), La famille dans la socit romaine, tude de moralit compare, 1889, p. 208 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
113
moindre modification. Suo quisque ritu sacrificium facial, telle tait la rgle absolue. Chaque famille avait ses crmonies qui lui taient propres, ses ftes particulires, ses formules de prire et ses hymnes. Le pre, seul interprte et seul pontife de sa religion, avait seul le pouvoir de l'enseigner, et ne pouvait l'enseigner qu' son fils. Les rites, les termes de la prire, les chants, qui faisaient partie essentielle de cette religion domestique, taient un patrimoine, une proprit sacre, que la famille ne partageait avec personne, et qu'il tait mme interdit de rvler aux trangers. De mme, dans les socits les plus traditionnelles d'aujourd'hui, chaque famille a son esprit propre, ses souvenirs qu'elle est seule commmorer, et ses secrets qu'elle ne rvle qu' ses membres. Mais ces souvenirs, de mme, d'ailleurs, que les traditions religieuses des familles antiques, ne consistent pas seulement en une srie d'images individuelles du pass. Ce sont, en mme temps, des modles, des exemples, et comme des enseignements. En eux s'exprime l'attitude gnrale du groupe ; ils ne reproduisent pas seulement son histoire, mais ils dfinissent sa nature, ses qualits et ses faiblesses. Quand on dit : Dans notre famille, on vit longtemps, ou : on est fer, ou : on ne s'enrichit pas , on parle d'une proprit physique ou morale qu'on suppose inhrente au groupe, et qui passe de lui ses membres. Quelquefois, c'est le lieu ou le pays d'origine de la famille, c'est telle ou telle figure caractristique d'un de ses membres, qui devient le symbole plus ou moins mystrieux du fonds commun d'o ils tirent leurs traits distinctifs. En tout cas, de divers lments de ce genre retenus du pass, la mmoire familiale compose un cadre qu'elle tend conserver intact et qui est en quelque sorte l'armature traditionnelle de la famille. Bien qu'il soit constitu par des faits qui eurent une date, par des images qui ne durrent qu'un temps, comme on y retrouve les jugements que la famille, et celles qui l'entourent, ont port sur eux, il participe de la nature de ces notions collectives qui ne se placent ni en un. lieu, ni un moment dfini, et qui semblent dominer le cours du temps. Supposons, maintenant, que nous nous rappelions un vnement de notre vie familiale qui, comme on dit, s'est grav dans notre mmoire. Essayons d'en liminer ces ides et ces jugements traditionnels qui dfinissent l'esprit de famille. Que demeure-t-il ? Mais est-il mme possible d'oprer une telle dissociation, et de distinguer, dans le souvenir de l'vnement, l'image de ce qui n'a eu lieu qu'une fois, qui se rapporte un moment et un lieu unique , et les notions o s'exprime en gnral notre exprience des actes et manires d'tre de nos parents. Quand Chateaubriand raconte, dans une page fameuse, comment on passait les soires au chteau de Combourg, s'agit-il d'un vnement qui n'a eu lieu qu'une fois ? A-t-il t, un soir plutt que les autres, particulirement frapp par les alles et venues silencieuses de son pre, par l'aspect de la salle, et par les dtails qu'il met en relief dans son tableau ? Non : mais il a rassembl sans doute en une seule scne les souvenirs de beaucoup de soires, tels qu'ils se gravrent dans sa mmoire et dans celle des siens : c'est le rsum de toute une priode, c'est l'ide d'un genre de vie. On y entrevoit le caractre des acteurs, tel qu'il ressort sans doute du rle qu'ils jouent dans cette scne, mais aussi de leur manire d'tre habituelle, et de toute leur histoire. Certes, ce qui nous intresse surtout, c'est Chateaubriand lui-mme, et le sentiment d'oppression, de tristesse et d'ennui qui s'entretient en lui au contact de ces gens et de ces choses. Mais qui ne voit qu'en un autre milieu ce sentiment n'aurait pas pu natre, ou que, s'il y tait n, il n'et t le mme qu'en apparence, et qu'il implique des coutumes familiales qui n'existaient que dans cette petite noblesse provinciale de l'ancienne France, aussi bien que les traditions propres la famille de Chateaubriand ? C'est un tableau reconstruit, et loin que, pour le voir s'voquer en sa ralit d'autrefois, il faille renoncer rflchir, c'est par rflexion que l'auteur choisit tels traits
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
114
physiques et telles particularits de costume, qu'il dit, par exemple, propos de son pre : il tait vtu d'une robe de ratine blanche que je n'ai vue qu' lui : sa tte demichauve tait couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit ; ... il penchait vers nous sa joue sche et blanche, sans nous rpondre , ou, de sa mre, qu'elle se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambe , et qu'il mentionne le grand flambeau d'argent surmont d'une bougie , l'horloge qui scandait cette promenade nocturne, et la petite tour de l'Ouest, tous traits associs dessein pour nous mieux rendre les caractres de ses parents, la monotonie de cette existence recluse telle que celle, d'ailleurs, de beaucoup de gentilshommes campagnards de ce temps, et pour recomposer l'atmosphre habituelle de ces soires familiales si tranges. Certes, c'est une description faite longtemps aprs par un crivain ; celui qui raconte est bien oblig de traduire ses souvenirs pour les communiquer ; ce qu'il dit ne correspond peut-tre pas exactement tout ce qu'il voque. Mais, telle quelle, la scne n'en donne pas moins, en un raccourci saisissant, l'ide d'une famille, et, pour tre un rsum de rflexions et de sentiments collectifs, elle n'en projette pas moins, sur l'cran d'un pass obscurci et brouill, une image singulirement vive. Une scne dtermine qui s'est droule dans notre maison, dont nos parents furent les personnages, et qui a marqu dans notre mmoire, ne reparat donc pas comme le tableau d'un jour, tel que nous le vmes alors. Nous la composons nouveau, et nous y faisons entrer des lments emprunts bien des priodes qui la prcdrent et qui la suivirent. La notion que nous avons en ce moment de la nature morale de nos parents, et de l'vnement en lui-mme jug distance, s'impose avec trop de force notre esprit pour que nous ne nous en inspirions pas. Et il en est de mme de ces vnements et de ces figures qui se dtachent sur l'ensemble de la vie familiale, qui la rsument, et servent de points de repre celui qui veut localiser des traits et circonstances moins importants. Bien qu'ils aient une date, nous pourrions en ralit les dplacer le long de la ligne du temps sans les modifier : ils se sont grossis de tout ce qui prcde, et ils sont dj gros de tout ce qui suit. A mesure qu'on s'y reporte plus souvent, qu'on y rflchit davantage, loin de se simplifier, ils concentrent en eux plus de ralit, 'parce qu'ils sont au point de convergence d'un plus grand nombre de rflexions. Ainsi, dans le cadre de la mmoire familiale, ce sont bien des figures et des faits qui font office de points de repre ; mais chacune de ces figures exprime tout un caractre, chacun de ces faits rsume toute une priode de la vie du groupe ; ce sont la fois des images et des notions. Que notre rflexion se porte sur elles : tout se passera sans doute comme si nous avions repris contact avec le pass. Mais cela veut dire, seulement, qu' partir du cadre nous nous sentons capables de reconstruire l'image des personnes et des faits. * ** Il est vrai que toutes sortes d'ides peuvent voquer en nous des souvenirs de famille. Du moment, en effet, que la famille est le groupe au sein duquel se passe la plus grande partie de notre vie, aux penses familiales se mlent la plupart de nos penses. Ce sont nos parents qui nous communiqurent nos premires notions sur les gens et les choses. Du monde extrieur nous ne connmes longtemps rien que par les rpercussions des vnements du dehors dans le cercle de nos parents. Pensons-nous une ville ? Elle nous peut rappeler un voyage que nous y fmes jadis avec notre frre. Pensons-nous une profession ? Elle nous rappelle tel parent, qui l'exerce.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
115
Pensons-nous la richesse ? Nous nous reprsenterons tels et tels membres de notre famille, tandis que nous chercherons valuer leur fortune. Il n'est donc point d'objet propos notre rflexion partir duquel, par une srie d'associations d'ides, il ne soit possible de retrouver quelque pense qui nous replonge, dans le pass lointain ou rcent, au milieu des ntres. Il n'en rsulte nullement que ce que nous avons appel le cadre de la mmoire familiale comprenne toutes ces notions qui correspondent des objets tout autres que la famille elle-mme. Supposons qu'au hasard d'une lecture le nom d'une ville de France, Compigne, vienne sous mes yeux, et que, comme je l'ai dit, je me souvienne ce propos d'un voyage qui m'y amena en compagnie de mon frre. De deux choses l'une. Ou bien que mon attention ne s'attache point particulirement mon frre en tant qu'il est mon frre, mais la ville que nous avons visite, la fort o nous nous sommes promens : je, me rappelle alors les rflexions que nous changions sur tout ce qui frappait nos yeux, ou au hasard de la conversation, et il me semble qu' mon frre je pourrais substituer un ami qui ne me serait parent aucun titre, sans que mon souvenir ft srieusement modifi : mon frre n'est en quelque sorte qu'un acteur parmi d'autres, dans une scne dont l'intrt principal n'est pas dans les rapports de parent qui nous unissent, soit que je pense surtout la ville, et que j'essaie d'en mieux reconstituer l'aspect, soit que je me rappelle telle ide qui fut pour nous sujet de discussion au cours de notre promenade : alors, bien que je pense mon frre, je n'ai cependant pas le sentiment de me rappeler un vnement de ma vie de famille. Ou bien, l'occasion de ce souvenir, c'est bien mon frre en tant que tel que je m'intresse. Mais alors, si je veux le mieux voir, je m'aperois que l'image que j'ai de lui dans l'esprit ne se rapporte pas plus cette poque qu' toute autre. Je le vois plutt tel qu'il y a quelques jours, si je veux voquer ses traits. Mais, bien plus qu' ses traits, c'est aux rapports qu'il y a eu, et qu'il y a encore, entre lui, moi, et les divers membres de ma famille, que mon attention s'applique. Quant aux dtails de notre excursion, ils passent peu peu l'arrire-plan, ou ils ne m'occupent que dans la mesure o ils ont t pour nous l'occasion de prendre conscience des liens qui nous tiennent unis entre nous et tous les ntres. En d'autres termes ce souvenir quelconque n'est devenu un souvenir de famille qu' partir du moment o, la notion qui l'avait fait reparatre dans ma mmoire, notion d'une ville de France, qui fait ellemme partie de la notion que j'ai de la France, s'est substitue, pour encadrer cette image, et aussi pour la modifier et la refondre, une autre notion, gnrale la fois et particulire, celle de ma famille. Ainsi il serait inexact de dire que l'ide d'un lieu voque un souvenir de famille : c'est la condition d'carter cette ide et d'clairer l'image voque la lumire d'une autre ide, ide non plus d'un lieu, mais d'un groupe de parents, que nous pouvons la rattacher ce groupe, et qu'elle prend alors seulement la forme d'un souvenir de famille. Il importe d'autant plus de distinguer de toutes les autres ces notions purement et spcifiquement familiales, qui forment le cadre de la mmoire domestique, que dans bien des socits, la famille n'est pas seulement un groupe de parents, mais qu'on pourrait, semble-t-il, la dfinir par le lieu qu'elle occupe, par la profession qu'exercent ses membres, par leur niveau social, etc. Or, si le groupe domestique concide parfois avec un groupe local, si parfois la vie et la pense de la famille sont envahies par des proccupations conomiques, ou religieuses, ou d'autres encore, il existe cependant une diffrence de nature entre la parent, d'une part, la religion, la profession, la fortune, etc., de l'autre. Et c'est pourquoi la famille a une mmoire propre, au mme titre que les autres genres de communauts : ce qui passe au premier plan dans cette mmoire, ce sont les rapports de parent, et si des vnements qui, premire vue, se
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
116
rattachent des ides d'un autre ordre, y prennent place, c'est que, par certains cts, ils peuvent tre envisags eux aussi comme des vnements, familiaux, et c'est parce qu'on les envisage alors sous cet aspect. Il est vrai que, dans certaines socits anciennes ou modernes, on a pu soutenir que, d'une part, la famille se confondait avec le groupe religieux, que, d'autre part, fixe au sol, elle faisait corps avec la maison et le champ. Les Grecs et les Romains des anciens ges ne distinguaient pas la famille du foyer o l'on clbrait le culte des dieux lares. Or le foyer est le symbole de la vie sdentaire... Il doit tre pos sur le sol. Une fois pos, on ne doit plus le changer de place... Et la famille... se fixe au sol comme l'autel lui-mme. L'ide de domicile vient naturellement. La famille est attache au foyer ; le foyer l'est au sol ; une relation troite s'tablit donc entre le sol et la famille. L doit tre sa demeure permanente qu'elle ne songera pas quitter 1. Mais les foyers doivent tre nettement spars les uns des autres, comme les cultes des diverses familles. Il faut qu'autour du foyer, une certaine distance, il y ait une enceinte. Peu importe qu'elle soit forme par une haie, par une cloison de bois ou par un mur de pierre. Quelle qu'elle soit, elle marque la limite qui spare le domaine d'un foyer du domaine d'un autre. Cette enceinte est rpute sacre. Et il en est de mme des tombeaux. De mme que les maisons ne devaient pas tre contigus, les tombeaux ne devaient pas se toucher... Les morts sont des dieux qui appartiennent en propre une famille et qu'elle a seule le droit d'invoquer. Ces morts ont pris possession du sol ; ils vivent sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut penser se mler eux. Personne d'ailleurs n'a le droit de les dpossder du sol qu'ils occupent ; un tombeau, chez les anciens, ne peut jamais tre dtruit ni dplac 2. Chaque champ tait entour, comme la maison, d'une enceinte. Ce n'tait pas un mur de pierre, mais une bande de terre de quelques pieds de large, qui devait rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. Cet espace tait sacr : la loi romaine le dclarait imprescriptible : il appartenait la religion... Sur cette ligne, de distance en distance, l'homme plaait quelques grosses pierres ou quelques troncs d'arbres, que l'on appelait des termes... Le terme pos en terre, c'tait en quelque sorte la religion domestique implante dans le sol, pour marquer que ce sol tait jamais la proprit de la famille... Une fois pos suivant les rites, il n'tait aucune puissance au monde qui pt le dplacer . Il y eut un temps o la maison et le champ taient ce point incorpors la famille qu'elle ne pouvait ni les perdre, ni s'en dessaisir 3. Comment la vue de la maison et du champ n'auraient-elles pas renouvel le souvenir de tous les vnements, profanes ou religieux, qui s'y taient drouls ? Sans doute une poque o la famille constituait l'unit sociale essentielle, c'est dans son cadre que se devait pratiquer la religion, et les croyances religieuses se sont peut-tre coules dans l'organisation de la famille, et calques sur elle. Mais, tout semble indiquer que ces croyances existaient dj avant elle, ou, en tout cas, qu'elles ont pntr en elle du dehors. Usener a montr qu' ct du culte des anctres, et peut-tre avant que les grandes divinits olympiennes n'eussent pris leur figure dfinitive, l'imagination des paysans romains et grecs peuplait les campagnes d'une quantit d'tres et puissances mystrieuses, dieux et esprits prposs tous les
1 2
FUSTEL DE COULANGES, loc. cit., p. 64 sq. Ibid., p. 68. La loi romaine exige que, si une famille vend la champ o est son tombeau, elle reste au moins propritaire de ce tombeau et conserve ternellement le droit de traverser le champ pour aller accomplir les crmonies de son culte. L'ancien usage tait d'enterrer les morts, non pas dans des cimetires ou sur les bords d'une route, mais dans le champ de chaque famille. Ibid., p. 73.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
117
principaux incidents de la vie, et aux diverses phases des travaux agricoles 1, qui n'avaient aucun caractre domestique. Quelle que soit l'origine du culte des morts, il n'est gure douteux qu'entre la nature des dieux lares, des mnes, et de ces dieux qu'Usener appelle Sonder ou Augenblicksgtter, il n'y eut d'troits rapports, et il se peut que ceux-l aient t conus l'imitation de ceux-ci. En tout cas, et malgr la diffrence de ces cultes, des lieux o on les clbrait, de leurs prtres, tous n'en taient pas moins compris dans un mme ensemble de reprsentations religieuses 2. Or ces faons de penser religieuses se distinguaient des traditions familiales. En d'autres termes, le culte pratiqu dans la famille, mme chez ces peuples, correspondait bien deux espces d'attitudes spirituelles. D'une part le culte des morts offrait la famille l'occasion de se resserrer, de communier priodiquement dans le souvenir des parents disparus, et de prendre plus fortement conscience de son unit et de sa continuit. D'autre part, lorsque, le mme jour de l'anne, dans toutes les familles, suivant des rites peu prs uniformes, on voquait les morts, on les conviait partager le repas des vivants, lorsque l'attention des hommes se portait sur la nature et le genre d'existence des mes dfuntes, ils participaient un ensemble de croyances communes tous les membres de leur cit, et mme de beaucoup d'autres ; l'occasion du culte de leurs morts, ils tournaient leur esprit vers tout un monde de puissances surnaturelles dont les mnes de leurs parents ne reprsentaient qu'une infime partie. De ces deux attitudes la premire seule reprsentait un acte de commmoration familiale : elle concidait avec une attitude religieuse, sans se confondre avec elle. Dans nos socits, le genre d'existence paysan se distingue encore de tous les autres en ce que le travail s'accomplit dans le cadre de la vie domestique, et que la ferme, l'table, la grange, alors mme qu'elle n'y travaille pas actuellement, demeurent au premier plan des proccupations de la famille. Il est ds lors naturel que la famille et la terre ne se dtachent point l'une de l'autre dans la pense commune. D'autre part, comme le groupe paysan est fix au sol, le tableau du pays limit et du village o il demeure se grave de bonne heure dans l'esprit de ses membres, avec toutes ses particularits, ses divisions, la position relative de ses maisons et l'enchevtrement de ses parcelles. Lorsqu'un habitant des villes cause avec un paysan, il s'tonne de ce que celui-ci distingue les maisons et les champs d'aprs la famille qui les possde et dit : ceci est l'enclos d'un tel, la ferme d'un tel ; les murs, les haies, les chemins, les fosss marquent ses yeux les limites qui sparent les groupes domestiques, et il songe, en passant le long d'un champ, ceux qui l'ensemencent et y promnent la charrue, le long d'un verger, ceux qui en rcolteront les fruits. Mais si la communaut paysanne groupe dans le village assigne en quelque sorte par la pense chacune des familles qui la composent une partie du sol, et dtermine la place que chacune d'elles occupe au sein d'elle-mme d'aprs le lieu o elle rside et o se trouvent situs ses biens, rien ne prouve qu'une telle notion soit aussi au premier plan de la conscience de chaque famille, et que le rapprochement de ses
1 2
USENER, Gtternamen, p. 75. USENER rapporte, d'aprs Babrios, l'histoire d'un cultivateur qui se rend la ville pour implorer les grands dieux, parce qu'ils sont plus puissants que ceux de la campagne. Ibid., p. 247. FUSTEL DE COULANGES, expliquant comment la plbe, autrefois foule sans culte, eut dornavant ses crmonies religieuses et ses ftes dit que tantt une famille plbienne se fit un foyer... tantt le plbien, sans avoir de culte domestique, eut accs aux temples de la cit. La cit antique, p. 328.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
118
membres dans l'espace se confonde pour elle avec la cohsion qui les tient associs. Plaons-nous dans le cas o ces deux sortes de rapports paraissent concider le plus troitement. Durkheim, tudiant la famille agnatique (c'est--dire celle qui comprend les descendants issus d'un mle par les mles) telle qu'elle existe encore chez les Slaves mridionaux, telle qu'elle a exist en Grce, remarque qu'elle repose sur le principe que le patrimoine ne peut sortir de la famille : on prfre se sparer des individus (par exemple des filles maries) que de la terre. Les liens qui rattachent les chose, la socit domestique sont plus forts que ceux qui y rattachent l'individu... Les choses sont l'me de la famille : elle ne peut s'en dfaire sans se dtruire elle-mme 1. S'ensuit-il que, mme dans ce rgime, l'unit de la famille se ramne l'unit des biens, c'est--dire que les membres de celle-ci considrent que leurs liens de parent, et ceux qui rsultent de la possession et de la culture en commun d'une mme terre, soient identiques ? Non. Ici encore, sous prtexte que les membres d'une mme parent vivent ainsi rapprochs, et travaillent de concert, sur le mme sol, il ne faut pas confondre deux directions de la pense paysanne, l'une qui l'oriente vers les travaux agricoles et leur base matrielle, vers la terre, l'autre qui la ramne vers l'intrieur de la maison et le groupe familial. Sans doute le travail de la terre se distingue de beaucoup d formes du labeur industriel en ce qu'il associe pour les mmes tches accomplies aux mmes lieux, au lieu de les disperser, les membres d'une mme famille ou de familles parentes. Le paysan qui, tandis qu'il peine, voit les siens, voit sa maison, et peut se dire : Ce champ est moi, ces btes nous appartiennent , semble mler des ides agricoles et familiales, et on pourrait croire en effet que, parce que son travail s'accomplit dans le cadre de la vie domestique, l'une et l'autre ne se sparent point dans sa pense. Pourtant, il n'en est rien. Qu'il pousse tout seul la charrue, qu'il fauche en mme temps que ses parents, qu'il batte le bl avec eux, qu'il s'occupe la basse-cour, il se rattache en ralit, et il ne peut ne pas se rattacher par la pense la collectivit paysanne tout entire du village et du pays, qui accomplit les mmes gestes et se livre aux mmes oprations que lui, dont les membres, bien qu'ils ne soient pas ses parents, pourraient l'aider et le remplacer. Il importe assez peu, pour le rsultat du travail, qu'il soit fait par des parents associs, ou par un groupe de paysans sans lien de parent. C'est donc que le travail, et le sol non plus, ne portent pas la marque d'une famille dtermine, mais de l'activit paysanne en gnral. Les raisons qui rapprochent les parents au travail sont bien diffrentes de celles qui les rapprochent au foyer : ce sont les rapports des forces physiques, et non les rapports de parent, qui expliquent que des cousins souvent trs loigns travaillent ensemble, alors que les grands-parents trop gs ou les enfants trop jeunes restent la maison. Quand, dans des champs voisins, des familles diffrentes profitent d'une belle journe, pour activer les semailles ou la rcolte, quand elles consultent le ciel, se demandent si la scheresse durera, si la grle dtruira les bourgeons, une vie commune s'veille et des proccupations pareilles se rpondent de l'une l'autre. C'est la pense et la mmoire paysanne ou villageoise qui entre alors en jeu, leur ouvre le trsor de ses traditions, de ses lgendes, de ses proverbes, les oblige se rgler sur les divisions coutumires du temps, sur le calendrier et sur les ftes, fixe les formes de leurs rjouissances priodiques, et, en leur rappelant les mauvais jours anciens leur enseigne la rsignation. Sans doute, la famille est toujours l, mais ce n'est pas sur elle, en ce moment, que se reporte la pense des paysans. Ou bien, si elle s'y reporte, alors les proccupations proprement agricoles, et toutes les notions purement paysannes, de tout l'heure disparaissent ou
1
DURKHEIM, loc. cit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
119
du moins s'cartent un peu ; chacun, parmi les compagnons de travail, cherche des yeux ses parents les plus proches, songe ceux qui restent la maison ; son horizon se limite maintenant aux siens, qui se dtachent alors du sol et de la communaut paysanne pour se replacer dans un autre ensemble, celui qui est dfini par la parent et par elle seule. Et il en est de mme de ces veilles o, aux membres de la famille, des amis et des voisins viennent se joindre : alors c'est l'esprit de la communaut paysanne qui, en quelque sorte, circule d'un foyer l'autre : mais que les amis s'loignent, que les voisins se retirent : alors la famille se replie sur elle-mme, et un esprit nouveau se fait jour, incommunicable aux autres familles, et qui ne rayonne pas au del du cercle de ses membres. Comment se confondrait-il avec la notion de la terre, telle que tout paysan et toute communaut paysanne la comprend et l'entretient en elle ? On dit quelquefois que l'volution de la famille a consist en ce qu'elle s'est dpouille progressivement de ces fonctions religieuses, juridiques, conomiques, qu'elle remplissait autrefois : le pre de famille n'est plus aujourd'hui le prtre, ni le juge, ni mme politiquement le chef du groupe domestique. Mais il est probable que, mme l'origine, ces fonctions se distinguaient dj l'une de l'autre, qu'en tout cas elles ne se confondaient pas avec la fonction du pre en tant que pre, et que les relations de parent taient autre chose que celles qui rsultaient de ces autres genres de pense et d'activit. Comment se seraient-elles dissocies, s'il n'y avait pas eu entre elles, ds le dbut, une diffrence de nature ? Certes, elles ont pu contribuer renforcer ou modifier la cohsion de la famille, mais si elles ont eu ce rsultat, ce n'est nullement en raison de leur nature propre. Des parents peuvent se sparer, une famille peut se diviser, J'esprit de famille peut s'affaiblir, parce qu'ils n'ont pas les mmes croyances religieuses, ou parce qu'ils se trouvent loigns l'un de l'autre dans l'espace, ou parce qu'ils appartiennent des catgories sociales diffrentes. Mais des causes ce point diffrentes ne peuvent produire le mme effet que parce que la famille ragit de la mme manire en prsence de l'une ou de l'autre. Cette raction s'explique essentiellement par des reprsentations familiales. La communaut des croyances religieuses, le rapprochement dans l'espace, la ressemblance des situations sociales ne suffiraient pas crer l'esprit de famille. Toutes ces conditions n'ont pour la famille que l'importance qu'elle leur attribue. Et elle est capable de trouver en elle la force suffisante pour s'en passer, pour surmonter les obstacles qu'elles lui opposent. Bien plus, il arrive qu'elle transforme ces obstacles en points d'appui, qu'elle se fortifie des rsistances mmes qu'elle rencontre hors d'elle. Des parents obligs de vivre loin l'un de l'autre peuvent trouver dans cet loignement temporaire une raison de s'aimer davantage, parce qu'ils ne songent qu' se rapprocher, et font tous leurs efforts cette fin. Pour combler l'intervalle que met entre eux la diffrence des croyances religieuses, l'ingalit du niveau social, ils tcheront de resserrer les liens de l'union familiale. Tant il est vrai que les sentiments de famille ont une nature propre et distincte, et que les forces du dehors n'ont prise sur eux que dans la mesure o ils s'y prtent. * ** A quoi se ramne enfin cet esprit et cette mmoire familiale ? De quels vnements garde-t-elle la trace, parmi tous ceux qui se droulent dans la famille ? Quelles notions y sont au premier plan, parmi toutes celles qui se croisent dans la pense des
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
120
membres d'un tel groupe ? Si l'on cherche un cadre de notions qui nous serve nous rappeler les souvenirs de la vie domestique, on songe tout de suite aux rapports de parent, tels qu'ils sont dfinis dans chaque socit. Nous y pensons en effet sans cesse, parce que nos rapports quotidiens avec les ntres, aussi bien qu'avec les membres des autres familles, nous obligent constamment nous en inspirer. Ils se prsentent sous la forme d'un systme bien li, qui offre prise la rflexion. Il y a dans les gnalogies familiales une sorte de logique : c'est pourquoi l'histoire des dynasties, des successions et des alliances au sein des familles royales, offre un moyen commode de retenir les vnements du rgne. De mme, lorsqu'on lit un drame aux nombreuses pripties, on serait bien embarrass et bien vite perdu, si on ne connaissait pas d'abord les personnages, et ce qu'ils sont l'un par rapport l'autre. Si l'on s'en tenait la parent toute nue, les relations qui dfinissent la famille moderne paratraient, il est vrai, beaucoup trop simples pour que puissent s'accrocher elles les souvenirs de tout ce qui nous a frapps, dans la manire d'tre de nos parents, dans leurs paroles, leurs actes, et aussi les souvenirs de nos actes, nos paroles, nos penses, quand nous nous comportions nous-mme en parent. Comment me suffirait-il de penser que j'ai un pre, une mre, des enfants, une femme, pour que ma mmoire reconstitue l'image fidle de chacun d'eux et de notre pass commun? Mais, si simple qu'il nous paraisse, ce cadre ne s'en complique pas moins, ds qu'au schma gnral d'une famille quelconque dans notre socit nous substituons le dessin, plus arrt et dtaill, des traits essentiels de notre famille. Il s'agit alors en effet de se reprsenter non plus seulement les diverses espces ou degrs de parent, mais les personnes qui nous sont parentes ce degr ou de cette manire, avec la physionomie que nous avons coutume de leur reconnatre dans la famille. Il y a ceci, en effet, d'assez curieux dans notre attitude vis--vis de chacun des ntres, que nous unissons en une seule pense l'ide de la position qu'ils occupent dans notre famille en vertu seulement de la parent, et l'image d'une personne individuelle trs dfinie. Il n'y a rien de plus abstraitement impratif, rien dont la rigidit imite davantage la ncessit des lois naturelles, que les rgles qui fixent les rapports entre pre et enfants, mari et femme. Sans doute ils peuvent tre dissous dans des cas exceptionnels : le pre romain avait le droit de rpudier ses enfants ; les tribunaux ont l'autorit ncessaire pour prononcer la dchance paternelle ou le divorce. Mme alors, la parent ou l'alliance laisse des traces dans la mmoire du groupe et dans la socit : celui qui est sorti ainsi de sa famille est considr par elle un peu comme un maudit qu'elle charge de son excration : comment cela s'expliquerait-il, s'il lui tait devenu tout fait tranger ou indiffrent ? En tout cas, tant qu'on ne sort pas de la famille, la diffrence des autres groupes dont les membres peuvent y changer et y changent parfois de place relativement aux autres, on demeure clans les mmes rapports de parent avec les siens. Les hommes peuvent passer d'un mtier l'autre, d'une nationalit une autre, monter ou descendre dans l'chelle des situations sociales, les sujets devenirs chefs et les chefs, sujets, un laque peut mme devenir prtre et un prtre redevenir laque. Mais un fils ne deviendra pre que quand il fondera une autre famille : mme alors, il demeurera toujours le fils de son pre ; il y a l un genre de rapport irrversible : et de mme les frres ne peuvent pas cesser d'tre frres : il y a l un genre d'union indissoluble. Nulle part la place de l'individu ne semble ainsi davantage prdtermine, sans qu'il soit tenu compte de ce qu'il veut et de ce qu'il est. Cependant il n'est pas de milieu non plus o la personnalit de chaque homme se trouve plus en relief. Il n'y en a point o l'on considre davantage chaque membre du
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
121
groupe comme un tre unique en son genre , et auquel on n'en pourrait et on nie conoit pas que s'en puisse substituer un autre. Une famille, de ce point de vue, serait moins un groupe de fonctions spcialises, qu'un groupe de personnes diffrencies. Certes nous n'avons choisi ni notre pre, ni notre mre, ni nos frres et surs, et dans beaucoup de cas nous n'avons choisi qu'en apparence notre poux. Mais, dans le milieu relativement clos qu'est notre famille, l'occasion des contacts quotidiens o nous entrons les uns avec les autres, nous nous examinons longuement et sous tous nos aspects. Ainsi se dtermine dans la mmoire de chacun une image singulirement riche et prcise de chacun des autres. N'est-ce point l, ds lors, la rgion de la vie sociale o on se laisse le moins dominer et guider, dans les jugements qu'on porte sur ses proches, par les rgles et croyances de la socit, o c'est en eux-mmes, dans leur nature individuelle, et non en tant que membres d'un groupe religieux, politique, ou conomique, qu'on les envisage, o l'on tient compte avant tout et presque exclusivement de leurs qualits personnelles, et non de ce qu'ils sont ou pourraient tre pour les autres groupes qui enveloppent la famille sans y pntrer ? Ainsi, quand nous pensons nos parents, nous avons dans l'esprit la fois l'ide d'un rapport de parent, et l'image d'une personne, et c'est parce que ces deux lments sont troitement fondus que nous adoptons vis--vis de chacun d'eux en mme temps une double attitude, et que nos sentiments pour eux peuvent tre dits la fois indiffrents leur objet, puisque notre pre et notre frre nous sont imposs, et cependant spontans, libres, et fonds sur une prfrence rflchie, car, en dehors de la parent, nous apercevons dans leur nature mme toutes sortes de raisons de les aimer. Ds le moment o elle saccrot d'un membre nouveau, la famille lui rserve une place dans sa pense. Qu'il y entre par naissance, mariage, adoption, elle remarque l'vnement, qui a une date, et se produit dans des conditions de fait particulires : de l nat un souvenir initial qui ne disparatra pas. Plus tard, lorsqu'on pensera ce parent, maintenant assimil entirement au groupe, on se rappellera en quelle qualit il y est entr, et quelles rflexions ou impressions les circonstances particulires du fait purent dterminer chez les membres du groupe. Bien plus, ce souvenir se sera rveill chaque fois que, dans l'intervalle, l'attention des membres de la famille aura t attire par les actes, les paroles ou simplement la figure du mme parent : ils n'oublieront jamais ce qu'il a t d'emble, ds qu'il s'est introduit dans leur groupe, et ce souvenir ou cette notion dterminera la pente que suivront maintenant toutes les impressions qu'il pourra veiller en eux. Ainsi il n'y a pas d'vnement ou de figure dont la famille garde le souvenir qui ne prsente ces deux caractres : d'une part il restitue un tableau singulirement riche, et en profondeur, puisque nous y retrouvons les ralits que, personnellement, nous connaissons par l'exprience la plus intime ; d'autre part il nous oblige l'envisager du point de vue de notre groupe, c'est--dire nous rappeler les rapports de parent qui expliquent son intrt pour tous les ntres. Il en est des personnes et des vnements de la famille comme de beaucoup d'autres. Il semble qu'on se les rappelle de deux faons, soit qu'on voque des images particulires, qui correspondent chacune un seul fait, une seule circonstance : - ce serait ici toute la suite des impressions que nous gardons de chacun des ntres, et qui explique que nous lui attribuions une physionomie originale, et ne le confondions avec aucun autre ; - soit qu'en prononant leurs noms, on prouve un sentiment de familiarit, comme en prsence d'un tre dont on connat bien la place dans un ensemble, la position relative par rapport aux tres et aux objets voisins : ce serait ici la notion des degrs de parent, telle qu'elle s'exprime l'aide de mots. Mais la
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
122
mmoire familiale De se ramne pas, nous l'avons vu, la reproduction pure et simple d'une srie d'impressions individuelles, telles qu'elles traversrent autrefois notre conscience. Et, d'autre part, elle ne consiste pas simplement rpter des mots, baucher des gestes. Enfin elle ne rsulte pas non plus d'une simple association de ces deux sortes de donnes. Quand la famille se souvient, elle use bien de mots, et elle fait bien allusion des vnements ou des images qui furent uniques en leur genre : mais ni ces mots, qui ne sont que des mouvements matriels, ni ces vnements ou images anciennes, qui ne sont que des objets virtuels de sensation ou de pense, ne constituent le tout de la mmoire : un souvenir de famille doit tre autre chose : et il doit cependant nous orienter vers ces images et ces vnements, et, en mme temps, s'appuyer sur ces noms. Rien ne donne mieux que les prnoms l'ide de ce genre de souvenirs, qui ne sont ni des notions gnrales, ni des images individuelles, et qui cependant dsignent la fois un rapport de parent, et une personne. Les prnoms ressemblent aux noms dont on se sert pour reprsenter les objets en ce qu'ils supposent un accord entre les membres du groupe familial. Lorsque je pense, par exemple, au prnom de mon frre, j'use d'un signe matriel qui, par lui-mme, n'est point sans signification. Non seulement il est choisi dans un rpertoire d'appellations fix par la socit, et dont chacune rappelle dans la pense commune certains souvenirs (saints du calendrier, personnages historiques qui l'ont port), mais encore par sa longueur, les sons qui le composent, la frquence ou la raret de son emploi, il veille des impressions caractristiques. Il en rsulte que les prnoms, bien qu'on les ait choisis sans tenir compte des sujets auxquels on les applique, semblent faire partie de leur nature ; non seulement un prnom, du fait qu'il est port par notre frre, change pour nous, mais notre frre, du fait qu'il porte ce prnom, nous parat autre que s'il s'appelait autrement. Comment en serait-il ainsi, si le prnom n'tait qu'une sorte d'tiquette matrielle attache l'image d'une personne, ou une srie d'images qui nous rappellent cette personne ? Il faut qu'au del du signe matriel nous pensions, propos du prnom, quelque chose qu'il symbolise, et dont il est d'ailleurs insparable. Or, si les prnoms contribuent ainsi diffrencier les membres d'une famille, c'est qu'ils rpondent au besoin qu'prouve en effet le groupe de les distinguer pour lui, et de s'entendre la fois sur le principe et le moyen de cette distinction. Le principe, c'est la parent, qui fait que chaque membre de la famille y occupe une position fixe et irrductible toute autre. Le moyen, c'est l'habitude de dsigner celui qui occupe cette position par un prnom. Le signe matriel en tant que tel joue donc un rle tout accessoire : l'essentiel, c'est que ma pense s'accorde alors avec celles qui, dans l'esprit de mes parents, reprsentent mon frre : le prnom n'est que le symbole de cet accord, dont je puis faire chaque instant, ou dont j'ai fait depuis longtemps l'exprience : c'est cet-accord que je pense, bien plus qu'au mot lui-mme, bien que le mot soit compris dans cet accord. C'est dire que ma pense est alors singulirement riche et complexe, puisque c'est la pense d'un groupe aux dimensions de laquelle, pour un moment, s'largit ma conscience. Je sens alors qu'il me suffirait de prononcer ce nom en prsence de nos autres parents pour que chacun d'eux sache de qui je parle, et s'apprte me communiquer tout ce qu'il sait son sujet. Il importe peu d'ailleurs que je ne procde pas effectivement cette enqute : l'essentiel est que je sache qu'elle est possible, c'est--dire que je reste en contact avec les membres de ma famille. La plupart des ides qui traversent notre esprit ne se ramnent-elles pas au sentiment plus ou moins prcis qu'on en pourrait, si on le voulait, analyser le contenu ? Mais on va rarement au bout de telles analyses, ni mme assez avant. Si maintenant je suppose que je poursuive cette enqute jusqu'au bout, je sais bien qu'elle me permettra de substituer au prnom tout l'ensemble des impressions
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
123
particulires et concrtes qu'aux poques successives tous mes parents et moi-mme avons reues de mon frre, dans la mesure o il nous est possible de les reconstituer. Il y a donc bien, derrire le prnom, des images qu'il serait possible, dans certaines conditions de faire reparatre mais cette possibilit rsulte de l'existence de notre groupe de sa persistance, et de son intgrit. C'est pourquoi, aux diffrentes poques, bien que le prnom dsigne pour nous le mme homme, uni nous par les mmes rapports de parent, comme le groupe change, comme son exprience, au sujet du mme parent, s'accrot de beaucoup d'impressions nouvelles, en mme temps qu'elle perd de son contenu, par la disparition de certains tmoins, par les lacunes qui se creusent dans la mmoire de ceux qui subsistent, le souvenir d'un parent ne reprsente pas, des moments successifs, le mme ensemble de traits personnels. Qu'arriverait-il, si tous les membres de ma famille avaient disparu ? Je garderais quelque temps l'habitude d'attribuer un sens leurs prnoms. En effet, lorsqu'un groupe nous a longtemps pntrs de son influence, nous en sommes tellement saturs que, si nous nous retrouvons seuls, nous agissons et nous pensons comme si nous tions encore sous sa pression. C'est l un sentiment naturel, car une disparition rcente ne produit qu' la longue tous ses effets. Au reste, quand mme ma famille serait teinte, qui sait si je ne retrouverais pas des Parents inconnus, ou des personnes qui connurent mes parents, et pour lesquelles ces prnoms et ces noms garderaient encore uni sens ? Au, contraire, mesure que les morts reculent dans le pass, ce n'est point parce que s'allonge la mesure matrielle du, temps qui les spare de nous, mais c'est parce qu'il ne reste rien du groupe au sein duquel ils vivaient, et qui avait besoin de les nommer, que leurs noms petit petit tombent dans l'oubli. Seuls se transmettent et se retiennent ceux d'anctres dont le souvenir est toujours vivant, parce que les hommes d'aujourd'hui leur rendent un culte, et demeurent au moins fictivement en rapport avec eux. Quant aux autres, ils se confondent en une masse anonyme. Il semble, dans quelques socits primitives ou anciennes, que chaque famille dispose en pleine proprit d'un nombre de noms limit, parmi lesquels elle doit choisir ceux de ses membres : ainsi s'explique peut-tre que les Grecs aient eu tendance donner aux petits-fils le nom de leur grand-pre ; mais ainsi s'exprime le fait que des limites s'imposent l'intrt et l'attention d'un groupe qui, en retirant aux morts leurs noms pour les appliquer des vivants, les limine de sa pense et de sa mmoire. L'individu qui ne veut pas oublier ses parents disparus, et s'obstine rpter leurs noms, se heurte assez vite l'indiffrence gnrale. Mur dans ses souvenirs, il s'efforce en vain de mler aux proccupations de la socit actuelle celles des groupes d'hier : mais il lui manque prcisment l'appui de ces groupes vanouis. Un homme qui se souvient seul de ce dont les autres ne se souviennent Pas ressemble quelqu'un qui voit ce que les autres ne voient pas. C'est, certains gards, un hallucin, qui impressionne dsagrablement ceux qui l'entourent. Comme la socit s'irrite, il se tait, et force de se taire, il oublie les noms qu'autour de lui personne ne prononce plus. La socit est comme la matrone d'phse, qui pend le mort pour sauver le vivant. Il est vrai que certains mourants prolongent leur agonie, et il y a des socits qui conservent plus longtemps que d'autres les souvenirs de leurs morts. Mais il n'y a gure entre elles, cet gard, qu'une diffrence de degr.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
124
* ** Nous avons dit que dans toute socit, s'il existe un type d'organisation qui s'impose toutes les familles, dans chaque famille se dveloppe d'autre part un esprit propre, parce qu'elle possde des traditions qui ne sont que les siennes. Comment en serait-il autrement, si la mmoire familiale conserve le souvenir non seulement des rapports de parent qui unissent ses membres, mais aussi des vnements et des personnes qui ont marqu dans son histoire ? Les familles sont comme autant d'espces d'un mme genre, et, puisque chacune d'elles se distingue des autres, il peut arriver soit qu'elles s'ignorent, soit qu'elles s'opposent, soit qu'elles s'influencent et qu'une partie des souvenirs de l'une pntrent dans la mmoire d'une ou plusieurs autres. Au reste, comme les croyances gnrales d'une socit parviennent aux membres des familles par l'intermdiaire de ceux d'entre eux qui sont le plus directement mls la vie collective du dehors, il peut arriver ou bien qu'elles soient adaptes aux traditions de la famille, ou inversement, qu'elles transforment ces traditions. Que l'un ou l'autre se produise, cela dpend d'une part des tendances de la socit plus large o sont comprises toutes les familles, qui peut ou bien se dsintresser plus ou moins de. ce qui s'y passe, ou (comme, sans doute, les socits primitives) rglementer et contrler sans cesse la vie domestique, et, d'autre part, de la force des traditions propres chaque famille, qui ne sont pas sans rapport avec les qualits personnelles de ceux qui les crent et les entretiennent. Si nous n'avons pas quitt nos parents pour fonder un autre foyer, si, fortes personnalits ou figures particulirement originales, ceux-ci surent communiquer et conserver notre groupe une physionomie bien tranche au milieu des autres, si d'ailleurs, pendant tout le temps o nous vcmes en contact avec eux, leur nature morale et leur attitude vis--vis du monde social environnant n'a pas chang sensiblement, eux, leurs actes, leurs jugements, les divers incidents de leur existence resteront toujours au premier plan de notre mmoire. Mais, mme si une famille subit un faible degr l'influence d'autres groupes, il se produit en elle des transformations invitables, morts, naissances, maladies, vieillesse, ralentissement ou accroissement de l'activit organique individuelle de ses membres, qui modifient d'une poque l'autre sa structure interne. On peut concevoir que ceux-ci, ou le plus grand nombre d'entre eux, ne s'en aperoivent pas, si, par exemple, ils vieillissent ensemble, s'ils s'isolent de plus en plus des autres, et s'enferment dans l'illusion qu'ils n'ont point chang, si bien qu'ils parlent des souvenirs d'autrefois comme ils purent en parler lorsqu'ils taient rcents encore : le cadre dans lequel il les replacent ne s'est gure ni modifi, ni enrichi. Le plus souvent ceux d'entre eux qui ne s'isolent point compltement des autres socits domestiques, et de la socit ambiante en gnral, constatent que leurs parents ne sont plus tels aujourd'hui qu'hier : ils redressent alors et compltent l'ensemble des souvenirs familiaux, en opposant aux dires de tmoins vieillis et peu srs l'opinion des hommes d'autres familles, et aussi des analogies, des notions courantes, et l'ensemble des ides admises leur poque, hors de leur groupe, mais autour de lui. C'est ainsi que l'histoire ne se borne pas reproduire le rcit fait par les hommes contemporains des vnements passs, mais, d'poque en-poque, le retouche, non seulement parce qu'elle dispose d'autres tmoignages, mais pour l'adapter aux faons de penser, et de se reprsenter le pass, des hommes d'aujourd'hui.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
125
Lorsqu'un mariage retranche du groupe domestique un de ses membres, le groupe d'o il est sorti a tendance ne pas l'oublier ; mais, dans le groupe o il entre, il est expos penser moins souvent ceux de ses parents qui ne sont plus auprs de lui, tandis que des figures et des vnements nouveaux passent au premier plan dans sa conscience. C'est ce qui avait lieu surtout dans l'antiquit, par exemple dans les socits grecque et romaine. Alors le mariage ne crait pas une famille nouvelle, mais faisait entrer un nouveau membre dans une ancienne famille : celui-ci, au pralable, devait tre dtach d'une autre famille ancienne, et cette sparation radicale ressemblait au retranchement d'un de ses membres que la mort imposerait au groupe. A Rome, la fille qui se marie meurt la famille de ses parents, pour renatre dans la famille de son mari. C'est pourquoi le mariage, du moins dans les premiers temps, alors que la famille demeurait l'unit sociale essentielle, tait un acte religieux, et prenait forme de rite, comme tous ceux qui modifiaient la composition d'un groupe. La femme ainsi marie, dit Fustel de Coulanges, a encore le culte des morts ; mais ce n'est plus ses propres anctres qu'elle porte le repas funbre ; elle n'a plus ce droit. Le mariage l'a dtache compltement de la famille de son pre, et a bris tous ses rapports religieux avec elle. C'est aux anctres de son mari qu'elle porte l'offrande ; elle est de leur famille, ils sont devenus ses anctres. Le mariage lui a fait une seconde naissance. Elle est dornavant la fille de son mari, filiae loco, disent les jurisconsultes. On ne peut appartenir ni deux familles, ni deux religions domestiques ; la femme est tout entire dans la famille et la religion de son mari 1. Or, sans doute, lorsqu'elle entre dans la famille de son mari, la femme n'oublie pas tous ses souvenirs antrieurs : les souvenirs d'enfance sont fortement gravs en elle ; ils sont renouvels par les rapports qu'elle conserve en fait avec ses parents, ses frres et surs. Mais elle doit les mettre d'accord avec les ides et les traditions qui s'imposent elle, au sein de sa famille actuelle. Inversement, une famille romaine ne s'assimilait pas la femme qu'un mariage y introduisait sans que l'quilibre de la pense de ce groupe n'en ft quelque peu branl. Il n'tait pas possible que, par elle, une partie de l'esprit de la famille d'o elle venait ne pntrt pas dans celle o elle entrait 2. La continuit de la famille n'tait bien souvent qu'une fiction. Les mariages taient l'occasion pour chacune d'elles de reprendre contact avec le milieu social plus large o elle tendait s'isoler, et de s'ouvrir de nouveaux courants de pense ; c'est ainsi qu'elles, transformaient leurs traditions. Aujourd'hui, la famille est discontinue : deux poux fondent une famille nouvelle, et la fondent en quelque sorte sur une table rase 3. Sans doute, lorsque, par son mariage, on pntre dans une sphre sociale plus leve, il arrive qu'on oublie sa famille d'origine et qu'on s'identifie troitement avec le groupe domestique dont l'accs vous ouvre aussi un monde plus considr.. Quand, des deux filles du pre Goriot, l'une pouse un comte, l'autre un riche banquier, elles tiennent leur pre distance et effacent de leur mmoire toute la priode de leur vie qui s'est coule dans un milieu sans distinction. Ici encore on peut dire que le mariage n'a pas cr des familles nouvelles, qu'il a permis seulement d'anciennes familles de s'accrotre de membres nouveaux. Mais quand deux personnes de mme niveau social s'unissent,
1 2
FUSTEL DE COULANGES, op. cit., p. 47. Aux temps fodaux de la Chine, les alliances entre familles nobles rpondaient des proccupations diplomatiques : il s'agissait pour chacune d'elles de s'assurer l'appui de telle ou telle. Comment ds lors les femmes, la fois le. gage et l'instrument de telles alliances, se seraient-elles fondues dans la famille de leur mari au point d'oublier celle de leurs parents ? GRANET, La religion des Chinois, 1922, p. 42. DURKHEIM, Cours indit, dj cit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
126
des traditions familiales de force comparable s'affrontent. Aucune de deux familles antrieures ne peut prtendre qu'il lui appartient d'absorber en elle l'poux qui est issu de l'autre. Il devrait en rsulter, et il en rsulte en effet le plus souvent, dans nos socits o la famille tend se rduire au couple, que les familles des parents paraissent finir l o parat commencer la famille fonde par leurs enfants. D'o nat une diffrence d'attitude assez sensible entre celle-ci et celles-l. Il est conforme la nature d'une famille qui ne s'accrot plus, qui est parvenue son terme, de ne pas oublier ceux de ses membres qui la quittent, et, sinon de les retenir, du moins de fortifier, autant qu'il dpend d'elle, les liens par o ils lui demeurent attachs. Les souvenirs qu'elle invoque alors, et qu'elle s'efforce d'entretenir en eux, tirent sans doute leur force de leur anciennet. La famille nouvelle se tourne d'emble vers l'avenir. Elle sent, derrire elle, une sorte de vide moral : car, si chacun des poux se complat encore en ses souvenirs familiaux d'autrefois, comme ces souvenirs ne sont pas les mmes pour l'un et l'autre, ils ne peuvent pas y penser en commun. Pour carter des conflits invitables, qu'aucune rgle accepte par tous deux ne permettrait de trancher, ils conviennent tacitement de considrer comme aboli un pass o ils ne trouvent aucun lment traditionnel propre renforcer leur union. En ralit ils ne l'oublient pas tout fait. Bientt, quand ils auront dj derrire eux une dure de vie commune assez longue, quand des vnements o leurs proccupations se sont mles suffiront leur constituer une mmoire propre, alors, parmi ces nouveaux souvenirs, ils pourront faire place aux anciens, d'autant plus que leurs parents ne seront pas demeurs trangers cette phase de leur existence o ils posaient les bases d'une famille nouvelle. Mais ces souvenirs anciens prendront place dans un nouveau cadre. Les grands-parents, en tant qu'ils se mlent la vie du mnage rcent, y jouent un rle complmentaire. C'est par fragments, et comme travers les intervalles de la famille actuelle, qu'ils communiquent aux petits-enfants les souvenirs qui sont les leurs, et qu'ils leur font parvenir l'cho de traditions presque disparues : ils ne peuvent faire revivre pour eux un ensemble d'ides et un tableau des faits qui ne trouveraient plus place, en tant qu'ensemble et que tableau, dans le cadre o se meut prsent la pense de leurs descendants 1. Ce n'est pas sans effort, et quelquefois sans souffrances et dchirements intrieurs, que s'opre entre deux gnrations cette sorte de brisure qu'aucun rapprochement et retour ne rparera. Or, s'il n'y avait ici que des consciences individuelles en prsence, tout se rduirait un conflit d'images, les unes qui nous retiendraient par l'attrait du pass, par tous nos souvenirs d'enfance, par les sentiments que nos parents veillent en nous, les autres par o nous tiendrions au prsent, c'est--dire aux tres nouvellement apparus dans le cercle de notre exprience. Ds lors, si les sensations et tats affectifs prsents taient assez forts pour que les individus sacrifient le pass au prsent, et s'arrachent aux leurs sans se reprsenter assez vivement les douleurs qu'ils laissent derrire eux, on ne comprendrait pas qu'ils se sentent diviss intrieurement, et que le regret prenne chez eux parfois la forme du remords. D'autre part, si les souvenirs s'imposaient eux avec une vivacit poignante, si, comme il arrive, ils taient mdiocrement pris, et si l'avenir ne se peignait pas leurs yeux en couleurs clatantes, on ne comprendrait pas qu'ils fussent capables de ce sacrifice.
1
Il en est autrement de la famille patriarcale, o le pater familias, tant qu'il vit, demeure le centre de la famille largie. Elle est compose de deux lments. Il y a d'abord le pater familias : c'est le plus ancien ascendant mle dans l'ordre agnatique (descendance masculine). Ensuite viennent tous les descendants issus soit de ce pater familias, soit de ses descendants mles. Quand le pater familias meurt (et alors seulement), les deux frres (s'il y en a deux) issus de lui se sparent et forment une famille part, deviennent leur tour pater familias. La famille comprend, et ne comprend que tous ceux qui sont ns d'un mme ascendant vivant. DURKHEIM, ibid.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
127
Mais ce ne sont pas deux sortes d'images, venues les unes du pass, les autres du prsent, ce sont deux faons de penser, deux conceptions de la vie et des hommes qui s'affrontent. Si, la logique familiale qui oblige un homme se considrer avant tout comme un fils, il n'en pouvait pas opposer une autre, qui l'autorise se considrer comme un mari ou comme un pre, il demeurerait indfiniment dans sa premire famille, ou, s'il en sortait, il serait expos tous les maux matriels et moraux qui accablent l'homme isol. Ses penses et ses souvenirs ne trouveraient plus place dans un cadre qui les empche de se disperser : c'est--dire qu'ils subsisteraient aussi longtemps que sa passion ou son dsir, ou que les circonstances qui les favorisent, mais ne s'appuieraient sur aucune croyance ou conception collective. Dans une socit qui n'admet pas qu'un Montagu pouse une Capulet, l'histoire de Romo et Juliette ne peut garder d'autre ralit que celle d'une image de rve. Il en est tout autrement, lorsqu'on ne quitte une famille que pour en fonder une autre suivant les rgles et croyances de la socit qui embrasse toutes les familles, ou, plus gnralement, pour entrer dans un autre groupe. Lorsqu'un membre d'une famille s'en loigne pour s'agrger un groupe qui n'est pas une famille, par exemple pour s'enfermer dans un couvent, il en trouve la force dans une croyance religieuse qu'il oppose l'esprit familial. Alors, les vnements, jugs du point de vue d'un autre groupe, le seront aussi en partant d'autres principes, en s'inspirant d'une autre logique. Quand la mre Anglique, un moment o l'esprit de famille combattait encore en elle le sentiment de nouveaux devoirs, se rappelait la journe du guichet Port-Royal, elle y voyait sans doute l'preuve la plus dure qu'elle ait eu supporter. Mais ce souvenir dut peu peu s'encadrer tout naturellement dans l'histoire des tapes de sa conversion, et, en mme temps, dans l'ensemble de ses penses religieuses : il devint bientt pour elle, et pour les membres de sa communaut, en mme temps une tradition, un exemple, et comme un aspect de la vrit. Ici en effet on peut dire que deux conceptions de la vie s'opposaient. Mais il n'en est plus exactement de mme, semble-t-il, lorsqu'un membre d'une famille la quitte pour en fonder une autre. En effet, tandis qu'une fille qui entre en religion ne retrouve gure dans le clotre, mme disposes autrement, ou appliques d'autres objets, les penses qu'elle respirait dans le milieu des siens, au contraire, lorsqu'un fils ou une fille se marient, on pourrait croire qu'ils se rclament au fond de la mme logique ou de la logique mme qu'ils ont apprise au sein de leur famille et au milieu de leurs parents. La famille, aprs tout, ne se ramne-t-elle pas un ensemble de fonctions que les hommes des gnrations successives sont appels remplir l'un aprs l'autre ? Le parent qui a t pre autrefois ne l'est plus ou ne l'est qu' peine aujourd'hui, soit qu'il ait disparu, soit que ses enfants aient de moins en moins besoin de lui. Comment son souvenir ne plirait-il point, du moment o il devient un nom, un visage, ou simplement un tre qui prouve et pour qui on prouve des sentiments qui s'expliquent moins par la fonction que par la personne, qui viennent de l'homme plutt que du pre, et qui vont l'homme plutt qu'au pre ? Comment toute la force de l'ide de pre ne se reporterait-elle pas sur celui qui, maintenant, a conscience de l'tre et d'tre regard comme tel, au plein sens du terme ? Pourtant, la famille n'est point comme une forme qui, d'un moment l'autre, changerait brusquement de matire. Lorsqu'un fils se marie, il ne se substitue pas son pre comme un roi qui succde un autre. Une famille qui se cre se pose d'abord en face de celles dont ses deux chefs sont sortis comme un tablissement nouveau. Ce n'est que peu peu et plus tard que le nouveau pre et la nouvelle mre identifient leur fonction avec celle qu'ont exerce avant eux leurs parents, et cette
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
128
identit ne leur apparat jamais que comme une ressemblance plus ou moins approche. Samuel Butler a observ que, si on suppose que les souvenirs passent des parents leurs enfants par la voie de l'hrdit, leur exprience hrditaire ne peut s'tendre, en descendant le cours du temps, au del du moment o ils ont t conus, puisqu' partir de cette poque il n'y eut plus, entre eux et leurs parents, aucune continuit organique. C'est pourquoi, tandis que les processus biologiques se poursuivraient avec une grande sret jusqu' l'ge adulte, parce qu'ils seraient alors guids par l'exprience ancestrale, partir du moment o l'homme est en ge de procrer il serait livr au hasard de ses propres expriences, et son corps ne saurait plus aussi bien s'adapter aux conditions o il lui faut vivre 1. Nous pourrions dire inversement que, de la vie de nos parents nous ne connaissons, par exprience directe, que la partie qui commence quelques annes aprs notre naissance : tout ce qui prcde ne nous intresse gure ; en revanche, quand nous devenons nous-mme mari et pre, nous repassons par une srie d'tats o nous les avons vus passer, et il semble que nous pourrions nous identifier ce qu'ils taient alors, Mais ce n'est pas encore assez dire. Il y a toute une priode, celle qui correspond aux dbuts du nouveau mnage, o prcisment il s'oppose la famille ancienne, parce qu'il est nouveau, et qu'il semble qu'il lui faille se -crer une mmoire originale hors des cadres traditionnels. C'est pourquoi ce n'est qu'assez tard, quand elle a perdu en quelque mesure une partie de son lan primitif, quand approche le moment o elle aussi va, par ses rejetons, donner naissance d'autres groupes domestiques qui se dtacheront d'elle, qu'une famille prend conscience de n'tre que la continuation, et comme une dition nouvelle, de celle d'o elle est sortie. C'est quand un pre et une mre approchent de la vieillesse qu'ils songent le plus leurs parents, en particulier ce qu'ils taient leur ge, et que, toute raison de se distinguer d'eux tendant disparatre, il leur semble que leurs parents revivent en eux et qu'ils repassent sur leurs traces. Mais dans toute la priode de sa vie active et de son expansion la famille, tourne vers l'avenir ou absorbe par le prsent, cherche justifier et renforcer son indpendance par rapport aux traditions familiales en s'appuyant sur la socit plus large des autres familles contemporaines. C'est donc bien une logique, et une conception de la vie nouvelle, plus large, et, pour cette raison, en apparence au moins plus rationnelle, celle qui existe dans cette socit, qu'elle oppose aux faons de penser et aux souvenirs de la famille ou des familles souches. Durant toute notre vie, nous sommes engags, eu mme temps que dans notre famille, dans d'autres groupes. Nous tendons notre mmoire familiale de faon y faire entrer les souvenirs de notre vie mondaine, par exemple. Ou bien nous replaons nos souvenirs familiaux dans les cadres o notre socit retrouve son pass. Cela quivaut considrer notre famille du point de vue des autres groupes, ou l'inverse, et combiner, en mme temps que les souvenirs, les faons de penser propres celle-l et ceux-ci. Quelquefois c'est l'un ou c'est l'autre de ces deux cadres qui l'emporte, et l'on change de mmoire, en mme temps qu'on change ses points de vue, ses principes, ses intrts, ses jugements, lorsqu'on passe d'un groupe l'autre. Ds qu'un enfant va l'cole, sa vie roule en quelque sorte dans deux lits, et ses penses se rattachent suivant deux plans. S'il ne voit les siens qu' de rares intervalles, il faut la famille toute la force acquise prcdemment, et la force, aussi, qui lui vient de ce qu'elle survit l'cole et au lyce, de ce qu'elle vous accompagne et vous enveloppe jusqu'aux approches de la mort, pour qu'elle conserve sa part d'influence. Mais il en
1
Samuel BUTLER, La vie et l'habitude, trad. fran., 1922, pp. 143 et 163.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
129
est de mme, un degr moindre ou plus lev, lorsque le jeune homme ou l'adulte se rattache d'autres milieux, si ceux-ci l'cartent des siens. Avant qu'on entre dans le monde, et aprs qu'on fa quitt, on se suffit, on s'intresse surtout ceux de son intimit la vie en quelque sorte s'intriorise, et la mmoire avec elle : elle s'enferme aux limites de la famille. Pris par le monde, au contraire, on sort de soi, et la mmoire se dploie au dehors : notre vie, ds lors, ce sont nos relations, et notre histoire, c'est leur histoire ; nos dmarches et nos distractions ne se dtachent pas de celles des autres, et on ne peut raconter celles-l ni celles-ci isolment. Lorsqu'on dit que la vie mondaine nous disperse, il faut l'entendre la rigueur. Sans doute on peut n'tre engag qu' demi dans le monde, ou seulement en apparence. Mais on joue alors deux personnages, et en tant qu'on se mle la socit, on accepte de se souvenir comme elle. Telle est sans doute l'volution de la plupart des hommes, qui ne se mlent et ne se confondent avec le groupe social o est le sige de leur activit que dans la priode courte et occupe o leur vie professionnelle et mondaine est son plein. Alors, la diffrence de l'enfant, qui n'a pas encore o se perdre, et du vieillard qui s'est repris, ils ne s'appartiennent plus. Feuilletez les mmoires o tel administrateur, tel homme d'affaires, tel homme d'tat qui s'acquitta en conscience de sa fonction relate les faits qui remplirent ses annes de labeur et d'agitation : plutt que son histoire, c'est celle d'un groupe social, professionnel ou mondain. C'est moins le contenu que le ton et quelques remarques (o d'ailleurs on retrouve souvent les ractions d'un cercle et l'esprit d'une coterie), et, peut-tre, le choix des vnements, qui distinguent un tel rcit individuel ou une telle autobiographie d'un crit historique o l'objet est de raconter les faits tels que les virent un ensemble d'hommes, et dans leur signification par rapport eux. Lorsqu'on dit d'un crivain que son histoire se confond avec celle de ses uvres, cela signifie qu'il ne sortit gure du monde intrieur qu'il s'tait cr : mais lorsqu'on dit d'un homme de guerre, ou d'un mdecin, ou d'un prtre, que son histoire se confond avec celle de ses actes, de ses gurisons, de ses conversions, on laisse entendre au contraire qu'il n'eut gure le temps de rentrer en lui-mme, et que les proccupations communes auxquelles il fut par sa fonction plus particulirement expos, ou prpos, suffirent remplir sa pense. En beaucoup de circonstances o des hommes et des familles diverses participent en commun aux mmes distractions, aux mmes travaux, aux mmes crmonies, l'vnement les frappe moins par ce qui passe en quelque sorte de lui dans la vie de la famille que par ce qui lui en demeure extrieur ; ils le retiennent comme un fait impersonnel. Mais il en est de mme lorsque, dans un groupe de familles voisines, les relations se multiplient, soit que, comme dans les villages paysans elles soient rapproches par le lieu qu'elles habitent, soit que, comme dans les hautes classes, elles puisent dans l'apprciation des autres et qu'elles aient besoin d'entretenir et renouveler au contact de celles-ci le sentiment de leur prminence. Alors les membres de chaque famille introduisent incessamment dans la pense de leur groupe des relations de faits, interprtations et apprciations empruntes aux familles voisines. Que devient la mmoire de la famille ? Elle doit embrasser dans son champ non plus un, mais plusieurs groupes, dont l'importance, l'aspect aussi bien que les relations mutuelles changent chaque moment. Du moment qu'elle envisage du point de vue des autres, aussi bien que du sien, les vnements assez remarquables pour qu'elle les retienne et les reproduise souvent, elle les traduit en termes gnraux. Le cadre d'vnements qui lui permet de retrouver les souvenirs propres la famille dont elle est la mmoire se distinguerait peut-tre aisment des cadres propres aux autres familles, si l'on s'en tenait aux figures, aux images : on dlimiterait ainsi dans l'espace le domaine de chacune, et on ne lui attribuerait que le cours des
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
130
vnements qui s'y sont drouls comme dans autant de cases distinctes. Mais, nous l'avons dit, bien plus que de figures ou d'images, le cadre de la mmoire familiale est fait de notions, notions de personnes et notions de faits, singulires et historiques en ce sens, mais qui ont d'ailleurs tous les caractres de penses communes tout un groupe, et mme plusieurs. Ainsi les traditions propres chaque famille se dtachent sur un fond de notions gnrales impersonnelles, et il n'est d'ailleurs pas facile d'indiquer la limite qui spare celles-ci de celles-l. On comprend qu'une famille qui vient de natre, et sent surtout le besoin de s'adapter au milieu social o elle est appele vivre, tourne le dos aux traditions des groupes parents dont elle vient de s'manciper, et s'inspire surtout de cette logique gnrale qui dtermine les relations des familles entre elles. Mais comme toute famille a, bien vite une histoire, comme sa mmoire s'enrichit de jour en jour, que ses souvenirs, sous leur forme personnelle, se prcisent et se fixent, elle tend progressivement interprter sa manire les conceptions qu'elle emprunte la socit. Elle finit par avoir sa logique et ses traditions, qui ressemblent celles de la socit gnrale, puisqu'elles en manent et qu'elles continuent rgler ses rapports avec elle, mais qui s'en distinguent parce qu'elles se pntrent peu peu de son exprience particulire, et que leur rle est de plus en plus d'assurer sa cohsion et de garantir sa continuit.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
131
Chapitre VI
La mmoire collective religieuse
Retour la table des matires
L'histoire ancienne des peuples, telle qu'elle vit dans leurs traditions, est tout entire pntre d'ides religieuses. Mais, d'autre part, on peut dire de toute religion que, sous des formes plus ou moins symboliques, elle reproduit l'histoire des migrations et des fusions de races et de peuplades, des grands vnements, guerres, tablissements, inventions et rformes, qu'on trouverait l'origine des socits qui les pratiquent. Ce n'est pas un point de vue o se sont placs d'emble ceux qui tudirent les religions de l'antiquit. Mais dj Fustel de Coulanges s'tonnait de retrouver, dans la cit antique, deux religions dont l'une se rattachait au foyer et perptuait le souvenir des anctres, tandis que le culte des Olympiens, publie et national, lui paraissait s'adresser aux puissances naturelles dont les figures reproduites si souvent par la sculpture ou la posie n'auraient t que des symboles 1. Il montrait en mme temps comment, mesure que les familles primitives renonaient leur isolement, et que naissaient des cits, par fusion entre tribus et phratries, nes elles-mmes, pensait-il, de la fusion des familles, des cultes nouveaux apparaissaient, et comment les divi1
FUSTEL DE COULANGES, La cit antique, 20e dition, 1908, p. 136 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
132
nits ponymes n'taient que la commmoration de ces origines et de ces transformations. Il insistait sur la persistance des souvenirs attachs la fondation des cits, et sur le culte qui est rendu leur fondateur plus ou moins mythique le plus souvent, divinit locale d'une tribu, promue la dignit de protectrice d'une cit 1. Une autre ide petit petit s'est fait jour : c'est que dans la Grce classique encore, si l'on regarde d'un peu prs la physionomie et les attributs des dieux olympiens, et, surtout, si on porte son attention sur des crmonies et des ftes, sur des croyances et des superstitions qui n'intressent plus gure, peut-tre, les cercles aristocratiques et cultivs, mais qui vivent d'une vie tenace dans les couches du peuple et parmi les groupes paysans, on s'aperoit qu'il y a, en effet, dans le monde antique, deux religions superposes, et d'ailleurs profondment engages l'une dans l'autre 2 : distinction qui a en apparence un tout autre sens que celle de Fustel de Coulanges, bien que, peut-tre, elle n'en soit qu'un nouvel aspect. La religion grecque serait ne de la fusion de cultes chthoniens et de cultes ouraniens. Les Ouraniens, dieux la volont claire, sont l'objet d'une [Mot grec dans le texte] : on leur rend des honneurs dans l'attente d'un bienfait. Les Chthoniens, au contraire, sont des esprits impurs, que le culte a pour fin d'carter. Les rites ouraniens, ou, si l'on veut, olympiens, se sont superposs aux rites chthoniens : ce sont deux strates de pense religieuse 3. M Ridgeway avait dj tent d'tablir que le duel entre les religions chthoniennes et ouraniennes correspond la guerre entre les Plasges et les envahisseurs nordiques, peuples dont la fusion a produit la Grce classique 4. Et M. Piganiol a soutenu, de son ct, que les croyances et les rites des Romains se rattachent deux religions distinctes et opposes et qui grand'peine se fusionnrent, le culte du Ciel et du Feu d'une part, et, d'autre part, le culte de la Terre et des Forces souterraines. Le culte de la Terre est propre aux paysans mditerranens, Ligures, Sabins, Plasges, le culte du Ciel, aux nomades septentrionaux 5. D'innombrables mythes rappellent la victoire des Ouraniens sur les Chthoniens, des pasteurs venus du Nord sur les laboureurs autochtones : c'est le combat des Dieux et des Gants (les Gants fils de la Terre) ; c'est le mythe du cavalier vainqueur d'un monstre femelle (ces socits primitives de laboureurs taient de type matriarcal) ; c'est Hercule et Cacus. Lorsque les dieux chthoniens et ouraniens s'associent, ou se marient entre eux, c'est le symbole d'une conciliation et d'un compromis entre les cultes et les civilisations, mais. de l'antagonisme ancien il subsiste des traces dans la lgende des dieux. Miss Harrison 6
1 2 3 4 5
Ibid., p. 161 sq. ROHDE (Erwin), Psyche. Seelencult und Unterblichkeitsglaube der Griechen, 5e und 6e Auflage, Tubingen, 1910. La 1re dition est de 1893. PIGANIOL, Essai sur les origines de Rome, 1917, p. 93. RIDGEWAY, Early age of Greece, t. I, p. 374. Op. cit., p. 94. Cette distinction correspondrait celle de la religion plbienne et de la religion patricienne, ibid., p. 132. Les patriciens driveraient des anciens conqurants venus du nord, les plbiens, des populations italiennes indignes. M. Piganiol a indiqu brivement comment l'histoire de beaucoup de civilisations s'explique de mme par un conflit entre deux peuples, qui laisse des traces durables dans leurs institutions et leurs croyances : civilisations phrygienne, thrace, gauloise, smitique, chaldenne, arabe, chinoise, africaine. Op. cit., p. 316 sq. Il a bien voulu nous signaler un article de ROSTOVTSEFF, paru dans la Revue des tudes grecques, 1919, p. 462 : Le culte de la grande desse dans la Russie mridionale, o on lit les passages suivants : Les conqurants smitiques en Msopotamie, les conqurants indo-europens en Asie mineure et en Europe ont apport avec eux le culte d'un dieu suprme , et, au sujet du mythe d'Hracls et de la grande desse : Ce mythe suppose 3 choses : le culte de la grande desse comme base de la religion indigne, le culte du grand dieu comme base de la religion des conqurants, l'apparition d'un peuple et d'une religion mixtes. Prologomena to the study of Greek Religion, 2e dition, 1908, p. 315.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
133
remarque, propos de Junon : La Hra qui, dans l'ancienne lgende argonautique, est reine en Thessalie et patronne du hros Jason, est du vieux type matriarcal ; c'est elle, l'Hra plasgienne, et non Zeus, qui domine ; en fait, Zeus est pratiquement inexistant. A Olympie mme, l'ancien Hraion, o Hra tait adore seule, date d'avant le temple de Zeus. Et elle ajoute : Homre lui-mme n'a-t-il pas le sentiment qu'elle a t marie de force , puisqu'il raconte les perptuelles disputes qui la mettent aux prises avec le pre des dieux ? Bien que le culte ouranien tende au monothisme, le Zeus, dieu du ciel et de la lumire, s'est dcompos, soit que ses attributs aient donn naissance des divinits distinctes 1, soit que son culte se soit contamin au contact des cultes chthoniens. Tandis que les dieux ennemis se sont ainsi rconcilis et forment aujourd'hui une mme famille, o cependant leurs attributs, leur lgende et leur physionomie morale rappellent plus ou moins ce qu'ils furent autrefois, on retrouve lorsqu'on examine les rites, les mmes compromis recouvrant les mmes oppositions. Miss Harrison, qui a tudi si attentivement et a interprt avec tant de pntration le rituel des Grecs, dit : Il est clair que la religion grecque renfermait deux facteurs divers et mme opposs... les rites de service taient rattachs par une tradition ancienne aux Olympiens, aux Ouraniens ; les rites d'aversion , aux fantmes, hros, divinits souterraines. Les rites de service avaient un caractre joyeux et rationnel, les rites d'aversion taient sombres, et tendaient la superstition. Or nous trouvons des services clbrs en l'honneur d'Olympiens, les Diasia en l'honneur de Zeus, les Thargelia, d'Apollon et d'Artmis, les Anthesteria, de Dionysos, et nous constatons qu'ils ont peu ou rien voir avec les Olympiens auxquels on les suppose adresss : ce ne sont pas des rites de sacrifice brl , de joie, de ftes, de combats ; mais des rites souterrains et tristes, de purification et d'adoration de fantmes. Sans doute les rites olympiens reprsentent une couche superpose : les uns n'ont pu sortir des autres 2. Dans la fte des Anthestries, le contraste est saisissant c'est une fte du printemps, consacre Dionysos. Elle dure trois jours. Le premier s'appelle Pithoigia (ouverture des tonneaux). Ils mettaient en perce le vin nouveau Athnes , dit Plutarque. C'est l'offre des premiers fruits. Les tonneaux ouverts, les rjouissances commencent et durent le jour suivant (appel les Chocs ou les Coupes), et le troisime (appel les Chytroy, ou les Pots). C'est le jour des Coupes qu'on clbre le mariage du roi-archonte avec le dieu Dionysos. Le troisime jour a lieu une lutte dramatique. Dans les Acharniens d'Aristophane, on trouve une vive peinture de la fte. Mais, travers cette excitation plutt joyeuse, rgne une Dote de tristesse. Les Anthestries taient anciennement une fte de toutes les mes. Aux Chytroy on sacrifiait, non des dieux olympiens, mais Herms Chtonios. Aux mets prpars
1
Welcker (s'appuyant surtout sur Eschyle) est arriv l'ide que le concept de Zeus, le ciel comme la divinit, est la racine profonde d'o sont sorties toutes les formes de dieux. Par diverses mthodes (tude du calendrier, des noms de mois, des ftes, des dieux qui y prsident ; des traces de formes de culte anciennes : sacrifices humains et dieux forme de ftiches; de la religion des peuples, figs plus tt, du nord et de l'est de la Grce, Macdoniens, Thraces, Bithyniens) on arrive au mme rsultat : ce sont les mmes 4 ou 5 dieux qui apparaissent comme les plus anciens... Or on peut rattacher ces quelques dieux (sauf la principale divinit fminine) au seul dieu du ciel : Zeus ; et cela parait s'imposer pour Dionysos et Apollon. On retrouve ainsi la conception de Welcker. USENER (H.), Gtternamen. Versuch einer Lehre von der religisen Begriffsbildung, Bonn, 1896, p. 275. Miss HARRISON, Op. cit., p. 10.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
134
pour le sacrifice, aucun homme ne gotait : c'est la nourriture des mes, le souper des morts. Le jour des Coupes, ils croyaient que les esprits des morts revenaient parmi eux. Ds le matin, ils avaient l'habitude de mcher de la bourdaine, et de frotter leurs portes avec de la poix : rites apotropiques qui tendent carter les influences des esprits. Le dernier jour, on disait (cette parole tait passe en proverbe) : A la porte, vous Kres, les Anthestries sont termines 1. Ainsi, les hommes se sont levs une religion et une conception gnrale du monde moins sombre : mais c'est dans un cadre prexistant de croyances aux divinits souterraines et l'action malfaisante des morts que ces nouvelles ides durent trouver place. Dans la religion grecque du Ve et du IVe sicle se juxtaposaient des lments, d'origine trs loigne dans le temps, et un contemporain suffisamment dgag de ces croyances, et capable d'entrevoir leurs contradictions, et retrouv en elles les traces d'une volution sociale et morale qui, des coutumes et superstitions primitives, fit succder des croyances et une organisation rituelle plus avances. Mais la loi de la pense collective est de systmatiser, du point de vue de ses conceptions actuelles, les rites et croyances qui lui viennent du pass et qu'elle n'a pu faire s'vanouir : ainsi, tout un travail mythologique d'interprtation altre progressivement le sens, sinon la forme, des anciennes institutions. Aux Thesmophories, ftes d'automne, on accomplissait certains rites en vue de favoriser la croissance des plantes et la naissance des enfants : des objets sacrs qu'on ne pouvait nommer (d'o le nom d'Arrtophories, ou action de porter des choses non nommes, qu'on donnait ces rites) taient promens processionnellement, : images de serpents et formes d'hommes faites en ptes de crales, cnes de sapin, et pores (en raison de leur caractre prolifique) : on dposait la chair des porcs en offrande aux puissances de la terre dans le megara du temple ; puis des femmes qui s'taient purifies pendant trois jours descendaient dans les sanctuaires infrieurs (kathodos et anodos) et dposaient sur des autels les restes de ces btes : tous ceux qui en prenaient et les mlaient leurs semences devaient avoir de bonnes rcoltes. Or, sur ces rites de fertilit, on a construit toute une lgende : cette crmonie (sacrifice des pores) se rattacherait Eubouleus, qui menait patre des pores, et qui fut englouti avec ses btes dans la crevasse o disparut Kor, quand le Dieu des enfers l'enleva. L'interprtation rationaliste laisse cependant subsister le rite, qui prendra plus tard une signification mystique, dans les mystres d'leusis. On assiste en effet, quelquefois, des renaissances imprvues, des retours offensifs de croyances anciennes. Les religions nouvelles ne russissent pas liminer entirement celles qu'elles ont supplantes, et, sans doute, elles ne s'y efforcent pas : elles sentent bien qu'elles-mmes ne satisfont pas tous les besoins religieux des hommes, et elles se flattent, d'ailleurs, d'utiliser les parties encore vivaces des cultes anciens et de les pntrer de leur esprit. Mais il arrive que les circonstances sociales se modifient en ce sens que de nouvelles aspirations se font jour, qui se grossissent de toutes celles que la religion officielle a jusqu' prsent refoules. Il ne faut pas se figurer, d'ailleurs, que c'est l effectivement une rsurrection du pass, et que la socit tire en quelque sorte de sa mmoire les formes demi effaces des religions anciennes pour en faire les lments du nouveau culte. Mais, en dehors de la socit,
1
Miss HARRISON croit que, de mme, les Pithoigia, bien que consacrs Dionysos, et, d'aprs Plutarque, marqus par des bats et des divertissements joyeux, n'en ont pas moins une signification funbre : les tonneaux, jars, voquent les anciennes tombes o l'on inhumait les morts : les Pithoigia des Anthestries perptueraient le rite ancien d'vocation des morts, recouvert par un rite printanier, et les anciens vases mortuaires seraient devenus les tonneaux de vin nouveau ; ou plutt, les deux ides seraient en mme temps prsentes l'esprit des Grecs. Loc. cit., p. 47.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
135
ou, encore, dans les parties de celle-ci qui ont t soumises le moins fortement l'action du systme religieux tabli, quelque chose de ces religions subsiste, hors de la mmoire de la socit elle-mme, qui n'en conserve que ce qui s'est incorpor ses institutions actuelles, mais dans d'autres groupes qui sont demeurs davantage ce qu'ils taient autrefois, c'est--dire qui se trouvent encore engags en partie dans les dbris du pass. Si la philosophie pythagoricienne eut un tel succs en Italie, c'est que celle-ci tait toute pntre d'influences plasgiques ou minoennes... Cette philosophie a trouv des adeptes prcisment dans les rgions italiennes qui ont t le moins, pntres d'lments indo-europens : Italie du Sud, peuples sabelliens, trurie ; faveur qui s'explique si les pythagoriciens ne faisaient qu'exprimer en langage philosophique et systmatiser les vrits de la religion mditerranenne . Le pythagorisme a d'troits rapports avec les cultes primitifs de l'Italie. On ne peut affirmer que Pythagore ait emprunt aux religions italiques plus qu'aux cultes crtois , mais il est sr que sa doctrine ne s'est rpandue en Italie que parce qu'elle tait conforme aux ides religieuses d'une fraction considrable des Italiens , mais de cette fraction, prcisment, qui ne s'tait pas laiss gagner au culte officiel des dieux patriciens 1. Ici, nous avons l'exemple d'une philosophie et d'une religion ( les superstitions pythagoriciennes ) 2, introduite et en partie labore dans une socit ou dans un groupe de socits, en opposition avec la religion officielle des classes dominantes et d'une partie, (tu peuple, mais en accord, avec les croyances qui subsistent dans des rgions tendues de la mme socit et auxquelles la religion officielle a d faire leur part. Mais ce culte nouveau n'en rsulte pas moins, en mme temps, d'une influence et d'une pntration extrieure, si bien que l'on peut dire ceci : d'une part, ce n'est pas seulement le souvenir des croyances anciennes qui reparat, ce sont les croyances anciennes subsistantes, mais combattues ou refoules, qui, la faveur de circonstances nouvelles, s'affirment ; d'autre part, les circonstances qui les fortifient sont les mmes qui les ont fait natre : la mise en contact avec des socits de mme race, de mme civilisation, qui renouvellent en quelque sorte le sol, lui restituent sa constitution primitive, et recomposent le mme milieu ethnique et moral. Mais c'est ce qui a d se produire souvent : admettons que les Aryens indo-europens conquirent les pays du Sud, et qu'ils imposrent ceux-ci, en se pliant d'ailleurs des compromis, leurs dieux et leur culte ; mais il y eut, ensuite, des invasions et retours offensifs de populations mditerranennes ; le rveil des cultes anciens est donc d, dans bien des cas, ce que se recrent les conditions o ils sont ns autrefois, et non ce que le souvenir de ces cultes reparat dans la mmoire de la socit qui les a abolis ou se les est assimils. Si la socit conserve ainsi, dans son organisation religieuse, des lments d'anciens rites ou d'anciennes croyances, ce n'est pas seulement pour donner satisfaction aux groupes les plus retardataires. Mais, pour apprcier exactement une dmarche ou un progrs religieux, les hommes doivent se rappeler, au moins en gros, d'o ils sont partis ; d'ailleurs, un grand nombre d'ides nouvelles ne se prcisent qu'en s'opposant. C'est ainsi que la lumire projete par les cultes olympiens sur l'univers et dans tous les replis de l'me humaine resplendissait d'autant plus qu'il subsistait dans la nature certains coins d'ombre et de mystre, hants encore par des animaux monstrueux ou
1 2
PIGANIOL, op. cit., p. 130 sq. Le rite de l'incinration est interdit aux Pythagoriciens; ils vnrent Rha, Dmter, et Pythagore a propos une thorie du culte des desses mres ; ils conservent les vtements de lin... ; ils attachent une valeur superstitieuse au nombre 4... ; la fve leur est interdite. Ibid., p. 131.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
136
des gnies ns de la terre, et qu'il subsistait dans l'me des terreurs par o les hommes civiliss d'alors s'apparentaient aux peuplades primitives. Le monde homrique, si dgag et clair, laisse encore quelque place ces anciennes superstitions : on y trouve des traces du culte des morts ; bien qu'Homre paraisse convaincu qu'aprs la mort l'ombre s'enfuit, et ne vient jamais plus troubler les mortels, l'ombre de Patrocle apparat en songe Achille, et Achille lui consacre un sacrifice qui rappelle les anciennes immolations de victimes humaines. La Nekuya , la descente d'Ulysse aux enfers, semble un arrire-fond sur lequel se dessine plus nettement l'Olympe aux brouillards faits de lumire, et une socit d'hommes avant tout amoureux de la vie. Pour que la supriorit des puissances ouraniennes ressorte, il faut qu'on voque confusment l'antique assaut des Gants, l'crasement ou l'asservissement des anciens dieux. De mme, pour montrer mieux l'originalit de la doctrine chrtienne, les fondateurs du christianisme, en particulier saint Paul, l'opposent au judasme traditionnel : c'est en des termes tirs de l'Ancien Testament, et par interprtation de prophties que les Juifs n'entendaient qu'au sens littral, et que la religion nouvelle pntre de son esprit, que celle-ci se dfinit. Paul considre que le rgne de la Loi a d prcder le rgne de la Grce, et qu'il a fallu que les hommes apprissent d'abord ce que c'tait que le pch, pour que la foi en l'Esprit et la misricorde nous en affranchissent 1. Loin d'annuler la Loi par la Foi, Paul croit que le christianisme la confirme. Dans les textes fondamentaux du christianisme, dans les vangiles et les, ptres, l'opposition entre les pharisiens et les chrtiens, entre le judasme orthodoxe et la religion du Fils de l'homme est, rappele incessamment : c'est de l'histoire, et on peut dire que le christianisme est en effet avant tout l'expression en articles de foi, en dogmes et en rites, d'une rvolution morale qui fut un vnement historique, du triomphe d'une religion de contenu spirituel sur un culte formaliste, et, en mme temps, d'une religion universaliste, qui ne fait pas acception de races ni de nations, sur une religion troitement nationale. Mais cette histoire, et la religion elle-mme, se comprendrait mal, on n'en saisirait pas toute la porte, si elle ne se dtachait pas sur un fond judaque. Surtout, lorsqu'une socit transforme ainsi sa religion, elle s'avance un peu dans l'inconnu. Elle ne prvoit pas, ds le dbut, toutes les consquences des principes nouveaux qu'elle pose. Ce sont des forces sociales qui, parmi d'autres, l'emportent,. et dplacent le centre de gravit du groupe : mais, pour que celui-ci conserve son quilibre, il faut que s'opre un travail de radaptation les unes aux autres de toutes les tendances, de toutes les institutions qui font sa vie commune. La socit sent bien que cette religion nouvelle n'est pas un commencement absolu. Ces croyances plus larges et plus profondes, elle veut les adopter sans briser entirement le cadre de notions dans lequel elle a grandi jusqu'alors. C'est pourquoi en mme temps qu'elle projette dans son pass les conceptions qu'elle vient d'laborer, elle se proccupe d'incorporer la religion nouvelle les lments des vieux cultes que celle-ci peut s'assimiler. Elle doit persuader ses membres qu'ils portaient dj en eux au moins, en partie ces croyances, et mme qu'ils retrouvent simplement celles dont ils s'taient depuis quelque temps carts. Mais ce ne lui est possible que si elle ne heurte pas de front tout le pass, si elle en conserve au moins les formes. La socit, au moment mme o elle volue, fait donc un retour sur le pass : c'est dans un ensemble de
Par la loi seule je connais le pch... Jadis, quand j'tais sans Loi, je vivais, mais le commandement me fut donn, le pch vint natre, et moi, je mourus. PAUL, ptre aux Romains, VII, 7.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
137
souvenirs, de traditions et d'ides familires, qu'elle encadre les lments nouveaux qu'elle pousse au premier plan. Remarquons, en effet, que par exemple, la mythologie homrique reste michemin entre les reprsentations religieuses et les fictions de la littrature. Supposons qu'on et alors, dans les classes aristocratiques et cultives de la Grce, obi pleinement la pousse rationaliste, qu'on et limin toute croyance une survivance des mes sous forme de fantmes, l'Hads, qu'on se ft imagin que d'aucune manire les hommes, ni pendant leur vie, ni aprs leur mort, ne peuvent entrer en relations avec les dieux : toutes les crmonies religieuses eussent, du mme coup, perdu leur prestige, et l'imagination, potique en et pris de plus en plus son aise avec l'Olympe et ses habitants. Si le polythisme homrique voulait rester une religion, forc lui tait de prendre au srieux un certain nombre des croyances qu'il aspirait supplanter. Ce qui empche les Grecs de ce temps de traiter les lgendes et les figures des dieux aussi lgrement que, plus tard, un Lucien, c'est qu'ils se sentent encore proches d'une poque o la religion n'avait pas t encore ce point humanise, c'est que, dans les anciens sanctuaires, aux anciens lieux prophtiques, il faut des dieux rels pour recueillir l'hritage des anciens monstres, des divinits locales, des puissances de la vgtation : on transforme leur aspect, mais on est oblig de leur conserver leur nature de dieux, au moins pour un temps.
De mme, si le christianisme ne s'tait point prsent comme la continuation, en un sens, de la religion hbraque, on peut se demander s'il aurait pu se constituer luimme comme religion. Lorsque Jsus dit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton. cur, de toute ton me, de toute ta pense. Voil le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-mme 1 , on voit bien qu'il avance une doctrine qui pourrait s'interprter en un sens purement moral. Aussi les fondateurs du christianisme ont-ils pris soin de multiplier les rapprochements entre les prophties de l'Ancien Testament et les dtails ou les paroles de la vie du Christ qui en reprsentent l'accomplissement. C'est en s'appuyant sur la promesse d'Abraham que Paul considre les Gentils comme les vrais descendants d'Isaac, les enfants non de la servante, mais de la femme libre 2, et par consquent les hritiers lgitimes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas t limin par le fils de l'homme ou, du moins, s'il a chang d'aspect, il n'en garde pas moins sa nature de Dieu. Au reste, mesure que le christianisme saccrot, l'attention se dtourne de cet aspect qui le reprsente comme une branche greffe sur une plante trangre, mais les ides thologiques fondamentales qu'il a empruntes au judasme subsistent ; il faut bien, en effet, que la morale chrtienne s'entoure d'une armature dogmatique et ritualiste, faite tout entire d'ides et d'institutions traditionnelles, si elle veut garder le prestige d'une religion.
1 2
MATTHIEU, XXII, 37-39. ptre aux Galates, IV, 22-31.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
138
* ** VI - ii
Retour la table des matires
Mais la religion reproduit le pass en un autre sens encore. Dtournons notre attention de l'origine ou du sens profond des mythes. Ne cherchons plus derrire ces traditions les vnements gnraux, migrations et fusions de peuples, dont elles sont peut-tre l'cho. Prenons-les pour ce qu'elles sont aux yeux des fidles. Il n'en est pas qui ne nous offre le tableau de la vie, des actes et de la figure d'tres divins ou sacrs. Sous des traits humains, animaux, ou autrement, l'imagination leur prte en tout cas une forme d'existence sensible : ils existent ou ils sont apparus en certains lieux, certaines poques. Ils se sont manifests sur la terre 1. Et c'est partir de ce moment que les hommes ont gard le souvenir des dieux ou des hros, qu'ils ont racont leur histoire, et que, par un culte, ils l'ont commmore. Si l'on passe en revue les diffrentes parties du culte chrtien, on reconnat que chacune d'elles est, en effet, essentiellement la commmoration d'une priode ou d'un vnement de la vie du Christ 2. L'anne chrtienne se ramasse en quelque sorte autour de la priode pascale qui est consacre reproduire, par l'ordre mme des crmonies et le contenu des prdications et des prires, les diverses phases de la Passion. Elle est, sous un autre point de vue, puisque chaque jour est consacr un saint, la commmoration de tous ceux qui contriburent constituer, diffuser ou illustrer la doctrine chrtienne. Avec une priodicit plus grande, chaque semaine, le dimanche, la messe laquelle tout fidle est tenu d'assister commmore la Cne. Mais la doctrine chrtienne tout entire repose sur une histoire, et se confond presque avec elle. Si les anciens paens n'ont pu faire leur salut, c'est que les vnements de l'histoire chrtienne ne s'taient pas encore drouls, et qu' la diffrence des Juifs ils ne pouvaient connatre les prophties, qui les annonaient avant qu'ils se fussent produits. Les Juifs ont prvu la venue du Messie ; les disciples de Jsus ont t les tmoins de sa vie, de sa mort et de sa rsurrection ; toutes les gnrations chrtiennes qui se sont succd depuis ont reu la tradition de ces vnements. Ainsi toute la substance du christianisme consiste, depuis que le Christ ne s'est plus montr sur la terre, dans le souvenir de sa vie et de son enseignement. Mais comment expliquer que la religion chrtienne, tourne ainsi tout entire vers le pass (et il en est d'ailleurs de mme de toute religion), se prsente cependant
1
Lorsqu'on examine de prs les rites des peuples primitifs qui, d'aprs eux, exercent une action sur les choses, on s'aperoit qu'ils consistent souvent reproduire quelque drame mythologique, c'est-dire mettre en scne un hros ou anctre lgendaire auxquels on reporte l'invention d'un procd magique ou technique nouveau. Sur les rites commmoratifs dans ces socits, voir, en particulier, Yrio HIRN, The Origins of Art, a psychological and sociological inquiry, London, 1900, chap. XVI. Les thologiens et les historiens ont toujours reconnu qu'une des fins de la liturgie c'est de rappeler le pass religieux et de le rendre prsent au moyen d'une sorte de reprsentation dramatique. Il n'y a pas de liturgie qui chappe cette rgle. L'anne liturgique est un mmorial. Le cycle des rites annuels est devenu la commmoration d'une histoire nationale ou religieuse. DELACROIX, La religion et la loi, pp. 15-16.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
139
comme une institution permanente, qu'elle prtende se placer en dehors du temps, et que les vrits chrtiennes puissent tre la fois historiques et ternelles ? Si l'on considre des systmes religieux o l'essentiel est l'enseignement moral apport par leur fondateur, on comprend que les vrits sur lesquelles ils reposent aient une nature intemporelle, et que passe l'arrire-plan la figure et le souvenir de, celui qui les a dcouvertes. C'est sans doute ce qui s'est ralis dans le bouddhisme. Le bouddhisme, en effet, consiste avant tout dans la notion du salut, et le salut suppose uniquement que l'on connat la bonne doctrine et qu'on la pratique. Sans doute elle n'aurait pu tre connue si le bouddha n'tait venu la rvler ; mais, une fois que cette rvlation fut faite, luvre du bouddha tait accomplie. A partir de ce moment, il cessa d'tre un facteur ncessaire de la vie religieuse. Et c'est pourquoi le bouddha ne peut tre un dieu. Car un dieu, c'est avant tout un tre vivant avec lequel l'homme doit compter et sur lequel il doit compter ; or le bouddha est mort, il est entr dans le Nirvna ; il ne peut plus rien sur la marche des vnements humains 1. L'ide que le chef divin de la communaut... demeure rellement parmi les siens... de telle sorte que le culte n'est autre chose que l'expression de la perptuit de cette vie commune, cette ide est tout fait trangre aux bouddhistes. Leur matre eux est dans le Nirvna : ses fidles crieraient vers lui qu'il ne pourrait les entendre 2. Sans doute le souvenir ineffaable de la vie terrestre du bouddha, la foi dans la parole du bouddha comme dans la parole de la vrit, la soumission la loi du bouddha comme la loi de la saintet, tous ces facteurs ont eu, cela va sans dire, la plus grande influence sur la tournure qu'ont pris, au sein de la communaut bouddhique, la vie et le sentiment religieux 3. Mais le bouddha n'est ni un mdiateur, ni un sauveur. La croyance aux anciens dieux avait disparu devant le panthisme de la doctrine de l'Atman ; ... l'empire de ce monde soupirant vers la dlivrance n'appartenait plus un dieu ; il tait pass la loi naturelle de l'enchanement des causes et des effets. Bouddha ne devait donc tre (sans aucune supriorit mtaphysique) que le grand Connaissant et le propagateur de la connaissance 4 : personnage historique, et qui n'est pas seul de son espce, puisqu'on en vint admettre qu'il y avait eu et qu'il y aurait un nombre illimit de bouddhas ; mais, enfin, personnage dont l'existence est circonscrite entre les dates de sa naissance et de sa mort. Comme, d'ailleurs, le bouddhisme... consiste avant tout dans la notion du salut , et que le salut suppose uniquement que l'on connat la bonne doctrine et qu'on la pratique , il y a bien, dans le bouddhisme, ct d'une morale, un lment religieux (sans lequel le bouddhisme, vrai dire, ne serait peut-tre pas une religion), mais un lment religieux qui se ramne tout entier des souvenirs. Ce qui est intemporel, c'est la morale : ce qu'il s'y mle de religion, au contraire, se rapporte une suite d'annes historiques bien dfinies et depuis longtemps close. Il en est tout autrement du christianisme. Ici, le Christ n'est pas seulement un Connaissant, ou un Saint : c'est un Dieu. Il ne s'est pas born nous indiquer la voie du salut : mais aucun chrtien ne peut faire son salut que par l'intervention, et grce l'action efficace de ce Dieu. Le Christ, aprs sa mort et sa rsurrection, n'a point perdu contact avec les hommes, il demeure perptuellement au sein de son glise. Il n'y a point. de crmonie du culte o il ne soit prsent, point de prire et d'acte d'adoration qui ne s'lve jusqu' lui. Le sacrifice par lequel il nous donne son corps
1 2 3 4
DURKHEIM, Les formes lmentaires de la vie religieuse p. 44. OLDENBERG, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communaut, trad. fr., p. 368. Ibid., p. 319. Ibid., p. 320 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
140
et son sang n'a pas eu lieu une seule fois : il se renouvelle intgralement chaque fois que les fidles sont assembls pour recevoir l'Eucharistie 1. Bien plus, les sacrifices successifs, clbrs des moments distincts, en des lieux distincts; ne sont qu'un seul et mme sacrifice 2. De mme, les vrits chrtiennes n'ont pas t rvles aux hommes par le Christ dans de telles conditions qu'il suffise, tout jamais, de les mditer pour en comprendre le sens : la rvlation au contraire se renouvelle sans cesse, ou plutt elle se poursuit, puisque les hommes, pour les comprendre, ont besoin d'tre clairs par Dieu. L'tude des textes vangliques et de l'criture, en l'absence de telles lumires surnaturelles, peut contribuer aussi bien nous carter de Dieu qu' nous en rapprocher, lorsque nous en remarquons surtout les obscurits et les contradictions : tot paginarum opaca secreta 3. Comment la vrit ternelle se serait-elle exprime tout entire dans des paroles humaines comprises dans un temps limit, et n'est-ce pas dj trop peu, pour la connatre, que l'enseignement de l'glise, qui. a fait le choix de ces textes et, travers tant de sicles, les a interprts ? Le dogme, comme le culte, n'a pas d'ge : il imite, dans le monde changeant de la dure, l'ternit et l'immuabilit de Dieu, autant que le peuvent des gestes, des paroles, et des penses humaines. Il n'en est pas moins vrai que l'essentiel du dogme et du rite s'est fix ds les tout premiers sicles de l're chrtienne. C'est bien dans ce premier cadre que tout le reste a t replac. Chaque fois que l'glise a d juger de nouvelles thses, de nouveaux cultes ou de nouveaux dtails du culte, de nouveaux modes de vie et de pense religieuses, elle s'est demand d'abord s'ils taient conformes au corps des usages et croyances de cette premire priode. L'essentiel du dogme et du culte se ramne bien ou tend se ramener ce qu'ils taient alors. L'glise se rpte indfiniment, ou prtend tout au moins se rpter. Aux premiers temps du christianisme, aux actes et aux paroles qui eurent alors le plus de retentissement, l'glise accorde bien une situation privilgie. Ce qu'elle place maintenant hors du temps, titre de vrits ternelles, s'est droul dans. une dure historique bien dtermine, quoique trs recule si l'on tient compte des formes successives revtues depuis par toutes les autres institutions sociales. Si donc l'objet de la religion semble soustrait la loi du changement, si les reprsentations religieuses se fixent, tandis que toutes les autres
1
Voir, ce sujet, toute la polmique entre Luther, d'une part, Carlostadt, Zwingle et Oecolampade de l'autre, entre 1523 et 1530. En particulier l'crit de LUTHER, Dass diese Worte : das ist mein Leib, etc., noch feststehen. Wider die Schwarmgeister, 1527 : Luthers Werke, 1905, Berlin, 2e Folge, Reformatorische, und polemische Schriften, t. II, pp. 371, 373, 415 et 416, 421 et 422. Luther affirmait que le manger dont Jsus-Christ parlait n'tait non plus un manger mystique, mais un manger parla bouche; ... qu'on voyait bien que son intention tait de nous assurer ses dons en nous donnant sa personne ; que le souvenir de sa mort, qu'il nous recommandait, n'excluait pas la prsence . BOSSUET, Histoire des variations des glises protestantes, 1688, Paris, t. I, p. 90. ZWINGLE lui-mme, qui inclinait au sens figur, disait cependant que ce n'tait pas un simple spectacle, ni des signes tout fait nus; que la mmoire et la Foy du corps immol et du sang rpandu soutenait notre me; que cependant le Saint-Esprit scellait dans nos curs la rmission des pchs, et que c'tait l tout le. mystre. Ibid., p. 85. L'glise romaine attachait beaucoup d'importance ce que les rites, de la communion continssent une expression trs claire et trs vive de l'unit ecclsiastique. C'est cela que se rattache l'usage du fermentum, du pain consacr envoy de la messe piscopale aux prtres chargs de clbrer dans les tituli ; c'est encore cette signification qui se retrouve dans le rite des sancta, du fragment consacr la messe prcdente, qui est apport au commencement de la messe et mis da-as le calice au Pax Domini. C'est partout, dans toutes les glises de Rome, c'est toujours, dans toutes les assembles liturgiques, celle d'aujourd'hui comme celle d'hier, le mme sacrifice, la mme eucharistie, la mme communion. L. DUCHESNE, Origines du culte chrtien, p. 196. Saint AUGUSTIN, Confessions, t. XI, p. 2.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
141
notions, toutes les traditions qui forment le contenu de la pense sociale voluent et se transforment, ce n'est point qu'elles soient hors du temps, c'est que le temps auquel elles se rapportent se trouve dtach, sinon de tout ce qui prcde, du moins de tout ce qui suit ; en d'autres termes, l'ensemble des souvenirs religieux subsiste ainsi l'tat d'isolement, et se spare d'autant plus des autres souvenirs sociaux que l'poque o ils se sont forms est plus ancienne, si bien qu'il y a un contraste plus marqu entre le genre de vie et de pense sociale qu'ils reproduisent, et les ides et modes d'action des hommes d'aujourd'hui. Il y a en effet ceci de particulier dans la mmoire du groupe religieux, qu'au lieu que les mmoires des autres groupes se pntrent mutuellement et tendent s'accorder l'une avec l'autre, celle-ci prtend s'tre fixe une fois pour toutes et, ou bien oblige les autres s'adapter ses reprsentations dominantes, ou bien ignore les autres systmatiquement, et, opposant sa propre permanence leur instabilit, les relgue un rang infrieur. Entre ce qui est donn une fois pour toutes, et ce qui ne l'est que transitoirement, il y a ds lors une diffrence non de degr, mais de nature, et l'on comprend qu'elle se traduise dans la conscience religieuse en une opposition radicale. Puisque tout le reste de la vie sociale se dveloppe dans la dure, il faut bien que la religion en soit retire. De l l'ide qu'elle nous transporte dans un autre monde, que son objet est ternel, et immuable, et que les actes religieux o il se manifeste, bien qu'ils se produisent une date et en un lieu, imitent tout au moins et symbolisent, par leur rptition indfinie et leur aspect uniforme, cette ternit et cette fixit. Il n'y a peut-tre qu'un ordre de phnomnes dans la vie sociale qui prsente les mmes caractres, et puisse voquer la mme ide : ce sont les reprsentations qu'veille dans les groupes le spectacle des grands faits naturels priodiques, les lois de la nature. Et il est remarquable qu'un grand nombre de religions se soient en effet coules en quelque sorte dans le moule des variations saisonnires, que l'alternance de leurs crmonies et de leurs ftes reproduise celle des aspects successifs de la terre et du ciel. Mme dans les religions les plus modernes, les plus volues et intellectualises, la notion de Dieu et de sa volont se rapproche singulirement de l'ide de l'ordre naturel, et bien des dveloppements thologiques s'inspirent d'une telle comparaison. Mais, dans le catholicisme en particulier, c'est en un sens tout spiritualiste que s'interprte la fixit de la religion. La religion s'est adapte aux variations saisonnires, elle a droul le drame de la vie chrtienne dans le cadre de l'anne profane, mais elle s'est efforce en mme temps d'entraner dans le courant de sa pense propre et d'organiser suivant son rythme les reprsentations collectives du cours et des divisions du temps. D'autre part la religion chrtienne n'a jamais envisag l'ordre de la nature matrielle que comme le symbole d'un ordre cach et d'une autre nature. La science humaine et toutes ses notions ne se distinguent pas pour elle essentiellement des autres dmarches de la pense profane : elle demeure ses yeux incertaine et changeante : elle est soumise la loi du temps : la ncessit qu'elle nous dcouvre dans les choses est toute relative notre connaissance imparfaite. Les vrits religieuses seules sont dfinitives et immuables. Il n'y a, en somme, aucun intermdiaire, aucun moyen terme entre ce qui est donn une fois pour toutes, et ce qui n'existe ou n'est vrai que pour une poque, et il n'y a que la pense sociale d'une poque privilgie, et du groupe qui se borne la conserver et la reproduire, qui puisse s'opposer, par ce caractre de fixit, aux penses sociales phmres de toutes les autres poques ou des autres groupes. Si tel est bien l'objet de la religion, si elle vise conserver intact, travers les temps, le souvenir d'une poque ancienne, sans aucun mlange de souvenirs ultrieurs, il faut s'attendre ce qu'aussi bien le dogme que le rite reoivent de sicle en
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
142
sicle des formes plus arrtes, afin de rsister mieux aux influences du dehors, d'autant plus dangereuses que la diffrence augmente entre le groupe religieux et tous les autres. Au reste, bien que la rvolution morale et sociale qui se trouva ainsi commmore ait mrit peut-tre, par sa profondeur comme par son tendue, de passer au premier plan, d'autres vnements se sont produits depuis, qui ou bien prcipitrent l'volution dans le mme sens, ou bien ouvrirent l'activit et la pense des hommes des voies nouvelles. Pourquoi la mmoire religieuse ne se serait-elle pas enrichie de tant d'expriences non moins dcisives peut-tre que la prcdente ? Nous n'examinerons pas jusqu' quel point elle demeura effectivement impermable tout cela. En tout cas, elle a prtendu s'y fermer, et on ne conoit pas en effet, si elle tenait subsister, qu'elle ne se ft pas, autant qu'il lui tait possible, replie sur elle-mme. Mais, tandis qu'au dbut elle trouvait, dans le milieu social ambiant, des tmoignages, des souvenirs, et mme des faits nouveaux qui la pouvaient alimenter et renforcer sans la dtruire ou l'altrer gravement, puisque la socit tait encore toute proche des vnements que cette mmoire voulait fixer, mesure qu'elle s'en est carte, au contraire, s'accroissait la somme des vnements sans rapport avec ceux-ci, auxquels correspondaient des souvenirs sans rapport avec les siens. La mmoire du groupe religieux, pour se dfendre, a pu quelque temps empcher d'autres mmoires de se former ou de se dvelopper autour d'elle. Elle a triomph facilement des religions anciennes, mmoires si loignes de leur objet et qui, depuis longtemps, ne vivaient plus gure que sur elles-mmes : elle s'est assimil tout ce qui, de leur contenu, pouvait passer en elle, c'est--dire tout ce qui en tait le plus rcent, et avait reu la marque de l'poque mme o le christianisme tait n, c'est--dire encore ce qui en elles tait le plus extrieur : dbris de religions en voie de dcomposition, entrs dans la conscience collective des premiers sicles de l're chrtienne, et dont l'histoire chrtienne du temps gardait elle-mme des traces. Elle s'est assimil de mme bien des ides philosophiques, juridiques, politiques, morales, dbris, encore, d'anciens systmes, ou lments pars non encore rattachs en un ensemble. A cette poque, en effet, dans le christianisme tout proche de ses origines on ne distinguait pas encore facilement ce qui tait souvenir, et conscience du prsent : pass et prsent se confondaient, parce que le drame vanglique ne paraissait pas encore termin. On attendait toujours le dernier acte. On n'avait pas encore cart l'espoir du retour du Christ et de l'apparition de la Jrusalem cleste 1. Dans le culte, ct de l'Eucharistie, les charismes, ou effusions extraordinaires de l'Esprit saint, tenaient une place essentielle : les gurisons ou autres actes miraculeux, les visions, la prophtie, la glossolalie 2. Le christianisme ne s'opposait pas encore la pense collective contemporaine comme le pass un prsent sans attaches avec lui, mais il pouvait aspirer lgitimement, tant engag lui-mme dans le prsent, imposer sa forme toutes les croyances comme toutes les institutions. Bien plus, dans le domaine spirituel, ses plus grands adversaires se rclamaient de la mme tradition que lui : c'taient des mmoires diffrentes, mais, toujours, de la mme suite d'vnements, et du mme enseignement. Ce qui distingue les unes des autres les hrsies, et les doctrines plus ou moins orthodoxes, ce n'est pas que les unes s'inspirent du prsent ou d'un pass trs proche, les autres du pass lointain, c'est la faon dont chacune rapporte et comprend une mme priode du pass, assez voisine encore pour qu'il y ait son sujet une grande diversit de tmoignages et de tmoins. Sans doute, certaines parties
1
L'vangile de saint Jean dans la force de sa rcente popularit, veillait la proccupation du Paraclet; l'Apocalypse offrait d'imposantes descriptions de la Jrusalem cleste et du rgne de mille ans... Le droit des prophtes parler au peuple chrtien au nom de Dieu tait consacr par la tradition et par l'usage. L. DUCHESNE, Op. cit., t. I, p. 272. Voir tout ce chapitre sur le montanisme. Ibid., t. I, p. 47.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
143
de la tradition durent se fixer alors avant les autres : mais elles taient trop solidaires les unes des autres, et toutes plongeaient dans un pass trop rcent encore, pour qu'aucune pt s'isoler, pour que la conscience chrtienne ne les confrontt plus chaque jour toutes entre elles. C'est la priode de formation, o la mmoire collective est encore disperse entre une multitude de petites communauts loignes dans l'espace : celles-ci ne s'tonnent, ne s'inquitent ni ne se scandalisent de ce que les croyances ne s'accordent pas toujours d'une communaut l'autre, et de ce que celle d'aujourd'hui n'est plus exactement celle d'hier : elles ont fort faire de convertir les incroyants, et cherchent plutt propager leur foi qu' se mettre d'accord avec les autres communauts chrtiennes. Mais n'en est-il pas de mme de toute pense collective, lorsqu'elle se proccupe plutt de vivre que de se souvenir ? Nous sommes si habitus aux formes actuelles de la liturgie. et du dogme, de la hirarchie et de la discipline, que nous avons quelque peine comprendre jusqu' quel point l'glise chrtienne, qui se distingue actuellement de faon si nette de la socit temporelle, y tait alors engage, ou plutt ne s'en tait pas encore dgage, combien d'ides circulaient de l'une l'autre, et comme on apportait peu de rigueur et de formalisme dans la pratique de la religion et les diverses fonctions de l'glise. Certes l'adhsion au christianisme tait une dmarche de trs grave consquence. Il fallait, sur bien des points, se squestrer de la vie ordinaire. Les thtres, par exemple, et, en gnral, les jeux publics, coles d'immoralit, figuraient au premier plan des pompes de Satan auxquelles il fallait renoncer. Il en tait de mme de la fornication. Il va de soi qu'on rompait avec l'idoltrie ; mais il n'tait pas toujours ais d'en viter le contact : la vie prive des anciens tait si pntre de religion ! 1. Mais, dans le cadre des ides chrtiennes, tous les abus auxquels les fidles renonaient, les crmonies paennes dont ils s'abstenaient, avaient leur place. On ne pouvait gure penser la religion sans voquer toutes les circonstances de la vie o elle imposait au chrtien une attitude particulire. Toute la socit d'alors tait en somme peu prs celle o le Christ, ou les premiers aptres avaient vcu, et dont il tait chaque instant question dans les rcits de la vie du Christ et dans l'enseignement des aptres. La mmoire chrtienne retrouvait autour d'elle, hors mme du groupe religieux, une quantit d'objets qui rveillaient et vivifiaient sans cesse ses souvenirs. Comment s'en serait-elle entirement isole, et quoi bon ? A certains gards un catholique, dix ou quinze sicles plus tard, comprendra bien moins les vangiles qu'un paen ou qu'un Juif, qu'un Oriental ou qu'un Romain des deux premiers sicles : du genre de vie sociale qu'ils supposent et o ils sont ns, des hommes et des usages qu'ils ont condamns, contre lesquels ils se sont dresss, quels vestiges restera-t-il plus tard et quels souvenirs vraiment vivants en aura-t-on gards ? En un sens le christianisme tait le couronnement et le rsultat de toute une civilisation ; il rpondait des proccupations, des inquitudes, des aspirations qui font sans doute partie de la nature humaine toute poque, mais qui ne pouvaient se manifester qu'alors sous cette forme et avec cette intensit. C'est pourquoi il pouvait sans crainte se disperser et essaimer dans un milieu hostile sans doute, mais qui ne lui tait jamais entirement tranger. Comment d'ailleurs les chrtiens auraient-ils eu d'emble le sentiment qu'il leur fallait fixer ds maintenant en des formes rigides leurs pratiques et leurs croyances, pour qu'elles rsistent aux assauts des socits qui se succderont dans le monde autour d'eux, puisqu'ils espraient au contraire leur imposer leur foi et les modeler leur image ? A cette poque, loin de reprsenter le pass en face du prsent, c'est
1
DUCHESNE, ibid., t. I, p. 46.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
144
l'avenir, dj visible dans le prsent, qu'ils opposent au pass. Certes le christianisme s'appuyait lui aussi sur une tradition. Il adoptait dans son ensemble l'Ancien Testament. La Bible leur donnait une histoire, et quelle histoire ! Avec elle on remontait bien au del des traditions grecques... On atteignait les plus anciennes rgions de l'archologie gyptienne et chaldenne. On remontait, ce qui tait infiniment plus important, l'origine mme des choses... On assistait la premire propagation de la race humaine, la fondation de ses premiers tablissements 1 . Mais la tradition d'Isral orientait aussi la pense chrtienne vers l'avenir. Ici il ne faut pas faire trop de diffrences entre les livres de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau, entre les canoniques et les apocryphes. Tous ils tmoignent d'une mme proccupation nous touchons la fin des choses ; Dieu va avoir sa revanche son Messie va paratre ou reparatre 2. Il n'est pas douteux que, de la pense juive, c'est cela que retenaient surtout les chrtiens : ils appuyaient sur cette pointe par o elle pntrait dans l'avenir. De la tradition judaque ils prenaient en somme les parties les plus vivantes, celles qui rpondaient le mieux aux proccupations d'alors. Sans doute, encore, les chrtients se sont constitues peu prs de la mme faon que les synagogues juives, et il y avait bien des ressemblances entre le culte des unes et des autres. A la synagogue,- comme l'glise, on prie, on lit la Bible, on l'explique. Mais d'une part le christianisme laisse tomber, du culte judaque, toutes les parties purement juives, la circoncision, et nombre d'interdictions rituelles, souvenirs morts, qui n'ont plus aucune attache dans le prsent. D'autre part il juxtapose et en ralit il superpose au culte juif ainsi allg l'Eucharistie et les exercices d'inspiration, lments spcifiques du christianisme : or rien ne leur correspond dans les anciennes pratiques judaques, mais elles sont par contre certainement en rapport avec les aspirations qui se font jour la mme poque en beaucoup de points de l'empire ; ce qui fait leur force, c'est qu'elles rpondent des besoins moraux et religieux nouveaux ; et c'est aussi pourquoi, quelque temps, elles se dveloppent assez librement dans le cadre mouvant de la vie populaire contemporaine. Plus tard, des abus se produiront, mme dans la clbration de l'Eucharistie : On fut oblig de simplifier le plus possible le repas (agape) qui en tait comme le premier acte ; plus tard on le spara de la liturgie et enfin on le supprima plus ou moins compltement. Quant aux visions, aux prophties, aux gurisons miraculeuses, comme elles n'taient gure compatibles avec la rgularit du service liturgique, elles cessrent bientt de s'y produire 3. Premier pas en vue d'viter toute contamination avec les pratiques religieuses rpandues dans les milieux non chrtiens. Il n'en est pas moins vrai qu'au dbut le culte plongeait dans le prsent, et se confondait en partie avec la pense et la vie spontane des groupes contemporains. Le christianisme pouvait alors se mler sans crainte la vie du sicle. Certes, il s'opposait elle, en tant qu'il reprsentait une forme de vie morale qui paraissait importe du dehors, et conue pour un type de socit formant avec la socit romaine un violent contraste. Et cependant le christianisme, pour se diffuser dans les grandes cits du temps, devait se prter bien des contacts et des compromissions. Loin de s'enfermer dans une armature liturgique, il lui fallait trancher au contraire sur les cultes anciens par sa rpugnance au formalisme. Le caractre indfini de son proslytisme l'obligeait se mettre au niveau d'une quantit de penses et de consciences formes dans le sicle, au moins l o s'ouvraient ses voies d'accs, Peu de
1 2 3
DUCHESNE, loc., cit., t. I, p. 39. Ibid., p. 41. DUCHESNE, loc. cit., t. I, pp. 48-49.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
145
situations taient considres comme incompatibles avec le christianisme, mme avec la qualit de prtre ou d'vque. Saint Cyprien connaissait des vques, et en assez grand nombre (plurimi), qui acceptaient des grances dans l'administration des domaines, couraient les foires, exeraient l'usure, procdaient des victions... La maison impriale, depuis Nron jusqu' Diocltien, compta toujours beaucoup de chrtiens. A la longue on en vint accepter non seulement des grances financires, mais des magistratures municipales ou mme provinciales. Que dis-je ? On vit des fidles du Christ devenir flamines, c'est--dire prtres paens... Enfin il y avait, parmi les chrtiens, des gens de thtre, des gladiateurs, jusqu' des filles de joie 1. De mme la distinction, qui deviendra plus tard fondamentale, entre les prtres et les laques, n'a pas, ds les premiers sicles, tout son sens 2. Sans doute dans l'ensemble de la communaut, le clerg formait une catgorie dj bien tranche... Cependant les confesseurs et les continents volontaires acquirent bientt une position spciale... A force d'tre clbrs par les autres et de se clbrer eux-mmes, les confesseurs et les vierges tendaient constituer dans la socit chrtienne une aristocratie, qui pouvait tre tente de contester la hirarchie ses droits au gouvernement de l'glise 3. C'est que la tradition religieuse est encore si rcente, les rites si simples, le dogme si peu charg, qu'on prouve encore faiblement le besoin de crer, dans la socit chrtienne, un organe prpos leur conservation. Les prtres administrent la communaut, mais ils ne constituent pas encore une sorte de caste que son caractre sacr met part des autres fidles. Le clibat ecclsiastique n'apparat qu' la fin du IIIe sicle. Au ive sicle, la distinction entre laques et clercs est dj entre, et trs profondment, dans les habitudes. Non seulement dans le culte, mais dans l'administration temporelle, le clerg est seul compter... Le laque n'a rien dire l'glise ; son attitude y est uniformment passive ; il doit couter lectures et homlies, s'associer par de courtes acclamations aux prires que le clerg formule, recevoir de lui les sacrements et le reconnatre comme le dpositaire et l'ordonnateur 4. Mais, jusqu' ce moment, la mmoire religieuse vit et fonctionne dans le groupe des fidles tout entier : elle se confond, en droit, avec la mmoire collective de la socit dans son ensemble. Il ne parat pas ncessaire que ceux qui l'entretiennent sortent du sicle, qu'elle se dtache et s'isole de la masse des penses et souvenirs qui circulent dans les groupes temporels. L'glise elle-mme, pendant longtemps, tmoigne d'une relle dfiance et d'une hostilit dclare vis--vis du mouvement monacal, et des monastres o s'labore l'idal asctique. Pourquoi tourner ainsi le dos au monde, alors que le monde se pntre de pense chrtienne ? Pourquoi la mmoire religieuse n'oprerait-elle pas dans les mmes conditions qu'une mmoire collective qui s'alimente et se renouvelle, se fortifie et s'enrichit, sans rien perdre de sa fidlit, tant que la socit qui la supporte dveloppe une existence continue ? Mais la socit religieuse s'aperoit bientt que les groupes qu'elle se rattache progressivement conservent leurs intrts propres et leur propre mmoire, et qu'une masse de souvenirs nouveaux, sans rapport avec les siens, refusent de prendre place dans les cadres de sa pense. C'est alors qu'elle se rtracte, qu'elle fixe sa tradition, qu'elle dtermine sa doctrine, et qu'elle impose aux laques l'autorit d'une hirarchie de clercs qui ne sont plus simplement les fonctionnaires et les administrateurs de la communaut chrtienne, mais qui constituent un groupe ferm, spar du monde, tourn tout entier vers le pass, et uniquement occup le commmorer.
1 2 3 4
DUCHESNE, loc. cit., t. I, p. 521. Voir : GUIGNEBERT, Le christianisme antique, 1921, p. 178-179. DUCHESNE, loc. cit., p. 531. Ibid., t. III, p. 22.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
146
Dans nos socits, chez la plupart des fidles qui se rattachent : la confession catholique, les actes et les penses religieuses sont mls beaucoup d'autres, et n'absorbent l'attention qu' des intervalles plus ou moins loigns. S'ils assistent la messe dominicale, si, les jours de fte, ils vont dans les glises et participent des rites, si, chaque jour, ils rcitent des prires, s'ils jenent, sans doute ne pensent-ils pas surtout aux vnements passs dont ces pratiques reproduisent certains traits, comme un cho rpercut travers les sicles. Proccups de faire leur salut suivant les formes coutumires, de se plier aux rgles observes par les membres mmes du groupe religieux, ils savent bien que ces institutions existaient avant eux, mais elles leur paraissent si bien adaptes ce qu'ils en attendent, l'ide qu'ils s'en font est si troitement lie toutes leurs autres penses, que leur couleur historique s'efface leurs yeux, et qu'ils peuvent croire qu'elles ne pouvaient tre autrement qu'elles ne sont. Ainsi un enfant n'imagine pas que la fonction remplie auprs de lui par tel ou tel de ses parents et la faon dont ils s'en acquittent s'explique par la nature individuelle de chacun d'eux, qu'elle a commenc un jour, qu'elle aurait pu tre tout autre, que le jeu des affections familiales en et t modifi. Il ne distingue pas son pre d'un pre en gnral. Tant qu'il n'est pas sorti de sa famille, tant qu'il n'a pas pu ,comparer la sienne et les autres, tant, surtout, qu'il ne demande pas ses parents plus, et autre chose, que ce dont se contente ordinairement un enfant, il n'voque pas les circonstances particulires de leur vie, ne cherche pas se rappeler tout ce qu'ils ont t pour lui depuis qu'il les connat, et se figurer ce qu'ils ont pu tre avant que sa conscience se ft veille. Sans doute le fidle conserve bien dans sa mmoire certains grands faits que l'instruction religieuse lui a enseigns, vers lesquels, par la pratique de la religion, son attention a t souvent dirige : mais du fait seul qu'il y a repens souvent, et que d'autres y ont repens avec lui, ces notions de faits sont devenues des notions de choses. Dans l'ide qu'il a de la messe, des sacrements, des ftes, entre tout un ensemble d'autres ides qui se rapportent la socit actuelle et ses membres ; la clbration du dimanche concide, en effet, avec l'arrt du travail et avec des distractions d'un caractre laque ; lorsqu'il se confesse ou lorsqu'il communie, si son attention se concentre sur le sacrement, c'est le caractre sacr et l'action de purification et de renouvellement de son tre intrieur, qui l'occupe, et sa pense se tourne alors vers le prsent bien plus que vers le pass. Sans doute les paroles mmes du prtre voquent dans son esprit le souvenir de la Cne du Christ, mais cette image disparat plus qu' demi derrire des reprsentations plus actuelles, le lieu et la pompe du culte, les officiants, la sainte table, et ceux qui s'en approchent avec lui. Considrons maintenant non plus la masse des fidles, mais ce petit noyau de croyants, clercs ou laques, pour qui la religion est la substance de la vie, qui reportent sur elle toutes leurs penses, et dont on peut dire qu'ils vivent vraiment en Dieu. Pour eux, il y a cette diffrence essentielle entre la religion et les autres coutumes que celles-ci, en effet, ne valent que transitoirement, comme moyens d'organiser tant bien que mal la socit temporelle, tandis que celle-l plonge ses racines dans le plus lointain pass, et ne se transforme qu'en apparence. Le croyant ne se retire du sicle, il n'est assur de s'approcher de l'objet de son culte, qu' condition de tourner sans cesse ses regards vers les temps o la religion venait de natre, o, entre elle et les choses profanes, il n'y avait pas encore eu contact. Il lui faut revivre en pleine comprhension le drame initial auquel tous les dveloppements ultrieurs se rattachent, aussi bien d'ailleurs que les autres vnements religieux dont le souvenir s'est assimil au corps de l'histoire de l'glise. Certes, il y a eu toujours, dans la religion, deux courants, l'un dogmatique et l'autre mystique : mais l'on voit bien que si tantt l'un, tantt l'autre l'ont emport, et si, finalement, la religion rsulte d'un
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
147
compromis entre l'un et l'autre, c'est que les mystiques aussi bien que les dogmatiques s'efforcent de remonter aux origines, et qu'en mme temps les uns, aussi bien que les autres, risquent de s'en carter. Il y a l un conflit permanent sur lequel il vaut la peine d'insister, car on y aperoit clairement les conditions contradictoires o la mmoire collective est quelquefois oblige de s'exercer.
* ** VI - iii
Retour la table des matires
Les dogmatiques prtendent possder et conserver le sens et l'intelligence de la doctrine chrtienne, parce qu'ils savent comment les termes, les propositions ou les symboles qui prtent controverse ont t dfinis autrefois, et parce qu'ils disposent aussi d'une mthode gnrale pour les dfinir aujourd'hui. A la diffrence des mystiques qui s'efforcent par la lumire intrieure de retrouver le sens des textes et des crmonies, les dogmatiques le cherchent principalement au dehors, dans les dcisions ou interprtations des pres, des papes et des conciles. Ceci suppose une distinction fondamentale, qu'on retrouverait d'ailleurs en toute religion 1, entre deux groupes bien dlimits, celui des clercs et celui des laques. Pourquoi les laques n'ont-ils pas voix au chapitre ? C'est que, faisant partie d'une autre socit ou d'autres socits que le groupe religieux (puisqu'ils sont engags dans la vie profane), ils ne participent pas la mme vie collective, et ne sont rellement initis ni aux mmes traditions, ni la mme science. L'autorit de la tradition thologique lui vient de ce qu'elle est comme la mmoire du groupe clrical, qui, au moyen d'une chane de notions solidement tablies et convenablement systmatises, peut reconstruire, de la vie et de l'enseignement primitif de l'glise chrtienne, tout ce qu'il lui importe d'en retenir. Il est vrai que ces notions ont t fixes et lucides des poques trs diffrentes, et, parfois, des poques trs loignes des origines. La proccupation de remonter aux textes et de reconnatre l'authenticit de ceux-ci, de distinguer dans les livres saints comme dans les crmonies ce qui est primitif et ce qui y est surajout, de reporter chaque crit et l'origine de chaque institution sa date, est toute rcente, et ce n'est pas dans les conciles ou les assembles religieuses, c'est dans les milieux non
1
MARTHA (Jules), dans son livre classique sur Les sacerdoces athniens, 1882, remarque il est vrai que chez les prtres athniens, dont un grand nombre n'exercent leurs fonctions que pendant un an, pour redevenir ensuite de simples citoyens, il n'y a rien qui donne l'ide d'un clerg . Mme les prtres vie ne sont prtres qu'aux heures o il s'agit d'accomplir certaines crmonies, p. 141. C'est que le sacerdoce est en ralit une magistrature de la cit. Le prtre, soumis aux lois et aux dcrets, n'a d'autres pouvoirs que ceux qu'il tient de l'autorit souveraine. Bien ne spare l'tat de la religion, le principe civil du principe religieux. - La distinction entre clercs et laques semble disparatre, dans certaines sectes protestantes, en particulier chez les quakers. Mais la communaut religieuse tant alors compose exclusivement, comme la communaut chrtienne primitive, d'hommes inspirs par Dieu, les lus, d'ailleurs, se sparant rigoureusement du monde et renonant tous rapports non ncessaires avec ceux qui y vivent, le groupe des quakers ressemble cet gard un ordre monacal. Ils se rapprochent d'autre part des mystiques, en ce qu'ils croient la rvlation continue: Dieu parle directement en particulier qui veut l'entendre.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
148
ecclsiastiques que la critique historique s'est fait jour, pour s'imposer ensuite aux thologiens. D'ailleurs, quand nous parlons des premires gnrations chrtiennes et des premiers textes du christianisme, nous dsignons une priode o, en un temps relativement court, l'essentiel de la tradition chrtienne s'est fix, travers des remaniements et par tout un travail d'adaptation dont nous pouvons aujourd'hui comprendre peu prs la nature, mais dont la tradition religieuse n'a conserv que fort peu de traces 1. Les souvenirs collectifs conservs dans les textes ou fixs dans les crmonies ne reproduisent donc pas directement la vie et l'enseignement de Jsus, mais le tableau qu'en ont trac les premires gnrations de chrtiens : ds cette poque les donnes primitives de la foi chrtienne, pour pntrer dans la conscience de groupes domins jusqu' prsent par d'autres traditions, durent plus ou moins s'tendre et se gnraliser ; elles entrrent dans des cadres anciens qui teignirent en partie leurs couleurs originales. Ceci s'explique certainement par des ncessits de propagande, et aussi par la transformation de la communaut chrtienne en une glise. Lorsqu'au lieu de Jsus, prophte juif, Galilen, on se reprsenta le Christ sauveur de tous les hommes, les traits proprement juifs de Jsus, qui devaient tre si familiers ceux qui l'entouraient, ont d ou tomber dans l'oubli, ou se transposer: au souvenir de Jsus, ds les premiers sicles, dut se substituer une ide fonde sur quelques lments de souvenirs, mais dont le contenu parat s'expliquer par les tendances et exigences religieuses de ces premires communauts, en grande partie. Il est probable que les traditions chrtiennes, celles qui se rapportent aussi bien au Christ qu' ses disciples, aux saints, aux miracles, aux perscutions, aux conversions, durent se conserver quelque temps l'tat sporadique, et qu'on ne s'avisa qu'assez tard, c'est--dire un moment o, tous les tmoins manquant, aucun contrle direct n'tait plus possible, de rassembler les membres pars de la tradition chrtienne et d'en faire un corps de rcits doctrinaux et lgendaires. Il n'est pas tonnant qu'on y retrouve chaque endroit les faons de penser, la dialectique, les passions et les rancunes du milieu intellectuel et social o le christianisme traditionnel se constitua. Mais, toutes les poques qui suivirent, de mme que les peintres de la Renaissance affublent les personnages de l'poque chrtienne de costumes de leur temps ou de costumes romains conventionnels, de mme les thologiens mirent derrire les paroles du Christ et des pres des conceptions que l'glise primitive elle-mme ignorait, ou auxquelles elle n'attribuait pas la mme importance. Ainsi tout s'est pass comme dans ces cas o un vnement, passant d'une conscience individuelle ou du cercle troit d'une famille dans la pense d'un groupe plus tendu, est dfini par rapport aux reprsentations dominantes de ce groupe. Or le groupe tendu s'intresse bien plus ses traditions et ses ides qu' l'vnement et ce qu'il tait pour la famille ou l'individu qui en fut tmoin. Les dtails de temps et de lieu, si concrets et vivants pour les contemporains, se traduisent alors en caractres gnraux : la Jrusalem devient un lieu symbolique, une allgorie cleste, et, lorsque les Croiss partaient pour la Terre sainte, c'est vers un sanctuaire suspendu entre le ciel et la terre qu'ils se htaient, plutt que vers le cadre pittoresque o ont pu se drouler certaines scnes de la vie et de la mort du Christ. La date de naissance du Christ, du fait qu'on la fixait l'poque du renouvellement de l'anne, et d'une fte trs ancienne, acqurait elle aussi une signification symbolique. Tous ses actes et ses paroles n'taient pas seulement la ralisation des prophties, mais des exemples et des promesses d'une vie
1
Sur le rle jou par Paul dans la constitution de la doctrine, voir GUIGNEBERT, op. cit. Quand celui qui m'a choisi... jugea bon de rvler en moi son Fils... sur le champ, sans prendre conseil de personne, sans aller Jrusalem auprs de ceux qui taient aptres avant moi, je me retirai en Arabie, puis je revins Damas. Ensuite, trois annes plus tard, j'allai, il est vrai, Jrusalem, pour faire la connaissance de Cphas (Pierre) et je passai quinze jours auprs de lui; mais je ne vis aucun des autres, aptres, si ce n'est Jacques, le frre du Seigneur. ptre aux Galates, I, 15 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
149
nouvelle : on devait les reproduire si souvent qu'ils finissaient par jouer, dans la conscience chrtienne, le mme rle que les ides, dans notre pense habituelle. Ainsi, ds les premiers sicles, une thologie, une morale et une philosophie chrtiennes ont singulirement transform l'aspect du Christ et de son enseignement. C'est qu'en effet les dogmatiques ne se proccupent pas de revivre le pass, mais de se conformer son enseignement, c'est--dire tout ce qu'on en peut conserver, reconstituer et comprendre aujourd'hui. Le pass ne peut pas renatre, mais on peut se faire une ide de ce qu'il a t, et on y russit d'autant mieux qu'on dispose de points de repre bien tablis, et aussi que l'lment du pass auquel on pense a donn lieu un plus grand nombre de rflexions, qu'un plus grand nombre de sries de penses s'y sont croises, et nous aident en restituer certains aspects. La pense des chrtiens des premiers sicles ne nous est connue que par des textes que nous ne comprenons aujourd'hui qu'imparfaitement. Mais il y a une forme de pense thologique, qui tranche profondment sur la pense laque, et qui se dveloppe dans des cadres fixs depuis le dbut de l'glise et tellement stables qu'on peut y assigner la place de telle notion d'un fait ou d'un enseignement ancien, avec la certitude tout au moins que ces points de repre n'ont point boug. Il y a eu en effet une existence continue du groupe des clercs, qui chaque poque ont repris ces mmes cadrs, y ont appliqu nouveau leur rflexion, et se sont conforms ce que la tradition leur enseignait cet gard. Si la pense thologique ne s'est pas assimile au mme degr, chaque poque, tout le contenu de la conscience religieuse de l'poque prcdente, il n'en est pas moins vrai qu'entre toutes les notions il y a tant de rapports que celles qui sont stables permettent le plus souvent de dterminer celles qui ne le sont pas. Pour y parvenir, la meilleure mthode consiste, pour les clercs, pour ceux du moins qui possdent le mieux la tradition, se runir, et penser ou, plus exactement, se souvenir en commun. Ainsi la dogmatique joue, dans les oprations de la mmoire religieuse, le mme rle que, dans la mmoire en gnral, ces ides ou souvenirs collectifs qui demeurent prsents la conscience, ou sa disposition immdiate, et qui tmoignent d'un accord tabli une fois, ou plusieurs fois, entre les membres d'un groupe, sur la date et la nature aussi bien que sur la ralit d'un fait pass. Sans doute, en dehors de ces faits et de ces enseignements qui ont donn lieu une dclaration du groupe, il en est d'autres que l'glise, mesure qu'elle s'en cartait, laissait de plus en plus dans l'obscurit, et sur lesquels par consquent il ne s'est transmis aucune tradition ; mais il s'agit alors, le plus souvent, de points qui n'intressaient que les contemporains des premiers temps de l'glise et que celle-ci n'a plus eu l'occasion d'envisager, parce qu'ils sont sortis de l'horizon des hommes aux poques qui suivirent. Le mysticisme, sous quelque forme qu'il se manifeste, rpond, il est vrai, au besoin d'entrer avec le principe divin en un contact plus intime qu'il n'est possible l'ensemble des fidles. Les mystiques ont dcrit souvent l'chelle des degrs par o on s'lve de la vie sensible la vie en Dieu, et beaucoup d'entre eux ont pouss si loin l'oubli des images familires dont est pntr l'enseignement de l'glise, que rien ne distinguait plus leur tat d'esprit, au moment o ils prtendaient se perdre en Dieu, de tout autre tat analogue o l'on peut s'lever dans une religion telle que le bouddhisme, ou par un effort de mditation et d'abstraction philosophique. Comment parlerait-on ici de traditions et de souvenirs, puisque l'esprit se vide des images qu'il pouvait contenir, s'efforce de ne plus distinguer ni les faits et les reprsentations sensibles, ni les ides les unes des autres, et tend se confondre lui-mme avec la substance transcendante ? Ce qui proccupe le mystique, n'est-ce point, prcisment,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
150
de s'unir immdiatement et dans le prsent avec Dieu ? Lorsqu'il imagine le Christ, lorsqu'il le voit, lorsqu'il s'entretient avec lui, presque toujours il a le sentiment de la prsence du Sauveur, qui se mle sa vie, s'intresse ses penses actuelles, inspire et dirige ses actions. Il est trs rare qu'il se croie transport, ces moments, dans le pass, l'poque o le Christ fait homme a enseign et a souffert. En tout cas, le plus souvent, l'image du Christ prsent ou pass n'est qu'un moyen de s'lever actuellement jusqu' Dieu. En ce sens, la pit mystique se distinguerait de la pit ordinaire en ce que l'on dtache alors son attention des formes extrieures du culte, de la pense commune des autres fidles, pour la fixer ou la laisser se fixer sur ce qui se passe au dedans de nous-mme. En s'isolant ainsi, la pense religieuse de l'individu ne perd-elle point contact avec, la pense de l'glise, et particulirement, avec ces souvenirs collectifs o elle s'alimente ? Pourtant le mysticisme ne s'oppose pas la religion officielle comme la pense individuelle. la tradition. D'abord l'glise n'admet pas qu'il y ait une forme de vie religieuse d'o se trouve exclue l'ide distincte des dogmes essentiels, c'est--dire les souvenirs fondamentaux du christianisme. En vrit, dit Bossuet, propos du quitisme, est-ce l une question entre chrtiens ? Et peut-on, parmi eux, chercher un tat o il ne se parle pas de Jsus-Christ ? S'tablir en Dieu seul, et mme en la nature confuse et indistincte de l'essence seule, c'est oublier la Trinit et les attributs divins. Qu'est-ce autre chose, sans exagrer, qu'un artifice de l'ennemi pour faire oublier les mystres du christianisme, sous prtexte de raffinement sur la contemplation ? 1 Le mystique garde donc bien, travers ses transports et ses extases, le sentiment continu que ses expriences particulires prennent place dans un cadre de notions qu'il n'a pas inventes, qui ne lui ont pas t rvles lui seul, que l'glise conserve et qu'elle lui a enseignes. Ds lors, s'il se fait en lui une lumire plus grande, elle claire ces notions mmes, et l'aide approfondir les mystres de la religion chrtienne. Il y a continuit entre sa mditation ou sa vision intrieure et la pense de l'glise. Il peut se considrer comme capable, par faveur spciale, d'voquer plus vivement que les autres membres du mme groupe les traditions qui leur sont communes. Qu'importe, alors, qu'il entre ou croie entrer directement en rapport avec Dieu ou le Christ suppos prsent ? Il connat le Christ par la tradition ; au moment o il pense au Christ, il se souvient. Lorsqu'il s'efforce de se rapprocher de Dieu jusqu' se fondre en-lui, il essaie d'imiter le Christ, ou ceux qui ont le mieux russi l'imiter avant lui ; toute vie mystique est une imitation de Jsus-Christ, soit qu'on reproduise en soi-mme, dans ses sentiments et dans ses actes, ceux que les vangiles lui attribuent, soit qu'on reproduise dans sa pense ses traits, les vnements de sa vie terrestre, sa transfiguration glorieuse. Qu'est-ce donc autre chose qu'un effort d'vocation, o la mmoire du mystique vient complter et en partie suppler celle de l'glise ? S'il y a eu, dans l'histoire religieuse, des ractions mystiques, si les mystiques n'ont pas cess de jouer un rle dans l'volution du christianisme, c'est que toujours des croyants ou des groupes de croyants furent sensibles aux insuffisances, la raideur et la scheresse de la pense thologique officielle. D'une part, du fait qu'on s'loignait des premiers temps du christianisme, la mmoire de l'glise devait s'organiser de faon subsister intacte dans un milieu social qui, sans cesse, se transformait. Il fallait mettre les vrits religieuses d'accord les unes avec les autres, et, aussi, avec les ides et croyances de toute nature qui circulaient hors de l'glise, et ne pouvaient pas ne point y faire sentir leur influence. Le dogme prenait peu peu figure
1
Cit par DELACROIX, tudes d'histoire et de psychologie du mysticisme, p. 289.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
151
de systme. Des proccupations politiques et philosophiques s'imposaient aux prlats assembls dans les conciles. Une vrit religieuse, nous l'avons dit, est la fois un souvenir traditionnel et une notion gnrale : dans la dogmatique des thologiens la valeur des dogmes en tant que notions se trouvait renforce, mais il devenait parfois de plus en plus difficile de retrouver leur point d'attache dans l'histoire du Christ et dans l'enseignement des premiers aptres. Bien des mystiques reprocheront l'glise de s'tre trop laiss pntrer par l'esprit du sicle, et l'accuseront d'infidlit l'esprit du Christ. D'autre part, il est dans la nature des souvenirs, lorsqu'ils ne peuvent se revivifier en reprenant contact avec les ralits qui leur ont donn naissance, de s'appauvrir et de se figer. Les dogmes et les rites une fois fixs, mesure qu'on y repense et qu'on les reproduit, de gnration en gnration, s'usent et perdent leur relief. Les variations qu'ils comportent dans le cadre fix par l'glise restent limites. Si, au dbut, dans la priode d'invention et de formation, ils parlrent, par leur nouveaut mme, l'imagination et la sensibilit des hommes, la longue ils s'immobilisent en formules littrales, en gestes monotones, dont l'efficacit dcrot. Tel est le danger, auquel s'expose la thologie dogmatique, et le rle des mystiques fut, bien souvent, de modifier d'abord le tableau des premiers temps chrtiens en l'largissant, d'attirer l'attention des fidles sur certains faits et certains personnages des vangiles d'abord ngligs, mal connus, peu remarques, et, aussi, de repeindre, en quelque sorte, de couleurs plus vives, tels traits, ou tels dtails du corps et de la physionomie du Christ : de l rsultrent autant de formes de dvotion, mais qui correspondaient dans l'esprit de leurs initiateurs aussi bien que de l'glise qui les adoptait comme une direction nouvelle de la mmoire religieuse, mise mme de ressaisir telles parties de l'histoire vanglique demeures jusqu'alors l'arrire-plan. Lorsque saint Bernard,, au XIIe sicle, recommande la dvotion aux mystres de la vie mortelle du Sauveur et aux personnages qui y furent mls, comme la Sainte Vierge et saint Joseph , lorsqu'il mdite l'humanit de Jsus , lorsque, dans ses sermons, il s'tend avec prdilection sur la nuit de Nol et la Nativit du Christ, sur la circoncision, lorsqu'il met en scne le drame du Calvaire, aussi bien que lorsqu'il clbre la virginit et l'humilit de Marie, et les vertus de saint Joseph, toutes les parties de l'histoire vanglique qu'il met ainsi au premier plan sont nouvelles en ce sens qu'elles n'apparaissent pas, ou peine, et, en tout cas, qu'elles ne ressortent pas si vigoureusement dans les homlies des pres de l'glise 1. Cependant il ne procde pas comme, plus tard, Ludolphe le Chartreux, qui, ayant retenu la parole de saint Jean que tout ce que le Christ a fait ou dit n'est pas crit... supple au rcit des vangiles par les rcits des apocryphes, et aussi par des suppositions imaginaires conformes aux vrits de la foi et aux vraisemblances 2. Saint Bernard se reporte aux textes canoniques, en particulier au 3e vangile. C'est le trsor de la mmoire de l'glise qu'il explore, pour y dcouvrir des souvenirs qui s'y trouvent conservs depuis l'origine, mais qui n'ont pas encore t, ou n'ont t qu'incompltement reproduits. Et l'on sait d'ailleurs que bien d'autres mystiques, un saint Augustin, un saint Franois nous disent qu'ils sentirent s'veiller leur vocation et entrevirent de nouveaux aspects du
1
J'ai cit longuement les sermons de saint Bernard sur les mystres de la vie du Christ, parce qu'ils ont donn une orientation nouvelle la pit... Un genre de littrature nouveau, celui des vies du Christ, va natre. Les prdications de l'abb de Clairvaux forment, dans leur ensemble, une sorte de biographie mystique du Sauveur. il fut aussi celui qui contribua peut-tre le plus au dveloppement du culte de Marie au Moyen ge . Ce fut lui qui intressa la pit chrtienne au sujet des anges gardiens et qui mit le premier en relief les grandeurs et les vertus de saint Joseph . POURRAT, suprieur du grand sminaire de Lyon, La spiritualit chrtienne, t. II, Le Moyen ge, 1921, pp. 76, 89 et 93. Ibid., p. 472. Secundum quasdam imaginarias repraesentationes quas animus diversimode percipit... Vita Christi, prol., pp. 4-5.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
152
christianisme aprs avoir lu, quelquefois par hasard, tel ou tel texte de l'criture sur lequel toutes les forces de leur attention se sont concentres. Ce qui les distingue donc tous des dogmatiques, ce n'est pas qu'ils opposent une sorte d'inspiration personnelle la doctrine de l'glise, mais, plutt, qu'ils remettent en valeur, et poussent au premier plan, des parties de la primitive histoire chrtienne que la tradition officielle a, pour une raison ou l'autre, laisses dans l'ombre. Seulement si les mystiques prtendent ainsi, sans s'appuyer sur le systme dogmatique contemporain, reprendre contact directement avec le christianisme primitif, ce n'est pas dans les textes qu'ils citent, dans les parties de l'criture auxquelles ils s'attachent, qu'on trouverait l'explication du point de vue nouveau d'o ils envisagent la religion. Bien au contraire, si tels aspects mconnus ou ngligs des critures sacres attirent leur attention, c'est qu'ils rpondent des aspirations religieuses plus ou moins conscientes qui existaient en eux avant mme qu'ils eussent fix leur pense sur ces textes. On peut opposer si l'on veut la mystique la dogmatique comme le souvenir vcu la tradition plus ou moins rduite en formules. Ce n'est point par une mthode dialectique, et en s'inspirant des procds intellectuels qu'appliquent les hommes d'glise contemporains, que le mystique construit sa vision, qu'il interprte les textes de faon en tirer un sens nouveau. Parce qu'il aborde la religion librement, dans la simplicit de son cur, il croit tre mieux capable de la comprendre, comme s'il y avait une secrte correspondance entre sa nature intime et ces vrits. Mais il se trouve que, priv de l'appui qu'offre aux dogmatiques la tradition officielle, s'efforant de revivre le pass chrtien par ses seules forces, il risque d'en tre entran bien plus loin que les thologiens qu'il veut dpasser. Car, la tradition carte (sur les points au moins o il innove), quels tmoignages du pass lui reste-t-il, sinon les textes ? Sans doute, une lumire nouvelle lui parat jaillir de l'criture : mais d'o vient-elle ? Des textes eux-mmes, ou de lui ? Si elle vient de lui, c'est donc qu'il interprte lui aussi le pass par le prsent, et par une partie du prsent singulirement plus limite que la pense actuelle de l'glise. En fait, le mystique est un homme qui, s'il chappe la pression de l'glise officielle sous certains rapports, n'en subit pas moins l'influence de l'poque et du milieu social o il vit. Lorsque des modernes lisent les mystiques du Moyen ge, ou mme d'poques plus proches de nous, certes sous les mots d'alors ils peuvent mettre des tats de conscience, mais des tats de conscience de modernes ; quant aux intuitions particulires qu'exprime le langage de ces crivains mdivaux, pour les retrouver, il faudrait se replacer au pralable dans la socit d'alors, qui n'existe plus, et qu'il n'est pas ais de reconstituer. Mais il en tait de mme des mystiques du XIIe et du XIIIe sicle, lorsqu'ils lisaient les vangiles. Ils ressemblaient des hommes qui, ne disposant pas des souvenirs qu'ils veulent revivre, se priveraient par ailleurs de l'aide que pourrait leur offrir la pense traditionnelle. Ds lors ils devaient projeter dans le pass leurs sentiments ou faons de voir personnelles, ou celles de groupes dont ils subissaient plus ou moins inconsciemment l'influence : or rien ne prouve que ces points de vue se rapprochaient plus du pass rel que la tradition de l'glise. Quand saint Franois se consacre la pauvret, il s'oppose l'glise de son temps qui ne mprise pas les richesses, et il croit retourner ainsi la vrit de l'vangile. Mais la pauvret ne saurait avoir le mme sens, ni peut-tre la mme efficacit morale, dans la socit italienne du XIe sicle et au temps de Jsus. La Dame pauvret de saint Franois est une sorte d'entit moyennageuse et romanesque : est-elle vraiment l'image exacte de la pauvret vanglique ? Ses frres mendiants, par bien des traits, se rapprochent peut-tre plus des moines bouddhistes que des membres de l'glise primitive : le genre d'asctisme qu'ils pratiquent est peut-tre plus loin du christianisme des premiers sicles que la simple charit chrtienne que l'glise d'alors recommande aux fidles demeurs dans
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
153
le sicle. Quand Catherine de Sienne dclarait que la vie du Christ, du commencement la fin, n'avait t qu'une longue passion, et que, s'il suppliait Dieu, Gethsmani, d' carter de lui ce calice , c'est que ce calice tait vid, et qu'il demandait qu'un autre, plein de souffrances plus amres, lui ft prpar, elle croyait que nous devons avant tout nous dpouiller de la chair et nous revtir du Crucifi 1. Cette confusion qui fait qu'elle trouvait la souffrance comme un got du Christ vient sans doute des exemples et prceptes religieux qu'on lui proposa de bonne heure, et aussi de ce que par sa nervosit et l'extnuation de son corps, elle s'apparentait une ligne de mystiques qui s'hypnotisrent sur leurs douleurs et sur celles du Christ, au point de ne plus voir, dans tout le christianisme, que cela. De mme la dvotion au Saint-Sacrement, l'adoration du Sacr Cur, supposent, chez leurs fondateurs, une tournure d'esprit bien particulire : got des allgories, sensiblerie un peu fade, corruption du got, curiosit et imagination maladives, mlange des genres (on veut voir les plaies et le sang du Christ, on applique l'amour divin le langage de l'amour profane), qui, sans tre entirement trangre au christianisme primitif, n'y occupait cependant, autant qu'il nous est possible d'en juger, qu'une place trs rduite. Dans toutes ces formes nouvelles du culte, ainsi que dans les inspirations qui sont leur source, on retrouve plutt le genre d'imagination des groupes dvots o elles apparurent que la pense originale de l'vangile. Il n'y avait pas tant de raffinement psychologique chez les premiers chrtiens que chez sainte Thrse, et, coup sr, quand les aptres et les fidles des premiers sicles voquaient Jsus, ils s'appuyaient sur des souvenirs et des tmoignages encore rcents, et ne s'inspiraient pas de l'imagerie pieuse des jsuites d'o cette sainte tirait les figures de ses visions. L'glise, en prsence des mystiques, a toujours eu des ractions assez complexes. Les dogmatiques se dfiaient d'abord de ces illumins, qui prtendaient voir jusqu'o la pense traditionnelle religieuse n'atteignait point, comme une collectivit tendue et ancienne, qui a prouv la valeur et la solidit de ses croyances, redoute les innovations des individus ou des groupes plus petits qu'elle renferme. Elle ne pouvait cependant leur refuser son attention, les traiter comme des trangers ou des adversaires du dehors, car ce n'est pas seulement dans le sein de l'glise, c'est parmi ceux qui taient le plus pntrs de son esprit, que, le plus souvent, les mouvements mystiques, ont pris leur source. La plupart des mystiques ont t des moines, des religieuses, et, en tout cas, ont t forms au contact de prtres ou de frres. Ils ne se sont levs au-dessus ou ne se sont placs en dehors de la tradition qu'aprs s'tre, plus que les autres clercs, assimil celle-ci. Plus ouverts que la moyenne des prtres et des fidles tous les courants qui traversent et agitent le monde religieux, plus sensibles aux nuances de la pense thologique, saturs en quelque sorte de dogmes et de pratiques, ils taient, dans l'glise, le contraire de corps trangers., Mme s'ils ne possdaient pas cette science de la religion, il suffisait qu'ils fussent en rapport comme ils le furent en effet frquemment avec des prtres et des thologiens qui eussent senti eux-mmes l'aridit du culte et de l'enseignement du temps, et dont les directions les eussent encourags chercher de nouveaux sens et faire l'essai de nouveaux exercices, pour qu'on pt dire d'eux qu'ils avaient pntr au cur de la pense thologique, et particip la vie la plus intense de lglise. Nous nous abusons quand nous nous figurons que la pense mystique a pour conditions l'isolement et un certain degr d'ignorance ou de simplicit. Il y faut au contraire le plus souvent l'aiguillon d'une pit exigeante et blase, et l'appui d'une famille spirituelle, sorte
1
VOERGENSEN (J.), Sainte Catherine de Sienne, 4e dition, 1919, pp. 144-145. Les dominicains ont toujours eu une prdilection pour les pnitences corporelles. La vie d'un Henri Suso, de sa Se anne sa 40e, n'est qu'une succession de tortures qu'il s'inflige lui-mme.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
154
d'avant-garde de l'glise si remplie de son esprit qu'en elle il dborde. Ainsi la pense mystique est collective, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'glise ne peut pas la ngliger. L'glise, nous l'avons dit, a sa mmoire. Que l'un quelconque de ses membres prtende la rectifier ou la complter, l'glise ne s'en proccupera que s'il n'est pas seul, que s'il parle au nom d'un groupe, et surtout que si ce groupe est un de ceux qui sont le plus pntrs de sa doctrine, c'est--dire qu'elle exigera d'abord que toute dvotion et toute forme nouvelle de croyance ou de culte s'appuient sur certains lments de sa propre tradition, et se prsentent comme un aspect de la pense chrtienne collective. De fait il y a non pas une, mais plusieurs traditions mystiques, et chacun des grands innovateurs peut se rclamer d'une srie de prcurseurs, et de courants de pit qui, inaperus jusqu' ce moment, n'en ont pas moins depuis les origines leur direction propre et leurs fidles 1. Chaque mystique a peut-tre le sentiment, lorsqu'il est ravi en extase, lorsqu'il dcouvre des aspects cachs de la divinit, qu'il est favoris d'une grce personnelle, et qu'il passe par des tats religieux sans prcdent. Mais, lorsqu'il dcrit ce qu'il a vu ou prouv, lorsqu'il se proccupe d'difier ou d'enseigner, lorsqu'il fait la thorie de ses visions, il les prsente comme la confirmation de telle ou telle partie de ce qu'il croit tre et avoir toujours t la tradition de l'glise et la doctrine chrtienne. Au reste, le mystique, de mme qu'il n'a pas allum tout seul les lumires nouvelles qu'il promne sur le dogme et sur l'glise, ne les alimente pas sans l'aide de disciples : il enseigne d'autres hommes, il les forme son image ; il se dtache toujours au sein d'un groupe, et rien ne prouve qu'il ait toujours t lui seul le foyer autour duquel tous se sont serrs. La tradition et la lgende aiment reporter sur une seule tte les mrites exceptionnels et les actions clatantes dont une socit a senti les effets. Pour un esprit religieux, qui interprte l'histoire de la religion par l'intervention divine, quoi de plus naturel que d'admettre que l'action de Dieu s'est manifeste en quelques. hommes choisis, et par leur intermdiaire ? Certes, nous ne pouvons pas plus dmontrer qu'il se trompe, que lui ne le peut, qu'il ne se trompe pas. Qui nous aurait racont, dans le dtail intime, les circonstances de la vie d'un saint, sinon ceux qui le suivirent, prirent avec lui, rpandirent durant sa vie et aprs sa mort ses ides, ou plutt firent connatre sa figure, son activit, ses tribulations et sa gloire ? Or, il n'est pas concevable qu'ils aient pu tre guids, dans leur rcit, par un souci de vrit historique. Proccups d'action, ils durent inconsciemment arranger les faits passs de la manire la plus convenable en vue d'inspirer, aux fidles et aux infidles, des sentiments d'tonnement religieux, d'dification, d'admiration et d'adoration pour celui que Dieu avait distingu assez entre tous les hommes pour se manifester par lui. Mais il y avait des avantages certains, de ce point de vue, ce que tel mouvement religieux ft rattach un seul fondateur, et ce que les autres apparussent rellement comme des disciples qui, chacun pris part, et mme tous rassembls, n'eussent rien
1
Sans doute ils ont le vit sentiment de la spontanit et de l'originalit de leur exprience . Mais ils aspirent dpasser le christianisme ordinaire, sans l'abandonner; le christianisme est leur point de dpart, et le milieu o ils voluent; leur vie mystique est enveloppe dans la vie chrtienne. Chaque mystique rencontre une tradition mystique. Sainte Thrse lit Osuna et d'autres bons livres . Mme Guyot lit saint Franois de Sales. Suso a eu pour matre Eckart. Dans ses Instructions sur les tats d'oraison, BOSSUET dit : Il y a quatre cents ans qu'on voit commencer des raffinements de dvotion sur l'union avec Dieu et sur la conformit sa volont qui ont prpar la voie au quitisme moderne. Mme Guyon dclare : Je vous conjure de vouloir bien examiner fond si ce que j'cris ne s'offre pas dans les auteurs mystiques et saints approuvs depuis longtemps. DELACROIX, Op. cit., pp. 258, 285, 355-358.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
155
t sans lui. Deux ou trois fondateurs se nuiraient mutuellement. On aurait des doutes sur leur inspiration divine, car il est peu vraisemblable que Dieu se manifeste ainsi, au mme degr, en trois hommes que des circonstances accidentelles ont rapprochs. Comme leurs caractres et leurs enseignements, malgr d'troites analogies, ne sauraient se couvrir exactement, on ne pourrait s'interdire ni interdire de les comparer, de prfrer l'un l'autre, de les opposer : ils seraient en tout cas ramens la situation d'hommes qui n'aperoivent qu'un aspect de la vrit : ils se diminueraient tous, en se limitant l'un l'autre. Enfin, au lieu d'attribuer un seul une richesse prodigieuse de grces et de vertus surnaturelles, comme il faudrait les rpartir, on n'inspirerait pas assez aux hommes l'ide d'un tre suprieur infiniment la commune humanit. Tout inclinait donc les membres d'une secte ou d'un ordre attribuer ainsi au fondateur et lui seul la rnovation religieuse ou morale qui, sans doute, ne pouvait russir en ralit que parce qu' une pratique ou une croyance collectives elle opposait une croyance ou une pratique galement collectives. Quoi qu'il en soit, partir du moment o une exprience personnelle se prsente ainsi comme la source d'un courant de pense religieuse qui entrane tout un groupe de clercs et de fidles d'une dvotion prouve, l'glise voit ce qu'elle gagnerait la sanctionner, et les risques qu'elle courrait la condamner. Une seule raison la retient : c'est la crainte que ce tmoignage prtendu se rvle incompatible avec d'autres tmoignages qui sont pour elles les colonnes de la foi, et les vrits capitales du christianisme. Ds qu'elle s'aperoit que loin de se heurter aux autres, il les fortifie, et que cette vue nouvelle sur la doctrine rpand sur toutes ses parties plus de lumire, elle l'accepte : mais elle s'efforce alors de la rattacher son systme, ce qui n'est possible que si elle la dpouille peu peu d'un grand nombre de ses traits originaux : ce mystique est canonis, et prend place dans la liste des saints officiels ; l'histoire de sa vie prend forme de lgende, ses disciples. doivent se plier aux rgles de la vie monastique, et l'on rduit son enseignement au niveau de l'entendement religieux commun. Mais, pour que l'glise puisse s'assimiler ainsi ces lments -qui, bien qu'labors dans son sein, n'en reprsentent pas moins en ralit autant d'additions successives sa tradition, il faudrait que celle-ci ne s'affaiblit point. Nous avons dit que la doctrine religieuse est la mmoire collective de l'glise. L'glise primitive vivait sur les souvenirs vangliques, souvenirs rcents, et qui baignaient encore dans le milieu social o s'taient drouls les vnements qu'elle commmorait. A mesure qu'on s'en est loign, la socit chrtienne a d fixer son dogme et son, culte, et l'opposer aux croyances et aux pratiques de la socit sculire, qui reprsentait un autre temps et obissait d'autres impulsions qu'elle-mme. Elle trouvait dans son esprit traditionnel la force ncessaire pour maintenir toujours au premier plan ses souvenirs fondamentaux, et conserver, au sein des autres groupes, son originalit. Il y avait alors en elle un tel ressort, une telle vitalit organique, qu'elle n'hsitait pas imposer sa mmoire propre des socits jusqu'alors trangres sa pense et sa vie, et dont les souvenirs et les traditions bientt s'effaaient ou se confondaient dans la tradition chrtienne. Ainsi, bien que l'glise se distingut du monde temporel, l'un et l'autre participaient d'une mme mmoire collective. Sans doute, la fidlit, la richesse et l'intensit des souvenirs religieux variaient, suivant qu'on passait du corps des clercs l'ensemble des laques rassembls dans les glises, et des assembles de fidles aux groupes qui satisfaisaient des besoins profanes : familles, corps professionnels, tribunaux, armes, etc. Trop d'intrts sculiers se mlaient, dans ces derniers, aux ides chrtiennes, qui les dformaient et les teignaient en partie. Toutefois, la tradition religieuse, dans toute cette priode o son ascendant sur les peuples europens n'tait
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
156
pas contestable, ne s'en appuyait pas moins non seulement sur l'autorit des chefs de l'glise (comme il tait naturel), mais aussi sur l'assentiment des fidles et de tout le monde chrtien. Malgr sa prtention de se suffire, la mmoire religieuse, puisqu'elle tendait son action sur les groupes laques et profanes, et en vue de fortifier cette action, devait prendre la forme d'une doctrine qui rpondt aux proccupations du temps. En droit, le dogme ni le culte ne changeaient : en fait le christianisme n'a pu tenir lieu, pendant tout le Moyen ge, de philosophie et de science, que parce que tout le mouvement intellectuel d'alors a trouv en lui un abri et des encouragements. Il pouvait se montrer ce point accueillant et large. La socit tout entire n'tait-elle pas chrtienne ? Si les penses nes dans les cercles sculiers s'taient coules dans un moule chrtien, tait-il tonnant que leur place ft en quelque sorte marque d'avance dans la doctrine chrtienne ? Tant que l'glise fut capable d'imposer au monde sa tradition, toute la vie et l'histoire du monde durent se conformer la tradition de l'glise : tous les souvenirs correspondant cette vie et cette histoire durent tre autant de confirmations de l'enseignement de l'glise, qui put, sans dvier de la ligne de son pass, enrichir sa mmoire de tous ces nouveaux tmoignages. On s'tonne quelquefois de ce que la doctrine chrtienne ait subsist ainsi, inchange pour l'essentiel, et que la pense sociale, qui se transformait de sicle en sicle, soit demeure dans ce lit. C'est que le christianisme avait une emprise assez forte. sur les groupes pour que toute la vie de ceux-ci ft contrle par lui, et que rien ne s'y pt produire qui ds le dbut ne portt sa marque. Les activits intellectuelles, morales, politiques ont sans doute leurs conditions propres : ceux qui les exercent obissent des tendances qui, en leur fond, n'manent pas de la religion. Mais, tant qu'elles ne sont point assez dveloppes pour qu'on prenne conscience de ce qu'il y a en effet, en chacune d'elles, d'irrductible la religion, elles ne revendiquent pas leur indpendance : pousses l'ombre de l'arbre chrtien, il semble qu'elles fassent corps avec lui, et qu'elles puisent leur sve dans ses racines. Les sciences, les philosophies, et tous les ensembles de penses quelconques s'difient sur des traditions qu'on ne distingue pas alors de la tradition chrtienne. On s'est habitu de bonne heure les revtir de formes, les exprimer dans un langage qui est celui de l'glise. Au reste, ce sont lu clercs qui, l'origine et trs longtemps ensuite, s'y sont appliqus, et toutes les uvres auxquelles ils ont travaill refltent les croyances de leurs auteurs. Les savants, les philosophes, les hommes d'tat de cette priode ne conoivent pas d'ailleurs qu'on puisse acqurir la connaissance des lois du monde naturel, et des lois des socits, par l'observation des choses. La source de toute science, leur enseigne-ton, ne peut s'obtenir que par rflexion sur des ides, c'est--dire par une opration dont l'objet aussi bien que la nature est purement spirituelle. Or l'esprit relve de la religion. C'en est le domaine exclusif. La distinction entre les choses sacres et les choses profanes prend de plus en plus clairement le sens d'une opposition entre l'esprit et les choses. Puisque le domaine des choses lui est ferm, o s'alimenterait l'esprit, si ce n'est dam la tradition ? Ce n'est pas vers le prsent, c'est vers le pass, que s'oriente la rflexion de tous ceux qui s'efforcent de penser. Mais le seul pass que l'on connaisse, c'est le pass chrtien. Malgr tout, il est vrai, aux choses, la vie temporelle, aux ncessits du prsent, la pense ne peut pas chapper tout fait. Elles obligent l'glise laisser dans l'ombre une partie de sa tradition, toutes les parties de sa doctrine qui heurtent trop violemment les ides des cercles laques, qui ne s'accordent d'aucune manire avec l'exprience, si rduite et si dnature soit-elle, de socits trop diffrentes des premires communauts chrtiennes. Mais tout se passe alors comme dans le cas d'une mmoire qui n'voque plus certains de ses souvenirs parce que la pense des hommes d'aujourd'hui ne s'y intresse plus. L'glise peut dtourner son attention de telle ou telle de ses traditions, si sa doctrine demeure
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
157
intacte pour l'essentiel, et si, en gagnant plus de libert de mouvements, elle ne perd pas trop de force et trop de substance. Seulement, si l'glise est oblige de modifier ainsi son dogme pour qu'il puisse demeurer la pense commune des socits laques, il lui faut, d'autre part, tenir compte des besoins religieux divers qui se font jour, dans le corps des clercs, sous forme de pousses mystiques : de l naissent pour elle d'autres difficults et d'autres dangers. Sous la tradition gnrale de l'glise, commune tous les clercs, on aperoit en effet, au cours de l'histoire, toute une srie de traditions particulires, qui semblent disparatre certaines poques, mais reparaissent d'autres : il y a des ordres, dont chacun s'attache plus spcialement tel aspect du culte et de la doctrine ; il y a des courants de dvotion qui entranent une partie des croyants, clercs ou fidles plus zls que les prtres eux-mmes. A l'intrieur de la mmoire collective chrtienne, ce sont autant de mmoires collectives galement et dont chacune prtend reproduire plus fidlement que toute autre ce qui est leur objet commun, la vie et l'enseignement du Christ. L'glise ds les premiers temps a connu bien des conflits de ce genre. Sous des formes attnues, les coles mystiques reproduisent des hrsies anciennes, ou s'apparentent des hrsies rcentes. On ne connat pas encore bien, mais on entrevoit par quelles voies, l'hrsie des Albigeois put se propager jusqu' saint Franois d'Assise 1. L'cole mystique allemande du XIVe sicle est sortie de matre Eckart dont les ouvrages furent condamns comme hrtiques 2. Luther s'est rclam du Moyen-ge pour justifier son propre mysticisme totalement affranchi de l'autorit de l'glise. On sait que la mystique des jansnistes s'apparente, n'est pas sans rapport avec le protestantisme. Bossuet dnonait dans le quitisme une doctrine parente de celle des illumins espagnols, des beghards flamands ou allemands 3. Or ce qu'il y a de particulier, chez les mystiques comme chez les hrtiques, c'est qu'ils opposent la religion commune non pas l'esprit du sicle et le rationalisme de la pense laque, mais des exigences religieuses plus strictes, et un sentiment de ce qu'il y a de spcifique et d'irrationnel dans le christianisme. Ils veulent, en d'autres termes, ramener la religion son principe et ses origines, soit qu'ils tentent de reproduire la vie de la communaut chrtienne primitive, soit qu'ils prtendent abolir la dure et entrer en contact avec le Christ aussi directement que les aptres qui l'ont vu, touch, auxquels, aprs sa mort, il s'est manifest. Ce sont, en quelque sorte, les ultras du catholicisme. Il leur manque la connaissance exacte de l'ordre des temps, et le sens des ralits. En revanche ils obissent un instinct religieux profond lorsqu'ils reprochent lglise de rduire le culte des rites de plus en plus formels, et, en rationalisant le dogme, d'oublier que le christianisme est avant tout l'imitation directe de la vie du Christ. C'est pourquoi l'glise est bien oblige de leur accorder quelque crdit. Mais, aux poques o la dialectique chrtienne tait en plein essor, tant que la pense de l'glise s'est sentie assez forte, en vertu de la richesse de sa doctrine et de la vigueur de ses, traditions, pour conserver dans la socit temporelle son indpendance et son originalit, elle s'est servie des mystiques, mais. elle n'a rserv qu'une place subordonne, dans son enseignement, leurs interprtations : ni dans le culte, ni dans le dogme, elle ne les a mis au premier plan. Si les mystiques prdominaient. dans l'glise, ce serait le signe que la grande tradition chrtienne des vangiles, des pres, et des conciles peu peu s'puise et se perd.
1 2 3
SABATIER (Paul), Vie de saint Franois d'Assise, dition de 1920, pp. 7, 42-45, 51-54. POURRAT, op. cit., t. II, p. 233 sq. DELACROIX, op. cit., p. 268.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
158
* ** VI - iv
Retour la table des matires
En rsum, dans le christianisme, comme dans toute religion, il y a lieu de distinguer des rites et des croyances. Les rites consistent en un ensemble de gestes, de paroles, d'objets liturgiques, fixs dans une forme matrielle. A ce point de vue, les textes sacrs ont un caractre rituel. Ils ne se sont pas modifis depuis l'origine. On les rpte littralement au cours des crmonies, et ils se mlent troitement au culte. La rcitation des, vangiles, des ptres, des prires a la mme valeur qu'une gnuflexion, une oblation, un geste de bndiction. Le rite est peut-tre l'lment le plus stable de la religion, puisqu'il se ramne des oprations matrielles constamment reproduites, et dont les rituels et les corps de prtres assurent l'uniformit dans le temps et dans l'espace. A l'origine, les rites rpondirent sans doute au besoin de commmorer un souvenir religieux, par exemple, chez les Juifs, la fte pascale, et, chez les chrtiens, la communion. Les fidles des premiers temps, lorsqu'ils clbraient le rite, en comprenaient le sens primitif, c'est--dire gardaient le souvenir direct de l'vnement qu'il reproduisait ce moment, rites et croyances se confondaient, et, en tout cas, se correspondaient troitement. A mesure qu'on s'loigne des origines, on peut admettre que l'essentiel du rite subsiste tel qu'il tait primitivement. Sans doute, comme la socit chrtienne se dispersait alors en diverses communauts locales, et qu'elle s'est agrandie en s'incorporant des groupes qui conservrent et y introduisirent une partie de leurs coutumes, il y eut au dbut, mme dans ce domaine, bien des contaminations et des remaniements. En tout cas, ds que le rite a t unifi, et fix pour toute l'glise, on s'attache n'y plus rien modifier. Et il en est de mme des textes ; aprs une priode de flottement et d'incertitude, l'autorit ecclsiastique arrte la liste des textes canoniques, auxquels on n'ajoutera et d'o l'on ne retranchera rien. Mais il en fut autrement des croyances qui interprtaient ces rites. Assez vite, toute une partie des souvenirs de l'histoire religieuse s'effacent et se perdent. Ceux qui demeurent s'attachent sans doute aux rites et aux textes, mais ils ne suffisent plus les expliquer. Comme on a oubli en, partie le sens des formes et des formules, il faut les interprter: ainsi nat le dogme. Sans doute il y a dans l'glise, au dbut tout au moins, une tradition qui assure la continuit entre sa pense d'autrefois et sa pense d' prsent. Mais, comme le groupe religieux, bien qu'il s'oppose la socit profane, en demeure cependant solidaire, la thologie de chaque poque s'inspire d'une dialectique qui est en partie celle du temps 1. La rflexion sur le dogme n'a pas pu
1
Les conceptions que l'glise prsente comme des dogmes rvls ne sont pas des vrifis tombes, du ciel et gardes par la tradition religieuse dans la forme prcise o ils ont paru d'abord. L'historien y voit l'interprtation de faits religieux, acquise par un laborieux effort de la pense thologique... La raison ne cesse pas de poser des questions, la foi, et les formules traditionnelles sont soumises un travail perptuel d'interprtation... Loisy, L'vangile et l'glise, pp. 158-159. Une socit durable, une glise peut seule maintenir l'quilibre entre la tradition qui conserve l'hritage de la vrit acquise et le travail incessant de la raison humaine pour adapter la vrit ancienne aux tats nouveaux de la pense et de la science. Ibid., p. 173. La thologie est comme une adaptation de la doctrine rvle aux diffrents tats de culture que traverse l'humanit. DU MME, tudes bibliques.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
159
s'isoler des autres modes de rflexion ; or la pense laque voluait, avec les institutions laques : la dogmatique religieuse a volu plus lentement, et de faon moins apparente, mais elle n'a point pu ne pas glisser le long de la pente sur laquelle, malgr tout, elle tait pose. Le dogme rsulte donc de la superposition et de la fusion d'une srie de couches successives et comme d'autant de tranches de pense collective : il est rationnel, mais en ce sens que la raison de chaque poque y a laiss sa trace ; la pense thologique projette ainsi dans le pass, l'origine des rites et des textes, les vues qu'elle en a prises successivement. Elle reconstruit sur plusieurs plans, qu'elle s'efforce de raccorder, l'difice des vrits religieuses, comme si elle n'avait travaill que sur un plan unique, celui-l mme qu'elle prte aux fondateurs du culte et aux auteurs des crits fondamentaux. Seulement, les rites et les textes ne posent pas seulement des problmes d'interprtation rationnelle. Bien plus, chacune de ces interprtations, comme on s'carte en ralit du sens originel, on perd contact avec les souvenirs primitifs, tels qu'ils pouvaient exister dans les consciences d'alors. En ralit, au sentiment religieux, qui rsulte de la mise en rapport avec le Christ et ses aptres, de la contemplation directe de leurs personnes et de leurs vies, on substitue un systme de notions qui reposent seulement sur l'autorit de l'glise. L'glise, sans doute, n'oblige pas les clercs et les fidles, lorsqu'ils lisent les textes ou participent aux rites, s'en tenir aux explications qu'elle leur en prsente. Bien au contraire, elle les encourage se rapprocher de Dieu par des lans de foi et de pit 1. Mais elle ne leur donne gure, sous forme de prescriptions gnrales, de rgles et de conseils bien efficaces cet gard. Collective, l'glise est, par l mme oriente, vers ce qu'il y a de proprement collectif dans la pense humai-ne, c'est--dire vers des concepts et des ides. C'est pourquoi, dans le christianisme comme dans toutes les religions, il s'est manifest presque chaque poque, dans des groupes plus restreints, un besoin de s'initier aux formes d'une vie religieuse plus intenses, o une place plus grande serait faite au sentiment. Les mystiques cherchent le sens d'un sacrement non exclusivement dans ce qu'en enseigne l'glise, mais surtout dans les sentiments qui s'veillent en eux lorsqu'ils y participent, comme s'il leur tait alors possible d'atteindre directement l'vnement ou le personnage sacr qu'il commmore. Certes, il est donn peu de fidles de voir Dieu, de s'unir avec lui. L'glise se dfie de l'closion des rveries de la rvlation prive... L'illusion est facile en mystique; elle peut aisment faire prendre pour des tats surnaturels et divins ce qui n'en est que la contre-faon humaine ou diabolique 2. Toutefois lorsqu'elles sont attestes par des groupes importants, c'est--dire lorsqu'elle en reconnat la nature collective, la mmoire chrtienne, en mme temps que l'histoire vanglique et des premiers temps de l'glise, retient ces rvlations, ces illuminations et ces visions, titre de tmoignages sinon de mme valeur que les autres, du moins qui mritent d'tre considrs. Dira-t-on que seule la tradition dogmatique possde les attributs d'une mmoire collective, et qu'une tradition religieuse qui recueille et traite comme des tmoignages les rvlations des mystiques, est semblable une mmoire qui s'encombre de rsidus
1
L'glise n'exige pas la foi ses formules comme l'expression adquate de la vrit absolue... le formulaire ecclsiastique est l'auxiliaire de la foi, la ligne, directrice de la pense religieuse : il ne peut pas tre l'objet intgral de cette pense, vu que cet objet est Dieu mme, le Christ et son oeuvre ; chacun s'approprie l'objet comme il peut avec les secours du formulaire. Comme toutes les mes et toutes les intelligences diffrent les unes des autres, les nuances de la foi sont aussi d'une varit infinie sous la direction unique de lglise et dans l'unit de son symbole. Loisy, L'vangile et l'glise, p. 175. POURRAT, Op. cit., t. II, p. 508.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
160
de paramnsies ? Mais l'glise n'admet pas, au fond, que Dieu se soit rvl une fois pour toutes, aux temps vangliques, et que son rle se rduise seulement conserver aussi fidlement que possible le souvenir de cette poque. Certes, il y a dans le christianisme, une part si considrable de donnes historiques originales, qu'on ne conoit pas qu'il et t possible, par un simple effort de pense et de rflexion, de construire le dogme chrtien. Mais ces donnes ont t ce point labores dialectiquement et transposes en notions intellectuelles qu' ct de la thologie rvle on a toujours fait place une thologie rationnelle, et que, pendant toute la priode scolastique, on a cru qu'il tait possible de dmontrer rationnellement la religion. Bien plus, au dessus et en dehors de la succession des vnements, on conoit les tres sacrs de la religion comme des substances surnaturelles qui restent identiques et chappent la loi du temps. Ds lors, pour les croyants, la religion d'aujourd'hui n'est pas seulement la commmoration du pass : depuis sa rsurrection, le Christ est prsent dans l'glise, tout moment et en tous lieux. L'glise peut donc admettre, sans contradiction apparente, que des rvlations nouvelles se produisent. Mais elle ne s'en efforce pas moins de rattacher ces donnes nouvelles aux donnes anciennes, de les replacer dans le corps de sa doctrine, c'est--dire de sa tradition. En d'autres termes, elle n'admet pas que ces donnes soient vraiment nouvelles : elle prfre supposer que, de la rvlation primitive, on n'a pas aperu tout de suite tout le contenu. En ce sens elle complte et elle claire ses souvenirs antrieurs par des reprsentations qui, bien qu'elles n'aient attir son attention que rcemment, sont, elles aussi, des souvenirs. Ainsi la mmoire religieuse, bien qu'elle s'efforce de s'isoler de la socit temporelle, obit aux mmes lois que toute mmoire collective : elle ne conserve pas le pass, niais elle le reconstruit, l'aide des traces matrielles, des rites, des textes, des traditions qu'il a laisss, mais aussi l'aide de donnes psychologiques et sociales rcentes, c'est--dire avec le prsent.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
161
Chapitre VII
Les classes sociales et leurs traditions
Retour la table des matires
chaque poque, il y a des oeuvres que la socit peut raliser mieux qu' toute autre. Plus tt, elle n'en prouvait pas le besoin, ou elle n'en tait pas capable. Plus tard, son attention sollicite par d'autres objets ne pourra plus se concentrer sur elles. Nietzsche remarque quelque part que la vie religieuse suppose avant tout beaucoup de loisir, et que, dans nos socits affaires, o l'activit laborieuse qui les absorbe a, depuis des gnrations, dtruit lentement en eux l'instinct religieux, la plupart des gens ne savent plus quoi la religion est utile, et se contentent d'enregistrer son existence avec un profond tonnement : Pris par leurs affaires, et par leurs plaisirs, ils n'ont plus de temps lui consacrer, d'autant plus qu'ils ne savent pas trs bien s'il s'agit l d'une affaire, ou d'un plaisir 1. C'est, sans doute, parce qu'on sent tout de mme que la religion a sa fonction dans nos socits comme dans les autres, et qu'on doute que, tourns vers d'autres objets, nous puissions, si elle manquait, l'inventer, que nous la respectons et que nous hsitons en modifier les formes. Mais il en est de mme de la plupart des lments que nous conservons du pass, et de tout ce systme
1
Jenseits von Gut and Bse, 3es Hauptstck, 58.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
162
de valeurs traditionnelles qui, nous le savons bien, ne correspond plus aux conditions actuelles, en droit, en politique, aussi bien qu'en morale. Nous ne sommes pas srs cependant qu'ils n'aient pas encore un rle jouer, et nous craignons (peut-tre tort), si nous les liminions, de ne plus possder en nous la foi et la puissance cratrice ncessaires pour en trouver l'quivalent. C'est pourquoi on s'attache des formules, des symboles, des conventions, de mme qu' des rites qu'il faut rpter et reproduire, si on veut conserver les croyances qui leur donnrent naissance. Par tout cela, c'est la socit, d'hier, ce sont des poques successives de l'volution sociale qui se perptuent aujourd'hui. Si nous en soulignons l'anciennet, si nous empchons qu'on en efface tout ce qui n'offre plus une utilit actuelle et ne sert qu' les distinguer de ce qui est rcent, c'est pour qu'elles s'en distinguent en effet. Il s'agit de lester la socit du poids d'une partie de son pass. C'est parce qu'on en attend ce service qu'on les respecte et qu'on s'y attache. Il peut tre utile, en effet, tandis que se poursuit dans une socit un travail de transformation, que certaines de ses institutions et mmes les parties fondamentales de sa structure demeurent quelque temps inbranles, ou du moins qu'elles paraissent subsister telles quelles. Une socit ne passe pas d'une organisation une autre en vertu d'un effort conscient de ses membres, qui se donneraient de nouvelles institutions en vue des avantages rels qu'ils en tireront. Comment les connatraient-ils, avant que ces institutions n'eussent fonctionn, et n'eussent fonctionn prcisment dans leur groupe ? Certes, plus Lard, ils s'y attacheront pour des motifs qu'on peut appeler rationnels , et qui, du moins, seront tels leurs yeux, mais seulement aprs qu'ils en auront prouv et qu'ils croiront en comprendre les bienfaits. Mais, tant qu'ils n'en sont pas arrivs encore ce point, les institutions nouvelles ne peuvent leur en imposer que si s'attache elles le mme prestige qu'aux institutions anciennes, et il faut donc que, quelque temps, jusqu' ce qu'elles soient consolides, celles-l soient en quelque sorte masques par celles-ci. Alors, ou bien, par une srie de retouches insensibles, la vraie figure des institutions nouvelles se dgage : ainsi le rgime dmocratique de l'Angleterre moderne s'est lentement labor sous le couvert d'institutions de l'autre sicle ; ou bien une rvolution fait tomber le masque. On oppose quelquefois le rgime moderne ceux qui l'ont prcd, dans l'Europe occidentale, en disant qu'au rgime fodal s'est substitu un rgime bureaucratique 1. En d'autres termes, une administration centralise s'est de plus en plus impose aux seigneurs et leurs vassaux : la souverainet, disperse au Moyen ge et divise entre tant de mains, s'est concentre. Mais cette volution s'est poursuivie pendant plusieurs sicles sous le couvert des formes fodales. Pendant longtemps, avant qu'il ft possible de justifier les pouvoirs et le rang des fonctionnaires par l'utilit relle de leur fonction, on a d fonder leur autorit sur des titres nobiliaires, des privilges et des droits, fonds eux-mmes sur leurs qualits et leurs prouesses personnelles (trs distinctes de celles qui taient requises pour l'accomplissement de la fonction), ou sur celles de leurs anctres dont le mrite durait fictivement en eux. Rien ne montre mieux quel point il fallait, durant cette priode, faire appel la mmoire de la socit, pour obtenir une obissance que, plus tard, on rclamera en s'appuyant sur l'utilit des services rendus, et sur la comptence du magistrat ou du fonctionnaire. Au Moyen ge s'tait constitu un systme de valeurs nobiliaires, fondes sur l'histoire des familles nobles, et o se trouvaient enregistrs les souvenirs de toutes les circonstances notables de leur vie, leurs noms, leurs blasons, leurs actes de vaillance,
1
Max WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der Sozialkonomik, II Abtng., Tbingen, 1922, p. 650 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
163
leurs alliances, les services par eux rendus leur seigneur en qualit de vassaux, les titres eux confrs, etc. Il nous est d'ailleurs peu facile de nous reprsenter exactement l'origine et la nature de ces valeurs, et des sentiments qu'elles veillaient ; en tout cas elles reposaient sur des donnes historiques, sur des traditions plus ou moins anciennes qui se conservaient dans les groupes de familles nobles, et qui taient en rapport troit avec l'histoire gnrale du royaume. On peut faire la thorie de ces relations fodales, et il apparat qu'il y avait en elles une logique cache qui petit petit s'est dgage, et dont le pouvoir royal s'est servi lui-mme pour recouvrer une partie de ses droits 1. Mais il est peu probable qu' l'origine les seigneurs et leurs vassaux se soient reprsent ce systme comme une thorie abstraite. Pour eux, les rapports qui les unissaient ressemblaient plutt aux liens d'amiti, aux services mutuels, aux tmoignages d'estime et de considration qui rapprochent, dans une socit relativement stable, des familles voisines ou parentes, expriment leurs yeux, comme aux yeux des autres, leur rang dans l'ensemble, et dont le souvenir se transmet de gnration en gnration. Certes, derrire ces familles, il y a une ralit substantielle qui fonde leur situation sociale : c'est la richesse dont chacune dispose, ou le genre de fonctions qu'exercent ses membres, et qui mettent dans leur dpendance un certain nombre d'autres familles de rang voisin, ou qui les mettent en rapport avec des familles de rang plus lev. De mme la puissance d'un seigneur repose sur le nombre et l'tendue des terres qu'il a donnes en fiefs, et sur sa place dans la hirarchie au sommet de laquelle est le roi, c'est--dire sur la distance plus ou moins grande qui le spare de lui. Il n'en est pas moins vrai qu' l'origine tout s'est pass comme si ces biens et ces rangs allaient ceux qui, par leurs dons et qualits personnelles, les mritaient. Si pendant trs longtemps un prjug dfavorable s'est attach aux professions trop visiblement lucratives 2, c'est qu'il a paru qu'entre la richesse ainsi acquise et celui qui la dtenait il n'y avait qu'un rapport tout extrieur, et que fonder le rang social sur la richesse, ce serait substituer une hirarchie des choses celle des personnes. Au contraire la qualit noble du seigneur ou du tenancier se communique sa terre : derrire les champs, les forts, les terres de rapport, c'est la figure personnelle du seigneur qu'on aperoit. La voix des laboureurs qui rpondent, quand on veut savoir qui sont ces champs : C'est au marquis de Carabas , c'est la voix de la terre elle-mme. Tel assemblage de terres, forts, collines, prairies a une physionomie personnelle : elle lui vient de ce qu'elle reflte la figure et l'histoire de la famille seigneuriale qui chasse dans ces forts, parcourt en tous sens ces terres, btit ses chteaux sur ces collines, surveille ces routes, qui a runi tel bien et tel autre telle poque, par conqute, par don royal, par hritage ou alliance. Il serait tout autre, prsenterait un aspect diffrent, n'inspirerait pas les mmes sentiments, n'voquerait pas les mmes souvenirs, si d'autres personnes, une
1 2
ESMEIN, Histoire du droit franais, p. 313 sq. Les exercices drogeants la noblesse sont ceux de procureur postulant notaire, clerc, marchand et artisan de tous mtiers, fors de la verrerie... Ce qui s'entend quand on fait tous ces exercices pour le gain : car c'est le gain vil et sordide qui droge la noblesse, de laquelle le propre est de vivre de ses rentes, ou du moins de ne point vendre sa peine et son labeur. LOYSEAU (mort en 1627), Trait des seigneuries, des ordres ci simples dignits, des offices. Et toutefois les juges, avocats, mdecins, et professeurs de sciences librales ne drogent point la noblesse qu'ils ont d'ailleurs, encore qu'ils gagnent leur vie par le moyen de leur estat : pour ce que (outre qu'il procde du travail de l'esprit et non de l'ouvrage des mains) est plutt honoraire que mercenaire... Le labourage ne droge point la noblesse, non pas, comme on estime communment, cause de l'utilit d'iceluy ; mais d'autant que nul exercice que fait le gentilhomme pour soy et sans tirer d'argent d'autruy n'est drogeant. Sont vils, au contraire, ceux qui ont pour vocation ordinaire de labourer pour autres comme fermiers ; exercice qui est aussi bien dfendu la noblesse comme la marchandise. Cit dans l'Organisation du travail, par Charles BENOIST, 1914, t. II, p. 118 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
164
autre famille tenaient la place des possesseurs actuels. Du jour o les titres tombent dans le domaine public, o on les achte, et o, en effet, une famille de sang roturier peut se substituer une famille de sang noble, bien qu'on cherche, par la fiction de la continuit des titres, dissimuler ces changements de personnes ou de lignes, la socit s'en aperoit cependant, et le respect pour la proprit noble dcrot. Mais, tant qu'il subsiste, il repose bien sur l'ide que le titulaire des biens ne peut pas tre remplac par tout autre, et qu'il exerce son droit de possession en vertu de qualits qui ne sont propres qu' lui, sa famille ou son sang. C'est donc une physionomie singulirement concrte et particulire que celle de l'ordre social cette poque : les noms et les titres voquent le pass des familles, la situation gographique de leurs biens, leurs relations personnelles avec d'autres familles nobles, leur proximit des princes et de la cour. C'est l'ge des particularits et des privilges. Tous les hommes et tous les groupes, qui le peuvent cherchent ainsi se crer des droits historiques, prendre place dans ce cadre : les villes obtiennent des chartes, et datent leurs franchises de l'avnement d'un roi, ou d'une dcision de tel seigneur. Lorsqu'une famille noble s'teint, c'est une tradition qui meurt, c'est une partie de lhistoire qui tombe dans l'oubli : et l'on ne peut en mettre une autre sa place, comme on remplace un fonctionnaire par un autre. Comme les personnes meurent sans cesse, il faut que la socit fodale se rpare sans cesse aussi, par un renouvellement incessant d'hommages, par de nouveaux mrites, et de nouvelles prouesses. Il ne suffit pas de mettre une nouvelle matire dans d'anciens cadres : mais comme les personnes elles-mmes et leurs actes, et le souvenir de leurs actes, constituent les cadres de cette vie sociale, les cadres disparaissent quand les personnes ou les familles s'vanouissent, et il faut en reconstruire d'autres, de la mme manire, suivant les mmes lignes, mais qui n'auront pas exactement la mme forme, ni le mme aspect. Lorsque dans les derniers sicles de la monarchie s'accomplit l'volution d'o sortira le rgime moderne, ce n'est pas brusquement qu'on pouvait obtenir des hommes qu'ils obissent la fonction, alors qu'ils taient habitus s'incliner devant le titre 1. C'est pourquoi, en particulier au XVIIe et au XVIIIe sicle, tandis que la centralisation est pousse de plus en plus loin, et que les seigneurs se laissent dpouiller petit petit de tous leurs pouvoirs, la monarchie garde des dehors fodaux 2.
1
Titre, d'aprs Littr, est un nom exprimant une qualit honorable, une dignit. Il a le titre de duc, de marquis. -Sans doute, en fait, ces dignits se rattachent d'anciennes fonctions. Ces seigneuries suprieures (les grands fiefs) portent toutes des titres spciaux, des titres de dignit. Ce sont d'abord les duchs et les comts, et ici l'origine de la seigneurie et du titre est facile discerner : ce sont les grandes divisions administratives de la monarchie carolingienne qui leur ont donn naissance, par l'appropriation des fonctions publiques au profit des ducs et des comtes. Au dessous (en ordre de dignit) sont les baronnies : celles-l sont une cration nouvelle, un produit de l'ge o s'est forme la fodalit. Elles ne correspondent point une fonction publique de la monarchie carolingienne... : elles ont t d'abord une puissance fait, puis sont devenues la forme principale de la pleine seigneurie fodale. La liste des fiefs titrs... comprend aussi... les vicomts et les chtellenies. Ici, nous avons affaire deux fonctions infodes, deux supplants devenus titulaires. Le vicomte, dans la monarchie franque, tait le supplant du comte : le chtelain tait, l'origine, un dlgu du baron... ESMEIN, Histoire du droit franais, 10e dition, p. 181. Mais l'appropriation des fonctions publiques par les seigneurs titrs n'est qu'un aspect du dmembrement de la souverainet : les fonctions, en d'autres termes, supposent un titre, et ne suffisent pas le crer. Ce qui le prouve, c'est que, comme les terres, elles sont toujours tenues en fief, soit d'un seigneur, soit du roi (ibid., p. 180). Ainsi, quand au XVIIe sicle on charge de l'administration des provinces les intendants, vritables fonctionnaires, contrleurs de tous les services publics, on conserve les snchaux et baillis de la monarchie fodale, et les gouverneurs de la monarchie tempre. Or, les gouverneurs, comman-
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
165
Alors que le systme de la monarchie absolue et centralise s'achve, qu'on en fait la thorie, qu'elle dispose de tous ses agents, il semble que le ressort du nouveau rgime pourrait tre uniquement le sentiment de l'intrt gnral 1, et que le roi trouverait dans la bourgeoisie, qui est dj riche et cultive, dont beaucoup de membres exercent des fonctions de judicature et de finance, les lments ncessaires pour gouverner. Il s'en sert, en effet, et il fait largement appel leurs services. Il utilise leurs aptitudes 2, mais il croit ncessaire de leur imposer d'abord un stage dans la situation noble. On a remarqu qu'un trs grand nombre des nobles du XVIIe et du XVIIIe sicle l'taient de frache date, que la noblesse de race, de sang, d'pe, tait cette poque faiblement reprsente dans l'ensemble des nobles, dcime par les guerres des sicles prcdents, ruine parce qu'elle avait d vendre ses biens pour payer ses dettes, et parce qu'elle n'tait pas adapte aux conditions conomiques nouvelles. Les hommes de cette poque plongeaient encore trop profondment dans le pass pour comprendre tout de suite la logique du nouveau systme. La monarchie, pour se procurer les sommes considrables qu'une administration aussi vaste rclamait, et pour plier ses sujets l'obissance, dut s'appuyer sur le prestige traditionnel de la noblesse ; la bourgeoisie riche et cultive, pour exercer les fonctions d'autorit, pour siger dans les conseils, dans les cours de justice et de finance, dut s'installer dans les chteaux des nobles, acqurir leurs blasons, acheter leurs titres. Ainsi, la structure nouvelle s'labore sous la structure ancienne. On pourrait dire que les notions nouvelles ne se dgagent qu'aprs avoir pris longtemps figure de notions anciennes : c'est sur un fond de souvenirs que les institutions d'aujourd'hui se construisent, et, pour beaucoup d'entre elles, il ne suffit pas, pour les faire accepter, de dmontrer qu'elles sont utiles : il faut qu'elles s'effacent en quelque sorte, pour laisser voir les traditions qui sont derrire elles, et qu'elles aspirent remplacer, mais avec lesquelles, en attendant, elles cherchent se confondre. Au reste il ne faut pas croire qu'il y ait l un simple jeu d'illusions, qu'on cherche seulement abuser le peuple des sujets, et entretenir en eux la croyance que les hautes classes reprsentent comme une catgorie humaine d'espce plus leve parce qu'elle peut se rclamer d'anctres qui firent leurs preuves, parce qu'en elle se perptue et se renouvelle un ensemble de proprits physiques et spirituelles qui se transmettent hrditairement et rehaussent la valeur personnelle de ses membres. Sous la fiction du sang noble il y a, chez les gens titrs, une conviction sincre : ils croient rellement que leur groupe est la partie la plus prcieuse, la plus irremplaable, en mme temps que la plus active et bienfaisante du corps social, qu'il est, en un sens, la raison d'tre de la socit. Il faut analyser cette croyance, qui ne se ramne pas un simple entranement de vanit collective, et qui est fonde sur une apprciation assez exacte de la nature et du rle d'une classe noble.
dants militaires l'origine, taient toujours pris dans la haute noblesse. Loyseau, la fin du XVIe sicle, voyait en eux le germe d'une nouvelle fodalit politique. En cela il se trompait . Leur charge, au XVIIIe sicle, tait devenue une vritable sincure, d'ailleurs largement rtribue. ESMEIN, op. cit., p. 589 sq. On sait que de bonne heure les lgistes laissent entendre que le pouvoir du roi s'exerce pour le commun profit (BEAUMANOIR ds le XVIIIe sicle). Les monarques captiens eurent de bonne heure, attachs leur personne et vivant au palais, des conseillers privs et intimes, qu'ils choisissaient de prfrence parmi les clercs instruits et, lorsque l'tude des lois fut remise en honneur, parmi les lgistes. Ils entrent dans la Curia regii (premire forme du Parlement) et y jouent un rle trs important de Louis VII Philippe Auguste. Le droit romain et canonique commence pntrer la procdure de la cour, qui se fait plus savante, plus difficile comprendre ceux qui ne sont point des hommes du mtier. C'est ainsi que le personnel du Parlement prit peu peu un caractre professionnel, et que s'en trouvrent limins (sauf les pairs) la haute noblesse et les prlats. ESMEIN, op. cit., p. 371 sq.
1 2
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
166
Dans le rgime fodal, les vassaux taient tenus d'assister le seigneur : ils mettaient son service leur personne et leurs armes en cas de guerre ; ils sigeaient ses conseils ; ils l'aidaient rendre la justice. Si la socit fodale prsente ainsi l'image d'un groupe dont les membres s'acquittent de diverses fonctions, de toutes celles qui sauvegardent l'intgrit matrielle du groupe et lui rendent mme possible de s'accrotre en grandeur et en force, de celles qui y maintiennent l'ordre et une certaine uniformit, un autre point de vue, l'occasion de l'exercice de chacune de ces fonctions, les membres du groupe prennent mieux conscience des rapports de subordination et d'hommage qui dfinissent leur rang, tmoignent des honneurs et en reoivent, se retrouvent parmi leurs pairs, accomplissent des gestes rituels, dploient leurs enseignes, revtent leurs insignes, prononcent des paroles et des formules traditionnelles, et pensent en commun dans les cadres qui leur sont familiers. Il est mme certain que toujours, et de plus en plus mesure que la socit se complique, c'est ce second aspect de leur activit qui passe au premier plan. Toutes les fois qu'il est possible de dissocier dans la fonction ce qui est crmonie, parade, reprsentation, et ce qui est technique, on fait appel des clercs, des scribes, des lgistes, des ingnieurs, et on leur abandonne tout ce qui ne met pas en jeu les qualits par o se distinguent les nobles 1. On comprend d'ailleurs qu'il en soit ainsi, si l'on remarque que toute fonction, dpouille des formes conventionnelles dont l'enveloppe chaque socit comme pour s'y retrouver elle-mme, limite et dnature la vie sociale, et reprsente comme une force centrifuge qui tend carter les hommes du cur de la socit. Pour exercer l'une d'elles, il faut en effet que les hommes, temporairement au moins, s'abstiennent des autres. Spcialiss, ils limitent leur horizon, d'autant plus que, pour s'appliquer leur tche, il leur faut se tourner, tourner leurs penses et orienter leurs actes vers les parties de la vie sociale o l'empire des ncessits matrielles semble se faire le plus sentir. Dans la guerre, il faut observer une discipline qui consiste souvent traiter les hommes comme de simples units physiques ; il faut transporter et approvisionner les troupes, tenir compte des distances et de la disposition des lieux ; il faut s'occuper des armes, des munitions, des fortifications. Luvre de lgislation oblige dfinir d'une faon uniforme et abstraite les tres et les conditions auxquels les lois s'appliquent : les lois concernant l'hritage par exemple, pour le calcul des degrs de parent, se reportent un type gnral de famille, cadre dans lequel toute famille peut tre replace, et divisent les biens en un certain nombre de catgories. Toutes les lois reposent sur une classification des hommes, des actes, d'es situations, des objets, d'aprs des caractres extrieurs, et, par tout un aspect, le droit est une pratique terre terre, qui envisage les individus et leurs-relations du dehors, tend se figer en formules, et se rduire I'application mcanique de rgles. Ramens la situation de dfendeur et de demandeur, les hommes sont devant les juges comme des tres qu'il faut peser, cataloguer, tiqueter. Le droit pnal tenait compte sans doute autrefois de la situation sociale des plaignants, et des accuss ; il y avait des coutumes et des lois diffrentes suivant les provinces ; il y avait des tribunaux ecclsiastiques, etc. Il n'en est pas moins vrai que, mme cette poque, tout homme qui s'tait rendu coupable de quelque dlit ou de quelque crime
1
Dans les corporations du Moyen ge le devoir d'assister aux crmonies civiques entranait une perte de temps assez considrable, de sorte que les frres les plus pauvres taient assez ports laisser de plus riches le devoir de reprsenter leurs compagnies avec la magnificence requise dans ces occasions solennelles . W. ASHLEY, Histoire et doctrines conomiques de l'Angleterre, Il; p. 166. Traduction franaise, 1900. Voir aussi ce qu'il dit de la livre Londres, qui aprs avoir t la marque d'un mouvement dmocratique, avec le luxe dans les vtements devint l'emblme d'une aristocratie civique . Ainsi les plus riches des membres de la corporation se spcialisent dans l'exercice des fonctions crmonielles.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
167
comparaissait devant un tribunal qui jugeait son acte, plutt que sa personne, ou qui jugeait que sa personne tait modifie du fait de son acte, et qu'il rentrait dans une des catgories d'hommes qualifis dlinquants ou criminels. Les valuations et calculs financiers, la perception des taxes, le paiement des agents, officiers, pensionns, etc., plus forte raison encore, reviennent des oprations de mesure, des dplacements de biens matriels, o l'on fait abstraction des diffrences entre les hommes, qui rsultent de rien d'autre que leurs revenus, leurs dettes ou leurs crances vis--vis du Trsor. On voit que ceux qui exercent toutes ces fonctions se reprsentent les groupes d'hommes auxquels ils ont affaire en s'attachant plutt leurs caractristiques extrieures qu' leur nature personnelle, qu'ils les traitent comme des units rparties entre des catgories auxquelles manque la souplesse des groupements humains spontans. Plus la fonction se rduit cela, plus il est naturel, que les nobles s'en dsintressent. La noblesse repose en effet sur un tout autre ordre d'apprciation : on y considre non les caractres qui permettraient de placer l'homme dans un de ces cadres et de le confondre avec beaucoup d'autres, mais ceux qui le distinguent de tous ceux qui l'entourent, et, mme parmi ses pairs, lui confrent un rang que lui seul peut occuper. La hirarchie noble n'a aucun rapport avec les rgles techniques qu'appliquent au classement des hommes, le technicien militaire, le lgiste, le code pnal, et tous les agents chargs de rpartir et lever les taxes ; elle ne tient compte, en principe que de l'honneur, du prestige, des titres, c'est--dire de notions purement sociales, o n'entrent aucun lment de nature physique qui se prte la mesure, au calcul, ou une dfinition abstraite. En d'autres termes, chaque noble ou chaque famille noble est plonge si profondment dans l'ensemble des autres familles de mme classe, qu'elle les connat (ou est cense les connatre) toutes, et que, d'autre part, toutes la connaissent, et connaissent ses origines, sa place et ses ramifications dans leur groupe. Deux nobles, qui se rencontrent sans, s'tre jamais vus doivent tre en mesure, aprs un change de quelques propos, de se reconnatre comme deux membres d'une mme famille tendue qui retrouveraient leur relation de parent ou d'alliance. Ceci suppose que se perptue dans la classe noble, travers les gnrations, tout un ensemble bien li de traditions et de souvenirs. Comme rien de semblable ne se rencontrait dans les autres groupes, il faut dire que la classe noble a t longtemps le support de la mmoire collective. Son histoire, vrai dire, n'est pas toute l'histoire de la nation. Mais nulle part ailleurs on ne trouve une telle continuit de vie et de pense, nulle part ailleurs le rang d'une famille n'est dfini ce point par ce qu'elle et les autres savent de son pass. Dans les classes commerantes et artisanes, et dans les parties leves de la bourgeoisie, l'homme se confond avec sa tche, sa profession, sa fonction : c'est elle qui le dfinit. Un noble ne peut pas s'absorber dans sa fonction, il ne peut pas devenir simplement un instrument ou un rouage, mais il est un lment et une partie de la substance mme de la socit. On juge un fonctionnaire sur les services actuels qu'il rend ; on veut qu'il soit bien adapt aux conditions prsentes et sa tche immdiate : on tient compte sans doute de ses services anciens, mais dans la mesure o ils garantissent sa comptence et son habilet d'aujourdhui. Le rang d'un noble se fonde au contraire, sur l'anciennet de sont titre. Pour l'apprcier, il faut du recul. Sa figure se dtache sur une perspective de familles nobles, dans un tableau o le pass et le prsent sont aussi troitement superposs et aussi fondus qu'un texte et les corrections successives qu'on y a apportes. Ici, en effet, les rapports ne sont pas seulement d'homme homme (ce qui pourrait s'entendre en un sens demi physique et technique), mais de groupe groupe, de valeur sociale valeur sociale. Or une valeur de ce genre consiste en une
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
168
srie de jugements, rsulte d'une, association de penses qui, comme tous les tats de conscience un peu complexes, ont demand du temps pour se constituer et se prsentent comme des souvenirs au moins autant que comme des tats prsents. Il y a sans doute chaque poque une faon de penser et tout un systme d'apprciations qui s'applique au prsent, aux hommes actuels, et qu'on pourrait croire inn la classe noble, au mme titre que les notions qui leur sont communes avec les autres hommes. Et il faut croire qu'elles trouvent encore dans le prsent, dans la nature et le genre de vie des nobles du moment, une apparence au moins de raison d'tre. Mais ce systme d'ides, quelque logique qu'on y dcouvre, et alors mme qu'on ne se rappelle plus l'origine de tel ou tel de ses lments, n'est qu'une transposition de souvenirs. Un noble, en contemplant les portraits de ses anctres dans une galerie de son chteau, en voyant les murailles et les tours leves par ceux-ci, sent bien que ce qu'il est aujourd'hui s'appuie sur les vnements et les personnes dont ce sont l des vestiges. Il projette d'ailleurs dans le pass le lustre de sa situation prsente : tel petit gentilhomme effac, qui fut au point de dpart d'une ligne illustre, apparat lui-mme transfigur et tout rayonnant de la gloire posthume. Ainsi, tandis que la socit se dcompose en un certain nombre de groupes d'hommes prposs aux diverses fonctions, il y a en elle une socit plus troite dont on peut dire qu'elle a pour rle de conserver et maintenir vivante la tradition: tourne vers le pass ou vers -ce qui, dans le prsent, continue le pass, elle ne participe aux fonctions actuelles qu'autant qu'il importe de les plier elles-mmes aux traditions et d'assurer, travers leurs transformations, la continuit de la vie sociale 1. En effet, la force centrifuge qui porte les hommes prposs une tche s'y absorber, oublier tout ce qui n'est pas leur objet actuel, qu'il s'agisse d'objets anciens de mme nature, ou d'objets actuels d'autre nature, il faut opposer d'autres forces qui les rattachent cette partie de la socit o le pass se relie au prsent, et o les diverses fonctions se rejoignent et s'quilibrent. Reprenons et considrons de ce point de vue les grandes activits spcialises telles que la guerre, la lgislation, la justice. Nous disions que, ds qu'elles se compliquent au point que chacune d'elles, et mme chaque branche de l'une d'elles suffit absorber tout le temps et tous les efforts d'un groupe d'hommes, elles maintiennent ceux-ci dans une zone de vie sociale limite et diminue> puisque les rgles techniques y introduisent beaucoup de mcanisme, puisque les fonctionnaires sont en rapport avec des hommes sans doute, mais avec des hommes simplifis. Mais ce n'est l qu'un de leurs aspects, et peut-tre le plus superficiel. Pour la conduite d'une guerre, ce n'est pas assez de l'ordre, de la discipline, et de l'instruction militaire qu'on reoit dans les camps, Les qualits techniques n'y supplent point aux qualits personnelles. Le chef ne doit pas seulement faire preuve d'une valeur hors de pair : il doit encore tre capable de ces subites inspirations, de ces inventions et de ces improvisations qui supposent la connaissance des hommes, le maniement des ides, une mmoire active, une imagination toujours en mouvement. Or, ces qualits ne se dveloppent que dans ces milieux de vie sociale intense o se croisent les ides du pass et du prsent, o entrent en contact en quelque sorte non seulement les groupes
1
Le Parlement de Paris devait... jusqu'au bout contenir accoupls... deux lments... : une cour fodale et une cour royale de justice. Le premier lment est reprsent par les pairs de France, le second par les magistrats du parlement. ESMEIN, Op. Cil., P. 365. SAINT-SIMON remarque que la dignit de due et pair de France est, par sa nature, singulire et unique, une dignit mixte, de fief et d'office. Le due est grand vassal; le pair est grand officier. Il ajoute: l'office de pair est appel non seulement l'imptrant, mais, avec lui, par une seule et mme vocation, tous ses descendants masculins l'infini, tant et si longtemps que la race en subsiste, au lieu qu' tous les autres offices, quels qu'il& soient, une seule personne est appele, et nulle autre avec elle . Mmoires, t. XXI, pp. 236-239.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
169
d'aujourd'hui, mais ceux d'autrefois : l'esprit s'y aiguise reconnatre les traits originaux de chaque personne, le sentiment de l'honneur, de ce qu'on se doit, ainsi qu' son nom et ses titres, y lve l'homme au-dessus de lui-mme, et fait refluer en lui toutes les ressources inpuises du groupe qu'il reprsente. Mais il en est de mme du lgislateur, du conseiller, du juge. Une loi n'est pas un simple instrument tel qu'il, suffise, pour le construire, de savoir quels doivent tre ses dimensions, le nombre de ses pices, sa porte, les rsistances, qu'il doit vaincre. On ne peut pas dire non plus qu'elle rsulte d'une simple dlibration technique o ceux qui discutent ne mettent en commun que leur connaissance du droit et leur exprience pratique. Un lgislateur doit possder le sens de l'quit (telle qu'on l'entend dans la socit dont il est membre.) qui ne s'acquiert que dans les groupes o les hommes s'apprcient avec une telle norme. Il y a une justice dont on s'inspire pour rendre chacun les honneurs qu'on lui doit : elle repose sur une exacte apprciation du prestige et des mrites des familles, et permet de faire des lois justes qui s'appliqueront tout le corps. social. Si le seigneur appelait ses vassaux siger en conseil, ce n'est pas titre de techniciens : mais dans le corps des nobles se transmettait et s'entretenait un esprit commun d'estime mutuelle, et la proccupation de rendre chacun le tribut, d'hommage que ses qualits de noblesse mritaient. Eux seuls taient capables d'introduire cet esprit dans les instruments, lgaux prpars par les scribes, lgistes, parce que de tels sentiments ne pouvaient se fixer qu'au cours de longues et multiples expriences collectives, c'est--dire seulement dans un corps de nobles. De mme enfin aucune pratique subalterne, aucun, recueil de rgles ne suffirait former un juge : il y a une trop grande diversit de circonstances, les plaignants et les inculps diffrent trop les uns des autres, pour qu'il soit possible de ranger tous les cas et toutes les personnes en un certain nombre de catgories assez simples pour que l'opration de justice se ramne une simple routine d'administration. Le juge plus que tout autre doit tre capable d'valuer moralement les actions et les actes. O l'aurait-il appris, sinon hors du tribunal o les juges, les avocats, les inculps, etc., constituent un milieu tout artificiel o les personnes et les sentiments disparaissent derrire les formes conventionnelles du langage de la procdure et des actes, o le pli de la profession communique l'esprit une raideur qui risque de passer dans les arrts ? Ainsi, partout o la fonction rclame, outre une comptence technique, l'exercice de la rflexion, ce n'est pas elle qui peut y prparer, puisque, livre elle-mme, elle s'exercerait sans rflexion. On comprend au reste qu'il faille un milieu spcial, tranger aux proccupations exclusives de la profession, pour qu'on y apprenne discerner et apprcier les nuances des valeurs humaines. Mais c'est l o la pense se reporte sans cesse sur des personnes, sur des groupes qui ont une physionomie et une histoire propre, que ce sens dlicat se forme le mieux. C'est pourquoi de bonne heure il y a eu une noblesse de robe 1. On a cru assez tt que des juges, appels trancher des questions qu'on ne pouvait bien comprendre sans une connaissance tendue des situations sociales, et
1
Un rglement d'Henri III pour les tailles, en 1582, ne reconnat encore que deux sortes de nobles, ceux qui sont de maison et de race noble, ceux aussi dont les ancestres ont obtenu lettres d'anoblissement. Depuis, la maxime a t introduite que les rois confrent la noblesse non pas seulement par lettres, qui est le moyen ordinaire et exprs, mais encore par un moyen tacite, c'est-dire par les hauts offices de justice et par les services que le pre et l'aeul ont continu de rendre au public . DE LA ROQUE Trait de la noblesse, 1768, chap. XXXI, p. 22, cit par ESMEIN, op. cit., p. 679. Ds 1613, Jean ROCHETTE, dans Questions de droit et de pratique, p. 23 (ibid., p. 676) dit : Entre roturiers, les fiefs se partent galement ; toutefois, ils sont partags noblement entre les enfants de conseillers des cours souveraines, lesquels sont anoblis par leurs estats. Dans, les Mmoires du Cardinal de Retz (dit. de l820, t I, p. 236) on lit encore : Il (M. le Prince) me dit en jurant qu'il n'y avait plus moyen de souffrir l'insolence et l'impertinence de ces bourgeois (le Parlement) qui en voulaient l'autorit royale.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
170
dont il fallait quelquefois retrouver des exemples en remontant le cours de l'histoire, ne pouvaient ne pas se rattacher la noblesse tout court et ne pas tre avec elle peu prs de plain-pied. Deux courants de sens inverse ont travers la classe noble et en ont lentement renouvel la composition. D'une part ceux des nobles qui reprsentaient des traditions trop anciennes, qui ont vcu sur leur pass sans le renouveler et l'enrichir, qui ne furent pas capables de se signaler et de signaler leur famille par l'acquisition de titres nouveaux dus soit la faveur du roi ou des plus hauts seigneurs, soit des alliances avec d'autres familles distingues, ne peuvent plus tenir leur rang : alors ils s'isolent, et ne sont plus que de loin en loin en rapport avec d'autres nobles ; on les oublie petit petit, et ils s'oublient eux-mmes, jusqu' exercer des fonctions qui font dchoir et o l'on ne trouve que des gens de bourgeoisie. Aux XVIe et XVIIe sicles, toute une partie de la vieille noblesse de race, de sang et d'pe s'est ainsi rsorbe. C'est donc aussi une partie de la mmoire collective noble qui s'est dissoute : il s'y est creus des trous, des pans tout entiers s'en sont dtachs. Les souvenirs propres de telles familles places maintenant hors du courant de la vie collective ne trouvaient plus en effet leur place dans les cadres de la mmoire noble transforme : pour qu'ils subsistassent, il et fallu les associer des souvenirs plus rcents, multiplier les rapports entre eux et les autres ; il et fallu que la pense commune, dans son cours actuel, et eu l'occasion de repasser souvent sur leurs traces. Ils ressemblent au contraire ces souvenirs individuels si loigns des proccupations actuelles du sujet, si trangers ces associations d'ides familires, qu'on ne les voque jamais, et qu'on n'y songe plus : de ce moment ils disparaissent, puisqu'il n'y a plus, dans ce qui subsiste d'eux ou de leur entourage, les lments ncessaires pour les reconstruire. Il est vrai qu'on n'est jamais sr qu'une telle disparition soit dfinitive 1. Des circonstances imprvues peuvent replacer l'esprit dans des conditions telles qu'il puisse se les rappeler cependant, de mme qu'elles font quelquefois qu'on repense des amis ngligs parce qu'ils se retrouvent sur notre passage, soit qu'ils aient chang de place, soit que notre chemin, prsent, nous rapproche d'eux. De mme il arrive que des familles nobles qu'on croyait teintes reprennent leur rang aprs une longue priode d'existence obscure, fassent revivre leurs titres, redorent leur blason. La mmoire collective noble, ces moments, retrouve des souvenirs qu'elle n'avait pas voqus depuis trs longtemps, qu'elle pouvait croire teints. Ils ne l'taient pas, tant que subsistait la possibilit de les reconstruire. Ce qui a permis un tel retour d'clat et de fortune, aprs de longs revers, c'est que cette famille est rentre dans la noblesse par des chemins qui n'existaient pas autrefois, qui ont t ouverts rcemment, et qu'elle a suivis en mme temps que beaucoup d'autres familles qui jamais n'avaient t nobles : elle s'est d'abord enrichie, par exemple, dans le commerce, puis s'est leve des fonctions qui rapprochent de la situation noble, puis d'autres qui confrent la noblesse. La classe noble, qui reconnat l'un de ses membres qu'elle croyait perdu, peut supposer, maintenant, que ce noble a conserv sa qualit sous l'apparence de l'obscurit roturire, comme on s'imagine quelquefois que dans l'obscurit de l'inconscient les souvenirs oublis subsistent. En ralit sa noblesse d'aujourd'hui n'est identique qu'en apparence
1
La noblesse se perdait... par le fait de droger, c'est--dire de mener un tat de vie incompatible avec la qualit de noble... C'tait toutefois une question de savoir si, alors, la noblesse tait perdue, ou si elle sommeillait seulement pendant la drogeance... Mme lorsque la noblesse avait t radicalement teinte, le roi pouvait la restituer par des lettres de rhabilitation. ESMEIN, op. cit., p. 680. Mais il faut toujours revenir ce point que la noblesse n'est pas absolument teinte par tels actes drogeants, mais est seulement tenue en suspens, de sorte que le gentilhomme est toujours sur ses pieds pour rentrer sa noblesse quand il voudra s'abstenir d'y droger. LOYSEAU, Cit par BENNOIST, op. cit., p. 118.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
171
sa noblesse d'autrefois. Les cadres de la mmoire sociale se sont modifis d'une poque l'autre. Autrefois, elle retenait les prouesses de guerre, tout ce qui entre dans la notion du chevaleresque, tout ce qui frappait l'attention d'hommes dont l'estime allait des activits non techniques ni lucratives. A prsent (vers la fin de l'ancien rgime), elle s'est singulirement largie. Elle ne fait pas encore, dans sa table des valeurs, une place celles qui consistent dans une supriorit intellectuelle, une comptence exceptionnelle, un talent prouv, si elles n'ont pas revtu le vtement de cour et ne se prsentent pas sous des dehors nobles, non plus qu' la richesse pure et simple. Mais de plus en plus la richesse, le talent et l'habilet sont la condition de ces activits nouvelles qui, dans la classe noble, modifient et dfinissent les rangs, une poque o celle-ci, pour maintenir son clat, doit d'une part accrotre son luxe, et d'autre part pntrer de son esprit toutes les fonctions nouvelles qui naissent, toutes les fonctions anciennes qui se divisent, se compliquent et se spcialisent. La qualit noble suppose maintenant la disposition de biens matriels, et d'un crdit financier, et, sous forme au moins de relations, quelque accs dans les rgions leves de l'appareil administratif. Un titre nu, sans tout cela, ne compte plus gure. Ce n'est pas de lui-mme, par sa vertu propre (ou par la vertu des qualits qui le fondrent autrefois) qu'il se conserve. Il importe ds lors assez peu que la mme famille retrouve le titre qu'elle avait perdu, ou que ce soit une autre qui l'obtienne. L'essentiel, c'est la fiction de la continuit des titres, la croyance qu'ils se transmettent de gnration en gnration avec les qualits personnelles qu'ils reprsentent, si bien que ceux qui les possdent aujourd'hui peuvent se rclamer des prouesses de ceux qui, les premiers, les obtinrent. Cette croyance la fois faisait obstacle ce qu'un roturier entrt dans la classe noble, et, au cas o tel d'entre eux s'appropriait indment un titre et russissait passer pour noble, favorisait cependant la confusion entre le noble par prescription et le vrai noble de race ou l'anobli 1. Il est arriv en effet de plus en plus frquemment (c'est le second courant que nous signalions) que les descendants de roturiers, d'hommes sans pass (c'est--dire de ceux dont la mmoire collective ne retenait pas le pass), pntrassent dans la classe des nobles , ainsi appels parce qu'on les distinguait, qu'on les remarquait, eux et leur ligne. Or en achetant le chteau, en acqurant la fonction et le titre, le roturier n'entrait point dans une famille noble prexistante, il ne se greffait pas sur elle, ni ne se substituait aucun de ses membres, il ne pouvait se rclamer de ses anctres. Au moment o le renouvellement et un recrutement largi de la classe noble s'imposa, il fallut que la socit s'accommodt de ces empitements, qu'elle trouvt le moyen de lgitimer ces hommes entrs dans la noblesse par effraction, sans titre, sans parrains, sans parents ; et il fallait par consquent qu'elle remanit et modifit plus ou moins les cadres de sa mmoire. Elle pouvait y parvenir de deux faons. Ou bien, dlibrment, elle pouvait dnaturer le pass. Ce qui, en effet, prouve la noblesse, c'est que, remontant de gnration en gnration, on trouve, chez un anctre, un fait gnrateur de noblesse. S'il n'existait pas, on pouvait, de toutes pices, l'inventer. Une dformation aussi audacieuse des faits accomplis se heurtait, il est vrai, aux intrts des nobles authentiques,
1
Il faut distinguer ce cas de celui de l'anoblissement. Le roi pouvait confrer un roturier des lettres de noblesse. La noblesse de lettres tait en droit parfaitement quivalente la noblesse de race et transmissible aux hritiers de l'anobli. -D'autre part,, l'ancienne manire d'anoblir par la collation de la chevalerie persistait au profit du roi; elle quivalait des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dornavant par la nomination l'un des ordres de chevalerie successivement institus par les rois, ordre de l'toile, de Saint-Michel, du Saint-Esprit et de Saint-Louis . ESMEIN, op., cit. p. 678.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
172
qui n'hsiteraient pas la dnoncer. Si l'on forgeait des gnalogies, elles devraient s'accorder avec celles qu'on conservait dans d'autres familles, elles devraient s'accorder aussi avec ce qu'on savait, par &autres sources, de la famille elle-mme 1. Mais la socit pouvait aussi, dtourner son attention de tout ce qui n'tait pas trs proche dans le temps, et limiter de champ de sa mmoire aux toutes dernires gnrations. De plus en plus, c'est ce second parti qu'elle s'est arrte 2. Cela revenait en somme constater qu'il est plus conforme aux souvenirs rcents des hommes d'admettre que telle famille est noble que le contraire, alors mme qu'on, peut croire qu'elle ne l'est pas rellement. C'est ainsi que les hommes modifient quelquefois leurs souvenirs individuels, pour les mettre en accord avec ce qu'ils pensent en ce moment, et qu'ils y russissent, le plus souvent, en s'en tenant aux souvenirs rcents, en supposant qu'il n'est pas possible d'atteindre directement les plus anciens, et en reconstituant ceux-ci par le moyen de ceux-l. Mais, dans la mesure o elle renonait ainsi ses souvenirs les plus anciens, la socit affaiblissait la valeur des titres et des prrogatives qui reposaient sur l'anciennet du rang, et portait atteinte aux catgories de nobles qui s'en rclamaient, c'est--dire la noblesse la plus authentique ; ainsi s'obscurcissaient les traditions les plus vnrables, et en mme temps les notions fondamentales de la pense noble ; d'o bien des hsitations, des rsistances, et des reculs. C'est cet embarras qui donne tout leur sens aux conflits rapports si au long dans les Mmoires de Saint-Simon, conflits entre les btards et les princes du sang, entre la noblesse d'pe et la noblesse de robe. Les dfenseurs rigides des titres et de l'anciennet sentaient bien qu'on ne peut limiter ainsi le champ de la mmoire sans la dformer, que les vnements et les hommes du pass lointain perdraient de leur importance, et leurs descendants aussi, dans la mesure o on mettrait au premier plan les vnements et les hommes d' prsent, et qu'une fois engag dans cette voie, on ne pourrait s'arrter. Mais ce qui branla le plus profondment la vieille noblesse ce lut l'apparition d'une noblesse nouvelle. De nouvelles avenues, en effet, s'ouvraient l'activit humaine : de nouvelles fonctions se craient, et les fonctions anciennes, subalternes jusqu'alors, gagnaient en importance ; si la vieille noblesse ne s'y intresse pas, si sa pense et sa mmoire se ferment ce qui s'accomplit dans ces domaines, il ne s'en dgage pas moins, des groupes, qui s'y consacrent, une lite. Il suffit que quelquesuns aient marqu une fonction de leur empreinte personnelle bien apparente, pour qu'eux-mmes, et tous ceux qui l'occuperont aprs eux, se distinguent de la masse des autres, pour que la socit leur fasse une place part dans sa mmoire. La socit, chaque poque, en effet, met au premier plan les activits qui l'intressent et lui importent le plus : autrefois, c'tait la guerre, aujourd'hui, c'est l'administration, la
1
Le pre du premier Pontchartrain, secrtaire d'tat, autour des Mmoires, n'tait que conseiller au prsidial de cette ville. Avant lui on ne voit que de simples bourgeois, et c'est sans doute pourquoi les continuateurs du Pre Anselme ont prfr se dispenser d'en reconstituer la filiation en anoblissant et embellissant les gnrations antrieures la fin du XVIe sicle, comme la faisaient les commissaires aux preuves de l'ordre de Malte ou autres. SAINT-SIMON, Mmoires, vol. XXI, p. 380, note. La rgle commune reue en France fut qu'il suffisait de prouver la possession de la noblesse pendant trois gnrations, y compris celle dont l'tat tait contest ; mais, dans certaines provinces, on exigeait cette preuve pendant quatre gnrations. La preuve devait tre faite en principe par crit et par actes authentiques; mais, dfaut, la preuve testimoniale par 4 tmoins tait admise. Cela avait mme fait natre une question, savoir : si la noblesse, ne pouvait pas s'acqurir par prescription... Certains l'admettaient, mais l'opinion dominante tait en sens contraire. La possession pendant trois gnrations faisait prsumer la noblesse et dispensait d'une preuve complte et adquate, mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'adversaire pouvait tablir la rature dans la famille, la prsomption devenait inefficace. ESMEIN, op. cit., p. 677.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
173
justice, les charges de magistrature et de finance ; des patriarcats urbains se constituent qui sont une noblesse avant la lettre : la bourgeoisie prend conscience d'ellemme, et coule sa mmoire dans le cadre des charges o les meilleurs de ses membres se sont signals. Mais si la vieille noblesse se trouve ainsi lentement submerge par la nouvelle, quelle diffrence, d'autre part, en dehors du titre, peut bien sparer un avocat, un procureur, et mme un commerant riche, actif, cultiv, d'un conseiller au Parlement, ou d'un titulaire d'un de ces offices qui confrent la noblesse de dignit ? 1 Ils sont unis par des relations de famille et d'alliance, ils se rencontrent dans les mmes salons, ils lisent les mmes livres, ils participent galement cette vie sociale o l'on n'apporte pas les proccupations de la fonction, o la socit ne s'intresse qu' elle-mme, qu' tout ce qui qualifie ses membres pour y entrer, ce qui les met mme de l'animer, d'aiguiser et renouveler et d'tendre la conscience qu'elle prend d'elle-mme. Une volution irrsistible entranait l'ensemble des fonctions devenir une aristocratie de fait, sinon de droit. Les deux dits (de 1649 et 1650), qui confrrent la noblesse premire vie tous les membres du Parlement, puis, aprs vingt ans d'exercice, aux matres de la Chambre des comptes... ne rencontrrent pas la rsistance des nobles, du corps social dont on abaissait les barrires protectrices. Ce furent au contraire ceux qui n'taient pas appels en bnficier qui firent chouer la rforme. Au Trsor et la Chambre des comptes, trsoriers, correcteurs, auditeurs protestrent avec violence contre le privilge qu'ils n'taient pas appels partager, et qui restait limit aux prsidents, matres et avocats gnraux. C'est que les dits traaient une frontire brusque dans un tout homogne 2. Sans doute cette noblesse de fonctions chercha plus tard se fermer, et au XVIIIe sicle, elle devint une caste. Alors tous les siges dans les cours souveraines taient occups par des familles tablies dans leurs dignits comme dans des fiefs patrimoniaux, et qui dfendaient leurs rangs avec un soin jaloux . Mais cet effort pour rattacher le titre l'office tait, au fond, paradoxal et contradictoire 3. La vieille noblesse reposait sur un ordre de qualits personnelles, fixes traditionnellement dans la mmoire de la socit, mais qui ne se pouvait sparer de l'tat de l'opinion et des croyances o elle avait pris naissance. Sous le couvert de ces traditions artificiellement entretenues, une volution s'accomplissait, qui poussait au premier plan non pas seulement les titulaires des offices, mais toute une classe d'o ils sortaient, et dont ils demeuraient solidaires. Il tait naturel que la vieille noblesse, qui s'tait largement
1
2 3
Le plus souvent le fils de l'avocat, si sa fortune le lui permet, prfre acheter une charge de matre des comptes ou de conseiller au parlement... De telle sorte que le barreau fut, en fait, le vestibule immdiat des cours souveraines... Ce groupe (des procureurs) nombreux et influent participait avec les avocats et mme les parlementaires de haut sige, d'une confraternit ne de la communaut des labeurs, et entretenue par ce contact de tous les jours. Cette fonction active, lucrative... fut un dbouch naturel pour cette bourgeoisie commerante, qui avait le sens traditionnel des affaires. La profession de procureur marque donc l'tape sociale essentielle de la petite bourgeoisie en marche vers les cours. ROUPNEL, La ville et la campagne au XVIIe sicle. tude sur les populations du pays dijonnais, Paris, 1922, p. 170 sq. ROUPNEL, op. cit., p. 174. La classe qui dtient les offices, et la classe que nous appellerons la noblesse parlementaire, ne sont pas absolument la mme chose... On n'est pas forcment un noble parce qu'on remplit une haute charge de justice et de finance... La plupart des familles parlementaires ont acquis cette noblesse de fonction sans ajouter jamais aucune particule leur nom. Leur qualit venait d'ailleurs... L'office qui apporte la noblesse administrative ne russissait pas par lui-mme confrer cette distinction, la fois prive et publique, que le langage du temps appelle la qualit. En fait la plupart des familles qui pntrent dans les cours souveraines ont dj depuis longtemps acquis cette notorit spciale, d'une lgance affranchie de titres et de prcisions administratives. Aussi se passe-t-on facilement de celles-ci et de ceux-l. ROUPNEL, Op. cit., p. 182.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
174
recrute autrefois, se fermt aujourd'hui, alors que la socit ne produisait plus les qualits qui la fondaient. Elle devait vivre sur son fond ancien, chaque jour diminu. Ainsi la mmoire d'une poque dfinitivement close ne trouve plus autour d'elle rien qui la renforce : elle se dfend contre les souvenirs nouveaux en s'isolant dans le pass. Mais la bourgeoisie en plein essor et d s'ouvrir, au contraire, et laisser pntrer librement en elle les hommes dous des qualits que la socit actuelle faisait surgir. Ainsi la mmoire des vnements rcents et actuels ne peut s'immobiliser. Elle a pour fonction d'adapter ses cadres aux souvenirs nouveaux : ses cadres eux-mmes sont faits de tels souvenirs. L'ide d'une noblesse parlementaire put jouer le rle d'une fiction commode : ainsi le peuple s'habitua reporter sur des qualits bourgeoises, rehausses par l'apparence d'un titre, le tribut de respect qu'il payait aux nobles. Mais ce n'tait qu'une fiction. Ds le jour o le systme des notions, c'est-dire des traditions bourgeoises, se fut constitu, elle devenait inutile et gnante. La socit devait dlibrment laisser tomber dans l'oubli le pass ancien, avec tout l'ensemble d'apprciations, toute la hirarchie des personnes et des actes qui s'y appuyaient, pour s'attacher au pass rcent qui se continuait dans le prsent. * ** On retrouverait, dans la socit contemporaine, o les titres n'existent plus, o, lgalement, les barrires qui sparaient les classes se sont abaisses presque au niveau du sol, l'analogue cependant sinon de la classe noble, du moins du genre d'activit spirituelle et sociale qui s'y dveloppait. Certes, aujourd'hui, bien plus qu'autrefois, la socit se prsente nous surtout comme un ensemble bien agenc de fonctions de plus en plus spciales. Quand on considre la socit fodale, au premier plan se dtache la noblesse, qui est une forme de vie et de pense, plutt qu'un organe ou un instrument du corps collectif : la rigueur on peut dire qu'elle a pour fonction de maintenir la tradition, et mme de la faire ; mais peut-on parler de fonction, si la noblesse se considre en ralit comme le couronnement de la socit, bien plus, comme le foyer de toute la vie sociale ? Les diverses fonctions proprement dites du corps social lui sont au contraire subordonnes ; la noblesse n'entre en contact avec celles-ci que pour marquer sur elles sa suprmatie: mais ce ne sont pas les qualits du bon fonctionnaire qui confrent la noblesse ; il faut, tout au moins, que, dans l'exercice d'une fonction, l'homme fasse preuve de mrites qui la dpassent, et qui manifestent la personne; il faut que la fonction soit prise par lui comme un moyen de se distinguer, au lieu d'tre exerce pour elle-mme. A la guerre mme, un chef qui se fera battre en accomplissant des prouesses se conduira plus noblement que s'il remportait la victoire en abritant sa personne. Aujourd'hui, on serait tent de dire que c'est l'inverse. Loin que la fonction existe en vue de l'homme, il semble que de plus en plus l'homme existe en vue de la, fonction. En tout cas, chaque fonction existe en vue de toutes les autres, et si la conscience collective accorde certaines catgories d'hommes un prestige plus grand qu' d'autres, c'est aux hommes dont l'activit profite le plus au corps social tout entier. Cependant, prenons-y garde. Il est toujours possible d'envisager l'homme sous deux aspects : d'une part, comme un agent de la socit, prpos une tche dfinie ; d'autre part, comme le membre de groupes, familiaux, mondains, ou tout autres, qui
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
175
ne sont pas subordonns d'autres groupes, et dont toute l'activit n'a d'autre objet qu'eux-mmes, leurs intrts de tout ordre, et tout ce qui peut enrichir ou intensifier leur vie spirituelle. Considrons de ce point de vue les groupes urbains, et dtournons notre attention la fois de ce qui demeure, dans nos socits, de la classe noble, et des agglomrations paysannes, qui reprsentent certains gards un genre de vie aujourd'hui dpass. Ce qui nous frappe, c'est qu' mesure que la fonction absorbe davantage l'individu, mesure aussi il prouve le besoin de dlimiter dans le temps les priodes o il se consacre sa profession, et d'autres priodes o il fait partie d'autres groupes, qu'il y oublie d'ailleurs ou qu'il y garde les proccupations de sa fonction. La question que nous nous poserons est maintenant celle-ci : ces groupes : famille, monde, etc., ne jouent-ils pas, par rapport aux professions, le mme rle dont s'acquittait autrefois la classe noble, par rapport aux fonctionnaires et aux fonctions? Et, puisque la noblesse tait le support des traditions, et que la mmoire collective vivait en elle, n'est-ce pas dans la vie sociale extra-professionnelle, telle qu'elle est organise aujourd'hui, que la socit conserve et labore ses souvenirs ? On pourrait nous, objecter qu'il n'est pas ncessaire de chercher hors de la fonction ce qu'on trouverait sans doute en elle. Il n'est pas de grande administration o, ct de la technique, il n'y ait aussi des traditions, et tout homme qui entre dans une profession doit, en mme temps qu'il apprend appliquer certaines rgles. pratiques, se. pntrer de cet esprit qu'on peut appeler corporatif, et qui est comme la mmoire collective du groupe professionnel. Qu'un tel esprit se forme, et se fortifie d'ge en ge, cela rsulte de ce que la fonction qui en est le support dure elle-mme depuis longtemps, et que les hommes qui l'exercent sont en rapports frquents, de ce qu'ils accomplissent les mmes oprations, ou en tout cas des oprations de mme nature, et de ce qu'ils ont le sentiment continu que leurs activits se combinent en vue d'une couvre commune. Mais, en mme temps, ce qui les rapproche les uns des autres, c'est que leur fonction se distingue des autres fonctions du corps social, et qu'il leur importe, dans l'intrt de leur profession, de ne pas laisser s'obscurcir, mais de bien marquer et de souligner ces diffrences. Lorsque, dans l'exercice de leur fonction, des fonctionnaires entrent en rapports avec d'autres hommes, l'esprit des uns, comme l'esprit des autres, est rempli ce moment de l'objet immdiat et spcial qui est l'occasion de leur rencontre, mais ils ne l'envisagent pas du mme point de vue Le fonctionnaire veut remplir les obligations de sa fonction, qui s'imposent lui comme tous les membres de la mme profession. Les administrs, s'ils obissaient l'impulsion des milieux sociaux, famille, classe, etc., dont ils font partie, ne se conformeraient pas toujours volontiers aux rgles dont chaque catgorie de fonctionnaires assure l'excution. Ce sont donc bien des hommes d'un groupe, celui des fonctionnaires, et des hommes d'autres groupes, qui s'affrontent. Ds lors on peut se demander si la mise en contact prolonge, souvent renouvele, avec des hommes domins par d'autres penses et d'autres sentiments qu'eux, ne risque pas d'amortir ou d'amoindrir, chez les hommes prposs la fonction, l'esprit professionnel. Il faut, pour qu'ils rsistent des hommes qui, le plus souvent, leur opposent des croyances et traditions collectives, qu'ils s'appuient eux-mmes sur des croyances et des traditions propres leur groupe. En d'autres termes, le corps judiciaire, par exemple, est oblig d'interposer toute espce de barrires entre ses membres et ceux des groupes auxquels ils rendent la justice, pour rsister aux influences du dehors, aux passions et aux prjugs des plaignants : c'est pourquoi, par leur costume, la place qu'ils occupent dans le prtoire, et par tout l'appareil des tribunaux, on rend sensible la distance qui spare le groupe des juges de tous les autres ; c'est pourquoi la communication entre le juge et les
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
176
plaignants se fait, non sous la forme d'une conversation, comme dans les autres groupes, mais par voie d'interrogatoire, ou par crit, suivant certaines formes, ou par l'intermdiaire d'avous et d'avocats. Mais cela ne suffit pas. La pression exerce par les groupes non judiciaires sur celui-ci est tellement forte qu'il doit leur opposer une tradition dont tous ses membres soient le plus possible pntrs. Or, d'o viendraitelle, et qui l'aurait cre, si ce n'est le corps judiciaire lui-mme ? Les principes du droit et toute la jurisprudence reprsentent l'uvre collective d'une suite de jurisconsultes et de magistrats minents. L'esprit juridique et les qualits de tout ordre qui distinguent les juges trouvent leur expression et leur modle dans quelques grandes figures. Ces souvenirs sont prsents aux magistrats qui, pour comprendre le sens d'une loi, doivent se reporter aux interprtations qu'on en a donnes, c'est--dire faire appel leur mmoire, et qui, alors mme qu'ils raisonnent et argumentent, enferment leur pense, sans toujours s'en rendre compte, dans des formes qui ont t introduites une date prcise, et portent la marque d'une poque ancienne : tant la pense juridique est pntre d'histoire. Mais toutes ces traditions, ces prcdents, tout ce qu'il entre de rituel dans les formes de la justice, l'autorit qui s'attache certains noms, le prestige de certains modes d'argumentation, tout cela n'est-il pas le produit de la fonction elle-mme ? N'est-ce point dans le milieu judiciaire qu'elles se sont manifestes, qu'on en a fix la valeur, qu'on les a rattaches les unes aux autres en une sorte de systme, qu'on les a mises au point, adaptes et transformes, mesure que de nouvelles initiatives juridiques se faisaient jour ? Il en est de mme de toutes les fonctions. Si l'on appelle mmoire collective l'ensemble des traditions d'un corps de fonctionnaires, on dira qu'il y a au moins autant de mmoires collectives qu'il y a de fonctions, et que chacune de ces mmoires s'est forme l'intrieur de chacun de ces corps, par le simple jeu de l'activit professionnelle. Telle est l'objection qu'on pourrait nous opposer, quand nous prtendons que c'est hors de la fonction, dans la partie de la socit o les hommes n'exercent pas leur activit professionnelle, que prennent naissance et se conservent les souvenirs collectifs les plus importants. Mais elle ne vaudrait que si la coupure qui spare la vie professionnelle et la vie familiale ou mondaine empchait les ides de l'une de pntrer dans l'autre. Or il n'en est gnralement pas ainsi. Nous avons montr ailleurs que, dans les socits urbaines, ce qui distingue la classe ouvrire des autres groupes, c'est que les ouvriers de l'industrie sont mis, l'occasion de leur travail, en contact avec des choses, non avec des hommes. Toutes les autres professions s'exercent au contraire l'intrieur de milieux humains, et sont l'occasion principalement de rapports d'homme homme. Les membres de ces classes se bornent donc, lorsqu'ils vont leurs occupations comme lorsqu'ils en reviennent, passer d'un groupe dans un autre, et il n'y a pas de raison pour qu'ici comme l ils ne gardent pas leur nature d'tre social. Au cours de ces alles et venues, il est invitable qu'ils introduisent dans un de ces groupes des faons de penser empruntes l'autre, et inversement. Mais on peut prvoir que les proccupations de la famille et du monde pntreront plus profondment dans les milieux spcialiss des professions que les habitudes d'esprit professionnelles dans les cercles mondains et familiaux. Pour que, dans ceux-ci, on s'intresse aux faits qui se droulent dans les cadres de la justice, de la politique, de l'arme, etc., il faudra qu'ils se dpouillent de leur aspect technique et spcial. Quand on parle d'un procs dans un jalon, il est rare qu'on y discute des points de droit, moins qu'ils ne soulvent quelque problme de morale ou de psychologie ; mais on y juge le talent des avocats, on analyse les passions, on dcrit les caractres, ou bien on insiste sur telle scne dramatique comme s'il s'agissait d'une pice de thtre. En ralit, dans les faits de ce genre, le monde trouve un nouvel aliment, condition de les replanter en quelque sorte dans son terrain, d'en secouer la poussire des bureaux,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
177
de les dgager du fatras des procdures, de briser l'armature technique o on les enfermait, de leur rendre la souplesse et l'lasticit des choses sociales. Mais on oublie davantage sa profession lorsqu'on rentre dans sa famille ou dans le monde, qu'on oublie sa famille et le monde, lorsqu'on s'occupe de son mtier. Dans les milieux familiaux et mondains en effet les ,proccupations gnrales, celles qui sont communes au plus grand nombre d'hommes, prennent le pas sur toutes les autres : c'est l que le social se cre sous ses formes les plus pures, c'est de l qu'il circule travers les autres groupes. Il est naturel que les hommes qui y sjournent en soient profondment modifis et que, quand ils se regroupent dans les cadres professionnels, ils y apportent les ides, les points de vue et tout l'ordre d'apprciations de leurs familles ou de leur monde. C'est ainsi que, dans l'exercice mme de leur fonction, ils demeurent rattachs ces groupes, qui sont en quelque sorte sociaux la deuxime puissance. L'opposition entre leur activit spcialise, et cette activit sociale plus gnrale n'est pas telle en effet que celle-l exclue celle-ci, et que, sous certains rapports, elle ne s'appuie pas sur elle. Un juge peut avoir juger, un avocat peut avoir dfendre des personnes qu'il est expos rencontrer dans le monde, ou qui, par telle ou telle particularit, par leur origine, leur ge, leur tournure d'esprit, leur faon de parler ou de s'habiller, et mme leur aspect physique, voquent en lui l'image de parents ou d'amis. Quand un juge dlibre avec d'autres juges qui sigent avec lui, lorsqu'il coute un avocat, travers le langage juridique, dans le magistrat ou le membre du barreau, il arrive qu'il aperoive l'homme, sa situation sociale dans le monde, sa famille, ses amis, ses relations, et, plus prcisment son pass, dont ce monde, cette famille, ces amis conservent seuls le souvenir. Insistons sur ce point. La porte de l'usine reprsente assez exactement aux yeux de l'ouvrier la ligne de sparation -entre les deux parties de sa vie quotidienne. Si elle reste entr'ouverte, c'est plutt aprs la journe de travail qu'avant : une partie des habitudes de penser ou de ne pas penser, qu'entrane le contact exclusif avec la matire, reflue dans la zone de la socit o vit l'ouvrier hors de l'atelier. Quand il retourne dans les locaux de travail, il sent bien qu'il laisse derrire lui un monde pour entrer dans un autre, et qu'il n'y a entre les deux aucune communication. Mais, lorsqu'il entre au Palais, le juge ou l'avocat ne se sent point exclu et spar, mme pendant les audiences, pendant toutes les heures directement consacres sa fonction, des groupes au sein desquels se passe le reste de ses journes. Leur prsence relle n'est pas en effet ncessaire pour qu'il pense et se comporte encore, mme loin d'eux, comme membre de ces groupes, pour qu'il voque les jugements qu'on y Porte, les qualits qu'on y apprcie, les personnes, les actes et les faits auxquels on s'y intresse. Ain-si, invisiblement, la fonction, envisage comme un ensemble d'activits et de penses techniques, baigne dans un milieu d'activits et de penses non techniques, mais purement sociales. Il se pourrait que le vritable rle du fonctionnaire ft de faire pntrer dans l'organisation technique toute cette vie sociale extrieure la profession. Le reste ne reprsente que la moindre part de son activit, la moins difficile, et o il pourrait le mieux tre suppl par des sous-ordres. Le juge, comme l'avocat, comme tous les fonctionnaires du mme ordre, ne sont appels donner leur mesure que dans des circonstances exceptionnelles, s'il se prsente des affaires qui ne rentrent point facilement dans les cadres de la technique courante. La technique ne pose en effet que des rgles gnrales : elle ne connat pas les personnes . Il appartient au fonctionnaire de se mouvoir avec souplesse et sret entre ces deux sortes de notions, les unes techniques et gnrales, les autres personnelles et sociales. Or, c'est dans la socit en effet (familiale et mondaine) que les hommes se groupent, entrent en rapports, et se
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
178
hirarchisent d'aprs leurs qualits personnelles., si bien que chacun y occupe une place unique, qu'aucun autre ne pourrait tenir en son lieu, dans l'opinion des membres du groupe. C'est dans la socit qu'on s'habitue saisir et apprcier l'aspect personnel des actes, des paroles, des caractres, et qu'on trouve des rgles assez complexes pour classer ces valeurs et pour raisonner sur elles. Le rle de ces milieux sociaux est prcisment de retenir de telles apprciations et d'entretenir un tel esprit, par tous les moyens, ceux de l'ducation et de la tradition dans les familles, ceux de la conversation, des relations intellectuelles et de sentiment, du croisement d'ides et d'expriences empruntes des poques, des rgions et des catgories sociales diverses, dans les runions mondaines, ceux du thtre, de la littrature, dans les groupes cultivs et qui lisent. Bien entendu, on ne trouve plus ici, comme dans la socit noble de l'ancien rgime, une hirarchie des titres qui serait en mme temps une histoire abrge d'une classe, Mais si on ne croit plus aujourd'hui aussi fermement qu'autrefois la transmission par la voie du sang des qualits qui lvent certaines familles au-dessus des autres, l'opinion fait encore une part cet ordre d'apprciation. Dans les villes de province qui sont demeures l'abri des grands courants de la vie conomique, o subsistait, surtout au dbut du XIXe sicle, une socit bourgeoise assez restreinte et assez assise, les modes d'apprciation bourgeois se calquaient ou se calquent sur le type des jugements des nobles : on se rappelle l'histoire des familles ; leur prestige se dtermine d'aprs leur anciennet, d'aprs leurs alliances, etc. Dans les grandes villes modernes, tant donn le nombre des personnes qui y entrent en relation, d'origine souvent trs diverse et lointaine, il est de plus en plus difficile pour la socit de fixer ainsi dans sa mmoire tant de ramifications familiales. On y rencontre cependant quelques groupes, vestiges de l'ancienne noblesse, o le respect des titres s'entretient, d'autres, embryons d'une noblesse nouvelle, fonds sur l'exclusivisme des relations et des alliances, sur l'importance exceptionnelle des fortunes, sur un nom que quelque circonstance a rendu clatant. Mais, en gnral, la bourgeoisie, en s'accroissant de toute espce d'apports, a perdu le pouvoir de fixer ainsi en elle une hirarchie, d'arrter des cadres dans lesquels les gnrations successives devraient se placer. La mmoire collective de la classe bourgeoise a perdu en profondeur (entendant par l l'anciennet des souvenirs) ce qu'elle gagnait en tendue. Nanmoins les familles y sont encore considres en raison de leur faade sociale, c'est--dire de leur fonction et de leur richesse, de la mesure o cette fonction qualifie pour s'insrer troitement dans la rgion o les rapports sociaux se multiplient tandis que la conscience sociale s'intensifie, et dans la mesure aussi o cette richesse dveloppe en eux et leur permet de satisfaire les besoins auxquels le groupe attache le plus de prix. Comme il faut quelque temps pour que de telles situations s'tablissent, c'est--dire pour que l'opinion les sanctionne, il y a bien dans nos socits une hirarchie sociale qui a derrire elle une certaine dure. Il faut apprendre la connatre ou la reconnatre, se pntrer des habitudes d'esprit et des connaissances de fait (traditions trs rcentes, mais traditions tout de mme) que ce mode d'apprciation implique. On peut dire que, dans nos socits, certaines familles jouissent encore d'un prestige qui les distingue de toutes les autres ; seulement ce prestige ne date en gnral que d'une poque. assez rcente, pour chacune d'elles, pour qu'elle se souvienne et qu'on se souvienne de son obscurit, qu'elle sache et qu'on sache qu'elle est expose y retomber. Qu'on ne nous reproche pas de nous faire une ide singulirement pauvre de la pense sociale, parce que nous la rduisons cet ordre d'apprciations. On verra que nous ne l'y rduisons pas. Nous sommes obligs de reconnatre que, de mme que la
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
179
mmoire des titres dans l'ancienne noblesse, de mme la mmoire des fonctions et des fortunes dans nos milieux est la base des jugements que la socit porte sur ses membres. Mais elle ne s'attache point l'aspect technique de la fonction, non plus qu' l'aspect matriel de la fortune. Le juge, le conseiller la cour, le prsident de la cour d'appel ces noms voquent en effet des ides et des images bien diffrentes chez ceux qui les entendent dans un salon ou dans un tribunal. Pour les parties au procs, pour le publie, c'est une autorit sociale, sans doute, mais actuelle et impersonnelle, c'est l'agent qui exerce une fonction : on fait plus attention son costume qu' sa personne ; on ne se demande pas s'il a un pass, s'il occupe son sige depuis longtemps. Dfini par rapport aux autres membres du tribunal, au personnel subordonn des greffiers, aux accuss, aux avocats. au public, c'est un centre de rapports purement techniques, c'est une pice dans un appareil qu'il semble qu'on aurait pu construire le jour mme ou la veille. Tout cela recouvre l'homme, c'est--dire la personne et le milieu d'o elle vient et o elle frquente. Pour le monde, au contraire, c'est un prestige social qui date de loin, ou qui est le reflet de souvenirs de toute nature dont quelques-uns sont trs anciens, c'est le sentiment des milieux d'o proviennent le plus grand nombre de magistrats, des gens qu'ils frquentent, avec lesquels ils s'allient, ce sont quelques personnes dfinies que nous connaissons, dont la figure et l'allure nous sont familires, et qui personnifient pour nous cette profession. Ainsi pntre en chacun de nous l'ide d'une sorte de nature ou d'espce morale que chacun des magistrats que nous connaissons, directement ou par ou dire, ou simplement par l'histoire et par nos lectures, reprsente sa manire et contribue constituer : l'ide de qualits la fois personnelles, puisque tous les hommes ne les ont pas et que ceux qui les ont ne les possdent pas au mme degr, et sociales, puisque la socit les comprend et les apprcie, puisqu'elles ne se manifestent que dans des formes. dtermines par elle. Sans doute, nous ne songeons pas ces formes ; elles ne sont que l'occasion o les qualits se montrent. Nous ne songeons qu'aux qualits : c'est pourquoi, dans le magistrat que nous rencontrons dans le monde, avec qui nous causons, ct de qui nous sommes table, nous voyons une personne qui doit valoir par son talent, son exprience des hommes, sa pntration, ,sa gravit, etc. Que, jugeant ainsi, nous nous trompions souvent, c'est possible : il n'y en a pas moins, toute poque et dans toute socit, une apprciation de la fonction qui suppose celui qui l'exerce un certain ordre de qualits personnelles. La vieille supposition qu'un homme exerce une fonction en vertu d'aptitudes innes (ou hrditaires) fait que nous attribuons aux juges les qualits qui ont mis en relief dans l'histoire le corps des magistrats : et les magistrats jugent eux-mmes et se jugent eux-mmes ainsi. Or ces qualits relvent la valeur de l'homme social en mme temps que du fonctionnaire, et c'est pourquoi, lorsque la socit tient compte de la fonction d'un de ses membres, au del de la fonction, ce sont les qualits que celle-ci suppose auxquelles elle s'intresse, parce qu'elles qualifient l'homme non pas seulement pour la fonction, mais pour la vie dans la famille et dans le monde. Alors que, dans la classe noble, on distinguait le titre et la fonction, dans nos socits la fonction, sous un aspect, reprsente une activit technique, et sous l'autre, des qualits qui ont une valeur sociale hors de la profession. En ce sens la fonction quivaut en partie au titre. Mais d'o la socit tirerait-elle la notion de ces qualits, sinon de la tradition ? De mme, la fortune vue de l'tude d'un notaire est une chose, et le rang social qui correspond un genre de vie, un certain niveau de dpenses ostensibles, en est une autre. L'ingalit des richesses, surtout l'intrieur d'un groupe qui runit des gens
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
180
d'une mme classe, et les conflits d'intrts, opposent les hommes plus qu'ils ne les rapprochent. D'ailleurs, si l'on n'envisageait que la quantit d'argent possde par chacun, il n'y aurait rien l qui pt fonder une notion ou une apprciation sociale : les hommes, confondus avec leurs biens, se confondraient avec des choses. Si, lorsqu'on parcourt les terres possdes par un homme riche, lorsqu'on s'arrte devant sa maison, lorsqu'on fait le calcul de ses biens, on s'meut comme au spectacle d'une puissance, c'est que derrire tout cela on se reprsente celui qui possde. Il y a dans la richesse un principe de puissance ; mais ce n'est pas dans les biens matriels, c'est dans la personne de celui qui les a acquis ou qui les dtient qu'elle rside. Si entre le riche et ses biens il n'existait qu'un rapport accidentel, si l'on ne supposait pas qu'un riche est riche parce qu'il est qualifi pour l'tre, la socit (entendant par l, toujours, ces milieux trangers toute activit technique et lucrative, o l'on ne s'intresse qu'aux relations entre les hommes, et non entre les hommes et les choses) ne tiendrait pas compte de la richesse dans son apprciation des personnes. Que la personne passe au premier plan, que les biens possds soient le signe et la manifestation visible des qualits personnelles de celui qui possde, que les titres de proprit reposent sur les titres tout courts, c'est, ce qui apparat dans la socit noble, si l'on envisage l'investiture, la distinction des terres en nobles et non nobles 1, les rgles de la transmission des biens entre vifs ou par dcs, etc. C'est pourquoi aussi pendant longtemps les nobles se sont dtourns (en France) des occupations lucratives, commerciales et industrielles, o trop visiblement c'est la fonction qui enrichit l'homme. Une fortune dont les sources sont trop visibles, et qu'on peut trop aisment expliquer, perd une partie de son prestige. Un riche qui explique comment il l'est devenu offense les gens bien levs : il ravale en effet la richesse, en y montrant le rsultat de travaux ou de combinaisons qui n'ont rien de mystrieux; c'est un effet de scandale aussi grand que si l'on prtendait expliquer des personnes religieuses comment par des oprations de psychologie collective assez simples se forme une lgende, ou comment on fabrique un saint. Le mot fortune conserve une part de son sens tymologique : ceux qui la possdent doivent apparatre comme favoriss du sort, non pour leur richesse, mais parce qu'ils sont ns sous une bonne toile, et qu'ils apportaient avec eux ds leur naissance cette nature d'exception qui, dans la pense populaire, distingue les hommes riches des autres et les appelle la richesse. L'exprience oblige sans doute reconnatre que des riches perdent leur richesse, et que des pauvres deviennent riches, sans que rien indique, qu'ils aient chang d'autres gards. Mais on n'hsite pas alors conserver aux premiers une part au moins de la dfrence qu'on leur tmoignait dans leur prosprit : le souvenir de leur ancienne fortune les couvre ; ils demeurent dans les milieux o il semblerait que leur fortune rduite ne les accrdite plus. La qualit de riche ne se perd donc pas avec la richesse, de mme que la qualit de noble survit l'abolition des titres. Et quant ceux qui acquirent leur fortune trop brusquement,, ou par des moyens trop visibles, parvenus et nouveaux riches., il semble qu'ils n'aient point des titres suffisants tre admis dans la classe de ceux qui possdent, mais depuis plus longtemps, des fortunes quivalentes. De mme, en religion, il y a des saints qui ne font plus de miracles, et il y a, d'autre part, de faux miracles.
1
Les tenures roturires taient des terres qui, la diffrence des fiefs, n'avaient pas la qualit de nobles. Au dbut on s'attache au principe que les roturiers ne peuvent, restant tels, acqurir des fiefs, et deviennent nobles s'ils en acquirent. Plus tard cette rgle fut abroge: les roturiers, demeurant roturiers purent acqurir des fiefs. Le droit se fixa en ce sens, mais lentement, non sans rsistance; cela ne devint une loi prcise et gnrale qu'au XVIe sicle, par l'ordonnance de Blois de 1579. ESMEIN, op. cit., p. 211 et 224 sq.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
181
Ainsi, tandis qu'une fortune, conomiquement, est tout de suite tout ce qu'elle est, tandis qu'elle peut se construire ou se dtruire en quelques jours, en quelques heures dans des spculations de bourse, ou en quelques instants autour d'une table de jeu, socialement elle ne compte, et on n'en tient compte dans les milieux du monde, qu'au bout d'un certain temps. En effet, ces qualits que l'opinion suppose derrire la richesse, il ne serait pas admis, il ne serait pas convenable (ni d'ailleurs possible), qu'on en fit la preuve en un moment, par la production de ses titres de proprit, ou l'exposition du contenu de son coffre-fort. Au reste, cet gard, les diffrentes couches de la socit seront ingalement exigeantes. L'homme de la rue se contente de preuves relativement faciles, qui cotent peu de temps et de peine, coupe des vtements, allure gnrale qui tmoigne de quelque dcision et contentement de soi, prsence dans certains lieux publics et absence des autres, emploi de certains modes de locomotion, etc. Dans le milieu un peu ml des runions mondaines, les hommes se jugeront d'aprs leur tenue et leurs manires, leur langage et leur conversation : il faut plus de temps, plus d'occasions, plus d'tude et d'exprience aussi, pour se comporter sans efforts, tous ces gards, suivant les rgles admises dans ces groupes; ils attacheront d'ailleurs moins d'importance ce qui, en effet, demande moins de temps, et passeront sur une tenue nglige, dans une socit o il y a d'autres manires, qui exigent plus d'exercice, et qui marquent plus dans la mmoire, de montrer qu'on en est. Dans un milieu plus troit encore de personnes qui se voient plus frquemment et plus intimement, il faudra montrer qu'on connat les gens et les familles, qu'on sait ce qui est d chacun, ce que l'opinion du groupe estime tre d chacun. On y pardonnera l'homme riche une certaine brutalit de manires, de l'insolence mme et une affectation de grossiret, laquelle l'on reconnat quelquefois dans d'autres milieux une extraction infrieure, ou qui en donnerait l'ide, pourvu qu'il n'ignore pas ces conventions, plus dlicates parce qu'il y en a presque pour chaque personne nouvelle et pour chaque nouvelle circonstance, et parce que chacune d'elle repose sur des souvenirs souvent nombreux et qu'on ne conserve que dans le groupe. Ainsi les manires, le got, la politesse et la distinction de l'homme du monde se transforment, et se nuancent de plus en plus, mesure qu'on pntre dans les rgions de la socit o l'on connat mieux les personnes parce qu'on les y observe depuis plus longtemps. Mais sur quoi se fondent ces conventions ? Quels sont ces souvenirs, quelle est cette histoire ? Ceux qui mettent en relief les qualits qu'on suppose derrire la richesse ? Mais les aptitudes d'un industriel et d'un financier intressent-elles (du point de vue mondain) la socit ? Et, d'ailleurs, n'y a-t-il pas bien des fortunes qui, transmises par hritage, et administres par des hommes d'affaires, n'exigent aucune activit et aucune aptitude de ceux qui les possdent ? Reprenons ici la distinction que nous indiquions, quand nous parlions de la faon dont la socit classe les hommes d'aprs leur profession. Nous disions que la socit apprcie les qualits professionnelles son point de vue, qui n'est pas celui de la technique, qui est celui de la tradition, et qu'elle les envisage sous l'angle qui l'intresse. Peut-il en tre de mme des qualits lucratives ? A priori, on peut rpondre : pourquoi pas ? Supposons une socit o il n'existe pas de fortunes acquises, mais o, pour tous les hommes nergiques et capables d'un effort continu et pnible. s'offrent beaucoup d'occasions de fortune. Dans certaines classes, certaines poques, dans certains pays, cela s'est prsent. Par exemple en Angleterre, dans les classes commerantes et artisanes, au XVIe sicle, et aux tats-Unis, durant toute une longue priode
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
182
d'tablissement et d'expansion. On peut concevoir que, dans ces socits, l'esprit de renoncement qui s'applique des occupations lucratives ait pu tre aussi cultiv et apprci pour lui-mme. Des sociologues n'ont pas manqu de remarquer que la grande industrie et le capitalisme apparurent et grandirent d'abord dans des pays protestants. Est-ce, comme l'ont cru les uns, parce que, dans ces pays, la masse de la population et tout au moins ses premires assises appartiennent la race anglosaxonne, plus nergique la fois et plus positive (plus matter of fact) que les autres 1 ? Ou bien est-ce parce que ces populations adhrrent les premires, et restrent attaches aux doctrines morales et religieuses du protestantisme, qui leur enseignait aimer l'effort pour l'effort, si bien que l'activit capitaliste reproduirait dans le domaine conomique ce qu'est l'activit puritaine dans le domaine religieux 2 ? Certaines tendances ethniques comme une certaine attitude religieuse prdisposent peut-tre une vie de labeur volontaire et sans dtente. L'conomie, l'honntet, l'austrit, vertus que n'ignorrent pas les socits et les morales de l'antiquit, reurent peut-tre l'empreinte des socits anglo-saxonnes puritaines. Elles cessrent d'y tre considres comme des qualits un peu terre terre de marchands pratiques, du jour o elles passrent au premier rang dans l'chelle des valeurs sociales. Transportes hors de la profession, dans les relations de famille et d'amiti, et dans tout l'ordre des rapports que les hommes entretiennent hors du comptoir ou du bureau, aux heures o ils ne travaillent plus pour gagner, elles pourraient fonder une hirarchie des rangs. On ferait partie d'une classe, on serait plus ou moins considr par les membres de cette classe, parce qu'on serait plus ou moins riche. Cette richesse garantirait sans doute la prsence en nous des qualits qui, dans ce type de socit, permettent seules de s'enrichir. Mais on envisagerait ces qualits en les dgageant de leur forme commerciale ou artisane : c'est moins l'argent qu'elles procurent qu'aux mrites moraux et sociaux qu'elles supposent, qu'on s'attacherait. On admettrait que l'on trouve plus de matrise de soi, d'esprit de sacrifice, une disposition plus certaine conformer ses actes ses ides, un sens plus aigu de l'honntet et de la probit, plus
1 2
THORSTEIN VEBLEN, The instinct of workmanship, New-York, 1914, 2e dit., 1918. Voir aussi notre article: Le facteur instinctif dans l'art industriel, Revue philosophique, 1921, p. 229. C'est la thse qu'a Soutenue Max WEBER dans Gesammelte Aufstze zur Religionssoziologie, pp. 17-236, die prolestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Tbingen, 1920, publi d'abord dans : Archiv fr Sozialwissenchaft und Sozialpolitik, 1904-1905). D'aprs lui, l'esprit capitaliste serait un produit direct du puritanisme. L'activit capitaliste suppose un ensemble de qualits morales, force de caractre, application intensive, renoncement aux jouissances et distractions de tout ordre, organisation mthodique de la vie professionnelle, qui naissent de ce que l'individu s'efforce de vrifier ainsi, par le fait, qu'il est en tat de grce. - BRENTANO, dans: Die Anfnge des modernen Kapitalismus, pp. 117-157, Puritanismus und Kapilalismus, Mnchen, 1916, soutient au contraire que les sentiments du devoir professionnel, du devoir bourgeois (Handwerksund Brgerehre, Borufspflicht, Brgerpflicht) rsultaient du rgime corporatif, qu'il n'y a pas eu, cet gard, de solution de continuit entre la priode antrieure et la priode postrieure la Rforme. Si l'ide puritaine s'y superposa un moment, c'est que, dans le nord-ouest de l'Europe, la petite bourgeoisie luttait contre les rois et l'aristocratie, et les a temporairement vaincus... Elle devait trouver un puissant appui dans une doctrine qui transfigurait ce qui faisait sa force, ce travail professionnel, en glorification de Dieu, et condamnait toute aristocratie comme une divinisation de la crature, qui porte atteinte la gloire de Dieu . p. 147. Mais l'thique puritaine a t l'thique conomique traditionaliste de la petite bourgeoisie, o s'est reflt l'esprit de l'artisanat dans la deuxime moiti du Moyen ge , p. 148. - Il y a l un gros problme historique qui ne peut tre examin et rsolu dans le cadre d'une note. Ce qui nous importe ici, c'est moins d'ailleurs l'origine de cette apprciation nouvelle de l'activit lucrative que le fait de son existence et de sa diffusion, durant les derniers sicles de l'ancien rgime, dans des cercles tendus de bourgeoisie.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
183
de loyaut et de fidlit dans l'amiti, des vertus familiales plus enracines, et une puret de murs plus irrprochable dans les classes riches que dans les autres. La pauvret y quivaudrait l'immoralit, et la lgislation des pauvres traiterait les mendiants comme des coupables. Ces notions, conserves dans la mmoire collective, reposeraient sur l'exprience des vertus ou du moins des manifestations de vertu des riches. On y retrouverait le reflet et l'cho, aussi bien des figures et des actes vertueux qui frapprent vivement l'imagination que des prdications et exhortations incessamment entendues ou retrouves dans les lieux publics, dans les runions familiales ou d'amis, dans les journaux et la littrature. Certaines priodes o une telle morale bourgeoise et puritaine dut lutter contre d'autres, o il fallut de l'hrosme et un effort presque contre nature pour la maintenir et la faire triompher, laisseraient des souvenirs plus profonds. L'action puissamment formatrice ou dformatrice qu'elle exera jadis se marquerait dans la raideur des gestes, dans le nasillement prdicant, non moins que dans l'allure compasse et guinde de la pense. La forme idale d'une telle socit serait une sorte de capitalisme patriarcal, o la classe industrielle et commerante riche s'efforcerait d'lever moralement les pauvres, et de leur enseigner les vertus qu'elle met au premier plan de sa morale : l'conomie, l'abstinence, l'amour du travail. Ces qualits, en effet, les pauvres ne les possdent pas naturellement, puisqu'ils sont pauvres ; il n'y a pas, dans la classe des pauvres, de traditions morales quelconques qui puissent en tenir lieu; il faut donc que l'exemple vienne d'en haut. Prtention de constituer une nouvelle noblesse sur de nouveaux titres, dont on ne peut dire qu'elle ait pleinement chou. Ce qui importe ici, c'est la morale nouvelle qui ds la fin du Moyen ge s'labore dans les cits, dans les cercles d'artisanat et de commerce : morale dont les moralistes professionnels chercheront bien des dmonstrations, mais qui est un fait historique. Des diverses notions de cette morale on trouverait en effet l'origine dans l'histoire de la classe industrielle et commerante ; maintenant encore, lorsqu'on songe telle vertu, on se reporte par la mmoire ceux qui, les premiers, l'ont prche et pratique : le prestige qui s'attache aujourd'hui encore la richesse s'explique en partie par le sentiment que la notion moderne de vertu s'labora dans la classe riche, et qu'on en trouverait en elle les premiers et les plus mmorables exemples. Alors mme que les conditions conomiques sont transformes, la tradition subsiste d'une priode o chaque individu, chaque chef de famille ne pouvait s'lever la richesse que par son propre effort. Il est probable que cette conception, comme la doctrine librale des droits de l'homme, de la dignit et de l'indpendance individuelles, oppose par les commerants et les artisans la conception fodale de la richesse fonde sur la noblesse d'origine, la doctrine des droits du sang et de la primaut des titres, n'a russi s'imposer qu'au moment o elle ne correspondait plus la ralit, o, en particulier, on s'lve surtout la richesse dans la mesure o on profite de quelque revenu social 1. Mais la croyance aux vertus patriarcales et la discipline morale des riches est depuis trop longtemps en suspens dans la mmoire collective des classes industrielles et commerantes, c'est un souvenir qui correspond une trop grande masse d'expriences pour qu'elle ne joue plus son rle dans la conscience moderne des socits. Elle est renforce de temps en temps par l'exemple difiant d'un homme ou d'une famille qui trouve dans une richesse tardive la rcompense de ses privations et de ses efforts L-dessus, plus solidement que sur le respect de la naissance, se fonde le prestige de la richesse, d'autant plus que les vertus du riche, par l'ducation familiale, se peuvent transmettre, et qu'ainsi s'explique de faon plus rationnelle le privilge de la descendance. En dfinitive, malgr les exemples dmoralisants de
1
THORSTEIN VEBLEN, op. cit., p. 340.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
184
fortunes trop vite et trop facilement acquises, malgr ce que les moralistes appellent l'action corruptrice de la richesse, certains riches ralisent encore le type du marchand qui tient les comptes de ses bonnes et de ses mauvaises actions avec autant d'exactitude que les comptes de ses dpenses et de ses recettes, et qui transporte dans sa vie prive, c'est--dire dans sa vie sociale, le sentiment du devoir dvelopp en lui dans l'exercice de la profession. Ce que les hommes respectent dans la fortune, ce n'est pas une certaine quantit de biens matriels, quel que soit leur possesseur, mais c'est le mrite prsum du possesseur qui dtient ces biens, et qui est considr comme, plus ou moins, l'auteur de sa propre fortune. Il faut qu'il y ait, derrire l'chelle des fortunes, une chelle de mrites personnels, qui corresponde celle-ci approximativement, pour qu'on s'incline devant la richesse comme devant une valeur sociale. Or, ce qui distingue des biens le possesseur, et ses qualits de leur quantit, c'est que, tandis que les biens et leur quantit sont donns et calculables tout entiers dans le prsent, le possesseur et ses qualits vivent et se dveloppent dans la dure, qu'une socit ne peut donc les apprcier que quand elle les connat et les observe depuis longtemps, et que quand ils ont assez marqu dans sa mmoire. C'est pourquoi, dans la socit fodale et jusqu' la Rvolution, on s'incline devant les privilges parce que, derrire les privilges, il y a le titre, et que le titre (quivalent d'une srie de souvenirs collectifs) garantit la valeur de la personne. Lorsque la bourgeoisie commerante et artisane s'lve la fortune, elle ne peut pas Invoquer de tels titres. Mais l'exercice de ces professions et la russite dans ces professions exigent, l'origine, outre des aptitudes et connaissances techniques qui, aprs tout, pour l'essentiel, peuvent s'apprendre et s'acqurir, des qualits humaines, propres la personne, et qu'une classe peut renforcer et transmettre ses membres par une sorte de discipline sociale. C'est sous le rgime et dans le cadre des corporations de mtier que ces vertus sont dfinies, et qu'on prend l'habitude d'apprcier les hommes d'aprs les rgles bien vite devenues traditionnelles d'une morale nouvelle. On s'incline prsent devant la fortune par respect pour les qualits d'nergie laborieuse, d'honntet, d'conomie qui paraissent indispensables pour s'enrichir. Certes, assez vite les conditions conomiques changent, et nombre de bourgeois deviennent riches soit, simplement, par hritage, ou par habilet, ou par chance. Mais l'ancienne conception subsiste, peut-tre parce qu'elle s'accorde encore le plus souvent avec les faits, peut-tre, en partie, parce que la classe riche y voit la meilleure justification de sa richesse. On admet que ceux qui hritent d'une fortune bourgeoise acquirent avec elle les vertus bourgeoises, sous l'influence de l'ducation et du milieu. Il est difficile d'ailleurs, dans une entreprise, de dire quelle est la part de l'habilet, quelle est la part de l'effort. La prudence est-elle une habilet, est-elle une vertu ? On incline penser que, puisque l'honntet est parfois la meilleure des habilets, l'une et l'autre, d'un point de vue suprieur, se confondent. Les morales utilitaires, nes sur la terre classique du commerce, n'ont pas d'autre objet que de justifier moralement l'activit mercantile, puisqu'elles appliquent la conduite de la vie les rgles de la comptabilit commerciale. Le risque lui-mme rentre dans le cadre de ces vertus, puisqu'il suppose un effort de sacrifice et de dsintressement 1. Il y a eu toutes les poques des mtiers o l'on s'exposait plus que dans d'autres. Il est mme probable que les premires corporations prirent naissance dans ces troupes itinrantes de marchands aventureux qui parcouraient des pays infests d'hommes
1
Le concile de Latran de 1515, sous Lon X, dfinit ainsi l'usure: L'usure consiste rechercher un gain dans l'usage d'une chose qui n'est pas productive en elle-mme (comme l'est un troupeau ou un champ), saris travail, sans dpense ou sans risque, de la part du prteur. ASHLEY, op, cit., t. II, p. 534.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
185
d'armes et de brigands 1. Les doctrines modernes de l'intrt admettent que le risque mrite d'tre rmunr au mme titre que l'effort ou que la consommation diffre : ici et l on trouve en effet un lment de sacrifice et de renoncement. De toute faon, et au prix des fictions ncessaires, on russi sauver sinon les titres, du moins ce qui en tait la substance. La socit respecte la richesse parce qu'elle respecte les personnes des riches ; et elle respecte les personnes des riches en raison des qualits morales qu'elle leur suppose. Seulement, du type de riche que nous venons de dfinir, un autre s'est de bonne heure distingu. Dj au Moyen ge, si les corporations rglementaient le commerce et l'industrie l'intrieur de la ville, elles ne pouvaient imposer exactement leurs coutumes ni leur morale aux trangers qui s'occupaient de mettre en rapports les divers marchs urbains. Quand on a pass des formes commerciales et industrielles nouvelles, dans les conomies nationales modernes, cette opposition entre deux catgories de commerants, d'industriels et d'hommes d'affaires s'est accentue. Il y a, chaque poque, des mthodes lucratives qu'on peut appeler traditionnelles, et d'autres, qu'on peut appeler modernes, En particulier, toutes les poques de transformation conomique, des couches nouvelles de bourgeoisie surgissent, enrichies par des mthodes nouvelles. Une classe riche trop esclave de traditions qui correspondent un tat social rcent peut-tre, mais dpass, doit cder la place, dans le domaine de la production des richesses, des hommes pntrs d'un autre esprit, c'est--dire qui savent s'adapter aux conditions actuelles. Mais, d'autre part, dans toute socit un peu dveloppe, on distingue des rgions o l'activit des producteurs et des marchands se dveloppe dans des cadres depuis longtemps fixs, et d'autres o l'instabilit est la rgle : milieux de bourse et de finance, industries et commerces nouveaux, ou formes nouvelles de groupement et d'association d'industries anciennes. En d'autres termes, parmi les fonctions conomiques, il y en a (elles jouent d'ailleurs un rle croissant mesure que la socit se complique,) qui servent mettre les autres en rapport, les maintenir en quilibre. On ne s'enrichit, dans ces cercles, qu' condition de profiter d'un dsquilibre momentan : il faut l'apercevoir temps, et possder assez de dcision pour l'exploiter. Mis en prsence de ces riches nouveaux, les riches anciens prouvent des sentiments assez mlangs. Jusqu'alors ce qui expliquait et lgitimait la richesse, ce qu'on apercevait derrire elle, c'taient des habitudes d'ordre et de travail, d'honntet commerciale et de prudence marchande. Le commerant et l'industriel exeraient une profession depuis longtemps connue, et se conformaient aux rgles traditionnelles de leur corporation. Mais ces activits nouvelles ne rentrent pas dans le cadre des professions anciennes, et ceux qui les exercent paraissent ne s'appuyer sur aucune tradition. Ils ne craignent pas les spculations aventureuses, et l'on ne sait en quel rapport se trouve leur gain avec leur effort. Ils paraissent indiffrents quant la nature du commerce, de l'industrie, des affaires en gnral dont ils s'occupent : ce qui leur importe, c'est que l'entreprise ou la socit o ils placent leurs capitaux soient organises financirement, c'est--dire rapportent des sommes leves. Leur pense ne s'y attache qu'autant qu'il lui est ncessaire pour en comprendre le mcanisme et en calculer le rendement, mais pas assez pour s'y engager et y adhrer au point d'en recevoir et garder quelque empreinte. S'ils peuvent s'adapter aussi vite aux conditions actuelles, c'est qu'ils ne sont pas arrts ou gns par l'exprience des conditions anciennes, c'est qu'ils n'ont pas vcu jusqu' prsent de la vie de la socit o il
1
PIRENNE, Les anciennes dmocraties des Pays-Bas, p. 31.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
186
semble qu'ils viennent d'entrer. Or la classe bourgeoise, nous l'avons vu, se classe et classe ses membres d'aprs une ide de la moralit assez troite, o il entre de l'hypocrisie et de l'gosme de classe, mais qui n'en est pas moins, pour elle, la moralit. Constatant chez ces nouveaux bourgeois l'absence des qualits qu'elle estime les siennes, et la prsence des qualits opposes, elle est tente de voir en eux le type mme de l'immoralit. Tel est le sentiment obscur qui a souvent pouss une vieille classe bourgeoise condamner les modes nouveaux d'acquisition de la richesse et les hommes qui les pratiquaient. Mais, en mme temps, et surtout aprs qu'elle avait t oblige de s'accommoder de leur voisinage, il ne pouvait pas lui chapper que cette activit lucrative d'un nouveau genre, et les habitudes, murs et croyances sociales qui l'accompagnaient, n'taient pas suspendues dans le vide. Comment contester que ces hommes eussent une nature sociale, c'est--dire des traditions et des tendances empruntes une vie collective, puisqu'ils russissaient crer de la richesse et la dpenser dans la socit par des mthodes et sous des formes sociales ? Quand les Juifs de cette poque, exclus des corporations, jouaient le rle de revendeurs, ou pratiquaient le prt intrt dans des conditions que la morale marchande d'alors condamnait, ou vendaient meilleur compte que les autres en russissant vendre davantage, on pouvait les accuser de parasitisme et d'immoralit : au point de vue conomique, ils ne produisaient (au moins en apparence) aucune richesse ; par leur genre de vie humble et sordide et par leurs croyances sans racines dans la socit du temps, ils risquaient, si on les et admis, de n'y exercer qu'une action ngative, de destruction et de dissolution, et on ne voyait pas d'ailleurs de quels lments ils eussent pu l'enrichir. Mais lorsqu'on passa de l'conomie urbaine et artisane une industrie capitaliste, une conomie nationale, lorsque les oprations financires prirent plus d'envergure, les richesses qui eurent leur point de dpart dans cette transformation ne correspondaient pas une simple activit parasitaire. Si l'on critiquait les nouvelles mthodes, on ne contestait pas qu'il ft possible, par leur moyen, de produire davantage, de satisfaire plus de besoins, d'conomiser plus de temps et de peine. D'autre part, si on critiquait les ides et les murs nouvelles, on ne contestait pas que ce, fussent des murs et des ides, c'est--dire des faons de penser et d'agir qu'une socit pt adopter, et que la classe elle-mme pt assimiler. Il tait difficile, ds lors, de considrer les hommes qui introduisaient ces mthodes, ces ides et ces murs, comme des hommes sans traditions. O avaient-ils cependant acquis ces aptitudes et ces gots ? Ce ne pouvait tre dans la classe bourgeoise, puisque toute son organisation conomique et son genre de vie y tait contraire. C'tait donc dans d'autres socits. On se tromperait, en effet, si on supposait, parce que ces hommes sont trangers aux traditions de la classe bourgeoise ancienne, et parce que leur attention est perptuellement fixe sur le dernier tat de la socit, sur les besoins et les modes de production les plus rcents, si on supposait qu'ils ne s'appuient point sur le pass, et qu'avec eux on atteint cette zone ou ce plan de l'activit sociale o aucune mmoire collective n'intervient plus. Cela n'est vrai que si on parle de la mmoire collective de la classe bourgeoise ancienne et dans une certaine mesure seulement. D'abord, cette classe progressive de bourgeois ou d'aspirants bourgeois comprend, avec des hommes nouveaux des descendants et des membres de la vieille bourgeoisie qui aspirent se mler au mouvement des affaires et des ides modernes. Une partie de leurs traditions pntrent avec eux dans ce monde de penses nouvelles, et il arrive, soit qu'une partie de l'ancien cadre subsiste, largi et mieux amnag, de faon ce que la pense
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
187
moderne s'y puisse fondre dans la vieille culture, soit que les nouveaux cadres soient faits en partie d'lments traditionnels. Mais, surtout, les bourgeois conservateurs ne s'aperoivent pas que les mthodes de production, les ides et les coutumes qui s'introduisent certains moments dans une socit ou dans une classe ne sont nouvelles qu'en apparence, qu'elles existaient et se sont dveloppes dans une socit ou une classe voisine, et qu'elles reposent, elles aussi, sur des traditions, mais sur les traditions d'autres groupes. Une socit ne peut gure s'adapter des conditions nouvelles qu'en remaniant sa structure, soit qu'elle modifie la hirarchie et les relations de ses diverses parties, soit qu'elle se fonde, totalement ou partiellement, avec des socits voisines. Quelquefois, la mmoire collective de la classe bourgeoise n'apporte pas et n'est pas en mesure d'apporter une rponse une question ou des questions qui se posent pour la premire fois. Un individu, s'il ne trouvait pas dans sa mmoire le souvenir d'un cas analogue ou semblable celui qui l'embarrasse, s'adresserait aux personnes qui l'entourent, ou, ne comptant plus sur sa mmoire, chercherait user de raison. La socit fait de mme : elle s'adresse d'autres groupes, ou ceux de ses membres qui sont le plus en contact avec eux ; elle consulte d'autres mmoires collectives. C'est ainsi que la plupart des mthodes nouvelles qui rvolutionnent l'industrie et le commerce y sont introduites du dehors ; une technique perfectionne est dcouverte par des industriels qui furent en rapports avec des savants, avec des ingnieurs plus proccups de recherches que d'applications, par des industriels hardis et qui avaient appris l'tre en frquentant des hommes d'affaires ; quelquefois une industrie s'inspire de l'exemple d'autres, un pays emprunte l'tranger ; le capitalisme moderne consiste peut-tre en la pntration croissante des mthodes financires dans l'industrie et le commerce : l o la tradition artisane et commerante n'indique pas comment s'adapter aux conditions industrielles modernes, on fait appel l'exprience des banquiers ou de ces cercles intermdiaires entre la finance et l'industrie et qui combinent les traditions et mthodes de l'une et de l'autre. Mais comment en pourrait-il tre autrement ? Comment, dans une socit domine par des coutumes anciennes, des coutumes nouvelles, contraires aux prcdentes, natraient-elles, et comment tous les essais, ncessairement individuels, qu'on pourrait tenter en ce sens, ne seraient-ils pas touffs temps? C'est sur un autre plan, et comme dans un autre ordre d'ides, qu'on doit prparer de telles expriences, et qu'un courant social nouveau doit se dessiner librement. Et c'est parce que la socit ne s'aperoit pas tout de suite des applications qu'on en pourra faire au domaine o elle tient ne rien changer, qu'elle laisse laborer ces ides et ces mthodes, dans des cercles dont les activits lui paraissent trop loignes des siennes pour qu'elle puisse craindre la contagion de leur exemple. Admettons maintenant que ces riches nouveaux transportent dans le domaine des dpenses, du luxe et mme de la culture, les mmes facults actives qui les ont levs la fortune. De mme que dans l'industrie et le commerce ils trouvaient les places anciennes dj prises, dans le monde ils trouvent les rangs anciens occups. Ici comme l, il pourrait sembler, qu'ils prennent leur point d'appui dans le prsent. Ils exploitent les entreprises qui n'existaient pas, ou n'existaient pas sous telle forme, dans le pass. De mme ils introduisent dans le monde des distinctions sociales fondes sur des faons de vivre et de penser qui, puisqu'elles datent d'aujourd'hui, ne peuvent avoir pris forme de tradition. Les circonstances les incitent et les encouragent donc acclrer l'volution des ides et des murs, dans le groupe des riches, tandis que leur facult matresse les en rend capables. Dans une socit qui se proccupait avant tout de multiplier et renouveler le plus possible les objets auxquels elle s'intresse, de tels hommes qui s'adaptent vite, et qui, par leur exemple, aident les autres
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
188
s'adapter, seraient apprcis plus que les autres. On n'exigerait d'ailleurs d'aucun d'eux une supriorit quelconque en quelque domaine, un intrt particulier et durable pour quelque sorte d'activit artistique, littraire, etc. Le grand savant et l'artiste gnial, comme le boxeur fameux et l' toile de cinma pourront imposer momentanment l'attention du publie une thorie, une forme de talent, une performance, un motif de film ; mais ce que la socit apprciera surtout en eux, c'est que l'un succde l'autre, c'est que chacun d'eux apporte quelque aliment une curiosit superficielle, c'est que leur diversit mme lui permette d'largir indfiniment le champ de son attention, c'est que leur multiplicit oblige ses membres une sorte de gymnastique toujours plus difficile, et dtermine un rythme de vie sociale de plus en plus acclr. Or les bourgeois rcents mriteraient cet gard d'tre placs trs haut dans l'estime d'une telle socit. Puisqu'ils ne s'intressent rellement qu' ce qui est nouveau, dans l'ordre des placements et des entreprises, ils ne peuvent qu'tre attirs par ce qui est nouveau dans l'ordre des ides, des besoins, des gots et des modes. Ainsi, derrire la richesse, ce qu'on respecterait, titre de supriorit sociale, ce serait non plus les qualits morales qu'on attribuait l'ancien riche, mais la mobilit et la souplesse d'esprit qui dfiniraient le riche nouveau. Mais nous envisageons ici, sans doute, d'un point de vue un pou extrieur et formel aussi bien la socit moderne que les riches de nouvelle venue. La curiosit inquite et l'activit fbrile, dont s'inquitent les traditionalistes, n'est qu'un symptme de malaise. La socit se trouve gne et l'troit dans des institutions et des ides tailles la mesure de ce qu'elle tait autrefois. Quant ces gnrations de riches modernes et progressifs, il n'est pas exact qu'ils ne s'intressent qu'au prsent, et qu'ils se prcipitent les yeux ferms par toutes les portes que leur ouvrirait, successivement ou simultanment, mais incessamment, la socit. Ils obissent au contraire, nous l'avons vu, des impulsions collectives qui viennent quelquefois de loin et qui oint un sens assez dfini. Tandis que la vieille classe bourgeoise s'efforce de maintenir des barrires et comme des cloisons tanches entre elle et d'autres groupes qui ne possdent pas de traditions aussi continues et labores que les siennes, ils n'hsitent pas l'exposer toute sorte de contacts avec le dehors. Ils apportent avec eux des ides et des habitudes empruntes des milieux o ne rgnent pas les conceptions bourgeoises, socits d'artistes, groupes politiques, monde des thtres, de la bourse, des journaux, des sports, collectivits plus mles et plus ouvertes, o comme en terrain neutre, se ctoient des hommes de toutes provenances. Qu'on songe ces industriels saintsimoniens qui entrent, au dbut du rgne de Louis-Philippe, dans des carrires bourgeoises 1, tout pntrs encore d'ides et d'expriences sociales si trangres cette classe moyenne, dont J'esprit, d'aprs Tocqueville, ml celui du peuple ou de l'aristocratie, peut faire merveille, qui, seul, ne produira jamais qu'un gouvernement sans vertu et sans grandeur . Avant de crer les premiers chemins de fer, d'organiser financirement la publicit, de construire des canaux internationaux, de spculer sur les immeubles et sur les terrains des grandes villes, de dvelopper les banques, c'est au contact de philosophes, de savants, d'artistes, et de reprsentants des classes populaires que leur pense a pris l'habitude des vastes projets, des mthodes complexes, qui rpondent un type de socit plus volue et sans doute plus tendue
1
Voir dans L'cole saint-simonienne, son influence jusqu' nos jours, par Georges WEILL, Paris, 1896, le systme de la Mditerrane, pp. 112-113, et les chapitres V (Les saints-simoniens en Afrique), et VII (Le saint-simonisme sous Louis-Philippe) et, dans l'Histoire du Saint-Simonisme, par S. CHARLTY, Parie, 1896, le livre IV (Le Saint-Simonisme pratique).
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
189
que le monde occidental de leur temps. Dans ces groupes extrieurs la bourgeoisie traditionnelle, les ides modernes sont nes quelquefois de ractions dfensives ou agressives contre la contrainte des traditions; elles existent ou tendent se formuler, depuis que la contrainte s'exerce ; elles ont donc, elles aussi, derrire elles des traditions. Il ne faut pas s'tonner, d'ailleurs, si, transplantes de ces groupes dans le cadre de la pense bourgeoise (au sens troit) elles prennent l'aspect d'ides entirement nouvelles. Ces modes de penser et d'agir, comment auraient-ils un avenir, puisqu'ils n'ont pas de pass ? Ainsi raisonnent les hommes traditionnels. Ces modes d'agir et de penser, puisqu'ils ne se rclament pas de la tradition, ne peuvent driver que de la raison. Ainsi raisonnent les hommes progressifs. Mais la raison reprsente en ralit un effort pour s'lever d'une tradition plus troite une tradition plus large, o viennent prendre place les expriences passes non seulement d'une classe, mais de tous les groupes. Comme les groupes nouveaux ne se sont pas encore fondus avec les anciens, comme une conscience sociale plus comprhensive se dgage peine des rapports encore rares et partiels qu'ils ont entre eux, il n'est pas tonnant que l'on ne reconnaisse pas encore en elle ou derrire elle une mmoire collective. De mme qu' la fin de l'ancien rgime la bourgeoisie s'abritait sous le manteau de la noblesse pour obtenir une considration que ne lui et pas attire sa richesse pure et simple, parce que la socit respectait encore les titres, et ne reconnaissait pas encore le mrite bourgeois, de mme aujourd'hui les riches du nouveau type se confondent dans la masse des riches anciens, et se rclament des mmes traditions. Il ne peut exister, en effet, au mme moment et dans les mmes milieux, deux faons de lgitimer la richesse, et comme deux morales qui fonderaient les privilges des riches, et principalement l'estime qu'on leur tmoigne. C'est pourquoi l'industriel moderne et l'homme d'affaires laissent croire que leur gain rcompense une activit et un effort individuel, alors qu'ils pourraient se faire un mrite, plutt, de leur sens social. L'administrateur d'une socit, qui travaille dans l'intrt de cette collectivit, s'aperoit bien qu'il est comme un agent solidaire du groupe, et d'autant plus digne de considration qu'il reprsente et comprend mieux les intrts communs tous ses membres. Mais il sait aussi que l'opinion, pas plus dans la classe bourgeoise que dans les autres, n'apprcie pas encore sa valeur ce genre d'aptitude, qu'elle mconnat la nature collective de certaines manifestations de volont, et qu'en tout cas elle n'en reconnat pas la moralit. Force leur est donc d'accepter et d'entretenir pour leur compte la fiction que les privilges du riche sont la rcompense de l'effort, du travail et du renoncement individuel. Eux aussi prennent peu peu, aprs quelque temps, l'esprit conservateur, l'attitude guinde et rserve, et cette espce de svrit conformiste qui convient une classe un peu pharisienne. Mais, d'autre part, mesure que l'activit lucrative revt davantage la forme collective, la notion traditionnelle du mrite qui fonde la richesse volue : des ides et des expriences nouvelles s'y introduisent. La mmoire collective de la classe bourgeoise doit s'adapter aux conditions modernes. Le jour o la socit serait trop diffrente de ce qu'elle tait, au moment o ces traditions ont pris naissance, elle ne trouverait plus en elle les lments ncessaires pour les reconstruire, pour les consolider et les rparer. Elle serait bien oblige alors de s'attacher de nouvelles valeurs, c'est--dire de s'appuyer sur d'autres traditions mieux en rapport avec ses besoins et tendances actuelles. Mais c'est dans le cadre de ses notions anciennes, sous le couvert de ses ides traditionnelles, qu'un tel ordre d'apprciation nouveau se serait lentement labor.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
190
* ** Pour rsumer tout ce chapitre, nous distinguerons dans la socit, comme nous y invitent nos conclusions prcdentes, deux zones ou deux domaines, l'une que nous appellerons zone de l'activit technique, et l'autre, zone des relations personnelles (dans la famille, le monde, etc.). Nous admettrons d'ailleurs que ces zones qu'on pourrait croire aussi nettement spares que les priodes et les lieux o s'exerce la profession et ceux o l'on ne l'exerce plus, sont engages l'une dans l'autre, puisque des fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions, n'oublient pas les relations qu'ils ont eues ou qu'ils pourraient avoir sur un autre terrain. L'activit technique ne se confond donc pas avec l'activit professionnelle. Comment la dfinir ? Elle consiste connatre et appliquer les rgles et prceptes qui, chaque poque, prescrivent au fonctionnaire, en termes gnraux, les actes, les paroles et les gestes de sa fonction. Une technique offre ainsi un caractre surtout ngatif : elle dit ce qu'il faut faire, et dfaut de quoi la fonction ne serait pas accomplie. Si un professeur ne suit pas le programme, si un juge ne rend pas son arrt dans les formes, si un banquier escompte un taux illgal, leur activit, dans tous ces cas, n'atteint pas son but. Or une technique est, sans doute, faite en grande partie de rgles anciennes, crites ou non crites, et, d'autre part, il y a un tour d'esprit pdant, procdurier, mticuleux, formaliste, qui diffre suivant les techniques, mais se retrouve et semble se transmettre traditionnellement dans chaque groupe de techniciens. Est-ce l ce qu'on peut appeler une mmoire collective ? Mais ceux qui appliquent ces rgles, tourns vers l'action prsente cherchent bien plutt en comprendre le jeu qu' en connatre l'origine et se rappeler leur histoire. Trs souvent elles oprent presque mcaniquement, comme ces habitudes qui, une fois montes dans l'organisme, ne se distinguent plus des actes instinctifs, et semblent des attributs constitutifs de notre nature. Et il en est de mme de ce genre d'esprit qu'on respire en quelque sorte dans l'air, lorsqu'on entre dans un palais de justice, ou qu'on pntre dans des bureaux de banque, et qui fait qu'on rit encore au spectacle du Malade imaginaire, bien que les mdecins d'aujourd'hui ne portent plus de costume et ne parlent plus latin. Bien plus qu'un hritage du pass c'est un produit ncessaire de la profession. L'esprit acadmique nat spontanment dans un petit corps de savants ou de beaux esprits provinciaux, alors qu'aucun d'eux n'a pu l'apporter du dehors, et qu'ils se runissent pour la premire fois. Le tour d'esprit du militaire professionnel reparat, peu chang, au lendemain de guerres qui ont presque entirement renouvel le personnel des officiers, de mme que, malgr les intervalles de paix, il y a comme une espce naturelle et historique du soldat, c'est--dire certains traits communs aux soldats de tous les temps, qui s'expliquent par la vie des tranches et des camps, et trs accessoirement par des traditions militaires. Si, nous levant au-dessus de cette sorte de routine technique, o s'trique et se dfigure peut-tre l'esprit spcial de chaque fonction, nous examinons celui-ci sous sa forme pure, par exemple chez ceux qui doivent tre le plus pntrs des principes et de l'esprit d'une technique, puisqu'ils l'enseignent, nous trouvons, certes, une connaissance historique souvent prcise et tendue de l'origine et de l'volution des rgles. Mais tout cet enseignement est orient vers la pratique. Il est utile, par exemple, au futur magistrat d'tudier d'abord le droit romain, parce que les principes et les rgles s'y prsentent sous des formes plus simples, parce que c'est le modle classique du droit. Mais, des donnes historiques elles-mmes, que passe-t-il dans l'esprit du magistrat, et dans combien d'occasions s'en sert-il, et y pense-t-il ? En ralit, l'histoire du droit, l'tude de la
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
191
tradition juridique n'intresse qu'un petit nombre d'hommes, savants ou personnages haut placs dans la hirarchie de la fonction, et qui sont appels donner leur avis et intervenir activement lorsqu'il s'agit de modifier une technique : pour l'exercice de la fonction dans le cadre technique actuel, elles sont de plus en plus de nul usage. Une rgle, comme un instrument, s'applique une ralit qu'on suppose la fois immobile et uniforme. Comment s'y conformerait-on, et quelle autorit garderait-elle, si l'on n'y voyait qu'un mode d'adaptation provisoire des circonstances momentanes, qui n'ont pas toujours exist, qui se modifieront quelque jour ? Certes, ces rgles, extrieures l'individu, et qui s'imposent lui du dehors, lui apparaissent comme l'uvre de la socit. Elles ne sont ni des lois physiques, ni des forces matrielles. Par leur rigidit et leur gnralit, elles n'en imitent pas moins les lois et les forces de la matire. La volont sociale qu'on sent derrire s'est fixe et simplifie : elle a renonc s'adapter toutes les variations qui se produisent, dans le temps et dans l'espace, l'intrieur du groupe d'o elle mane 1. De toutes les influences sociales, celles qui prennent la forme d'une technique imitent le mieux le mcanisme des choses non sociales. Pourtant si les tres auxquels s'appliquent les diverses fonctions de la socit, par certains cts, reprsentent une matire, ils sont, essentiellement, une matire humaine. Si l'action que la socit exerce sur eux, par son uniformit et sa fixit, ressemble une action physique, c'est, essentiellement, une action sociale. La socit ne peut pas s'emprisonner dans les formes qu'elle a une fois arrtes. Mme dans une priode limite, elle doit sans cesse adapter ses rgles aux conditions sociales qu'elle aperoit derrire chaque cas en particulier La dfinition de chaque espce de cas n'en donne en effet qu'une vue toute schmatique. Elle suffit peut-tre dans ce qu'on appelle la pratique courante ; quand il faut juger des causes simples, o les faits ne sont gure discutables, et l'opinion de la conscience commune peu douteuse, le juge n'est qu'un organe excutif : on ne lui demande que de procder selon les formes et de rendre son arrt suivant la loi. Pourtant, mme alors, il y a des dtails et des circonstances qu'on ne peut dcouvrir sans finesse, et d'ailleurs, si l'on s'incline devant l'autorit du juge mme lorsqu'on pourrait facilement le suppler, c'est qu'on sait qu'en d'autres cas plus dlicats, plus difficiles, il serait seul capable de juger. Regardons-le, maintenant, et regardons l'avocat, regardons mme l'accus, dans un de ces procs qui soulvent toute espce de problmes dont on ne trouve la solution prcise ni dans les codes, ni mme dans la jurisprudence. La matrialit des actes, ici, importe moins que les dispositions psychologiques et morales des inculps. Il faut tenir compte de leur origine, de leur ducation, des influences, des occasions, du milieu et du rang, de la profession. Il faut obtenir et peser les tmoignages, observer le ton, les rticences, les contradictions, les accs d'humeur, tout le jeu des passions humaines tel qu'il transparat dans la physionomie, les gestes, les paroles, Il faut assister des discussions entre hommes soit du mme monde, soit de mondes diffrents, et arrter son opinion en son me et conscience , c'est--dire en laissant penser et parler en soi l'me et la conscience collective de son propre groupe. Cette fois, on oublie ou on nglige le costume du juge, l'aspect extrieur du prtoire, toute la solennit du cadre judiciaire ; le juge oublie mme un peu qu'il est juge, l'avocat qu'il est avocat, l'accus qu'il est accus ; le langage juridique s'assouplit et s'humanise jusqu' se rapprocher du ton de la conversation. Et, en effet, ce sont des hommes rassembls sans arrire-pense qui discutent une question de fait, un fait divers, un
1
Le contrat du droit priv, qui repose sur la fiction que les volonts des parties ne changent pas, n'est, en ce sens, qu'un instrument technique. Voir DEREUX (Georges), De l'interprtation des actes juridiques privs, Paris, 1904.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
192
crime passionnel ou politique, qui valuent les personnes et leurs actes d'aprs les modes d'apprciation en vigueur dans leur monde, modes d'apprciation traditionnels, et qu'on n'apprend connatre que lorsqu'on fait partie des groupes sociaux, classes ou milieux mondains, o ils se transmettent. Ainsi, insensiblement, du domaine technique nous voici transports en plein milieu social, c'est--dire dans cette zone des relations personnelles o la socit ne limite pas son horizon, parce qu'elle ne se proccupe pas d'accomplir une fonction, mais seulement de fortifier dans chacun de ses membres le sentiment de son rang social, ou, encore, d'intensifier en elle la vie collective. Du prsent, du domaine des ncessits et de l'action immdiate, nous nous transportons dans un pass proche ou lointain : ce n'est pas le juge d'aujourd'hui, c'est l'homme du monde, le pre de famille, qui se rappelle non seulement ses conversations avec des parents ou des amis, hier, avant-hier, il y a un mois, plusieurs mois, mais toute sa vie et toute son exprience, et tout ce qu'il -pu connatre de leur vie et de leur exprience, les ides et jugements qu'il leur doit, les traditions que les milieux o il frquente et les livres qu'il lit lui ont enseigns, c'est un tel homme, et ce n'est plus une toque et une robe, ou un code, qui juge. Certes il redeviendra un juge pur et simple, lorsqu'il lira ses attendus et son arrt, rdigs dans les formes ; de mme, l'avocat, dont l'loquence s'alimente aux sources de la vie sociale commune, et qui fait appel aux sentiments humains les plus gnraux en mme temps qu'il flatte les gots, prfrences et prjugs rcents ou anciens d'un monde ou d'une classe, redevient avocat lorsqu'il dpose des conclusions. De mme il faut bien qu'une tragdie ait 5 actes, et que le rideau tombe aprs le dernier : mais l'inspiration et le gnie des acteurs sont indpendants des rgles classiques, des costumes et des dcors, et de la scne : c'est dans le monde que l'auteur a observ les passions, c'est dans le monde que les acteurs ont appris les imiter. Ce qui est vrai de la fonction judiciaire l'est-il des autres ? On admettra sans peine que l'autorit de ceux qui exercent la justice leur vient en effet de ce qu'ils ont le sens de certaines traditions qui dominent toute la vie sociale. La justice doit raliser un conformisme non seulement des actions, mais des croyances, en particulier des croyances morales. Si ceux qui appliquent et interprtent les lois donnaient l'impression qu'ils procdent automatiquement, on ne respecterait ni les juges, ni la loi. Comme l'a dit Pascal : Il est dangereux de dire au peuple que les lois sont injustes, car il ne leur obit que parce qu'il les croit justes. Replacer la loi dans la tradition d'une vie sociale la fois ancienne et fortement organise, c'est fortifier la lettre de toute l'autorit de l'esprit, c'est faire reparatre, derrire l'appareil technique, la socit. Mais transportons-nous, dans un autre domaine, dans le commerce, l'industrie, les affaires : Aprs celle du juge, examinons la fonction des hommes qui s'enrichissent en crant et maniant des richesses. Ici, tout n'est-il pas technique, et se proccupe-t-on de savoir que derrire l'industriel et le commerant, prpos certaines oprations conomiques, il y a un homme, non plus qu' quel milieu social il appartient et au rang qu'il y occupe ? Quel rle joue ici la tradition ? Le but du commerant n'est-il pas avant tout et mme uniquement de gagner, et, si la technique de son commerce y suffit, n'est-ce pas assez qu'il la possde ? L'organisation conomique ne se distingue-t-elle pas prcisment de toutes les autres en ce qu'elle se modifie plus vite qu'elles? Mais elle entrane dans son mouvement tous ses agents, qui sont en face d'elle comme des ouvriers en face d'une machine. Si, dans les autres domaines, la technique est un instrument qui reoit son impulsion de la socit, ici la technique semble un mcanisme qui imprime son impulsion la socit. Pourtant, si nous ne nous sommes pas tromps lorsque nous analysions prcdemment l'activit lucrative et numrions les qualits qu'elle implique, ici, comme
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
193
ailleurs, il y a lieu de distinguer une activit technique et une activit sociale. A la base de la fonction, on trouve toujours un ensemble de traditions. Tenons-nous-en au commerce, et ramenons ses termes les plus simples l'activit du commerant. Il est en rapports avec un client. La technique commerciale donne l'un la figure d'un vendeur, l'autre, la figure d'un acheteur. Elle dtache les hommes des groupes divers dont ils font partie, ne les envisage que sous cet aspect, les place l'un en face de l'autre en cette simple qualit. Mais, ainsi entendu, le rapport entre vendeur et acheteur est un rapport d'opposition : nous dirions presque un rapport de guerre. Au point de vue du prix, aussi bien que de la qualit de la chose vendue, il y a entre eux antagonisme. Certes, la technique commerciale incite quelquefois mnager, ne pas dcourager la clientle, mais dans l'intrt seulement des ventes futures. Si l'on en restait l, il n'est mme pas sr qu'il y aurait jamais change de biens : en tout cas il n'y aurait pas une fonction commerciale prenant forme sociale. Durkheim disait, propos de la division du travail, qu'en dpit de son utilit technique elle ne pouvait fonctionner qu'entre des hommes faisant partie au pralable d'une mme socit; la diffrence des besoins qui fait que deux hommes s'opposent ne peut elle seule les unir et en faire des collaborateurs : aucun rapport social ne peut natre d'un simple antagonisme, ou de la guerre. Il faut donc que vendeur et acheteur prennent conscience, en mme temps que de ce qui les oppose, de ce qui les unit, c'est--dire que chacun d'eux retrouve derrire l'autre, au del de l'antagoniste, un homme social, et une socit dont lui-mme fait partie. Le commerant peut dans bien des cas se faire remplacer par un commis. La technique commerciale, en effet, permet de classer les clients et les produits en un certain nombre de catgories : quand un client et un produit rentrent exactement dans l'une d'elles, l'change s'opre presque mcaniquement, bien que, l-mme, il y ait toujours un certain jeu. Mais, au moins dans certains commerces, quand il s'agit de certaines marchandises et de certaines clientles ou de certains clients, la vente devient une opration plus dlicate, o le commerant en personne doit intervenir. Le client ne se contente point de regarder le produit ; il veut avoir l'assurance qu'il est de bonne qualit, qu'il n'est pas trop cher, et cette assurance vaudra ce que vaut ses yeux la personne de celui qui la donne, Le commerant ne se contente pas d'offrir le produit : il persuade le client qu'il est bien servi, qu'il n'est pas tromp, et, pour le persuader, il faut qu'il le connaisse en personne. Ainsi deux personnes s'affrontent, et la vente prend la forme d'un dbat, d'un change de propos, d'une conversation entre gens qui, pour un moment, oublient ou font mine d'oublier qu'ils sont, l'un acheteur, l'autre vendeur. Le client sortira du magasin en se disant: C'est vraiment une maison de confiance , entendez : une maison qui a des traditions ; il aura l'impression d'tre redescendu dans le pass, d'avoir pris contact avec une socit d'autrefois o survivait l'esprit des anciennes corporations. Ou bien il sortira du magasin en se disant: c'est une maison qui a de l'allant, c'est une maison moderne : entendez que le commerant, l'occasion de la vente d'un produit nouveau ou d'une mthode nouvelle de vente, lui aura ouvert des horizons sur les besoins et les gots qui viennent de natre, et sur les groupes qui contribuent le plus les dvelopper ; il lui semblera qu'il a pris contact avec ces groupes ou (s'il en faisait dj partie) qu'il s'y est retrouv, qu'il a parl leur langage, adopt leurs modes d'apprciation des hommes et des actes, et leur point de perspective sur le pass et l'avenir. Quant aux deux commerants, l'un et l'autre ont rempli leur rle, en rveillant des gots anciens, cri crant ou renforant des gots nouveaux dans leur clientle : la diffrence entre ancien et nouveau est
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
194
d'ailleurs toute relative. La mmoire collective remonte, suivant les cas, ingalement loin dans le pass. Les commerants s'appuient sur les traditions d'une socit plus ou moins ancienne, et plus ou moins troite, suivant que leur clientle elle-mme s'enferme dans le genre de vie fix par l'ancienne bourgeoisie, ou s'ouvre des besoins dcouverts et dvelopps depuis moins longtemps dans d'autres groupes., Ainsi toute activit qui a pour objet de produire des biens, de les vendre, et, plus gnralement, de faire valoir de la richesse, prsente aussi un double aspect. Elle est technique, mais, d'autre part, ceux qui l'exercent doivent s'inspirer des besoins, des coutumes et des traditions d'une socit. La technique reprsente la part de son activit que la socit abandonne temporairement au mcanisme. Mais d'autre part ses fonctions, si techniques soient-elles, supposent, au moins chez une partie de ceux qui les exercent, des qualits qui ne peuvent prendre naissance et se dvelopper qu'au sein de la socit, puisqu' cette condition seulement ils pourront se spcialiser sans perdre contact avec elle. Comme tout ce qui est social, et qui se prsente sous une forme personnelle, la socit s'intresse aux actes et figures qui manifestent ces qualits, elle fixe sur elles son attention, elle les retient : ainsi se forment ces apprciations traditionnelles que chaque classe sociale conserve dans sa mmoire. Les hommes les apportent avec eux et s'en inspirent, lorsqu'ils s'loignent de leurs cercles familiaux et mondains, o elles sont nes, pour se regrouper dans les cadres professionnels. En elles ils retrouvent, au del de leur activit spcialise, la notion de la place qu'elle occupe, et qu'occupent ceux qui sont qualifis pour l'exercer, dans la socit au sens troit, c'est--dire dans cette zone de la vie sociale o l'on s'intresse exclusivement aux personnes. Comme ces fonctions ne se sont pas toutes dveloppes au mme moment, les qualits que chacune d'elles suppose ne rvlent que progressivement leur valeur proprement sociale. Il est naturel que les apprciations anciennes aient empch pendant longtemps les apprciations nouvelles de passer au premier plan, et que celles-ci n'aient pu s'introduire qu'en prenant l'apparence de celles-l. Mais en mme temps que leur apparence, elles ont pris peu peu forme de tradition, et cela a suffi pour qu' un moment donn elles se soient fait accepter. Elles y ont russi, elles y russissent d'autant mieux qu'elles correspondent une forme de socit plus large et plus riche de contenu collectif, qui lentement s'bauche et prend figure. La socit ancienne, en effet, ne peut tre distraite de la contemplation de son image, que lui renvoie le miroir du pass, que si, dans ce miroir mme, d'autres images peu peu apparaissent, d'un contour moins net, peut-tre, et moins familires, mais qui lui dcouvrent de plus vastes perspectives.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
195
Conclusion
Retour la table des matires
Nous n'avons pas hsit, dans toute la premire partie de cette tude, suivre les psychologues sur leur terrain. C'est en effet chez l'individu que nous observions le rve, le fonctionnement de la mmoire, les troubles de l'aphasie, soit que nous nous examinions: nous-mmes, soit-que nous interrogions les autres sur ce qui se passait dans leur esprit. Nous tions donc obligs d'user de cette mthode d'observation intrieure laquelle on ne peut, semble-t-il, se plier sans admettre, du mme coup, que les faits de conscience, soustraits aux regards de la socit, chappent aussi son action. Comment en effet la socit tendrait-elle son pouvoir sur ces rgions de la vie psychique individuelle, o elle ne retrouve rien de sa nature, et dont elle ne peut rien apercevoir ? Mais comment, d'autre part, avions-nous chance, dans une ou plusieurs consciences, de dcouvrir rien qui ressemble l'action de l'ensemble de toutes les autres sur chacune d'elles, puisque nous nous placions au point de vue de ceux qui les sparent et les isolent comme par une multitude de cloisons tanches ? Il se pourrait cependant qu'alors qu'il croit s'observer intrieurement, le psychologue ne procde pas ici autrement qu'en prsence de tout autre objet, et que, dans la mesure o elle vaut, son observation ne vaille en effet que parce qu'elle est, comme on dit, objective. De deux choses l'une. Ou bien ce qu'il observe est unique en son genre, et il n'y a pas de mots qui lui permettent de l'exprimer. Il n'y a aucun moyen pour lui de contrler son observation par celles des autres, pour les autres, de reconnatre qu'il n'a pas t victime d'une illusion. Que peut valoir une description de
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
196
ce genre, qui carte, pour le prsent ,comme pour l'avenir, toute possibilit de vrification collective ? Ou bien (et c'est certainement le cas o nous nous trouvons, avec la psychologie de M. Bergson) ce qu'il observe n'est pas unique, et il y a des mots qui permettent de l'exprimer. Admettons que cette observation impose un genre d'effort particulirement difficile, et qu'entre l'expression et la chose exprime il subsiste un intervalle. Nous ne nous heurtons pas une impossibilit, et nous pouvons esprer que, peu peu, par l'habitude, l'effort deviendra moins pnible, et l'expression plus adquate. Dira-t-on qu'il y a, cependant, certains aspects des tats de conscience qui chappent toute expression, et tels, cependant, qu'on puisse en donner le sentiment ceux en qui ils apparaissent ? L commencerait l'observation intrieure : et l ne s'arrterait pas cependant la possibilit de contrler son observation par celles des autres. Mais qu'est-ce qui permettrait ce contrle, si ce n'est un accord sur le sens des signes qui rvlent que nous avons affaire, en effet, aux mmes sentiments que les autres ont prouvs avant nous ? Du moment que le psychologue prtend expliquer aux autres ce qu'ils doivent voir en eux, il tale les tats de conscience, il les extriorise. On peut, il est vrai, induire de ce qu'on voit l'existence de ralits ou de caractres qu'on ne voit pas. Mais elles n'ont alors de sens que par rapport ce que l'on voit, c'est--dire que la connaissance qu'on en a repose tout entire sur l'observation dite extrieure. L'observation intrieure se dfinit, pour les psychologues, par opposition la perception des objets matriels. Il semble que, dans celle-ci, nous sortions de nous, nous nous confondions en partie avec les choses extrieures, tandis que, dans celle-l, nous rentrons en nous-mme. Mais cette distinction ne se comprend que si l'on considre un individu isol. On appelle alors extrieur, tout ce qui est extrieur son corps et, par extension, son corps lui-mme, extrieur ce qu'on croit tre son esprit. On appelle intrieur tout ce qui n'est pas extrieur au corps, et, par extension, l'esprit, c'est--dire le contenu de l'esprit lui-mme, en particulier nos souvenirs. Considre-t-on, au contraire, non plus un individu isol, mais un groupe d'hommes qui vivent en socit ? Quel sens peut garder cette opposition ? Il n'y a pas alors de perception qui puisse tre dite purement extrieure, car, lorsqu'un membre du groupe peroit un objet, il lui donne un nom et il le range, dans une catgorie, c'est--dire qu'il se conforme aux conventions du groupe, qui remplissent sa pense comme celle des autres. Si l'on peut imaginer une perception intuitive et sans aucun mlange de souvenir chez l'individu isol, qui ne ferait et n'aurait fait partie d'aucune socit, il n'y a pas, au contraire, de perception collective que ne doive accompagner, puisque lui seul la rend possible, le souvenir des mots et des notions qui permettent aux hommes de s'entendre propos des objets : il n'y en a donc pas qui soit une observation purement extrieure. En mme temps qu'on voit les objets, on se reprsente la faon dont les autres pourraient les voir : si on sort de soi, ce n'est pas pour se confondre avec les objets, mais pour les envisager du point de vue des autres, ce qui n'est possible que parce qu'on se souvient des rapports qu'on a eus avec eux. Il n'y a donc pas de perception sans souvenir. Mais inversement, il n'y a pas alors de souvenir, qui puisse tre dit purement intrieur, c'est--dire qui ne puisse se conserver que dans la mmoire individuelle. En effet, du moment qu'un souvenir reproduit une perception collective, lui-mme ne peut tre que collectif, et il serait impossible l'individu de se reprsenter nouveau, rduit ses seules forces, ce qu'il n'a pu se reprsenter une premire fois qu'en s'appuyant sur la pense de son groupe. Si le souvenir se conservait sous forme individuelle dans la mmoire, si l'individu ne pouvait se souvenir qu'en oubliant la socit de ses semblables, et en allant, tout seul, allg de toutes les ides qu'il doit aux autres, au devant de ses tats passs, il se confondrait avec eux, c'est--dire qu'il aurait l'illusion de les revivre. Or, nous l'avons
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
197
montr, il y a bien un cas o l'homme se confond avec les images qu'il se reprsente, c'est--dire croit vivre ce qu'il imagine tout seul: mais c'est le seul moment aussi o il ne soit plus capable de se souvenir : c'est quand il rve. Au contraire, il se souvient d'autant mieux, il reproduit son pass sous des formes d'autant plus prcises et concrtes qu'il distingue mieux le pass du prsent, c'est--dire qu'il est lui-mme dans le prsent, qu'il a l'esprit tourn vers les objets extrieurs et vers les autres hommes, c'est--dire qu'il sort de lui. Il n'y a donc pas de souvenir sans perception. Ainsi, ds qu'on replace les hommes dans la socit, il n'est plus possible de distinguer deux sortes d'observations, l'une extrieure, l'autre intrieure. Prsentons la mme ide sous une autre forme. On dtache l'individu de la socit. On envisage d'une part son corps, d'autre part sa conscience, comme s'il tait le seul homme qu'on rencontre dans le monde, et on cherche ce qu'on trouve au terme de cette abstraction, dans son corps et dans sa conscience, lorsqu'il peroit et lorsqu'il se souvient. Dans son corps, on trouve un cerveau et des organes nerveux sensorimoteurs, o se produisent certaines modifications purement matrielles. Puisqu'on carte la socit, on ne se proccupe point et on ne tient pas compte de l'origine de ces mouvements, de la faon dont ces mcanismes ont t monts dans la substance crbrale. Du moment qu'on isole ceux qu'on trouve chez un individu de ceux qui leur correspondent chez les autres, on dtourne son attention de leur sens pour la reporter sur leur nature matrielle. On n'a pas de peine alors montrer que, de tels mouvements matriels, on ne peut rien tirer qui ressemble, de prs ou de loin, un tat de conscience. Comment, alors, expliquer la mmoire ? Comme il n'existe (c'est bien l'hypothse initiale) qu'un individu, et que sa mmoire ne peut rsulter de son corps, il faut qu'il y ait, hors du corps, et dans l'individu cependant, quelque chose qui explique la rapparition des souvenirs. Mais, dans la conscience, que trouve-t-on qui ne suppose aucun degr l'intervention d'autres hommes ? Quel est le type de l'tat de conscience purement individuel ? C'est l'image, l'image dtache du mot, l'image en tant qu'elle se rapporte l'individu et lui seul, abstraction faite de tout cet entourage de significations gnrales, de rapports et d'ides, c'est--dire de tous ces lments sociaux qu'on a dcid, ds le dbut, d'carter. Comme l'image ne peut driver du corps, elle ne peut s'expliquer que par elle-mme. On dira donc que les souvenirs ne sont rien d'autre que des images qui subsistent telles quelles, partir du moment o elles sont entres pour la premire fois dans notre conscience. Arrtonsnous l. Reconnaissons que, tant donnes les hypothses d'o on part, la conclusion s'impose. Mais ce sont ces hypothses qui nous paraissent bien contestables. D'abord, ces modifications nerveuses et ces mouvements, qui se produisent chez un individu, se produisent aussi chez les autres. Ils ne se produisent mme chez l'un ou chez les uns que parce qu'ils se produisent chez les autres. En quoi consistent-ils, en effet, si ce n'est en mouvements d'articulation, ou en modifications crbrales qui prparent de tels mouvements ? Or les mots et le langage supposent non pas un homme, mais un groupe d'hommes associs. Pourquoi briser ce groupe ? Certes, lorsqu'on isole un homme, lorsqu'on examine ses paroles en elles-mmes, sans les replacer dans le systme du langage 1 lorsqu'on dcide d'oublier qu'elles sont des questions ou des rponses adresses une collectivit, l'observation n'a rien d'autre o se prendre que l'aspect matriel de mots, que les mouvements corporels d'articulation. Pourtant, ce qui passe au premier plan, dans la conscience d'un homme qui parle, n'est-ce pas le sens de ses paroles ? Et le fait le plus important n'est-il point
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
198
qu'il les comprend 1 ? Il y a, derrire la suite des mots articuls, une suite d'actes de comprhension, qui sont autant de faits psychiques. C'est de ces faits que l'analyse psychologique qui s'en tient l'individu ne tient pas compte, prcisment parce qu'ils supposent l'existence d'une socit. Lorsqu'on dmontre que les mouvements d'articulation, envisags en tant que mouvements, n'ont rien de psychique, et qu'on n'en peut rien tirer qui ressemble un souvenir, on a raison. Mais on n'a pas dmontr, du mme coup, que les notions, ides, reprsentations qui accompagnent la parole et lui donnent son sens, n'ont rien de commun avec les souvenirs. Ce sont, en effet, des tats psychiques. Des tats du corps n'expliquent pas des tats de conscience : mais des tats de conscience peuvent produire ou reproduire et peuvent expliquer d'autres tats de conscience. On parle d'autre part d'images purement individuelles, qui subsisteraient telles quelles dans la mmoire aprs qu'elles sont entres, un moment dtermin, dans notre conscience, et dont la rapparition constituerait le souvenir. En quoi peuventelles consister ? Un tat de conscience quelque peu complexe, le souvenir d'un tableau ou d'un vnement, comprend, nous dira-t-on, deux sortes d'lments : d'une part, tout ce que n'importe quel autre que nous, dans notre groupe, peut en connatre et en comprendre : notions d'objets ou de personnes, mots et sens des mots qui les expriment. D'autre part, l'aspect unique sous lequel ils nous apparaissent parce que nous sommes nous-mme. Nous allons carter les premiers lments, qui s'expliquent par la socit, puisque nous nous plaons en dehors d'elle. Mais que reste-t-il alors ? Puisque les objets et leurs qualits, les personnes et leurs caractres, considrs isolment, ont une signification dfinie pour les autres hommes, il reste la faon dont ils sont groups dans notre esprit et dans lui seul, l'aspect particulier que prend chacune des images correspondantes dans l'entourage d'autres images qui, chaque instant, occupent le champ de notre conscience. En d'autres termes, nos souvenirs pris chacun part sont tout le monde : mais la suite de nos souvenirs n'appartiendrait qu' nous, et nous seuls serions capables de la connatre et de l'voquer. Mais toute la question est de savoir si ce qui est vrai de chacune des parties ne l'est pas du tout, et si la socit qui nous aide comprendre et voquer le souvenir d'un objet, n'intervient pas aussi et ne doit pas aussi intervenir pour nous permettre de comprendre et d'voquer cette suite d'objets qu'est un tableau complet ou un vnement en sa totalit. Le seul moyen de trancher la question consisterait raliser une exprience telle que nous soyons capables de comprendre et d'voquer les images des objets (ou de leurs qualits et de leurs dtails) isoles, mais qu'il ne nous soit pas possible de comprendre et d'voquer ces suites d'images qui correspondent un tableau ou un vnement complet. Or cette exprience existe, et se rpte continuellement : c'est le rve. Quand nous rvons, nous comprenons bien chacun des dtails de nos songes : les objets que nous apercevons alors sont ceux de la veille, et nous savons bien ce qu'ils sont. Si la mmoire, mme alors, a prise sur eux, c'est sans doute, que tout contact entre la socit et nous n'est pas supprim : nous articulons des mots, nous en comprenons le sens : cela suffit pour que nous reconnaissions les objets auxquels nous pensons et dont nous parlons en rve. Mais nous ne sommes plus capables d'voquer des scnes suivies, des sries d'vnements, des tableaux d'ensemble, qui reproduiraient ce que nous avons vu et vcu l'tat de veille. Comme le rve diffre
1
C'est, peu prs, ce que dit M. PIRON : Par cette intervention du symbolisme (du langage), le rle des points d'appui sensoriels devient beaucoup moins apparent, l'attention se portant sur la puissance vocative du symbole, beaucoup plus que sur la forme sensorielle sous laquelle il est voqu et qui est d'importance secondaire, que cette forme soit uniquement visuelle, auditive, kinesthsique, ou qu'elle soit mixte. Le cerveau et la pense, p. 25.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
199
de la veille en ce que nous ne sommes plus en rapport avec les autres hommes, ce qui nous manque alors pour nous souvenir, c'est l'appui de la socit. Il n'y a pas de vie ni de pense sociale concevable sans un 0u plusieurs systmes de conventions. Quand nous passons du rve la veille, ou inversement, il nous semble que nous entrons dans un monde nouveau. Non que nous percevions dans l'un, des objets d'une autre nature apparente que dans l'autre : mais ces objets ne prennent point place dans les mmes cadres. Les cadres du rve sont dtermins par les images mmes qui s'y disposent. En dehors d'elles, envisags en eux-mmes, ils n'ont aucune ralit, aucune fixit. En quelle partie de l'espace rel et du temps rel sommes-nous, lorsque nous rvons ? Quand bien mme il nous semble que nous sommes en un endroit familier, nous ne nous tonnons point de nous trouver transports brusquement trs loin de l. Les cadres du rve n'ont rien de commun avec ceux de la veille. Au reste, ils ne valent que pour nous : ils ne limitent point notre fantaisie. Quand nos imaginations changent, nous les modifions eux-mmes. Au contraire, lorsque nous sommes veills, le temps, l'espace, l'ordre des vnements physiques et sociaux, tel qu'il est reconnu et fix par les hommes de notre groupe, s'impose nous. De l un sentiment de ralit qui s'oppose ce que nous rvions encore, mais qui est le point de dpart de tous nos actes de mmoire. On ne peut se souvenir qu' condition de retrouver, dans les cadres de la mmoire collective, la place des vnements passs qui nous intressent. Un souvenir est d'autant plus riche qu'il reparat au point de rencontre d'un plus grand nombre de ces cadres qui, en effet, s'entrecroisent, et se recouvrent l'un l'autre en partie. L'oubli s'explique par la disparition de ces cadres ou d'une partie d'entre eux, que notre attention ne soit pas capable de se fixer sur eux, ou qu'elle soit fixe ailleurs (la distraction n'est souvent que la consquence d'un effort d'attention, et l'oubli rsulte presque toujours d'une distraction). Mais l'oubli, ou la dformation de certains de nos souvenirs s'explique aussi par le fait que ces cadres changent d'une priode l'autre. La socit, suivant les circonstances, et suivant les temps, se reprsente de diverses manires le pass : elle modifie ses conventions. Comme chacun de ses membres se plie ces conventions, il inflchit ses souvenirs dans le sens mme o volue la mmoire collective. Il faut donc renoncer l'ide que le pass se conserve tel quel dans les mmoires individuelles, comme s'il en avait t tir autant d'preuves distinctes qu'il y a d'individus. Les hommes vivant en socit usent de mots dont ils comprennent le sens : c'est la condition de la pense collective. Or chaque mot (compris), s'accompagne de souvenirs, et il n'y a pas de souvenirs auxquels nous ne puissions faire correspondre des mots. Nous parlons nos souvenirs avant de les voquer ; c'est le langage, et c'est tout le systme des conventions sociales qui en sont solidaires, qui nous permet chaque instant de reconstruire notre pass. * ** Mais comment concevoir que nos souvenirs, images ou ensembles d'images concrtes, puissent rsulter d'une combinaison de schmas, ou de cadres ? Si les reprsentations collectives sont des formes vides, comment, en les rapprochant, obtiendrions-nous la matire colore et sensible de nos souvenirs individuels ? Comment le contenant pourrait-il reproduire le contenu ? Nous nous heurtons ici une difficult qui n'est pas nouvelle, et qui n'a pas cess de proccuper les philosophes.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
200
Si, dans le systme de M. Bergson en particulier, elle parat insoluble, c'est qu'on y oppose plus nettement qu'on ne l'a jamais fait ce qu'on appelle l'image et le concept. On y dfinit l'image en la dgageant de toute notion de rapport, de toute signification intellectuelle, et on y dfinit le concept en le vidant de toute image. Si l'on y suppose que les souvenirs-images subsistent et reparaissent, c'est qu'on ne peut les reconstruire avec des concepts ainsi dfinis. Nous ne pouvons ici, mme brivement tudier du point de vue philosophique un problme aussi fondamental. Tenons-nous-en deux remarques. Des interprtes modernes de Platon ont montr que sa thorie n'tait point sans rapport avec les faons de penser du peuple grec au milieu duquel il l'a conue et labore. Si l'imagination populaire fit des dieux de Nik, d'ros, du Rire, de la Mort, de la Piti, de la Sant et de la Richesse, c'est qu'elle y voyait des forces actives, et que les hommes en sentaient l'action vivante en eux et chez les autres. Ce n'taient pas de simples personnifications, mais ce n'taient pas non plus des abstractions. Si l'on sentait ainsi, comment n'et-il pas t naturel de considrer aussi la Justice et la Vertu comme des forces actives, ternelles, leves au-dessus de toutes les choses terrestres ? Les potes et les artistes avaient pris les devants. Platon, sans doute, ne fait pas de la justice une desse, et se proccupe plutt, par une dsignation neutre, d'en carter tout lment personnel. Cependant c'est, pour lui, le contraire d'une abstraction. Ce n'est pas un concept. C'est bien plus. C'est un tre rel. Ainsi les ides platoniciennes ne dsignent pas des attributs , des qualits abstraitement considres, mais des sujets , sinon des personnes 1. Mais, d'autre part, Spinoza n'a vu dans les concepts ou notions communes qu'un mode de pense imparfait et tronqu. Il y a, d'aprs lui, un genre de connaissance la fois plus leve et plus adquate, qui nous reprsente non pas les proprits abstraites des choses, mais les essences particulires des tres, comme si l'objet vritable de notre activit intellectuelle tait d'atteindre ou de chercher saisir une ralit la fois rationnelle et personnelle. Ainsi le philosophe qui passe pour avoir invent la thorie des ides, et celui qui l'a, peut-tre, le plus approfondie, n'ont nullement vu dans les ides des points de vue abstraits sur les choses, qui ne nous en feraient connatre que les rapports et le dessin dcolor ; ils ont eu le sentiment au contraire qu'elles possdaient un contenu plus riche que les images sensibles. En d'autres termes, l'image sensible et individuelle tait contenue dans l'ide, mais n'tait qu'une partie de son contenu. D'autre part, l'ide contenait l'image (et bien d'autres images) ; mais elle tait la fois le contenant et le contenu. Une reprsentation collective a tout ce qu'il faut pour rpondre une telle dfinition. Elle comprend tout ce qu'il faut, aussi, pour expliquer la production ou la reproduction des tats de conscience individuels, et en particulier des souvenirs. Mais restons sur le terrain des faits. L'observation d'un fait, savoir qu'en rve on ne peut voquer le souvenir d'vnements ou de tableaux complexes, nous a rvl l'existence de cadres de la mmoire collective, sur lesquels la mmoire individuelle prend son point d'appui. C'est en observant ces cadres eux-mmes que nous avons appris distinguer en eux deux aspects troitement solidaires. Nous avons constat, en effet, que les lments dont ils sont faits peuvent tre envisags la fois comme des notions plus ou moins logiques, et logiquement enchanes, qui donnent prise la rflexion, et comme des reprsentations images et concrtes d'vnements ou de
1
VON WILAMOWITZ MOELLENDORFF, Platon, 1er Band, 1920, p. 348 sq. Sans doute, dans la Rpublique (507 b) l'ide est tout fait spare de l'image (bien qu'elle s'appelle : [mot grec], qu'on peut traduire par : forme), de telle sorte qu'elle peut paratre un concept logique. C'est dans cette direction que devait voluer la pense de Platon et de ses disciples, sous l'influence de la dialectique et de l'enseignement de L'cole. Mais c'est l un dveloppement ultrieur.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
201
personnages, localises dans le temps et l'espace. Si la pense sociale ne contenait que des notions purement abstraites, l'intelligence, chez l'individu s'expliquerait bien par la socit : par elle, il participerait la pense collective. Mais entre les images et les ides, il y aurait une diffrence de nature telle qu'on ne pourrait driver celles-l de celles-ci. Si, au contraire, les notions collectives une sont pas des concepts , si la socit ne peut penser qu' l'occasion de faits, de personnes, d'vnements, il n'y a pas d'ide sans images : plus prcisment, ide et image ne dsignent pas deux lments, l'un social, l'autre individuel, de nos tats de conscience, mais deux points de vue d'o la socit peut envisager en mme temps les mmes objets, qu'elle marque leur place dans l'ensemble de ses notions, ou dans sa vie et son histoire. Comment, nous demandions-nous, localise-t-on les souvenirs ? Et nous rpondions : l'aide des points de repre que nous portons toujours avec nous, puisqu'il nous suffit de regarder autour de nous, de penser aux autres, et de nous replacer dans le cadre social, pour les retrouver. Nous constations, d'autre part, que ces points de repre se multipliaient mesure que notre mmoire explorait des rgions plus voisines de notre prsent, au point que nous pouvions nous rappeler tous les objets et tous les visages sur lesquels notre attention, le jour prcdent, s'tait si peu que ce ft arrte. Enfin, c'est par une srie de rflexions qu'il nous semblait que nous passions d'un objet l'autre, d'un vnement l'autre, comme si, en mme temps qu' l'objet et son aspect extrieur, l'vnement et sa place dans le temps et l'espace, nous pensions leur nature, leur signification. En d'autres termes, objets et vnements se rangeaient dans notre esprit de deux manires, suivant l'ordre chronologique de leur apparition, et suivant les noms qu'on leur donne et le sens qu'on leur attribue dans notre groupe. C'est dire qu' chacun d'eux correspondait une notion qui tait la fois une ide et une image. Pourquoi la socit fixe-t-elle dans le temps des points de repre quelque peu espacs, trs irrgulirement d'ailleurs, puisque pour certaines priodes ils manquent presque tout fait, tandis qu'autour de tels vnements saillants quelquefois beaucoup d'autres galement saillants se tassent, de mme que les criteaux et poteaux indicateurs se multiplient mesure qu'on approche d'un but d'excursion ? Ils ne lui servent pas seulement diviser la dure, mais ils alimentent aussi sa pense, au mme titre que des notions techniques, religieuses ou morales qu'elle ne localise pas dans son pass plutt que dans son prsent. Les historiens se refusent de plus en plus tirer des vnements du pass des conclusions gnrales et des leons. Mais la socit qui porte des jugements sur les hommes de leur vivant, et le jour de leur mort, aussi bien que sur les faits, lorsqu'ils se produisent, enferme en ralit dans chacun de ses souvenirs importants non seulement un fragment de son exprience, mais encore comme un reflet de ses rflexions. Puisqu'un fait pass est un enseignement, et un personnage disparu, un encouragement ou un avertissement, ce que nous appelons le cadre de la mmoire est aussi une chane d'ides et de jugements. Inversement il n'y a gure de notion gnrale qui ne soit pour la socit l'occasion de se reporter telle ou telle priode de son histoire. Cela est vident lorsqu'il s'agit, pour elle, de se connatre elle-mme, de rflchir sur ses institutions et sa structure, sur ses lois et ses murs. Comment se fait-il, par exemple, qu'un Franais de culture moyenne n'entre que difficilement dans l'ensemble des ides politiques de pays tel que l'Angleterre ou l'Amrique, et que la simple description de leur Constitution ne laisse gure dans son esprit que des souvenirs verbaux tout au plus ? C'est qu'il ne connat pas ou connat de faon trop peu vivante la srie des grands vnements d'o cette lgislation est sortie : ces notions de droit constitutionnel ne s'clairent qu' la
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
202
lumire de l'histoire ; et il en est de mme de beaucoup d'autres. La science ne fait pas exception. Certes, elle ne se confond pas avec son histoire. Mais il n'est pas vrai que le savant ne se place que sur le plan du prsent. La science est oeuvre trop collective pour que le savant, alors mme qu'il s'absorbe dans une exprience nouvelle ou des mditations originales, n'ait pas le sentiment de suivre des directions de recherche et de prolonger un effort thorique dont l'origine et le point de dpart se trouvent derrire lui. Les grands savants replacent leurs dcouvertes leur date, dans l'histoire de la science. C'est dire que les lois scientifiques ne reprsentent pas seulement leurs yeux les lments d'un immense difice situ en dehors du temps, mais qu'ils aperoivent derrire elles, en mme temps qu'elles, toute l'histoire des efforts de l'esprit humain en ce domaine. Nous avons envisag de ce point de vue quelques-uns des milieux o tous les hommes, ou la plupart d'entre eux, passent leur vie: la famille, la socit religieuse, la classe sociale. Comment nous les reprsentons-nous ? Quelles penses veillent-ils et quels souvenirs laissent-ils dans notre esprit ? On peut dcrire du dehors l'organisation de la famille une poque et dans une rgion, dfinir en termes abstraits les rapports de parent, et le genre d'obligations qu'ils entranent. On peut mesurer l'intensit de l'esprit de famille. On peut aussi dessiner le cadre de la vie familiale, et rpartir les familles en un certain nombre de catgories, d'aprs le nombre de leurs membres, et d'aprs les vnements qui s'y produisent ou ne s'y produisent pas. Mais ce n'est certainement pas de cette manire que les hommes se reprsentent le groupe domestique dont chacun d'eux fait partie. Il y a bien, dans les rapports de parent, quelque chose qui rappelle l'objectivit des lois naturelles. Les devoirs de famille s'imposent nous du dehors. Ils ne sont pas notre oeuvre et nous ne pouvons rien y changer. Ils ne s'expliquent point d'ailleurs par les qualits de cur et d'esprit et par la personnalit de nos parents. Quand nous parlons d'eux, nous avons bien dans l'esprit des notions gnrales : notion de pre, d'poux, d'enfant, etc. Il n'en est pas moins vrai que chaque famille a son histoire, de mme que chacun de ses membres possde, aux yeux des autres, une physionomie originale. C'est dans notre famille, et c'est au prix d'une srie d'expriences personnelles, que nous avons appris distinguer tous ces rapports. Il n'y a rien de moins abstrait, et qui nous paraisse davantage unique en son genre, que le sentiment que nous prouvons pour tel des ntres. En d'autres termes, la famille est une institution. Nous pouvons, par rflexion, la replacer au milieu des autres institutions, distinguer en elle des organes, et comprendre la nature de ses fonctions. D'autre part la vie d'une famille comprend un certain nombre d'vnements : nous nous les rappelons, et nous gardons aussi le souvenir des personnes qui en ont t les acteurs. Mais il n'y a pas lieu d'opposer ou d'envisager sparment ces deux aspects du groupe domestique, car, en fait, ils se confondent. On ne comprendrait pas autrement qu'on puisse voquer ou reconstruire des souvenirs de famille. Certes, il y a des cas o il semble que la pense se porte plutt sur les rapports de parent, et se dtourne de l'histoire de la famille, par exemple quand une discussion d'intrts met en conflit des parents autour d'un hritage. Et il y en a d'autres o les relations personnelles passent au premier plan, o des parents paraissent oublier qu'ils sont parents, et se tmoignent des sentiments d'affection comme des amis en pourraient prouver l'un pour l'autre. Mais qui ne s'aperoit que si on se transporte la limite, dans l'un ou l'autre sens, on sort de la famille, et qu'on n'y reste qu' la condition de ne point traiter ses parents comme de simples units abstraites, non plus que comme des personnes dont nous rapprochent de simples affinits lectives ? Nous avons dit qu'il y a ceci de particulier et d'un peu trange, dans la famille, que nos parents nous sont imposs comme en vertu de rgles impersonnelles,
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
203
et que cependant nous les connaissons plus familirement que les autres hommes, et les prfrons aux autres comme si nous les avions choisis. La notion de rapport de parent est troitement unie l'image personnelle de notre parent. Que nous nous placions notre point de vue, ou celui de notre groupe domestique, nous nous reprsentons un de nos parents, et nous savons que toute notre famille se le reprsente, comme un tre unique en son genre et rellement irremplaable. L'esprit de famille est fait de penses qui ont ce double caractre : ce sont des notions, et ce sont en mme temps des images ou des ensembles d'images. Mais il en est de mme des croyances religieuses. On dit couramment qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas une religion. C'est que les rites, les sacrements, la rcitation des formules liturgiques, les prires, passent pour avoir par elles-mmes, en tant qu'actes accomplis et renouvels autant de moments successifs, une valeur permanente et une efficacit immdiate. Le baptme d'un nouveau-n le rgnre, alors mme qu'il ne connat encore rien de ce que de tels gestes, accomplis par de tels prtres, peuvent signifier. Trs souvent, lorsqu'on se confesse ou qu'on communie, on pense presque exclusivement aux pchs dont on veut tre lav, et dont on sent le poids jusqu' ce moment, une grce qu'on veut obtenir et qui nous proccupe comme tout bien que nous attendons dans l'avenir. Ainsi conues, les choses de la religion nous paraissent exister hors du temps : les dogmes sont vrais d'une vrit ternelle. Rien n'est plus abstrait, en un sens, que la pense religieuse ; que l'on considre Dieu et les tres surnaturels auxquels s'adresse le culte et qu'on dfinit surtout par des attributs trs gnraux, qu'on cherche se faire une ide des rapports entre Dieu et les hommes, du pch originel, de la rdemption, de la grce, du royaume cleste, on imagine des symboles ou on articule des mots, mais on sait bien que ce sont l des expressions confuses ou verbales d'une ralit qui nous chappe. Si l'on en restait l, si la pense religieuse n'tait rien d'autre, elle s'appliquerait des ides qui ne correspondraient aucune image, aucune ralit sensible, c'est--dire des formes vides de matire. Or, comme l'a profondment remarqu Kant, des concepts sans aucun contenu peuvent bien guider notre action, mais ne nous font rien connatre. Si la religion dans les limites de la raison ne s'appuie que sur des ides de ce genre, elle ne peut tre rien d'autre qu'une morale pratique. Mais la religion est certainement autre chose et plus que cela. Du moment que la forme des dogmes et des rites ne s'explique point par des motifs purement rationnels, ce n'est point dans le prsent, c'est dans le pass qu'on doit en chercher la raison d'tre. De fait, toute religion est une survivance. Elle n'est que la commmoration d'vnements ou de personnages sacrs depuis longtemps termins ou disparus. Et il n'y a pas de pratique religieuse qui, pour rester telle, ne doive s'accompagner, tout au moins chez l'officiant, et, si possible, chez les fidles, de la croyance en des personnages divins ou sacrs, qui ont manifest autrefois leur prsence et exerc leur action en des lieux et des poques dfinies, et dont les pratiques reproduisent les gestes, les paroles, les penses, sous une forme plus ou moins symbolique. Ainsi toute reprsentation religieuse est la fois gnrale et particulire, abstraite et concrte, logique et historique. Qu'on examine un article de foi, qui s'accompagne de preuves thologiques. La thologie applique des notions dfinies des mthodes de raisonnement rigoureuses. Cet article de foi est donc une vrit rationnelle. Qu'on le regarde d'un peu plus prs : il suppose l'existence du Christ, la ralit de ses paroles, de sa vie, de sa mort, de sa rsurrection. Ce qui nous paraissait une vrit logique est devenu, ou plutt tait ds le dbut, un souvenir.
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
204
Certes, suivant les poques, les lieux, les personnes, c'est l'aspect logique, ou bien c'est l'aspect historique de la religion qui passe au premier plan. Nous avons montr que, tandis que les thologiens dogmatiques s'efforcent de dmontrer la religion, les mystiques prtendent la vivre : les uns mettent l'accent sur l'aspect intemporel des dogmes, les autres aspirent entrer en intime communion de pense et de sentiment avec les tres divins reprsents comme des personnes, tels qu'ils durent se manifester l'origine, au moment o la religion a pris naissance. Mais, ici encore, si on passait la limite dans un sens ou dans l'autre, on sortirait de la religion. La religion ne se ramne pas un systme d'ides. Elle ne s'puise pas non plus en une exprience individuelle. Ce que les dogmatiques opposent aux mystiques, ce n'est pas une construction intellectuelle, c'est une interprtation collective et traditionnelle des vnements d'o la religion est sortie. Quant aux mystiques, ils n'opposent pas leur sens propre la conception de l'glise ; leurs visions et leurs extases ne s'introduisent dans la religion que sous une forme dogmatique ; c'est dans le cadre des croyances traditionnelles qu'elles prennent place. Si on les y admet, c'est parce qu'elles fortifient ce cadre dans son ensemble, de mme qu'en gomtrie la solution d'un problme claire et fait mieux comprendre les thormes dont il n'est qu'une application. Ainsi, il n'est point de pense religieuse qu'on ne puisse comprendre, comme une ide, et qui ne soit pas faite en mme temps d'une srie de souvenirs concrets, images d'vnements ou de personnes qu'on peut localiser dans l'espace et le temps. Ce qui prouve qu'il ne s'agit point l de deux sortes d'lments, les uns intellectuels, les autres sensibles, plaqus en quelque sorte les uns sur les autres, ou insrs les uns dans les autres, c'est que la substance du dogme s'accrot de tout ce qu'y introduit la mystique, c'est que l'exprience du mystique s'aiguise d'autant plus, et se prsente sous une forme d'autant plus personnelle, qu'elle se pntre de vues dogmatiques. C'est la mme substance qui circule dans la mystique et dans le dogme. Les penses religieuses sont des images concrtes qui ont la force imprative et la gnralit des ides, ou, si l'on veut, des ides qui reprsentent des personnes et des vnements uniques. Les classes sociales, enfin, comprennent des hommes qui se distinguent des autres par le genre de considration qu'ils se tmoignent mutuellement, et que les autres leur tmoignent. Sous l'ancien rgime, la classe noble se prsentait comme une hirarchie de rangs ; il fallait occuper un de ces rangs, pour faire partie de la noblesse. Ce qui passait donc au premier plan de la conscience collective des nobles, et de la socit en gnral lorsqu'elle tournait vers eux son regard, c'tait l'ide de cette hirarchie et de ces rangs. En un sens, il pouvait suffire, pour concevoir une telle division et de telles subdivisions, dans la socit et dans la classe noble, d'en bien comprendre les raisons d'tre actuelles. Il fallait que les hommes et les familles qui possdaient au plus haut degr les qualits de courage guerrier et de loyaut chevaleresque qu'on apprciait le plus l'poque fodale fussent hausss au-dessus de la masse, et signals au respect de leurs pairs ainsi que des gens moins haut situs, par des honneurs et des privilges. L'espce et l'ordre de ces prrogatives rpondaient bien des traits permanents de l'organisation sociale d'alors, et taient inscrits en quelque sorte dans la structure de la socit, o il tait possible chaque instant de les retrouver et de les lire. Tel tait l'aspect logique, et si l'on veut, conceptuel, de la notion de noblesse, et de toutes les autres qu'elle comprenait. Mais, par un autre aspect, la classe noble apparaissait comme le rsultat d'une longue volution, accidente et imprvisible dans le dtail, si, dans l'ensemble, elle rpondait bien aux conditions sociales contemporaines. Les divers rangs nobiliaires n'taient pas des cadres construits par d'ingnieux lgistes, abstraction faite de ceux qui devaient venir les occuper et de ce
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
205
qu'il y avait en eux de plus personnel. Au contraire, les titres de noblesse se transmettaient de pre en fils, de gnration en gnration, au mme titre qu'un hritage, mais un hritage spirituel et inalinable. Toute leur valeur rsidait dans le nombre et la qualit des souvenirs glorieux ou honorables qui les fondaient et qu'ils perptuaient. On ne pouvait donc songer au titre sans voquer ceux qui l'avaient obtenu les premiers, l'avaient en quelque sorte marqu de leur empreinte, et l'avaient possd avant l'actuel dtenteur. Ainsi, derrire la notion logique de rang se dcouvrait tout un ensemble de faits historiques : le titre prsentait bien ces deux faces. Il eut t inconcevable que, conservant les titres, on les eut, par exemple au lendemain d'une rvolution, transfrs tous des hommes nouveaux, sans aucun rapport de parent avec les anciens nobles. Les titres n'eussent plus t des titres, au sens ancien et traditionnel. Mais, inversement, des actions clatantes, des exploits, des prouesses n'eussent point suffi confrer la noblesse, si la socit n'avait pas vu dans ces actions comme autant de preuves que celui qui les accomplissait tait digne d'occuper, et qu'il occupait dj en droit, et comme de toute ternit, tel ou tel rang. C'est dans le cadre de l'organisation nobiliaire et c'est en se conformant aux ides et coutumes de la noblesse, que l'aspirant noble se comportait en homme d'honneur et de courage, et le titre qui devait les rcompenser semblait attach d'avance ses exploits. Tant il est vrai que, dans la pense noble aussi, le fait et l'ide ne se distinguaient pas. Dans nos socits modernes, les titres ont peu prs disparu, mais on continue distinguer de la masse, et considrer comme des membres de classes leves, tous les hommes dous (ou qui passent pour l'tre) des qualits les plus apprcies dans nos groupes. Ces qualits sont celles qui permettent de s'acquitter le mieux des fonctions, c'est--dire de dployer un genre d'activit non purement technique, et qui suppose surtout la connaissance des hommes et le sens des valeurs humaines admises ou fixes dans la socit considre. Les hommes prendraient donc conscience de la classe dont ils font partie, ds qu'ils se reprsenteraient le genre d'activit qu'ils exercent, et qu'ils sont capables d'exercer. Il y a, en effet, une notion sociale du magistrat, du mdecin, de l'officier et aussi (si nous nous tournons vers les fonctions lucratives), de l'industriel, du commerant, des diverses catgories de capitalistes, etc. Cependant, une telle notion n'est pas abstraite, et il ne suffirait pas, pour s'y lever, d'envisager la structure actuelle de la socit et d'en concevoir les diverses fonctions. C'est moins la fonction que l'on pense, lorsqu'on classe les hommes qui s'en acquittent, qu'aux qualits qu'elle suppose chez eux. Or ces qualits ne peuvent natre et se dvelopper, puisqu'elles supposent la connaissance des hommes et de leurs jugements, on ne peut aussi les apprcier leur juste valeur que dans un milieu social o l'on se proccupe avant tout des personnes. C'est pourquoi la notion de juge, par exemple, s'accompagne toujours du souvenir de tels magistrats que nous avons connus, ou tout au moins du souvenir des jugements que porte la socit sur tels magistrats que nous n'avons pas connus. Quand on pense aux commerants des hautes classes, en mme temps que les traits gnraux de l'activit commerciale, on se reprsente tels hommes avec lesquels on a t en relations personnellement et qui possdaient un degr lev les aptitudes qui qualifient pour le haut commerce, ou tout au moins on voque le souvenir des raisons traditionnelles qui depuis longtemps justifient, aux yeux des marchands comme aux yeux des autres, le rang social qui appartient au commerce. Si, pour dfinir une classe, on s'en tenait une ide, l'ide abstraite de telle ou telle fonction, on arriverait un rsultat assez paradoxal, puisqu'une ide ne peut reprsenter des personnes et qu'au contraire, dans la conscience de classe, ce sont des
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
206
qualits personnelles qui passent au premier plan. Mais, inversement, les aptitudes personnelles dveloppes au contact de la famille et dans le monde n'attirent l'attention de la socit que si elles peuvent lui tre utiles, que si elles permettent ceux qui les ont d'exercer une de ses fonctions. C'est pourquoi il n'y a pas de reprsentation de classe qui ne soit la fois tourne vers le prsent et vers le pass ; car la fonction est dans le prsent, c'est une condition permanente de la vie sociale ; mais les personnes qui possdrent au plus haut degr notre connaissance les qualits personnelles ncessaires pour l'exercer n'ont pu les manifester que dans le pass. Les cadres de la mmoire sont la fois dans la dure, et hors d'elle. Hors de la dure, ils communiquent aux images et souvenirs concrets dont ils sont faits un peu de leur stabilit et de leur gnralit. Mais ils se laissent prendre en partie dans le cours du temps. Ils ressemblent ces trains de bois qui descendent le long des cours d'eau, si lentement qu'on peut passer sur eux d'un bord l'autre ; et cependant ils marchent, et ne sont pas immobiles. Il en est ainsi des cadres de la mmoire : on peut, en les suivant, passer aussi bien d'une notion une autre, toutes deux gnrales et intemporelles, par une srie de rflexions et de raisonnements, que descendre ou remonter le cours du temps, d'un souvenir l'autre. Plus exactement, suivant le sens qu'on choisit pour les parcourir, qu'on remonte le courant, ou qu'on passe d'une rive l'autre, les mmes reprsentations nous sembleront tre tantt des souvenirs, et tantt des notions ou des ides gnrales. * ** L'individu voque ses souvenirs en s'aidant des cadres de la mmoire sociale. En d'autres termes les divers groupes en lesquels se dcompose la socit sont capables chaque instant de reconstruire leur pass. Mais, nous l'avons vu, le plus souvent, en mme temps qu'ils le reconstruisent, ils le dforment. Certes, il y a bien des faits, bien des dtails de certains faits, que l'individu oublierait, si les autres n'en gardaient point le souvenir pour lui. Mais, d'autre part la socit ne peut vivre que si, entre les individus et les groupes qui la composent, il existe une suffisante unit de vues. La multiplicit des groupes humains et leur diversit rsultent d'un accroissement des besoins aussi bien que des facults intellectuelles et organisatrices de la socit. Elle s'accommode de ces conditions, comme elle doit s'accommoder de la dure limite de la vie individuelle. Il n'en est pas moins vrai que la ncessit o sont les hommes de s'enfermer dans des groupes limits, famille, groupe religieux, classe sociale (pour ne parler que de ceux-ci), bien que moins inluctable et moins fatale que la ncessit d'tre enferm dans une dure de vie dtermine, s'oppose au besoin social d'unit, au mme titre que celle-ci au besoin social de continuit. C'est pourquoi la socit tend carter de sa mmoire tout ce qui pourrait sparer les individus, loigner les groupes les uns des autres, et qu' chaque poque elle remanie ses souvenirs de manire les mettre en accord avec les conditions variables de son quilibre. Si l'on s'en tenait la conscience individuelle, voici ce qui paratrait se passer. Les souvenirs auxquels on n'a point pens depuis trs longtemps se reproduisent sans changement. Mais lorsque la rflexion entre en jeu, lorsqu'au lieu de laisser le pass reparatre, on le reconstruit par un effort de raisonnement, il arrive qu'on le dforme, parce qu'on veut y introduire plus de cohrence. C'est la raison ou l'intelligence qui
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
207
choisirait parmi les souvenirs, laisserait tomber certains d'entre eux, et disposerait les autres suivant un ordre conforme nos ides du moment ; de l bien des altrations. Mais nous avons montr que la mmoire est une fonction collective. Plaons-nous donc au point de vue du groupe. Nous dirons que si les souvenirs reparaissent, c'est que la socit, chaque instant, dispose des moyens ncessaires pour les reproduire. Et nous serons amens peut-tre distinguer dans la pense sociale deux sortes d'activits: d'une part une mmoire, c'est--dire un cadre fait de notions qui nous servent de points de repre, et qui se rapportent exclusivement au pass ; d'autre part une activit rationnelle, qui prend son point de dpart dans les conditions o se trouve actuellement la socit, c'est--dire dans le prsent. Cette mmoire ne fonctionnerait que sous le contrle de cette raison. Quand une socit abandonne ou modifie ses traditions, n'est-ce point pour satisfaire des exigences rationnelles, et au moment mme o elles se font jour ? Seulement, pourquoi les traditions cderaient-elles ? Pourquoi les souvenirs reculeraient-ils devant les ides et rflexions que la socit leur oppose ? Ces ides reprsentent, si l'on veut, la conscience que prend la socit de sa situation actuelle; elles rsultent d'une rflexion collective, dgage de tout parti pris, et qui ne tient compte que de ce qui existe, non de ce qui a t. C'est le prsent. Sans doute il est difficile de modifier le prsent, mais ne l'est-il pas beaucoup plus, certains gards, de transformer l'image du pass, qui existe, elle aussi, au moins virtuellement, dans le prsent, puisque la socit porte toujours dans sa pense les cadres de sa mmoire ? Aprs tout, le prsent, si on considre la partie de la pense collective qu'il occupe, est peu de chose, par rapport au pass. Les reprsentations anciennes s'imposent nous avec toute la force qui leur vient des socits anciennes o elles ont pris forme collective. Elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont plus anciennes, et qu'est plus lev le nombre d'hommes, et que sont plus tendus les groupes qui les avaient adoptes. A ces forces collectives, il faudrait opposer des forces collectives plus grandes. Mais les ides actuelles s'tendent sur une dure beaucoup plus courte. D'o tireraient-elles assez de force et de substance collective pour tenir tte aux traditions ? Il n'y a qu'une explication possible. Si les ides d'aujourd'hui sont capables de s'opposer aux souvenirs, et de l'emporter sur eux au point de les transformer, c'est qu'elles correspondent une exprience collective, sinon aussi ancienne, du moins beaucoup plus large, c'est qu'elles sont communes non seulement (comme les traditions) aux membres du groupe considr, mais aux membres d'autres groupes contemporains. La raison s'oppose la tradition comme une socit plus tendue une socit plus troite. Au reste les ides actuelles ne sont vraiment nouvelles que pour les membres du groupe o elles pntrent. Partout o elles ne se heurtaient pas aux mmes traditions qu'en celui-ci, elles ont pu se dvelopper librement et prendre elles-mmes forme de traditions. Ce que le groupe oppose son pass, ce n'est pas son prsent, c'est le pass (plus rcent peut-tre, mais il n'importe) d'autres groupes auxquels il tend s'identifier. Nous l'avons vu : dans les socits o la famille est fortement constitue, celle-ci tend se fermer aux influences du dehors, ou, du moins, elle n'en laisse filtrer et pntrer en elle que ce qui s'accorde avec son esprit et ses faons de penser. Mais d'abord, il se peut que la continuit de la vie familiale soit interrompue, du fait qu'une nouvelle famille se cre par l'union d'un membre de l'une avec un membre de l'autre. Alors, quand bien mme la famille nouvelle ne serait que le prolongement de l'une ou de l'autre, avec un nouvel individu s'y introduit une partie de l'atmosphre o il a vcu, si bien que le milieu moral s'en trouve modifi. Si, comme en gnral dans nos
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
208
socits, chaque mariage marque le point de dpart d'un groupe domestique rellement. nouveau, bien que les deux conjoints n'oublient pas les traditions et souvenirs dont ils se pntrrent au contact de leurs parents, ils s'ouvrent bien plus largement que ceux-ci tous les courants extrieurs. Un mnage jeune se rpand avant de se ressaisir et de prendre nettement conscience de ce qui le distingue des autres. D'autre part, dans nos socits aussi, la famille entre en rapports de plus en plus frquents non seulement avec d'autres familles amies, ou qu'elle rencontre dans le monde, mais, par l'intermdiaire de celles-ci, avec beaucoup d'autres encore, avec tout un milieu social dans lequel baignent les familles, et o naissent et se propagent des coutumes et des croyances qui s'imposent toutes, et ne se rclament d'aucune en particulier. Ainsi, la famille est permable la socit ambiante. Comment en serait-il autrement, puisque les rgles et coutumes qui dterminent sa structure et les obligations rciproques de ses membres ont t fixes et lui sont imposes par cette socit ? D'ailleurs l'opinion qu'une famille a d'elle-mme ne dpend-elle pas bien souvent de celle qu'en ont les autres ? Ces ides nouvelles se substituent aux croyances traditionnelles de la famille et lui prsentent son propre pass sous un autre jour. Elles n'y russiraient pas, si elles taient nes l'intrieur de la famille elle-mme, si elles rpondaient par exemple un besoin d'indpendance et de renouvellement, brusquement senti par certains de ses membres. La tradition viendrait vite bout de telles rsistances et de telles rvoltes temporaires. Dans une socit isole o toutes les familles s'accorderaient reconnatre l'autorit absolue du pre, et l'indissolubilit du mariage, des revendications individuelles au nom de l'galit ou de la libert n'auraient pas d'cho. On ne peut remplacer des principes que par des principes, des traditions que par des traditions. En ralit, principes et traditions nouvelles existaient dj dans des familles ou des groupes de familles compris dans la mme socit que d'autres imbues de traditions et de principes plus anciens. Celles-l, la faveur de circonstances diverses, ont t soustraites plus ou moins la pression des croyances autrefois fixes. Plus sensibles aux conditions prsentes qu'au prestige du pass, elles ont organis leur vie sur de nouvelles bases, elles ont adopt de nouveaux points de vue sur les hommes et leurs actes. Certes, au dbut tout au moins, de telles familles peuvent tre exceptionnelles et peu nombreuses. Mais mesure que les conditions qui les ont ainsi diffrencies des autres se renouvellent et se prcisent, elles se multiplient. Elles dessinent les traits d'une socit o les barrires que les traditions particulires dressent entre les groupes domestiques seraient abaisses, o la vie familiale n'absorberait plus l'individu tout entier, o la famille s'largirait et se fondrait en partie dans d'autres formes de groupement. Leurs ides et croyances reprsentent les traditions naissantes de ces groupes plus tendus o les anciennes familles seront absorbes. Toute religion, nous l'avons vu, se rapporte aux rvlations et aux faits surnaturels qui marqurent son apparition comme son vrai principe. Mais on pourrait soutenir que ce n'en est pas seulement le principe, qu'en un sens c'en est le tout. Le rle des pres de l'glise, des conciles, des thologiens et des prtres aurait t, toutes les poques successives, simplement de mieux comprendre tout ce qui fut dit et fait par le Christ et par les chrtiens des premiers sicles. L o nous croyons voir une volution dtermine par les milieux o le christianisme fut pratiqu, l'glise affirme qu'il n'y eut qu'un dveloppement : comme si, force de fixer leurs regards et leur pense sur de tels souvenirs, les fidles y avaient distingu de sicle en sicle de nouveaux dtails et en avaient mieux saisi le sens. Du moins, les fidles cherchent dans leur religion ce qui peut guider leur conduite dans des conditions qui ne sont pas les mmes chaque poque. Il est naturel qu'ils reoivent des rponses diffrentes : mais
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
209
toutes ces rponses auraient t ds le dbut contenues dans la religion : elles n'en exprimeraient que des aspects successifs, mais tous galement rels. Il faudrait donc dire que les souvenirs qui se trouvent la base de la religion sont, non pas dforms et dnaturs, mais mieux clairs, mesure qu'on les rattache au prsent et qu'on en tire de nouvelles applications. Seulement, lorsqu'on tudie comment s'est constitue la doctrine chrtienne, et sous quelles formes successives elle s'est prsente jusqu' prsent, on arrive de tout autres conclusions. Il n'y a pas eu dveloppement, en ce sens qu'on retrouverait dans le christianisme primitif, l'tat envelopp et confus, tout ce qui, depuis, en a fait partie intgrante. C'est par une srie d'additions successives que des ides et points de vue nouveaux s'y sont agrgs. Loin de dvelopper les principes anciens, on les a, sur bien des points, limits. Or ces ides nouvelles, trangres en partie au christianisme primitif et qui y furent ainsi incorpores ne rsultent pas simplement d'un effort de rflexion sur les donnes anciennes. Au nom de quoi, et avec quelle force la rflexion ou l'intuition personnelle et-elle pu s'opposer la tradition ? On n'a pas obi de simples ncessites logiques: parmi les lments nouveaux, certains peuvent paratre moins rationnels que les anciens, et l'on s'est d'ailleurs accommod de bien des contradictions. Mais certaines de ces ides nouvelles existaient depuis plus ou moins longtemps, on y croyait, on s'en inspirait, dans des groupes qui n'avaient pas encore t touchs par la prdication chrtienne. Au reste, l'glise primitive comprenait beaucoup de communauts qui se sont dveloppes, sous certains rapports, indpendamment les unes des autres. Il y avait des doctrines que l'glise tolrait, sans les admettre au rang de vrits officielles, d'autres qu'elle condamnait comme hrsies, mais qui n'en subsistaient pas moins obscurment, et dont quelques parties au moins finissaient par pntrer dans le corps du dogme. Ici encore, ce sont les traditions du dehors qui sont entres en conflit et en concurrence avec la tradition du dedans. Certes, l'glise a choisi entre ces prtendants. Mais il serait possible de montrer qu'elle a t la plus accueillante aux ides qui pourraient servir de traditions communes une communaut chrtienne plus large. En d'autres termes, elle a replac ses traditions plus anciennes dans un ensemble de croyances plus rcentes, mais qui manaient de groupes avec lesquels elle pouvait esprer se fondre en une socit religieuse tendue. Si elle a cart le protestantisme, c'est que, par la doctrine du libre examen, il mettait la rflexion individuelle au-dessus de la tradition. Tant il est vrai que la pense chrtienne ne pouvait admettre de compromis qu'avec d'autres penses collectives, que sa tradition ne pouvait s'adapter qu' d'autres traditions. Les groupes sociaux que nous appelons des classes comprennent les hommes qui possdent, ou ceux qui ne possdent pas le genre de qualits les plus apprcies dans leur socit. Mais comme les conditions o vivent les socits sont sujettes changer, il arrive qu'aux poques successives ce ne sont pas les mmes qualits que la conscience collective met au premier plan. Il y a donc des priodes o l'on conteste aux hautes classes leur prminence, parce qu'elle se fonde sur un ordre d'apprciations qui appartient au pass. Dans quelles conditions s'engage la lutte entre ceux qui s'appuient sur des titres anciens, et ceux qui aspirent les supplanter ? On pourrait penser que l'obstacle o se heurtent les anciennes traditions, c'est le prsent. Des besoins nouveaux sont ns, que la socit ne peut plus satisfaire. Il faut qu'elle modifie sa structure. Mais o trouvera-t-elle la force ncessaire pour se dgager du pass ? Et suivant quelles lignes se reconstruira-t-elle ? Une socit ne peut vivre que si ses institutions reposent sur de fortes croyances collectives. Or ces croyances ne peuvent natre d'une simple rflexion. On aura beau critiquer les opinions rgnantes, montrer qu'elles ne rpondent plus la situation prsente, dnoncer les abus, protester
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
210
contre l'oppression ou l'exploitation. La socit n'abandonnera ses croyances anciennes que si elle est assure d'en trouver d'autres. De fait, la classe noble n'a pu tre dpouille de ses privilges que du jour o, dans des parties tendues de la socit, la conviction s'est implante qu'il y a un genre d'activit plus mritoire que l'exercice des vertus guerrires, et qu'il y a des qualits plus prcieuses et plus honorables que celles qui confrent la noblesse. C'est dans les villes libres corporatives, dans les cercles de marchands et d'artisans, qu'on s'est habitu penser ainsi. C'est de ces cercles que ces ides, qui avaient pris forme de tradition, ont pntr dans les milieux nobles eux-mmes. Les privilges nobles ont recul, non point parce qu'on les a critiqus en eux-mmes, mais parce qu'on leur a oppos d'autres privilges, fonds, comme eux, sur des croyances traditionnelles. Mais, son tour, la tradition bourgeoise a t battue en brche, mesure que les conditions de l'industrie et du commerce se sont transformes. C'est dans les cercles de financiers et d'hommes d'affaires, aussi bien que dans les milieux d'industriels et de commerants les plus au courant des mthodes conomiques modernes, c'est-dire hors de la classe o les traditions de l'ancienne industrie et de l'ancien commerce individualistes se perptuaient, qu'on s'est mis apprcier un ordre de qualits nouvelles : sens des forces collectives, comprhension des modes sociaux de production et d'change, aptitude mettre en oeuvre ceux-ci et utiliser celles-l. Si l'ancienne bourgeoisie a modifi ses traditions pour les adapter quelques-unes de ces ides nouvelles, c'est que, dans ces ides, elle a reconnu des croyances partages depuis quelque temps par des groupes tendus d'hommes progressifs, c'est que, derrire elles, elle a aperu une socit en voie d'organisation, plus vaste et plus complexe que celle qui suffisaient les traditions anciennes, et qui avait dj quelque consistance. En rsum, les croyances sociales, quelle que soit leur origine, ont un double caractre. Ce sont des traditions ou des souvenirs collectifs, mais ce sont aussi des ides ou des conventions qui rsultent de la connaissance du prsent. Purement conventionnelle (en ce sens), la pense sociale serait purement logique : elle n'admettrait que ce qui convient dans les conditions actuelles; elle russirait teindre, chez tous les membres du groupe, tous les souvenirs qui les retiendraient en arrire si peu que ce ft, et qui leur permettraient d'tre la fois en partie dans la socit d'hier, en partie dans celle d'aujourd'hui; purement traditionnelle, elle ne laisserait pntrer en elle aucune ide, mme aucun fait qui serait en dsaccord, si peu que ce ft, avec ses croyances anciennes. Ainsi, dans l'un et l'autre cas, la socit n'admettrait aucun compromis entre la conscience des conditions prsentes, et l'attachement des croyances traditionnelles: elle se fonderait tout entire sur l'un, ou sur l'autre. Mais la pense sociale n'est pas abstraite. Mme lorsqu'elles correspondent au prsent, et qu'elles l'expriment, les ides de la socit prennent toujours corps dans des personnes ou dans des groupes ; derrire un titre, une vertu, une qualit, elle voit tout de suite ceux qui la possdent; or des groupes et des personnes existent dans la dure et laissent leur trace dans la mmoire des hommes. Il n'y a pas en ce sens d'ide sociale qui ne soit en mme temps un souvenir de la socit. Mais, d'autre part, celle-ci s'efforcerait en vain de ressaisir sous une forme purement concrte telle figure ou tel vnement qui a laiss une forte empreinte dans sa mmoire. Tout personnage et tout fait historique, ds qu'il pntre dans cette mmoire s'y transpose en un enseignement, en une notion, en un symbole ; il reoit un sens ; il devient un lment du systme d'ides de la socit. Ainsi s'explique que puissent s'accorder les traditions et les ides actuelles ; c'est qu'en ralit les ides actuelles sont aussi des traditions, et que les unes et les autres se rclament en mme temps et au mme titre d'une vie sociale
Maurice Halbwachs (1925), Les cadres sociaux de la mmoire.
211
ancienne ou rcente, o elles ont en quelque sorte pris leur lan. Comme le Panthon de la Rome impriale abritait tous les cultes, pourvu que ce fussent des cultes, la socit admet toutes les traditions (mme les plus rcentes) pourvu que ce soient des traditions. Elle admet de mme toutes les ides (mme les plus anciennes) pourvu que ce soient des ides, c'est--dire qu'elles puissent prendre place dans sa pense, qu'elles intressent encore les hommes d'aujourd'hui, qu'ils les comprennent. D'o il rsulte que la pense sociale est essentiellement une mmoire, et que tout son contenu n'est fait que de souvenirs collectifs, mais que ceux-l seuls parmi eux et cela seul de chacun d'eux subsiste qu' toute poque la socit, travaillant sur ses cadres actuels, peut reconstruire. FIN DU LIVRE
You might also like
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19988)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5782)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (353)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyFrom EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyRating: 4 out of 5 stars4/5 (3321)
- Orgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceFrom EverandOrgueil et Préjugés - Edition illustrée: Pride and PrejudiceRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (20260)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleRating: 4 out of 5 stars4/5 (2552)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksFrom EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (19653)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersFrom EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersRating: 4 out of 5 stars4/5 (2305)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionFrom EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionRating: 4 out of 5 stars4/5 (12941)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationFrom EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationRating: 4 out of 5 stars4/5 (2385)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionFrom EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionRating: 4 out of 5 stars4/5 (2391)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookFrom EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookRating: 4 out of 5 stars4/5 (2515)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)From EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9485)
- How To Win Friends And Influence PeopleFrom EverandHow To Win Friends And Influence PeopleRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (6502)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderFrom EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderRating: 4 out of 5 stars4/5 (5700)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (3263)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)From EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (7769)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationFrom EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationRating: 4 out of 5 stars4/5 (5341)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)From EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (9054)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksFrom EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksRating: 4 out of 5 stars4/5 (7086)